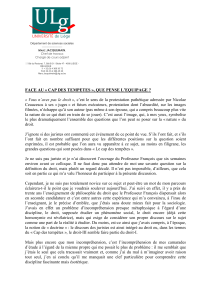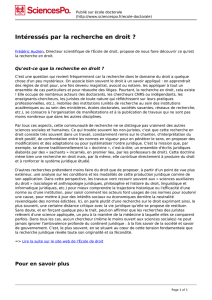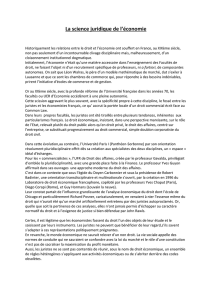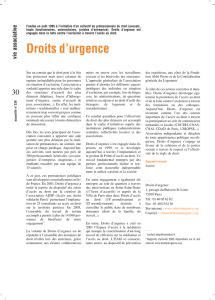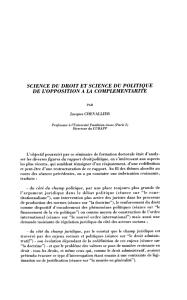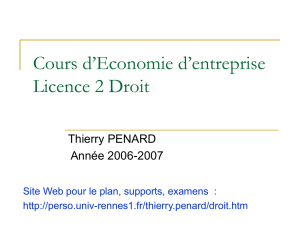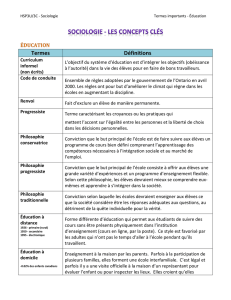E n seignem ent du d roit

181
Enseignement du droit
La part de La recherche dans L’enseignement du droit
par antoine JEAMMAUD*
Quelle place occupe la recherche – l’initiation ou
la sensibilisation à ses problèmes, exigences, pratiques et
résultats – dans l’enseignement du droit ? La commune
renommée voudrait qu’elle soit réduite. Mais nous ne
sommes pas en mesure, faute d’enquête méthodique,
de répondre à l’interrogation en dressant un véritable
état des lieux. Quelle place devrait-elle ou pourrait-elle
occuper ? De la position qui est la nôtre, la question paraît
plus abordable. On ne saurait toutefois entreprendre d’y
répondre sans tenter, d'abord, de préciser ce que sont les
pratiques intellectuelles qu’il convient de regrouper sous
l’appellation de recherche relative au droit (de préférence
à « recherche juridique »). Il s’agit même de la tâche la
plus ardue. D’autant plus que les conceptions des pro-
fessionnels chargés d’œuvrer à ces pratiques – juristes
enseignants-chercheurs des universités et chercheurs –
varient à un point qui étonnerait sans aucun doute leurs
collègues d’autres disciplines, « sciences tendres » autant
que « dures »1. Aussi allons-nous, au mépris délibéré d’un
* Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2. Membre du
Centre de recherches critiques sur le droit /CERCRID (Universités
de Saint-Étienne et Lyon 2/ UMR CNRS).
1 Un professeur de droit privé occupant une forte position
institutionnelle dans les milieux juridiques français, livre dans
les termes suivants sa conception de la recherche en droit (qui ne
des canons (hexagonaux) de la dissertation « juridique »,
consacrer la plus longue part de nos développements à un
essai de clarication de ce qu’est cette recherche prenant le
droit pour objet (1.), avant de nous prononcer sur la place
que les pratiques de recherche et leurs résultats occupent
ou pourraient occuper dans l’enseignement universitaire
centré sur le droit positif (2.), puisque paraît en cause le
poids de ce dernier, qui nourrit parfois une accusation
d’excessif « positivisme ».
semble pas exister, à ses yeux, hors des thèses de doctorat) : « Des
concepts, des outils, des techniques… avec toujours la même
ambition : le progrès de la connaissance. À quelle n ? Toujours une
meilleure compréhension des normes qui gouvernent la Cité. Souvent
la suggestion d’utilisations nouvelles d’outils connus ou la proposition
d’utiliser de nouveaux outils (voire de nouveaux concepts) pour
traiter de questions demeurées, peut-être, jusqu’alors sans réponse
(ou pour apporter de nouvelles réponses, mieux adaptées à un monde
qui change). Parfois la formulation de projets de textes à l’adresse du
législateur, qu’il s’agisse de réformer un dispositif existant an d’en
améliorer les performances ou d’enrichir le corpus législatif pour
porter remède à quelque diculté ou orir un cadre juridique
sûr à une pratique émergente […]» (B. T, « Libre propos »,
Recherche Droit et Justice, Lettre de la Mission de recherche Droit et
Justice, n° 32, printemps-été 2009, p. 2). Toute diérente est notre
représentation de la recherche relative au droit.

Antoine JeAmmAud
182
Enseignement du droit
1. Territoire et contrées de la recherche prenant le
droit pour objet
Nous n’allons pas négliger la querelle de la science
juridique, ni faire l’économie d’une prise de position à
son sujet serait-elle du genre agnostique (1.1.), avant de
proposer, ce qui nous paraît plus important, une typo-
logie des activités orientées vers une connaissance du
droit (1.2.).
1.1. Existe-t-il une « science juridique », ou à
quelles conditions pourrait-elle exister ?
Cette double interrogation a pu être, il y a deux ou
trois décades, plus vive qu’aujourd’hui. L’ enseignement
dispensé dans les facultés de droit françaises dans les
années soixante pouvait susciter le plus grand doute quant
à la scienticité du savoir qu’il visait à transmettre2. Sur-
tout dans le contexte de la n de cette décennie-là, temps
de découverte, pour les plus exposés aux pensées subver-
sives, des analyses d’un Bourdieu ou d’un Foucault voire
d’Althusser, puis de dénonciation de la « société bour-
geoise » et de toute forme de domination. Pour l’étudiant
avide de stimulation intellectuelle et un peu curieux de
comprendre comment le droit s’inscrivait dans l’histoire
et le monde social, la « fac de droit », le plus souvent,
distillait l’ennui. Des milliers de juristes formés à cette
époque entendaient ou comprenaient bien vite, d’une
part que la connaissance du droit n’était rien d’autre que
celle de ses règles, de ses solutions positives, d’autre part
2 Selon Frédéric Audren, analyste assidu de l’histoire des
Facultés de droit françaises, la IIIe République a pu être considérée
comme « un âge d’or des cathédrales doctrinales » en raison
de la fréquentation assidue des sciences sociales par les juristes
universitaires (Duguit, Hauriou, Lambert…) mais, « à partir de
l’entre-deux-guerres, la donne est très sensiblement rebattue. Au sein
des facultés juridiques, le renforcement de la dogmatique juridique
[…] et l’approfondissement des logiques disciplinaires cantonnent
les sciences sociales dans un statut purement auxiliaire » (« Quand le
droit était une science sociale », Recherche Droit et Justice, Lettre de
la Mission de recherche Droit et Justice, n° 32, printemps-été 2009,
p. 10).
que la « science » à acquérir résidait dans l’art de se repré-
senter ces règles en ordre rationnel et dans la culture de
« l’esprit juridique » pour le traitement de cas concrets par
application de ces règles. Ils étaient invités, pour le sur-
plus, à admettre que le droit réalisait tendanciellement la
justice autant que l’ordre requis dans la société ou qu’il
n’avait besoin d’autre légitimation que celle découlant de
la régularité de l’édiction de ses textes selon des critères
essentiellement formels de « légalité ». Hors de rares lieux
un peu dotés à cet eet – la Faculté de droit parisienne
essentiellement – ni initiation à la philosophie du droit
au-delà de quelques indications convenues dans le cadre
de l’introduction au droit en première année, ni sensibi-
lisation à l’intérêt attaché à une observation sociologique
de la production ou des divers modes de mise en œuvre
du droit. Les enseignements historiques oraient plus de
chances d’entendre de respectables érudits que d’acquérir
quelques hypothèses pour comprendre les rapports entre
droit et société3.
Le succès, relatif mais inattendu au-delà du cercle
des juristes non totalement réfractaires au marxisme,
d’Une introduction critique au droit de Michel Miaille,
publiée en 1976 par François Maspéro, a sans doute tenu
à sa critique d’inspiration bachelardienne et très péda-
gogique de la « science juridique » régnante4. Le courant
« Critique du droit », apparu en France à la n des années
soixante-dix, s’est d’ailleurs constitué contre « la science
du droit traditionnelle » autant qu’en vue de produire
une « théorie critique » ouvrant à l’intelligence du droit
3 Il faut certes nuancer. Ainsi, et pour évoquer une expérience
personnelle, les étudiants en droit de la Faculté de Lyon des années
soixante pouvaient élargir leur horizon avec Madeleine Grawitz
(méthodes des sciences sociales… pour les « publicistes ») et deux
autres professeurs (seuls à enseigner sans revêtir la toge) : Jacques
Lambert (ls d’Édouard), historien du droit reconverti dans le
droit comparé et la démographie, et Paul Didier, commercialiste
passionnant et initiateur des étudiants de troisième cycle à la
philosophie du droit.
4 Voir pages 31 sq., 277 sq.

LA pArt de LA recherche dAns L’enseignement du droit
183
Enseignement du droit
à partir d’une référence privilégiée, mais non exclusive,
au matérialisme historique et dialectique5. La contesta-
tion de la prétention des juristes universitaires d’être gens
de science et de délivrer un enseignement « scientique »
était au cœur de la dénonciation de l’idéologie cultivée
par les premiers et diusée par le second, c’est-à-dire
d’une représentation mysticatrice du monde social et
des fonctions remplies par le droit.
Quelques années plus tard, un groupe de réexion
créé à l’initiative du ministère chargé de la recherche et
animé par Mireille Delmas-Marty et Gérard Timsit,
comptant parmi ses membres des théoriciens, histo-
5 L’ Association « Critique du droit » a été fondée en 1977 et
la collection d’ouvrages, lancée sur la suggestion conjointe de
François Maspéro et des Presses universitaires de Grenoble (sur
le modèle de « Critique de l’économie politique »), a vu paraître
son premier titre en 1978. Cet ouvrage, simplement intitulé Pour
une critique du droit et composé par un groupe des fondateurs du
mouvement (Ph. Dujardin, J.J. Gleizal, A. Jeammaud, M. Jeantin,
M. Miaille, J. Michel), faisait place à un texte-manifeste proclamant
notamment : « La science du droit traditionnelle, après avoir servi la
construction de l’État libéral et avoir été honorée en conséquence,
est tombée en déshérence. Dans les ex-facultés, l’approche du droit
reste, à ce jour, très empreinte de formalisme et d’idéalisme. Un
enseignement prétendument objectif se satisfait de reconnaître un
État-de-fait, ne révélant ni les fondements ni les fonctions véritables
de l’État et du droit. L’ enseignement comme la recherche reposent
sur des distinctions arbitraires et préjudiciables à l’investigation
scientique : distinction science juridique/science politique, droit
public/droit privé. En outre, cet enseignement repose trop souvent
sur des synthèses qui, prétendant enclore leur sujet, occultent le
caractère mouvant et contradictoire de la réalité sociale, alors que
l’hypothèse fondamentale de la collection est que la science du
juridique relève d’une science du politique. » Pour une présentation
de ce mouvement, de ses thèses sur le droit, mais aussi de ses limites,
après quelques années d’activité, voir notre article : « Critique du droit
en Francia : de la búsqueda de una teoría materialista del derecho
al estudio crítico de la regulación jurídica », Anales de la Cátedra
Francisco Suarez, Univ. Granada, n° 25/1985, p. 105 sq. Pour une
évaluation plus récente : « La crítica jurídica en Francia, veinte años
después », Crítica jurídica (Mexique-Brésil), n° 25/2006, p. 111 sq.
On trouve d’autres évocations de la brève histoire de ce mouvement
(notamment dans Le droit gure du politique. Études oertes à Michel
Miaille, Univ. Montpellier I, 2008), mais peu de chose sur ses
apports théoriques s’opposant à « la science juridique » dominante.
riens et sociologues du droit réputés6 mais aussi quelques
animateurs de « Critique du droit », allait rééchir aux
« conditions d’une science du droit ». Sans parvenir
cependant à une position commune et ferme. C’est que,
déjà, l’exigence était moins de décider de ce qui était ou
pouvait être « scientique » dans la connaissance du droit
que d’identier les diverses pratiques de production de
connaissances relatives au juridique, d’acquérir une plus
nette conscience des conditions de leur pertinence et de
les mettre en relation.
Depuis beau temps d’ailleurs, et plus clairement
qu’il n’est d’usage dans les ouvrages introduisant à
l’étude du droit, Jean Carbonnier avait évoqué le pro-
blème. « S’il n’y avait de sciences que celles qui peuvent
opérer sur des phénomènes soumis au déterminisme et
qui sont en mesure de découvrir des lois de causalité
entre ces phénomènes, écrivait-il, le droit ne pourrait
assurément prétendre, sauf pour une très faible part,
au nom de science ». Pour apporter aussitôt une réponse
apaisante pour les juristes de l’Université7 et du Centre
national de la recherche scientique8 : « Si tout ensemble
de connaissances raisonnées et coordonnées mérite ce
nom (ne fût-ce que par opposition à l’empirisme), il est
6 André-Jean Arnaud, François Ost, Michel Troper, notamment.
Il est à noter que F. Ost, Michel van de Kerchove, Philippe Gérard
et d’autres juristes des Facultés Saint-Louis de Bruxelles, mais aussi
A.-J. Arnaud (pionnier, dès les années soixante, de la « critique du
droit » conçue comme démystication de la « neutralité » du droit et
de l’apolitisme du savoir transmis dans les facultés de droit) avaient
participé aux rencontres de « Critique du droit » de la n des années
soixante-dix et du début des années quatre-vingt, sans s’inscrire
véritablement dans le mouvement incarné par cette association.
7 Un certain nombre d’unités d’enseignement et de recherche
nées de la mise en œuvre de la loi Faure de 1969 avaient été
dénommées UER ou faculté « de sciences juridiques », par souci
d’acher une option moins «dogmatique » et plus « scientique » que
les traditionnelles Facultés de droit, secouées par le « Mouvement de
mai ».
8 Dont le Comité national comportait alors une section « Sciences
du droit » (avant la réforme de 1991 qui allait fondre cette dernière
dans une section « Sociologie, normes et règles »).

Antoine JeAmmAud
184
Enseignement du droit
bien certain qu’il y a une science du droit. Diérente
des autres, ce n’est pas discutable ; peut-être même irré-
ductible à toute autre, encore qu’on puisse lui trouver
des analogies avec l’histoire (science conjecturale), et
surtout avec les sciences du langage (qui, comme elle,
étudient des phénomènes et formulent des règles tout à la
fois)»9. On est tenté de se rendre à ces raisons. Mais il
importe surtout d’échapper aux confusions engendrées
par la polysémie du terme « droit » tel qu’on en use encore
banalement dans le milieu des juristes pour désigner, à
la fois, un phénomène social normatif – un phénomène
de régulation sociale à base de normes parmi d’autres, se
combinant avec d’autres10 dans la constitution, le fonc-
9 Droit civil 1, PUF, « Coll. émis », 12e édition, 1979, n° 7,
p. 35 sq.
10 Le terme « régulation » connaît, depuis une trentaine
d’années, une fortune que nourrit et qui nourrit sa polysémie. Un
peu de rigueur s’imposerait, et son usage comme synonyme de
« réglementation » au sens matériel, inutile anglicisme et pur eet de
mode, est à bannir. En revanche, d’autres usages dans le langage des
sciences sociales comme dans celui des juristes paraissent pertinents
et correspondent à autant d’espèces d’un concept générique qu’il
importe d’élaborer en se souvenant que le terme est emprunté à la
langue des sciences physiques et biologiques. Il nous semble que « ce
concept générique est celui d’une œuvre consistant à introduire des
régularités dans un objet social, à assurer sa stabilité, sa pérennité, sans
en xer tous les éléments ni l’intégral déroulement, donc sans exclure des
changements. Cet objet peut être la société dans son ensemble, telle de
ses dimensions ou ‘instances' – l’économie notamment – ou encore
un domaine particulier de pratiques sociales » ; théorie et sociologie
du droit peuvent utilement retenir le concept suivant de régulation :
« œuvre de stabilisation et pérennisation, passant par la réalisation de
régularités mais aussi d’amendements, à laquelle concourent divers
procédés ». Cette position est reprise et les citations sont extraites
d’une étude antérieure ; « Des concepts en jeu », in G. Martin et J.
Clam (dir.), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ,
Coll. « Droit et Société », 1998, p. 47 sq., spéc. p. 52 sq. Les autres
procédés de régulation de type normatif évoqués par ce texte sont les
morales, les mœurs, les déontologies non prises en charge par le droit
de l’État (et, plus généralement, non juridiées), les convenances
etc. (voir notre étude « Les règles juridiques et l’action », D. 1993,
chron. p. 207 sq. ; et, en version plus longue : « Normes juridiques
et action. Note sur le rôle du droit dans la régulation sociale », in
M. Miaille (dir.), La régulation entre droit et politique, L’ Ha rmat t an,
tionnement, la reproduction des relations sociales – et
l’étude de ce phénomène11. La formule de Carbonnier peut
dès lors paraître équivoque : les règles, dont la positivité
atteste la présence du droit comme phénomène social
normatif, seraient-elles fruits d’une activité de science,
d’une « science normative » ? L’ auteur dissipe heureuse-
ment le doute en distinguant, parmi les « sciences juri-
diques », plusieurs « sciences proprement juridiques » (par
opposition aux « sciences auxiliaires »), au nombre des-
quelles gure, à côté des « sciences du droit positif » (l’une
« de systématisation », l’autre « d’interprétation »), une
« science de la législation » destinée à éclairer l’élabora-
tion des droits sans constituer pour autant une « science
normative » (« ce n’est pas la science qui pourrait donner
un caractère obligatoire à des formules, c’est l’État »)12.
Ce tableau et les brevets de scienticité aussi libéra-
lement décernés restent discutables. Même si la physique
n’est plus nécessairement le modèle de la science ou la
matrice de tout savoir méritant cette qualication, même
s’il est entendu13 que sciences de la nature (« exactes »,
« dures ») et sciences « de l’esprit », ou sciences humaines
et sociales (« tendres »), reposent sur des objectifs et des
démarches diérents (expliquer pour les premières, com-
prendre pour les secondes). Même si l’on ne doit pas s’en
tenir à l’opinion visiblement très partagée hors du monde
des juristes, qu’il n’existe pas de science ayant le droit
1995, p. 95 sq.). Car il importe, et les distinctions sont tâches de la
théorie du droit au sens qui sera précisé plus avant, de ne pas céder à
la tentation « panjuriste » de voir du droit partout, dans toute forme
de normativité socialement produite.
11 Dicile d’écrire, par conséquent, que « le droit (autrefois) était
une science sociale » (F. A, « Quand le droit était une science
sociale », op. cit.).
12 On se souvient de l’éclairante enquête sur les sens donnés à
l’expression « science normative » autrefois conduite par Georges
Kalinowski (Querelle de la science normative, LGDJ, « Bibl.
philosophie du droit », 1969).
13 Au moins depuis les travaux de Wilhelm Dilthey, à la n du
e siècle.

LA pArt de LA recherche dAns L’enseignement du droit
185
Enseignement du droit
pour objet14. Même si le post-positivisme admet un plu-
ralisme méthodologique qui permettrait à la « science du
droit » d’être reconnue comme telle sans imiter pourtant
la démarche des sciences de la nature15 ! Nous n’irons pas
plus avant, toutefois, dans une querelle qu’il n’est pas
nécessaire de trancher dans le cadre du présent propos.
Nous nous en tiendrons à cette position que l’assertion
« le droit est une science » est, au moins équivoque, au
pire aberrante, et que l’armation « les facultés de droit
élaborent et diusent la science du droit » supposerait de
très fortes raisons, que nous n’apercevons pas, de bap-
tiser « science » tout ce qui requiert apprentissage, labeur
intellectuel, méthode et savoir-faire16 ! Tout recommande
de suivre Paul Amselek lorsqu’il juge « dérisoire » la pro-
pension à succomber à « la force attractive qu’exerce le
paradigme scientique dans le domaine des disciplines
juridiques, comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres
domaines […] comme si l’activité scientique était, de
toutes les activités humaines, la seule sérieuse et digne
d’être entreprise et qu’il fallait en conséquence à tout
14 Deux indices du poids de cette conviction, parmi d’autres,
fournis par des publications aux ambitions diérentes : on ne
trouve aucune trace des « sciences juridiques » dans l’Épistémologie
des sciences sociales, publiée il y a quelques années sous la direction
de Jean-Michel Berthelot (PUF, 2001) ; l’excellente revue de
vulgarisation Sciences humaines n’a, jusqu’à présent, réservé qu’une
place marginale aux interrogations contemporaines sur ce qui paraît
constituer un phénomène majeur dans l’agencement ou le contrôle
de nos sociétés développées, et l’on ne découvre ni rubrique, ni
entrée « droit » ou « juridique », ni d’autre trace de ces notions, dans
deux ouvrages généraux publiés par les Éditions Sciences humaines
(Le Dictionnaire des sciences humaines, 2004, et J.-F. D, Les
Sciences humaines. Panorama des connaissances, 2009).
15 V. V, La science du droit (trad. O. et P. N), Story
Scientia-LGDJ, Coll. « La pensée juridique moderne », 1990.
16 Au demeurant, tous les juristes « de doctrine » ne réclament
pas d’être reconnus comme des scientiques. On pense aux écrits
de Christian A, Science des légistes, savoir des juristes, PUAM, 3e
éd., 1993 ; Épistémologie juridique, PUF, 1994, et Dalloz, 2002. Voir
également : J.-P. C, « Philosophie du droit et théorie du droit,
ou l’illusion scientique », Arch. Philo. Droit, t. 45, Sirey, 2001,
p. 2002.
prix se placer sous sa bannière pour valoriser ce que l’on
faitet accéder à un statut de respectabilité »17. La véné-
ration de François Gény par tant de juristes français ne
tiendrait-elle pas, en partie, à ce qu’il a qualié de « libre
recherche scientique »18 la démarche qu’il les engageait
à pratiquer (et qu’ils pratiquaient ou auraient pratiqué de
toute façon)19 ?
L’ essentiel est bien, répétons-le, de distinguer ce
phénomène social que constitue le droit et les pratiques
intellectuelles dont il est l’objet, notamment celles visant à
le connaître et les savoirs qu’elles produisent. Autrement
dit d’accueillir ce que l’on nomme plus souvent « la dis-
tinction du droit et de la science du droit », fondatrice du
positivisme juridique (comme théorie du droit et comme
17 « La part de la science dans l’activité des juristes », D. 1997, chron.
337, p. 338. Pour cet auteur, la « science » consiste exclusivement
« à établir des rapports entre la survenance au monde d’un type
de phénomène, d’un type de chose, et certaines circonstances, un
certain contexte d’autres choses »). Il tient au passage des propos
sévères – mais rassurants, avouons-le – sur Science et technique en
droit privé positif de François Gény (il observe que si de « méchantes
langues » ont qualié cet ouvrage de « vrai bazar métaphysique », ce
jugement « ne paraît pas somme toute dépourvu de lucidité », avant
de dénoncer la « fameuse et fumeuse distinction du ‘donné’ et du
‘construit’ »). En faveur de la possibilité d’une science du droit, voir
par exemple : F. O, V° Science du droit, in A.-J. Arnaud (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit,
LGDJ-Story Scientia, 2e éd., 1993 ; É. M, éorie générale du
droit, PUF, Coll. « Connaissance du droit », 2006, p. 9 sq. Pour un
panorama plus général des opinions sur cette question : M. Troper,
V° Science du droit, in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la
culture juridique, Quadrige/PUF-Lamy, 2003, p. 1391.
18 « Un de ces slogans dont la trouvaille n’appartient d’ordinaire
qu’à des publicitaires sans cervelle », observe Philippe Jestaz, dans un
ouvrage consacré à une réévaluation de l’apport du doyen de Nancy
(C. omasset, J. Vanderlinden, Ph. Jestaz, dir., François Gény,
mythe et réalités. 1899-1999 Centenaire de Méthode d’interprétation
et sources…, Yvon Blais-Dalloz-Bruylant, 2000, p. 39).
19 « Le grand public voit dans le juriste un benêt qui apprend par
cœur des textes de loi : Gény nous a dit que nous étions des savants
et des chercheurs » (Ph. Jestaz, op. cit.).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
1
/
34
100%