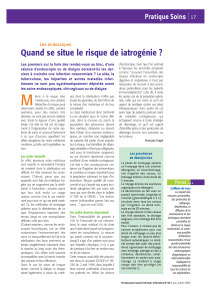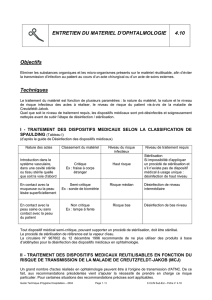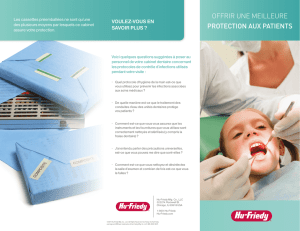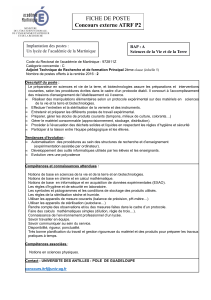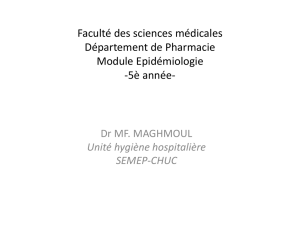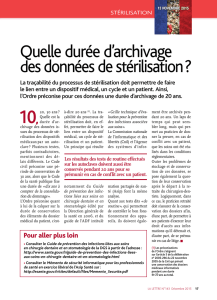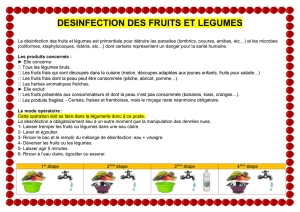sécurité des patients

Calédonien
Calédonien
Calédonien & Polynésien
& Polynésien
& Polynésien
A.D.I.M-N.C. - BP 14 999
98 803 NOUMEA Cédex
Tel: ( 687 ) 26.46.47.
Fax: ( 687 ) 25.92.62.
Email: [email protected]
http:// www.bmc.nc
A.D.I.M-P.F. - BP 52 580
98 716 PIRAE TAHITI
Email: g[email protected]
- Papeete - TAHITI
N° 41 - Septembre 2005
9 ème année
Bimestriel
Prix au numéro : 500 cfp
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ DES
DES
PATIENTS
PATIENTS
HYGIÈNE
HYGIÈNE
ET
ET
EXERCICE
EXERCICE
AU
AU
QUOTIDIEN
QUOTIDIEN
Attention
Attention
au
au
manuportage !
manuportage !
L’antisepsie
L’antisepsie
& les antiseptiques
& les antiseptiques
Recommandations
Recommandations
pour la
pour la
décontamination
décontamination
des dispositifs
des dispositifs
médicaux
médicaux
Déchets d’activité
Déchets d’activité
de soins:
de soins:
qu’en faites
qu’en faites-
-vous ?
vous ?

Septembre 2005 - N° 41
02
L
L
’hygiène, qu’Hippocrate avait pressentie et liée à l’environ-
nement, a été élevée depuis 1847 au rang de principe par
Semmelweiss, expliqué quelques années plus tard par Pasteur. La
révolution que constitua l’introduction des antibiotiques au 20ème
siècle a quelque peu mis dans l’ombre ce précepte, pourtant bien
développé dans la première moitié du siècle dernier, et notamment
son intérêt dans la prévention des infections.
Au cours des dernières années, l’évolution des bactéries vers
la multirésistance aux antibiotiques et l’augmentation de
l’incidence et de la sévérité des infections nosocomiales ont
entraîné un regain d’intérêt des professionnels de santé et des
autorités sanitaires pour les règles d’hygiène, l’antisepsie et la
désinfection. La sécurité du patient, comme l’indique le bulletin
de l’ordre des médecins du mois de juillet 2005, est « la révolution
culturelle à venir ».
L’évolution du concept de déterminant de la santé, de l’éthique
médicale, des pratiques professionnelles, de la réglementation et
des procédures judiciaires impose une réflexion qui justifie une
nouvelle approche replaçant l’hygiène à sa juste place dans le
dispositif de santé.
Il devenait urgent de disposer en Nouvelle-Calédonie d’un
guide réalisé par les acteurs de santé locaux, concernant certains
thèmes d’hygiène importants, et destiné à tous les professionnels
de santé qui exercent en Nouvelle-Calédonie.
Ce document, commandé et financé par la Direction des Affaires
Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie, simple, a pour
objectif d'apporter les bases techniques et les outils nécessaires
à la diminution du risque pour le patient mais aussi pour le profes-
sionnel, notamment lors de la réalisation des actes courants de
consultation et d'examen complémentaires.
Cette amélioration de la sécurité du patient qui vise à
transformer la gestion du risque infectieux pour éviter certains
évènements, passe par la mise en place de nouvelles pratiques,
notamment et en premier lieu, celle du signalement de ces
évènements.
Cependant, de nombreux freins demeurent encore chez les
professionnels, surtout lorsque les actes réalisés ont un potentiel
de risque ressenti faible (examen clinique standard, examen
oculaire, etc...). La Nouvelle-Calédonie a pourtant connu récemment,
des épidémies dont l’origine était un défaut d’hygiène.
Je voudrais remercier ici les auteurs de ce bulletin spécial.
Ils ont mis leur compétence et leur dynamisme en commun afin de
partager leurs connaissances et leurs intérêts pour cette
discipline fondamentale qui restitue la prévention à sa juste place.
Jean-Paul Grangeon
Directeur de la publication : E Lancrenon
Secrétaire de Rédaction : P. Nicot.
Conception, Maquette, Mise en page : J. Nicot
***
Comité de Rédaction de Nouméa pour le B.M. n° 41
C Chaubo, A Dupré, C Fuentes, J-Y. Langlet, B. Rouchon, J M Tivollier, F. Vangheluwe.
***
Comité de Rédaction de Papeete pour le B.M. n° 41
E Baratoux, E Beaugendre, G Detrun, Ph-E Dupire, A. Fournier, E Parrat, A Valence, AS Wurtz.
***
Les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
***
Tiré à 2 100 exemplaires par ARTYPO.
Distribué à 1500 exemplaires en Nouvelle Calédonie,Wallis et Futuna,
et à 500 exemplaires en Polynésie Française.
La responsabilité des professionnels de santé
en matière de prévention du risque infectieux… P 3
Risques infectieux liés aux soins réalisés
en dehors des Etablissements de Santé… P 4
Fiche technique n° 23:
Les précautions " standard "… P 5
Le lavage des mains… P 7
Le manuportage… P 8
La prévention de la transmission aérienne
des infections en milieu hospitalier... P 9
Recommandations pour la décontamination
des dispositifs médicaux... P 10
Entretien des biberons, tétines et sucettes.
À l’attention des structures recevant des enfants... P 14
Prévention des accidents d’exposition
au sang et aux liquides biologiques... P 15
Déchets d’activité de soins:
qu’en faites-vous?… P 16
Élimination des déchets d’activité de soins… P 18
Fiche technique n° 24:
Les dix commandements
de la stérilisation en cabinet dentaire… P 19
Les détergents et les désinfectants.
L’eau de Javel, un bon désinfectant… P 20
L’antisepsie et les antiseptiques… P 22
Fiche technique n° 25:
Les antiseptiques… P 23
Fiche technique n° 26:
Le traitement des surfaces
et des instruments médicochirurgicaux… P 24
Aménagement, organisation
et entretien des locaux… P 25
Épidémie de gale dans un service de gériatrie au
C.H.S. Albert Bousquet à Nouméa… P 28
Les idées fortes… P 30

Hygiène
Hygiène
Septembre 2005 - N° 41 03
La responsabilité des professionnels de santé
en matière de prévention du risque infectieux
JP Bailly
Les professionnels de santé sont exposés à trois types de responsabilité : disciplinaire, civile et
pénale. Les règles de bonne pratique exposées ci-dessous peuvent constituer en cas de
contentieux pour les instances disciplinaires, juridictions civiles et pénales un outil de référence
et d’appréciation de la pratique du professionnel de santé qui serait poursuivi.
La responsabilité disciplinaire
Elle est appréciée par les instances
ordinales dans les professions dotées d’un
ordre : elle se traduit par une sanction (de
l’avertissement à l’interdiction d’exercer) en
cas de manquement à la déontologie*.
Les règles déontologiques visent la
sécurité des patients et les conditions
d’exercice (hygiène et locaux).
1) Médecins
Code de déontologie médicale, délibération
n° 67 du 1er août 1997
Article 32 : « Dès lors qu’il a accepté de
répondre à une demande, le médecin s’engage
à assurer personnellement au patient des
soins consciencieux, dévoués et fondés sur
les données acquises de la science, en
faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers
compétents ».
Article 69 : « L’exercice de la médecine
est personnel ; chaque médecin est respon-
sable de ses décisions et de ses actes ».
Article 71 : « (…) Il doit notamment veiller
à la stérilisation et à la décontamination
des dispositifs médicaux qu’il utilise et à
l’élimination des déchets médicaux selon les
procédures réglementaires.
Il ne doit pas exercer sa profession dans
des conditions qui puissent compromettre la
qualité des soins et des actes médicaux ou
la sécurité des personnes examinées. (…)».
2) Chirurgiens dentistes
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes,
délibération n° 093/CP du 7 mai 2002
Article 23 : « Le chirurgien-dentiste ne doit,
en aucun cas, exercer sa profession dans des
conditions susceptibles de compromettre la
qualité des soins et des actes dispensés ainsi
que la sécurité des patients. Il doit notamment
prendre et faire prendre par ses adjoints ou
assistants, toutes dispositions propres à éviter
la transmission de quelque pathologie que
ce soit (…)».
Article 30 : « Le chirurgien-dentiste qui
a accepté de donner des soins à un patient
s’oblige : 1° à lui assurer des soins éclairés
et conformes aux données acquises de la
science. (…)».
Article 55 : « (…) Dans tous les cas doivent
être assurées la qualité des soins, leur confi-
dentialité et la sécurité des patients.
L’installation des moyens techniques,
la stérilisation, la décontamination des
dispositifs médicaux dont il dispose et
l’élimination des déchets provenant de
l’exercice de la profession doivent
répondre aux règles en vigueur concernant
l’hygiène ».
3) Sages-femmes
Délibération n° 375 du 7 mai 2003
relative à l’exercice de la profession de
sage-femme – chapitre III : règles déontolo-
giques de l’exercice de la profession de
sage-femme
Article 40 : « La sage-femme doit disposer
au lieu de son exercice professionnel d’une
installation convenable et de moyens
techniques suffisants.
En aucun cas, la sage-femme ne doit
exercer sa profession dans des conditions
qui puissent compromettre la sécurité et la
qualité des soins et des actes médicaux ».
Article 56 : « Dès lors qu’elle a accepté
de répondre à une demande, la sage-femme
s’engage à assurer personnellement avec
conscience et dévouement les soins conformes
aux données scientifiques du moment que
requièrent la patiente et le nouveau-né. (…)».
Elle est appréciée par le juge pénal,
lorsque la faute du professionnel peut être
qualifiée d’infraction pénale (ce qui, en
matière de santé, est généralement le cas).
Elle se traduit par des peines d’amende
ou de prison. Il est impossible d’assurer sa
responsabilité pénale : celle-ci est toujours
personnelle.
Ces trois responsabilités peuvent se
cumuler pour les mêmes faits.
En conclusion, les règles de bonne pratique
contenues dans le présent guide peuvent
constituer en cas de contentieux pour les
instances disciplinaires, juridictions civiles et
pénales un outil de référence et d’appréciation
de la pratique du professionnel de santé qui
serait poursuivi. Le jugement se fera également
en fonction de l’ensemble des circonstances
que révèle le dossier.
Il est conseillé au professionnel de santé
de bien s’informer auprès des services
juridiques de son assurance professionnelle.
La responsabilité civile
La responsabilité pénale
Elle est appréciée par les juridictions
civiles pour la pratique libérale, par les
juridictions administratives pour la pratique
dans une structure publique : elle se traduit
par le versement de dommages-intérêts
destinés à réparer le dommage que la faute
du professionnel a causé à la victime. Cette
indemnité est versée par l’assureur du
professionnel.
* NDLR : Le décret de compétences et règles
professionnelles N° 2004 802 du 29 juillet
2004 régissant l’exercice professionnel des
Infirmiers(ères) Diplômés(es) d’Etat, n’est pas
applicable sur le Territoire. Cependant il est
utilisé comme référence de bonne pratique
pour les infirmiers(ères) exerçant en
Nouvelle Calédonie.

Septembre 2005 - N° 41
04
Hygiène
Hygiène
Dans les Etablissement
de Santé (ES)
Risques infectieux liés aux soins réalisés
en dehors des Etablissement de Santé
B Garin*
*: Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie
Bibliographie
1- Luldlow HA. Infection consequences of continous ambulatory peritoneal dialysis. J Hosp Infect 1991 ; 18 : 341-354
2- White MC, Raglund KE. Surveillance of intravenous catheter-related infections among home care clients. Am J Infect Control 1994 ; 22 : 231-5
3- Olson. Cluster of post injection abscesses related to corticoid injections and use of benzalkonium chloride. Western Journal of Medecine 1999 ; 170 : 143-7
4- Melish M, Arpon R, Coon P and al. Community associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus infections in Pacific Islanders. Hawaii, 2001-2003. MMWR August 27, 2004 /
53(33) ; 767-770.
5- Issartel B, Lechevallier S, Bruyère F, Lina G, Jarraud S, Garin B, Lacassin F, Etienne J. Abcès cutanés communautaires en Nouvelle Calédonie. Rapport 2002 de l’Institut Pasteur.
Si dans les Etablissements de Santé le risque infectieux est une part importante des risques
globaux encourus lors d’une hospitalisation, en dehors des Etablissements de Santé les
dangers d’infections existent, même si les risques sont à priori moins élevés. Les
soins réalisés dans ou hors des Etablissement de Santé impliquent donc des précautions
d’hygiène qui leur sont adaptées.
L’organisation de la gestion du risque
infectieux se fait à travers le Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
le Service d’Hygiène et plus globalement
dans le cadre de la Démarche Qualité. Mais
c’est l’affaire de tous au quotidien. La quanti-
fication des dangers passe par l’utilisation
d’indicateurs de qualité dont la mise en place
nécessite la collaboration d’une grande partie
du personnel, y compris des médecins.
Les informations fournies par ces indicateurs
permettent de situer un hôpital par rapport
à un autre, de cerner les causes des
infections contractées, et de lutter contre elles.
La formation du personnel et l’écriture de
procédures consensuelles sont les deux points
essentiels qui permettent d’améliorer le niveau
d’efficacité d’un hôpital dans ce domaine.
En dehors des Etablissement
de Santé
Les dangers d’infections existent même si
les risques sont a priori moins élevés(1, 2, 3) .
Cependant, contrairement au milieu hospi-
talier, ils sont difficilement quantifiables du
fait, entre autres, de la multiplicité des lieux.
Les risques sont cependant moindres car les
actes réalisés sont moins invasifs, les structures
moins grandes, les résistances bactériennes
aux antibiotiques moins fréquentes. Quoi
qu’il en soit le risque existe et particulièrement
chez des patients ayant préalablement séjourné
à l’hôpital et porteurs de bactéries multi-
résistantes (BMR). Les infections peuvent
être transmises dans les deux sens et de
différentes façons.
- soit par le soignant d’un patient à un
autre (par les mains ou par une faute d’asepsie
ou par un vecteur, matériel d’ophtalmologie,
d’aérosolthérapie, endoscope, gel…),
- soit du patient au soignant en particulier
par exposition aux liquides biologiques après
blessure ou projection.
Pour illustrer ce propos général, voici
quelques exemples de situations à risque.
Les dispositifs médicaux stériles
Sont regroupés sous cette dénomination
tout le matériel stérile à usage unique. Il est
probable qu’en dehors des ES, ils soient
la cause la plus fréquente d’infections
qui peuvent d’ailleurs être graves. Elles
surviennent au décours de manipulations de
cathéters centraux ou de chambres implan-
tables lors des pansements, d’injections ou
de perfusions. La survenue d’une sympto-
matologie fébrile doit faire envisager leur
remplacement signe que les verrous anti-
biotiques n’ont pas empêché leur colonisation.
Les sondages urinaires, comme pour toute
manipulation de dispositifs médicaux
stériles, sont la source d’infections et un
respect scrupuleux de l’asepsie est
nécessaire. La petite chirurgie sous anesthésie
locale et les ponctions articulaires sont des
gestes invasifs à l’origine aussi de contami-
nations potentielles.
Les matériels à visée diagnostique
Lors d’échographies, notamment gynéco-
logiques, les sondes doivent être protégées et
nettoyées. Pour les endoscopies pulmonaires,
les procédures de nettoyage-désinfection et
de stockage doivent correspondre à la régle-
mentation énoncée dans les Circulaires et
Arrêtés et tenir compte du risque prion.
Les matériels thérapeutiques
Matériel d’aérosolthérapie, d’oxygéno-
thérapie avec notamment des risques de
contamination de l’eau ou des tuyauteries
dont il faut se méfier.
Les résistances bactériennes
Les résistances bactériennes étaient,
jusqu’à présent l’apanage des milieux
hospitaliers, mais l’émergence de Staphylo-
coccus Aureus Résistant à la Méthicilline
(SARM) en dehors des ES doit nous inciter à
la prudence(4,5) . Les Staphylocoques sont des
bactéries transmises par les mains et les
contaminations secondaires à une intervention
médicale sont le plus souvent manuportées.
Les pratiques à respecter
- Se laver les mains (Solutions Hydro-
Alcooliques).
- Utiliser des gants.
(suite page 9)

Septembre 2005 - N° 41 05
FICHE TECHNIQUE N° 23
FICHE TECHNIQUE N° 23
Les précautions "standard"
Elles s’appliquent pour tous les patients par tous les soignants.
Elles sont aux nombres de dix et doivent être connues et appliquées par tous.
1- Le lavage des mains
Immédiatement après le retrait des gants.
Entre deux patients.
Entre deux activités.
2 - Le port des gants
Pour tous gestes si risque de contact avec un liquide
biologique, ou si contact avec les muqueuses ou la
peau lésée du patient.
Si le personnel est porteur de lésions sur les mains.
3 - Collecteurs pour tous dispositifs piquants / tranchants / coupants
À portée de mains.
Stable et de taille adaptée. Niveau de remplissage visible.
Fermeture inviolable.
4 - Sécurité
Ne pas capuchonner les aiguilles.
Ne pas désadapter à la main les aiguilles et les lames.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%