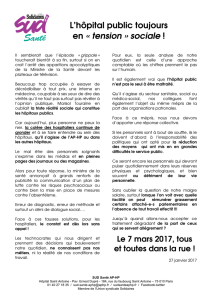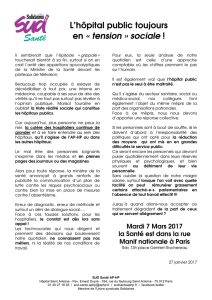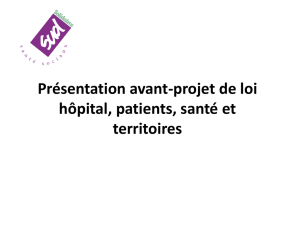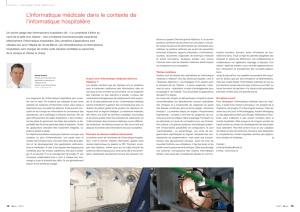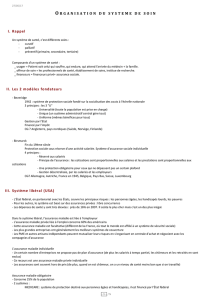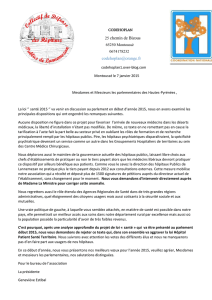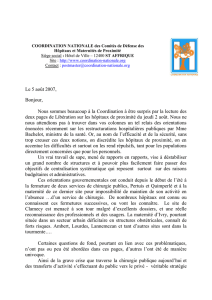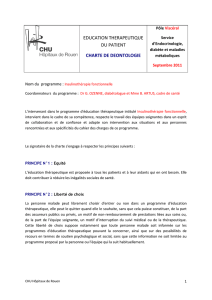René BARBERYE - Gestion et Finances Publiques

René BARBERYE
Vice-président du conseil d’administration
du centre hospitalier de Rambouillet administrateur de l’AP-HP
La loi « hôpital, patients, santé, territoire »
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires comporte quatre titres qui traitent succes-
sivement de :
– la modernisation des établissements de santé ;
– l’accès de tous à des soins de qualité ;
– la prévention et la santé publique ;
– l’organisation territoriale du système de santé.
Le présent article se limitera aux aspects concernant la réforme
hospitalière qui constitue l’élément qui a fortement focalisé les
débats à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Le rapport Larcher, qui était le résultat de très nombreuses consul-
tations de toutes les parties prenantes, avait été bien accueilli et
ses propositions avaient bénéficié d’un certain consensus. On
aurait pu penser que le projet de loi qui s’en inspirait très large-
ment recevrait le même accueil. Il n’en a rien été et cette affaire
illustre une nouvelle fois la difficulté qu’il y a, en France, à passer
de la réflexion à l’action ; ce qui explique sans doute le fait que
le cimetière des rapports morts-nés soit aussi important.
On a en effet vu se développer une fronde des médecins, notam-
ment hospitaliers, menée par quelques sommités médicales de
l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et une agitation sociale
des personnels hospitaliers conduite surtout par la CGT et Sud, ces
mouvements étant relayés au plan politique par l’opposition. Le
projet de loi a été toutefois soutenu courageusement par la Fédé-
ration hospitalière de France, présidée par l’ancien ministre
Claude Evin, par la CFDT et par un certain nombre de personna-
lités du monde médical comme les professeurs Vallancien et
Juvin, entre autres.
Deux questions à M. G. LARCHER,
président du Sénat, ancien président de la FHF,
auteur du rapport sur l’hôpital
Votre rapport avait bénéficié d’un accueil très largement
favorable ; or la loi HPST a soulevé de fortes oppositions syn-
dicales et politiques. Comment expliquez-vous ce décalage ?
Notre rapport sur l’hôpital a rencontré un large consensus de
la part de la plupart des acteurs hospitaliers mais aussi de la
part des élus comme des représentants des usagers. Cela est
dû sans doute à la large concertation que nous avons tenu à
organiser avec ces différents acteurs. Plus de 250 personnes
ou représentants d’organisations concernées ont été
entendus par la commission ou par moi-même. Mais je pense
aussi qu’une des raisons essentielles de l’accueil favorable des
propositions de la commission de concertation est due au fait
que l’objectif de ces propositions était de permettre la meil-
leure prise en charge des patients et non de servir telle ou
telle ambition de pouvoir à l’intérieur de l’hôpital. Et cela
chacun l’avait bien compris !
Il est vrai qu’au moment de l’examen du projet de loi par le
Parlement, les corporatismes divers se sont réveillés pour des
raisons qui sont parfois assez éloignées de l’intérêt véritable des
patients.
Le débat parlementaire particulièrement au Sénat, a permis
de trouver un bon équilibre permettant de préserver l’essentiel
du dispositif conformément aux orientations proposées dans
notre rapport qui toutes, je vous le rappelle, avaient pour but
de répondre à l’objectif de qualité des soins pour tous nos
concitoyens.
Par delà les textes de loi, quel doit être, selon vous, le rôle de
chacun des éléments participant à la gouvernance de
l’hôpital pour que celui-ci fonctionne d’une manière
optimale ?
La gouvernance à l’hôpital n’est pas le seul élément clé du
projet de loi. Il me semble en effet que les dispositions concer-
nant le rôle des établissements de proximité, le rôle des struc-
tures médico-sociales et leurs relations avec les établissements
de santé, la nouvelle place accordée à l’hospitalisation à
domicile, la rénovation de la notion de service public, la créa-
tion des communautés de territoire et l’adaptation des grou-
pements de coopération sanitaire, constituent pour moi le
cœur de la loi.
Je ne nie pas l’importance des règles de gouvernance à
l’hôpital, mais je pense que l’engagement réel des acteurs et
leur confiance réciproque qu’ils s’accordent sont plus impor-
tants que la simple application littérale de règles. En ce sens,
connaissant bien la foi dans le service public des principaux
responsables hospitaliers, qu’il s’agisse des directeurs ou des
présidents de CME, je suis profondément confiant dans leur
volonté commune de servir au mieux l’intérêt général au profit
des malades. Bien sûr, il faut un responsable à la tête de
l’hôpital mais il faut aussi que les médecins, comme d’ailleurs
l’ensemble des personnels soignants et non soignants, se sen-
tent concernés par les choix qui sont faits au niveau de l’insti-
tution, notamment au travers du projet médical. Il me semble
que le texte final a su préserver l’essentiel en reconnaissant le
rôle de chacun.
Le législateur a d’ailleurs prévu un suivi assorti d’une évaluation
au bout de deux ans pour apprécier sur le terrain la pertinence
des mesures prévues par la loi. Cette méthode, originale dans
notre pays, permettra de faire évoluer le dispositif si nécessaire
et de faire partager les expériences des uns et des autres. Elle
était souhaitable pour notre mission hôpital. Un rapport sera
remis au Parlement à l’échéance des deux ans.
hôpitaux
No10 - Octobre 2009 -
738

Trois questions à M. C. ÉVIN,
ancien ministre de la Santé,
président de la Fédération hospitalière de France
Le problème de la place du corps médical dans la gouver-
nance hospitalière a focalisé les débats sur la loi HPST. Qu’en
pensez-vous ?
Il me semble que les discussions se sont beaucoup focalisées
sur ce sujet, alors que la loi HPST ne se résume pas à la question
de la gouvernance hospitalière et comporte beaucoup
d’autres dispositions importantes.
Mais il est vrai que, dans les derniers mois, la communauté
médicale hospitalière a manifesté une certaine inquiétude. Je
crois qu’elle a été entendue et que le texte adopté est équi-
libré du point de vue de la gouvernance. Les chefs de pôles,
la CME et le président de CME voient leurs compétences ren-
forcées. Les modalités de la concertation et les circuits déci-
sionnels sont clarifiés afin de permettre aux dirigeants hospita-
liers de prendre les décisions et de rendre les arbitrages
qu’impose la gestion d’une institution complexe comme
l’hôpital.
Certains acteurs du secteur hospitalier public ont mal réagi
au fait que le secteur public puisse, dans certains cas, être
chargé de missions de service public. Quelle est la position
de la FHF ?
Dans la loi, les missions sont définies indépendamment du
statut des établissements et le service public n’apparaît plus
comme une exclusivité des établissements publics. Du point
de vue de la FHF, l’important est le service rendu aux usagers.
Il existe des territoires où, essentiellement pour des motifs de
démographie médicale, les contraintes liées au service public
telles que la permanence des soins ne peuvent être assumées
par les seuls établissements publics. En matière d’enseigne-
ment, certains établissements privés offrent un potentiel de
terrain de stage qu’il serait dommageable d’ignorer.
La FHF n’est pas opposée à ce que des établissements privés
soient opérateurs de service public sous réserve que les obli-
gations et devoirs associés soient intégralement pris en
compte. Dans les faits, l’hôpital public restera néanmoins le
lieu de recours, ouvert tous les jours, à toute heure, pour tous
les patients, notamment les plus vulnérables.
Comment voyez-vous la place des CHU dans la perspective
de la création de communautés interhospitalières ?
La Fédération hospitalière de France encourage depuis long-
temps les établissements à travailler ensemble, autour d’une
« stratégie de groupe » à organiser dans les territoires. Les
communautés hospitalières de territoire (CHT) donneront corps
à ces coopérations entre hôpitaux.
Si les CHU n’ont pas systématiquement vocation à intégrer une
CHT, cela doit rester possible lorsque le contexte le justifie. En
revanche, je pense que les CHT devront passer convention
avec un CHU, compte tenu de leurs missions spécifiques de
recours, d’enseignement et de recherche dans les régions.
A la vérité, il y a eu un amalgame entre le contenu du projet de
loi et certains sujets qui n’y figuraient pas et qui donnaient lieu à
débat avant même son dépôt, à savoir :
– la T2A qui avait bénéficié d’un a priori favorable des différents
acteurs du monde hospitalier avant qu’on ne s’aperçoive que les
gagnants et les perdants (car il y en a inévitablement) n’étaient
pas les mêmes que ceux de la dotation globale. Ce nouveau
dispositif qui, indéniablement, nécessite un certain nombre d’ajus-
tements, notamment pour la prise en compte de certaines
charges propres à l’hôpital public, a le mérite de mettre en
lumière le fait que des hôpitaux sont mieux gérés que d’autres et
que l’hôpital doit se préoccuper de maîtriser ses coûts et de faire
rentrer ses produits. L’appel dit des 25 est à cet égard représentatif
de cet amalgame ; il est écrit : « cette loi porte en elle la disparition
de cette médecine hospitalière au profit d’une médecine mer-
cantile. La préoccupation centrale n’est plus le malade mais le
compte d’exploitation de l’hôpital ». Cette affirmation éminem-
ment discutable est d’autant plus surprenante que certains signa-
taires exercent à l’hôpital public une part de leur activité en
libéral, ce qui leur assure des revenus très substantiels ;
– la convergence des tarifs entre les cliniques et l’hôpital public.
Ce point a toujours été contesté par les défenseurs de l’hôpital
public et par la Fédération hospitalière de France. Faute de tra-
vaux aboutis sur les charges particulières pesant sur l’hôpital
public, la controverse ne risque pas de s’éteindre. La ministre de
la Santé a fait preuve de sagesse en reportant la convergence
à 2018, ce qui donne le temps de rassembler davantage
d’éléments.
Si l’on revient à la loi proprement dite, le titre I traite successive-
ment de trois points importants :
– les missions des établissements de santé et notamment celle du
service public ;
– le fonctionnement des établissements de santé ;
– les outils de coopération entre les établissements de santé.
MISSIONS
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
La loi définit de manière très précise les missions des établisse-
ments de santé, qu’ils soient publics ou privés : « Les établissements
de santé publics, privés ou privés d’intérêt collectif assurent, dans
les conditions définies par le présent code, le diagnostic, la sur-
veillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes
enceintes. Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme
ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du
lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement rele-
vant du Code de l’action sociale et des familles. Ils participent à
la coordination des soins en relation avec les membres des pro-
fessions de santé exerçant en pratique de ville et les établisse-
ments et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’ARS
en concertation avec les conseils généraux pour les compé-
tences qui les concernent. Ils participent à la mise en œuvre de
la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance des-
tinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent en leur sein, une
réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge
médicale ».
Ainsi, l’accent est mis sur la coopération entre les différents
acteurs de santé, hôpitaux publics et privés, établissements et
services médico-sociaux, médecine de ville. De même, l’hospita-
lisation ne signifie plus nécessairement l’hospitalisation avec
hébergement dans un établissement de santé mais ce peut être
en hôpital de jour ou des soins à domicile.
Ces évolutions sont rendues nécessaires par le souci qui s’impose
à notre pays d’optimiser son système de santé alors même que
les dépenses de santé croissent plus vite que le PNB, que le déficit
de la Sécurité sociale financé par l’emprunt reporte une partie
des charges sur nos enfants et que la démographie médicale va
se traduire par une réduction du temps médical disponible. Par
ailleurs, dans un souci de qualité des soins, notre dispositif doit se
décloisonner et s’adapter au parcours du patient.
Les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, peu-
vent être amenés à mener ou participer à une ou plusieurs mis-
sions de service public :
– la permanence des soins ;
– la prise en charge des soins palliatifs ;
hôpitaux
-N
o10 - Octobre 2009
739

– l’enseignement universitaire et post universitaire ;
– la recherche ;
– le développement professionnel continu des praticiens hospi-
taliers et non hospitaliers ;
– la formation initiale et le développement professionnel continu
des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche
dans leurs domaines de compétence ;
– les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur
coordination ;
– l’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et
les autres professionnels de santé, personnes et services de santé ;
– la lutte contre l’exclusion sociale en relation avec les autres
professionnels et institutions compétentes en ce domaine, ainsi
que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion
et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination,
pour s’en tenir aux domaines les plus importants.
L’hôpital de Montfort-l’Amaury (78), un hôpital qui a su évoluer
La suppression de la distinction public-privé est importante :
jusqu’ici, ces missions reposaient, pour l’essentiel, sur les hôpi-
taux publics, si l’on met à part les urgences qui étaient assurées
par un certain nombre de cliniques. Cette évolution était
rendue nécessaire par le fait que, dans plusieurs zones géogra-
phiques, les cliniques privées sont seules en mesure d’assurer
certaines missions. Par ailleurs, dans des spécialités très poin-
tues, les cliniques privées occupent une place quasi exclusive,
ce qui suppose de faire appel à elles pour la formation des
futurs spécialistes. C’est pourquoi l’Agence régionale de santé
(ARS), par son rôle de pilote de l’organisation des soins et de
garant de l’accès aux soins, identifiera les territoires où il
convient, en cas de carence ou d’insuffisance de certaines
activités, de déléguer de telles missions de service public à des
établissements privés. Le texte prévoit que lorsqu’une mission
de service public n’est pas assurée dans un territoire donné,
l’ARS désigne l’établissement qui en sera chargé. Ce n’est donc
qu’en cas de carence qu’elle pourra demander à un établis-
sement privé d’exercer une mission de service public et le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précisera ces mis-
sions. Mais si cette autorisation crée des droits, elle crée aussi
des devoirs. Des établissements privés qui ont développé une
excellence dans un domaine pourront accueillir des internes,
mais ils le feront sous le contrôle d’un CHU. De même, la parti-
cipation à la permanence des soins suppose l’accueil des
populations défavorisées, en particulier celles qui bénéficient
de la couverture maladie universelle (CMU) et l’aide médicale
d’Etat (AME), ainsi que sur l’offre d’un pourcentage de presta-
tions à tarif opposable.
Certains défenseurs de l’hôpital public étaient hostiles à cette
mesure et la FHF a été parfois critiquée pour avoir fait connaître
qu’elle n’y était pas opposée. Son président a fait valoir à juste
titre que, sauf à préconiser la nationalisation du système de
santé, ce que personne n’envisage, donner à la population une
garantie de service public dans le domaine de la santé, passe
dans certains cas par l’exercice de missions de service public
par les cliniques privées. C’est une attitude réaliste prenant en
compte le fait que 60 % de la chirurgie est assurée par le secteur
privé et que dans certaines zones géographiques, l’hôpital
public n’offre pas de véritable alternative.
LE FONCTIONNEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
De nombreux rapports émanant d’horizons très divers avaient
pointé les lacunes du mode de gouvernance des hôpitaux
publics. Dans un rapport remis le 10 juillet 2008 sur la gouvernance
hospitalière, le professeur Vallancien écrivait : « en 2008, l’hôpital
est administré, mais il n’est toujours pas gouverné. Or, une bonne
gouvernance de l’hôpital implique la liberté de décision et
d’action de ses dirigeants, dans le cadre d’une politique de santé
clairement définie ». D’un point de vue purement objectif, il est
de fait que le fonctionnement de l’hôpital s’apparente plus au
fonctionnement d’une entreprise qu’à celui d’une administration,
même si peu de gens le reconnaissent publiquement de peur de
se faire taxer d’une vision comptable, voire mercantile, des pro-
blèmes de santé. Toutefois, le délégué général de la FHF déclarait
récemment et avec un certain courage : « l’hôpital est une entre-
prise mais une entreprise de service public ». Or, une entreprise
doit être gouvernée et c’est ce à quoi tendent les dispositions de
la loi.
La rénovation des instances et du mode de pilotage des établis-
sements publics de santé vise à responsabiliser davantage le
directeur d’établissement et à lui confier les outils d’une gestion
dynamique.
La gouvernance
des établissements publics
est clarifiée
La loi met en place de nouvelles instances de pilotage (directoire,
conseil de surveillance) sans remettre en cause les grandes orien-
tations définies en 2005. Il s’agit de doter l’hôpital d’une chaîne
hiérarchique claire et responsable, d’assurer une bonne coopé-
ration de l’administratif et du médical.
hôpitaux
No10 - Octobre 2009 -
740

L’organe délibératif des centres hospitaliers
Composition avant la loi
Conseil d’administration Composition après la loi
Conseil de surveillance
– Maire de la commune siège.
– Trois conseillers municipaux de la commune siège et deux d’autres
communes.
– Un conseiller général.
– Un conseiller régional.
– Quatre membres de la CME dont le président et le vice-président.
– Quatre représentants du personnel dont un membre de la commission des
soins infirmiers.
– Deux représentants des usagers.
– Trois personnalités qualifiées.
Le maire de la commune siège est président.
Trois collèges dont le nombre de membres est égal :
– au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs grou-
pements, dont le maire du siège et le président du Conseil général ou leurs
représentants ;
– au plus, cinq représentants du personnel médical et non médical, dont un
élu par les membres de la commission des soins infirmiers, les autres étant
désignés à parité par la CME et par les syndicats ;
– au plus cinq personnalités qualifiées, dont deux désignées par l’ARS et trois
représentant les usagers dont deux désignés par le préfet.
Le président est élu au sein du conseil.
Attributions avant la loi Attributions après la loi
Se prononce sur :
– le projet d’établissement et le contrat pluriannuel ;
– la politique de qualité et de sécurité des soins ;
– l’EPRD ;
– le plan de redressement ;
– les comptes et l’affectation des résultats ;
– l’organisation en pôles ;
– la politique de contractualisation interne ;
– la politique sociale et l’intéressement ;
– la participation aux réseaux de santé et actions de coopération ;
– les acquisitions, aliénations, échanges ;
– les baux emphytéotiques ;
– la prise de participation, la modification de l’objet social ;
– le règlement intérieur.
Se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement.
Il délibère sur :
– le projet d’établissement ;
– le compte financier et l’affectation des résultats ;
– certaines conventions ;
– tout projet de fusion avec un autre hôpital ;
– le rapport annuel d’activité ;
– les conventions avec un membre du directoire ou du conseil de
surveillance ;
– le statut des fondations hospitalières.
Il donne son avis sur :
– la politique de qualité et de sécurité des soins, la gestion des risques,
l’accueil et la prise en charge des usagers ;
– les acquisitions, aliénations baux de longue durée ;
– le règlement intérieur de l’établissement ;
Il entend le directeur sur l’EPRD et le programme d’investissement.
Il effectue les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns.
Le rôle du directeur,
président du directoire d’établissement
est renforcé
Le texte de loi conforte les pouvoirs d’autonomie du directeur
d’établissement qui se voit confier la pleine responsabilité de
l’établissement. En effet, c’est lui qui « conduit la politique géné-
rale de l’établissement. Il participe aux travaux du conseil de sur-
veillance. Il exécute ses délibérations. Il dispose d’un pouvoir de
nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général
du Centre national de gestion la nomination des directeurs
adjoints et des directeurs des soins. Sur proposition du chef de
pôle ou, à défaut du responsable de la structure interne, et après
avis de la commission médicale de l’établissement, il propose au
directeur général du Centre national de gestion la nomination et
la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux,
pharmaceutiques et odontologiques ».
Le débat parlementaire s’est beaucoup focalisé sur les pouvoirs
du directeur en raison d’une pression très forte du corps médical.
Cette focalisation a été très excessive car qui peut croire qu’un
directeur d’hôpital pourrait prendre une décision dans le
domaine médical sans recueillir un large consensus médical.
Cette méfiance à l’égard des pouvoirs des directeurs est allée
très loin. Le texte initial du Gouvernement prévoyait que le direc-
teur préparait les travaux du conseil de surveillance et y assistait.
C’est ainsi que fonctionne un conseil de surveillance dans les
sociétés privées. Or, le texte sorti des délibérations du Sénat indi-
quait qu’il « est entendu par le conseil de surveillance à sa
demande ou à celle du conseil de surveillance ». On ne peut que
s’interroger sur les conditions de fonctionnement d’un conseil de
surveillance où le directeur ne préparerait pas les dossiers et ne
les présenterait pas lui-même ou avec l’appui de ses adjoints.
Le texte définitif est plus réaliste : « il participe aux séances du
conseil de surveillance ». On n’a pas osé aller jusqu’à rétablir la
préparation des travaux mais cela va de soi.
S’agissant du statut des directeurs, la loi introduit une novation
puisque, par dérogation au statut général des fonctionnaires, des
personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être
nommées sur des emplois de directeur. Toutefois, ces personnes
doivent suivre à l’Ecole des hautes études en santé publique, une
formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
Un directoire resserré
remplace l’ancien conseil exécutif
Le directoire est l’instance au sein de laquelle débattra une
équipe de direction composée de cadres administratifs, de
cadres médicaux et d’un cadre de santé assistant le directeur. Il
est chargé de préparer, sur la base du projet médical initié par
le président de la commission médicale d’établissement (CME),
le projet d’établissement qui sera ensuite arrêté par le directeur
et soumis au conseil de surveillance. Plus largement, il est chargé
de conseiller le directeur dans la gestion et la conduite de
l’établissement.
Comme on le voit, il ne s’agit pas, fort heureusement, d’un véri-
table directoire comme on l’entend dans le droit des sociétés.
Cela aurait conduit à instaurer une coresponsabilité des membres
du directoire, ce qui n’était pas l’objectif recherché puisque la
loi vise à renforcer les pouvoirs du directeur. En fait, on est resté
dans l’esprit de ce qu’était l’ancien conseil exécutif mais en le
resserrant, ce qui peut d’ailleurs poser quelques problèmes de
susceptibilité.
Le directoire est composé de membres du personnel de l’établis-
sement dont une majorité de membres du personnel médical,
hôpitaux
-N
o10 - Octobre 2009
741

pharmaceutique, maïeutique et odontologique. (Le texte original
ne prévoyait pas cette majorité.) Il comporte sept membres et
neuf dans les CHU :
– le directeur, président du directoire ;
– le président de la CME, vice-président. Dans les CHU, il est pre-
mier vice-président, chargé des affaires médicales. Il y a en outre
un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de
recherche médicale ou président du comité de coordination de
l’enseignement médical et un vice-président chargé de la
recherche ;
– le président de la commission des soins infirmiers ;
– des membres nommés par le directeur ; ceux qui appartiennent
aux professions médicales sont nommés sur présentation d’une
liste de propositions établie par le président de la CME (avec les
autres présidents pour les CHU).
Le texte initial ne prévoyait pas de dispositions particulières pour
les CHU mais la publication en mai 2009 du rapport de la commis-
sion sur l’avenir des CHU, présidée par le professeur Marescaux
du CHU de Strasbourg, a amené le Gouvernement à introduire
certaines dispositions particulières au cours de la discussion par-
lementaire, ce qui a été critiqué par l’opposition.
Une des nouveautés de la loi est le renforcement du rôle et du
pouvoir du président de la CME puisqu’il devient vice-président
du directoire et se voit confier le rôle d’élaborer, avec le directeur,
et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la poli-
tique médicale de l’établissement. En effet, auparavant, le projet
d’établissement était préparé par le conseil exécutif auquel le
président de la CME appartenait sans en être le vice-président.
Un conseil de surveillance recentré
sur des missions de contrôle
se substitue au conseil d’administration
Le projet de loi initial limitait très sensiblement les attributions du
conseil de surveillance. Le conseil de surveillance exerçait simple-
ment le contrôle de l’établissement et délibérait sur :
– le projet d’établissement ;
– la convention constitutive des centres hospitaliers et universi-
taires et les conventions passées en application de l’article
L. 614-2-5 ;
– le compte financier et l’affectation des résultats ;
– le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par
le président du directoire ;
– toute convention intervenant entre l’établissement public de
santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de
surveillance ;
– les statuts des fondations hospitalières créés par l’établissement.
Au cours de la discussion parlementaire, une compétence a été
ajoutée : « toute mesure relative à la participation de l’établisse-
ment à une communauté hospitalière de territoire, dès lors qu’un
centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout
projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements
publics de santé ». C’est sans doute le signe d’une inquiétude
des parlementaires devant une perspective qui peut néanmoins,
dans certains cas, s’imposer au plan géographique, celle d’une
communauté interhospitalière centrée sur un CHU avec le risque
d’un alourdissement de la gestion et de la réactivité. Le fait que
la plupart des CHU soient en déficit a dû peser d’un certain poids.
Par ailleurs, la discussion parlementaire a prévu que le conseil de
surveillance donne son avis sur :
– la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité
des soins et la gestion des risques ainsi que des conditions
d’accueil et de prise en charge des usagers ;
– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur
affectation, les baux de plus de dix-huit ans et certains contrats
de partenariat ;
– le règlement intérieur de l’établissement.
En outre, le conseil de surveillance fait connaître à l’ARS ses obser-
vations sur le rapport annuel. Il opère les vérifications et les
contrôles qu’il juge nécessaires et, si les comptes de l’établisse-
ment sont soumis à certification, il nomme le commissaire aux
comptes. Enfin, il entend le directeur sur l’EPRD et sur les pro-
grammes d’investissement.
Le texte définitif reflète la tension entre le ministère qui souhaitait
que le conseil de surveillance ne vote plus l’EPRD et les parlemen-
taires qui rechignaient à lui enlever cette prérogative importante.
A l’expérience des années passées, le Gouvernement, en charge
de l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale, avait constaté,
en effet, que le fait de mettre autour de la table les différentes
parties intéressées par le fonctionnement de l’hôpital (politiques,
médecins, représentants syndicaux et des usagers, personnalités
qualifiées) n’était pas toujours compatible avec la prise de déci-
sions réalistes et courageuses sur les perspectives budgétaires.
Dans certains cas, des alliances de circonstance bloquaient le
vote de l’EPRD et le vote des plans de redressement qui impli-
quaient en général des mesures impopulaires s’avérait particuliè-
rement compliqué. En définitive, le conseil de surveillance
entendra le directeur sans même donner un avis.
La taille des nouveaux conseils de surveillance est resserrée par
rapport aux conseils d’administration mais une représentation
diversifiée des intérêts des territoires, du personnel et de la société
civile et des usagers est assurée via trois collèges égaux en
nombre :
– au plus cinq représentants des collectivités territoriales dont le
maire de la commune siège de l’établissement principal et le
président du Conseil général ou leurs représentants ;
– au plus cinq représentants du personnel médical et non
médical dont un représentant élu parmi les membres de la
commission des soins infirmiers, deux désignés par la CME et deux
par les organisations syndicales les plus représentatives ;
– au plus cinq personnalités qualifiées, dont deux désignées par
le directeur général de l’ARS, trois représentants des usagers dont
deux désignés par le préfet.
Comme aujourd’hui, le directeur général de l’ARS participe aux
séances avec voix consultative et il peut demander l’inscription
de toute question à l’ordre du jour. Par ailleurs, et il s’agit d’une
innovation importante, le directeur de la caisse d’assurance
maladie ou de la caisse de mutualité agricole, si elle est désignée
comme caisse pivot, participe aux séances du conseil avec voix
consultative.
Par contre, le représentant du Conseil régional n’y figure plus
expressément, ce qui peut représenter un inconvénient car les
écoles d’infirmières (IFSI) annexées aux hôpitaux sont maintenant,
comme l’ensemble de la formation professionnelle, financées par
les régions. De même, la présence du receveur hospitalier n’est
pas prévue expressément. Il serait pourtant regrettable qu’il
n’assiste pas car il participe activement au bon fonctionnement
de l’établissement et joue un rôle de conseiller financier.
Par ailleurs, le maire de la commune siège de l’hôpital n’est plus
automatiquement président du conseil de surveillance. Ce der-
nier élit son président parmi les représentants des collectivités ter-
ritoriales ou parmi les personnalités qualifiées.
La présidence automatique du maire ou de son délégué a donné
lieu dans le passé à beaucoup de débats, l’intérêt politique local
pouvant l’emporter sur l’intérêt général ou celui de l’établisse-
ment. En fait, il est très difficile de ne pas tenir compte du fait que
hôpitaux
No10 - Octobre 2009 -
742
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%