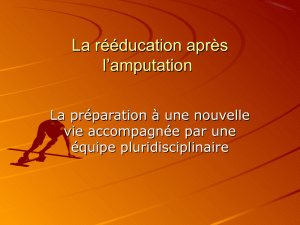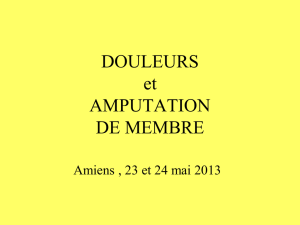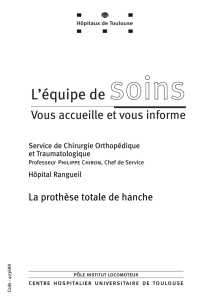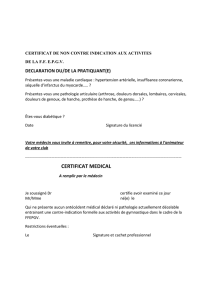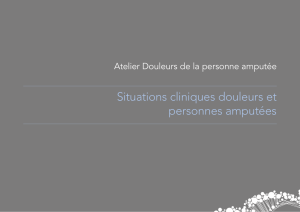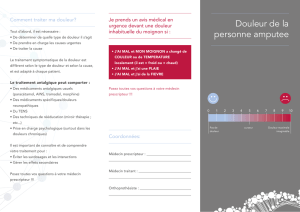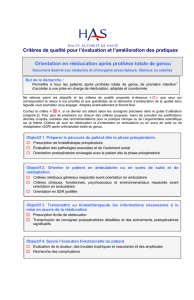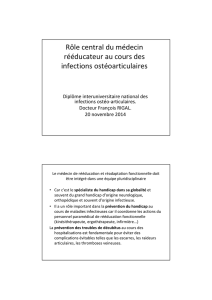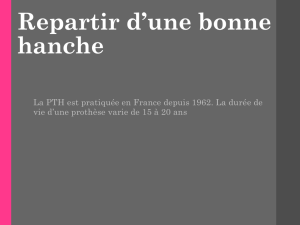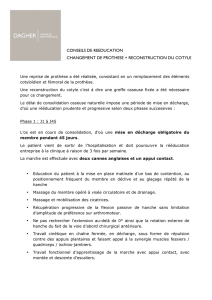Nantes-2012-BEZAT-Divers

POUR UN PATIENT CORONARIEN ET
AMPUTE FEMORAL
COMBINER REEDUCATION ET
REENTRAINEMENT A L’EFFORT
BEZAT Juliette
3ème année de masso-kinésithérapie
Dossier d’évaluation clinique en Masso-kinésithérapie
En vue de l’obtention du diplôme d’état
Stage du 6 septembre 2010 au 15 octobre 2010
Institut Régional de Formation aux Métiers de Rééducation
et Réadaptation des Pays de la Loire
54, rue de la Baugerie
44230 St Sébastien sur Loire

Résumé
M.R., 66 ans, est amputé transfémoral suite à une thrombose d’un pontage fémoro-poplité.
La prise en charge masso-kinésithérapique est orientée sur la «…réadaptation de l’amputé à
l’appareillage et une réadaptation cardiorespiratoire à l’effort… » chez un patient qui est
appareillé 15 jours après son arrivée en centre de réadaptation.
Dans ce cadre, différents moyens sont mis en place afin de permettre le réentrainement à
l’effort et d’atteindre l’objectif d’une marche en sécurité. Les différents paramètres de
surveillance pris en compte sont la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène. A la fin
de la prise en charge, la marche avec Rollator s’effectue en sécurité. Sans aide technique, elle
est possible mais de nombreux déséquilibres persistent encore.
Mots clés
Amputation / Amputation
Appareillage / Equipment
Réentrainement à l’effort / Rehabilitation training
Marche / Gait

Sommaire
1 Introduction : contexte rééducatif ...................................................................................... 1
2 Anatomie et pathologie ...................................................................................................... 1
2.1 Athérosclérose ............................................................................................................. 1
2.2 Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs ...................................................... 2
2.3 Traitements de l’AOMI ............................................................................................... 2
3 Présentation du patient ....................................................................................................... 4
4 Evaluation initiale du patient .............................................................................................. 4
4.1 Déficits de structure ..................................................................................................... 4
4.2 Limitations d’activités ................................................................................................. 5
4.3 Restrictions de participation ........................................................................................ 6
5 Bilan diagnostic masso-kinésithérapique ........................................................................... 6
5.1 Diagnostic kinésithérapique ........................................................................................ 6
5.2 Objectifs ....................................................................................................................... 7
5.3 Moyens ........................................................................................................................ 7
6 Techniques masso-kinésithérapiques ................................................................................. 7
6.1 Principes ...................................................................................................................... 7
6.2 Lutte contre la douleur ................................................................................................. 7
6.3 Entretien du moignon .................................................................................................. 9
6.4 Prévention du flexum de hanche ............................................................................... 11
6.5 Amélioration de l’équilibre ....................................................................................... 11
6.6 Correction de la qualité de la marche ........................................................................ 12
6.7 Réentrainement progressif à l’effort .......................................................................... 14
6.8 Réadaptation fonctionnelle ........................................................................................ 17
7 Evaluation à 6 semaines ................................................................................................... 18
7.1 Evaluation globale ..................................................................................................... 18
7.2 Evaluation cardio-respiratoire ................................................................................... 18
7.3 Evaluation fonctionnelle ............................................................................................ 18
7.4 Evaluation psycho-sociale ......................................................................................... 19
8 Discussion ........................................................................................................................ 19
9 Conclusion ........................................................................................................................ 21
Bibliographie
Annexes

1
Dossier Clinique
1 Introduction : contexte rééducatif
Retraité de 66 ans, M.R est admis au Centre Régional de Rééducation et de Réadaptation des
Capucins à Angers, le 15 septembre 2011 suite à une amputation trans-fémorale droite datant
du 6 septembre 2011. Un appareillage est réalisé deux semaines après son arrivée. Il s’agit
d’une prothèse contact à ischion intégré et d’un genou à verrou. Le moignon est recouvert
d’un manchon en silicone injecté et tramé.
Cette amputation fait suite à une ischémie aigue sur une thrombose du pontage fémoro-
péronier. Celle-ci provoque une rhabdomiolyse1 chez un patient coronarien.
La prescription médicale mentionne "…une rééducation à la marche et un réentrainement à
l’effort…"
Dans le contexte d’amputation, comment permettre la rééducation et le réentrainement à
l’effort chez un patient présentant des antécédents cardiaques ?
2 Anatomie et pathologie
2.1 Athérosclérose
L’athérosclérose [1] est une maladie inflammatoire qui touche
principalement les artères cérébrales, les artères carotidiennes, les
artères coronaires, l’aorte abdominale et les artères du membre
inférieur. Elle correspond à une perte d’élasticité de la paroi
artérielle et à une accumulation d’athérome c'est-à-dire de lipide, de
glucide, de sang et de calcaire dans la tunique artérielle [2]. A terme
la plaque athéromateuse peut causer une artériopathie oblitérante des
membres inférieurs (AOMI), un accident vasculaire cérébral (AVC)
ou un infarctus du myocarde si la plaque athéromateuse se rompt,
entraînant alors la formation d’un thrombus qui peut être la cause
1 La rhabdomyolyse correspond à une destruction des fibres musculaires squelettiques et dont le contenu se
déverse dans la circulation sanguine. Certains de ces produits de dégradation, comme la myoglobine sont nocifs
pour les reins et peuvent entraîner une insuffisance rénale
Figure 1: Athérosclérose

2
d’une occlusion de la circulation sanguine. Les facteurs de risque de l’artériopathie sont
l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le tabac, le surpoids, le diabète, l’alcool et la
sédentarité.
2.2 Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs
L’AOMI [cf. Annexe 1] ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs est une
conséquence de l’athérosclérose. Elle se traduit par une chute de l’index de pression
systolique (IPS) qui est le rapport entre la pression systolique à la cheville et la pression
systolique humérale (IPS<0,90). La plaque athéromateuse entraine une diminution du flux
sanguin. Dans les premiers temps, la maladie est asymptomatique (stade I de Leriche et
Fontaine). Avec l’évolution de la maladie, des douleurs musculaires à type de crampe vont se
produire et sont en rapport avec une diminution du débit artériel lors d’un effort (stade II ou
stade d’ischémie d’effort). A ce stade, la douleur disparaît à l’arrêt de l’exercice mais revient
dès la reprise de l’activité physique. Ce symptôme est appelé claudication intermittente. Au
stade III, les douleurs sont présentes au repos, et au stade IV lorsque le débit sanguin est
minime les souffrances tissulaires deviennent permanentes, entraînant des douleurs du
décubitus et des troubles trophiques.
2.3 Traitements de l’AOMI
Les traitements de l’AOMI ont pour but de diminuer l’évolution de la pathologie. Ils sont à la
fois médicaux, endovasculaires, chirurgicaux et une éducation à une meilleure hygiène de vie.
Les traitements médicaux comprennent les antiagrégants plaquettaires qui préviennent la
formation du thrombus, la statine qui est un hypolipidémiant utilisé pour baisser la
cholestérolémie. Enfin les inhibiteurs de l’enzyme de conversion inhibent l’enzyme de
conversion de l’angiotensine ce qui se traduit par une diminution du tonus vasculaire et de la
pression artérielle.
Parmi les traitements endovasculaires on retrouve les
angioplasties qui consistent à introduire et à gonfler un
petit ballonnet à l’endroit de la sténose. Celui-ci est
ensuite retiré de l’artère. C’est pourquoi ce geste est
souvent complété par la pose d’un Stent™ afin de
permettre l’ouverture parfaite de l’artère lorsque
l’angioplastie n’a pas été suffisamment efficace. Ces
Figure 2: Traitement endovasculaire par
angioplastie et pose de Stent
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
1
/
32
100%