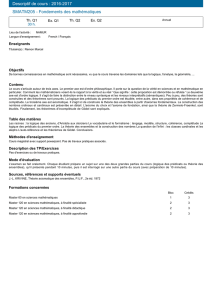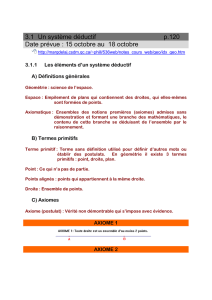Chapitre 1 La science - Free Sciences Site sur les mathématiques

FreeSciences
Christophe Roland
26 février 2017

Table des matières
1 La science 7
1.1 Qu’est ce que la science ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 Introduction .............................. 7
1.1.2 La science : l’aspect «ensemble de connaissances» . . . . . . . . . . 8
1.1.3 La science : aspect «ensemble de méthodes» . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 La notion de théorie scientifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1 Introduction .............................. 9
1.2.2 Remarque sur le terme «scientifique» . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 L’inductivisme ................................. 11
1.3.1 Idéegénérale .............................. 11
1.3.2 Critique de l’inductivisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 Leréfutationnisme ............................... 13
1.4.1 Introduction : critique de l’inductivisme . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4.2 Laréfutabilité ............................. 14
1.4.3 Le critère de démarcation vue comme une définition . . . . . . . . 14
1.4.4 Notion de confiance dans une théorie . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4.5 Exemple : théories freudiennes et relativité . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.6 Exemple : la théorie de l’atome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 Lerasoird’Occam ............................... 16
1.5.1 Énoncé ................................. 16
1.5.2 Exemple célèbre : l’éther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6 La notion de «science exacte» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.6.1 Définition................................ 17
1.6.2 Scienceexacte?............................. 17
1.6.3 Leproblème............................... 17
1.7 La mathématisation des sciences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.7.1 L’attrait pour la rigueur mathématique . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 Logique 19
2.1 Qu’est ce que la logique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.1 Définition................................ 19
2.1.2 La notion de vérité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1.3 Le paradoxe du menteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1

2.2 Notion naïve d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.1 Introduction .............................. 21
2.2.2 Concepts et notations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Lelangageformel................................ 21
2.3.1 Langage formel et langage naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.2 Définir la notion de langage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3.3 Construisons un exemple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Introduction au calcul des propositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4.1 Introduction .............................. 23
2.4.2 Connecteurs logiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.3 Langages propositionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4.4 Valuation ................................ 28
2.5 Tautologies ................................... 29
2.5.1 Définition................................ 29
2.5.2 Tautologies remarquables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.6 Calculdesprédicats .............................. 31
2.6.1 Motivations............................... 31
2.6.2 Quantificateurs existentiels et universels . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.3 Alphabet et syntaxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.6.4 Énoncés des langages prédicatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.7 Introduction à la théorie des modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.7.1 Motivations............................... 34
2.7.2 Notiondemodèle............................ 35
3 Théorie des ensembles 38
3.1 Une branche fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.1 Introduction - paradoxe de Galilée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.2 La crise des fondements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.1.3 Quelques remarques sur les axiomes ZFC . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2 Axiome d’extensionnalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.2 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.3 Écritureformelle............................ 40
3.3 Axiomedelaréunion.............................. 41
3.3.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.2 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3.3 Écritureformelle............................ 41
3.4 Axiome de l’ensemble des parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4.2 Notion de sous-ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4.3 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.4.4 Écritureformelle............................ 44
3.5 Schéma d’axiomes de remplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2

3.5.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5.2 Les relations fonctionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5.3 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.5.4 Écritureformelle............................ 45
3.5.5 Conséquences.............................. 46
3.6 Axiomedel’infini................................ 48
3.6.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6.2 Union de deux ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6.3 Ensemble ayant un élément quelconque . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6.4 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.6.5 Écritureformelle............................ 49
3.6.6 Conséquences.............................. 49
3.7 Axiomedefondation.............................. 49
3.7.1 Idée générale de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.7.2 Intersection............................... 50
3.7.3 Énoncé de l’axiome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.7.4 Écritureformelle............................ 50
3.8 Éléments, sous-ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.8.1 Élément d’un ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.8.2 Inclusion ................................ 50
3.8.3 Propriétés................................ 51
3.9 Définirunensemble .............................. 51
3.9.1 Définition en extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.9.2 Définition en compréhension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.10Unionetintersection.............................. 52
3.10.1Union .................................. 52
3.10.2Intersection............................... 53
3.10.3Distributivité.............................. 53
3.11Relationsbinaires................................ 54
3.11.1Notiondecouple............................ 54
3.11.2 Produit cartésien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.11.3 Relations binaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.12 Différents types de relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.12.1Fonction................................. 56
3.12.2Application............................... 56
3.12.3Injection................................. 56
3.12.4Surjection................................ 56
3.12.5Bijection ................................ 56
3.12.6 Loi de composition interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3

4 Nombres 58
4.1 L’ensemble des naturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4.1.1 Introduction .............................. 58
4.1.2 Définir l’ensemble des naturels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.3 Notion de successeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.2 Relationd’ordre ................................ 60
4.2.1 Définition................................ 60
4.2.2 Ordre totale et partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3 Principe de récurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.1 Idée générale du principe de récurrence . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.2 Écriture formelle du principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.3 Démonstration ............................. 62
4.4 L’addition.................................... 62
4.4.1 Définition................................ 62
4.5 Lamultiplication................................ 64
4.5.1 Définition................................ 64
5 Algèbre linéaire 66
5.1 Espacesvectoriels................................ 66
5.1.1 Notion intuitive de vecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.1.2 Définition................................ 69
5.2 Bases et dimension d’un espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.1 Combinaisons linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5.2.2 Sous-espace vectoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.2.3 Base................................... 72
5.3 Produit scalaire et espace dual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.3.1 Introduction .............................. 74
5.3.2 Définition................................ 75
5.3.3 Espacedual............................... 76
6 Trigonométrie 79
6.1 Introduction................................... 79
6.1.1 Lesinusd’unangle........................... 79
6.1.2 Introduction au concept de radian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.2 Fonctions trigonométriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.2.1 Fonctionsinus ............................. 81
6.2.2 Fonctioncosinus ............................ 83
6.2.3 Fonction tangente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7 Analyse 86
7.1 Introduction................................... 86
7.1.1 Les paradoxes de Zénon d’Elée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.1.2 Qu’est ce que l’analyse ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.2 Intervalles dans l’ensemble des réels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
1
/
143
100%