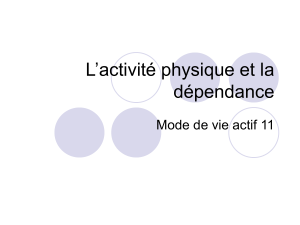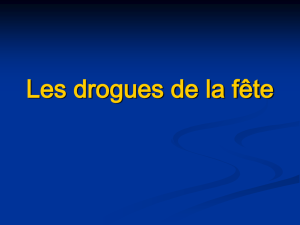Thèse finale - Stockage UP edel Nuxeo

Université de POITIERS
Faculté de Médecine et de Pharmacie
2014 Thèse n°
THESE
POUR LE DIPLOME D’ETAT
DE DOCTEUR EN PHARMACIE
(arrêté du 17 juillet 1987)
présentée et soutenue publiquement
le 11 juillet 2014 à POITIERS
par Monsieur GAILLARDON Vincent
né le 25 septembre 1987 à Royan
Intoxications aux drogues:
enquête aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers
Composition du jury :
Président : Monsieur le Professeur FAUCONNEAU Bernard
Membres : Madame PAIN Stéphanie, Maître de conférences (toxicologie)
Monsieur RICHARD Ghislain, Praticien hospitalier, Service
Urgences-SAMU-SMUR du CHU de Poitiers
Directeur de thèse : Madame PAIN Stéphanie


Université de POITIERS
Faculté de Médecine et de Pharmacie
2014 Thèse n°
THESE
POUR LE DIPLOME D’ETAT
DE DOCTEUR EN PHARMACIE
(arrêté du 17 juillet 1987)
présentée et soutenue publiquement
le 11 juillet 2014 à POITIERS
par Monsieur GAILLARDON Vincent
né le 25 septembre 1987 à Royan
Intoxications aux drogues:
enquête aux urgences du centre hospitalier universitaire de Poitiers
Composition du jury :
Président : Monsieur le Professeur FAUCONNEAU Bernard
Membres : Madame PAIN Stéphanie, Maître de conférences (toxicologie)
Monsieur RICHARD Ghislain, Praticien hospitalier, Service
Urgences-SAMU-SMUR du CHU de Poitiers
Directeur de thèse : Madame PAIN Stéphanie

U
U
N
NI
IV
VE
ER
RS
SI
IT
TE
E
D
DE
E
P
P
O
OI
IT
TI
IE
ER
RS
S
Faculté de Médecine et de Pharmacie
Année universitaire 2013-2014
PHARMACIE
Professeurs
COUET William, Pharmacie Clinique
FAUCONNEAU Bernard, Toxicologie
IMBERT Christine, Parasitologie
GUILLARD Jérôme, Pharmaco chimie
JOUANNETAUD Marie-Paule, Chimie
Thérapeutique
LEVESQUE Joël, Pharmacognosie
MARCHAND Sandrine, Pharmacocinétique
OLIVIER Jean Christophe, Galénique
PAGE Guylène, Biologie Cellulaire
RABOUAN Sylvie, Chimie Physique, Chimie
Analytique
SARROUILHE Denis, Physiologie
SEGUIN François, Biophysique, Biomathématiques
Maîtres de Conférences
BARRA Anne, Immunologie-Hématologie
BARRIER Laurence, Biochimie
BODET Charles, Bactériologie
BON Delphine, Biophysique
BRILLAULT Julien, Pharmacologie
CHARVET Caroline, Physiologie
DEJEAN Catherine, Pharmacologie
DEBORDE Marie, Sciences Physico-Chimiques
DELAGE Jacques, Biomathématiques, Biophysique
DUPUIS Antoine, Pharmacie Clinique
FAVOT Laure, Biologie Cellulaire et Moléculaire
GIRARDOT Marion, Pharmacognosie, Botanique,
Biodiversité végétale
GREGOIRE Nicolas, Pharmacologie
GREGOIRE Nicolas, Pharmacologie
HUSSAIN Didja, Pharmacie Galénique
INGRAND Sabrina, Toxicologie
MARIVINGT-MOUNIR Cécile, Pharmaco
chimie
PAIN Stéphanie, Toxicologie
RAGOT Stéphanie, Santé Publique
RIOUX BILAN Agnès, Biochimie
TEWES Frédéric, Chimie et Pharmaco chimie
THEVENOT Sarah, Hygiène et Santé publique
THOREAU Vincent, Biologie Cellulaire
WAHL Anne, Chimie Analytique
PAST - Maître de Conférences Associé
DELOFFRE Clément, Pharmacien
HOUNKANLIN Lydwin, Pharmacien
Professeur 2
nd
degré
DEBAIL Didier
Maître de Langue - Anglais
LIL WALL Amy

REMERCIEMENTS
A Monsieur le professeur Fauconneau Bernard (Toxicologie),
Pour l’honneur que vous me faites en présidant cette thèse.
A Madame Pain Stéphanie, Maître de Conférences (Toxicologie),
Pour avoir accepté de diriger ce travail,
Pour votre soutien et votre aide qui m’ont permis de mener à bien ce projet.
A Monsieur Richard Ghislain, médecin aux urgences du CHU de Poitiers,
Pour l’honneur que vous me faites en acceptant de juger cette thèse.
A ma famille, tout particulièrement à toi, maman,
Pour avoir toujours cru en moi,
Pour votre écoute, votre soutien et la force que vous m’avez transmise pendant mes études.
A l’ensemble de mes amies,
Pour les six années inoubliables passées à vos côtés.
A l’ensemble du service des urgences du CHU de Poitiers,
Pour m’avoir permis de réaliser mon enquête.
A Madame Brousse Pharmacie des Trois Cités,
Madame Aubertot Pharmacie de Marennes,
Madame Coïc Pharmacie de la Tremblade,
Pour votre gentillesse, votre confiance et votre écoute,
Pour tout ce que j’ai appris à vos côtés.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
1
/
106
100%