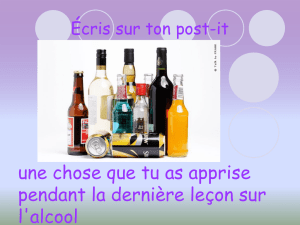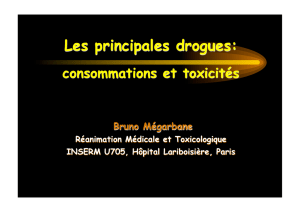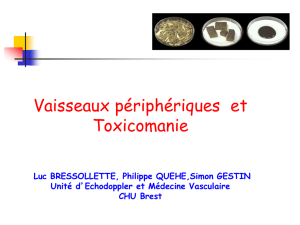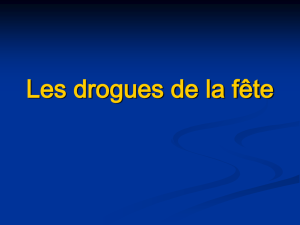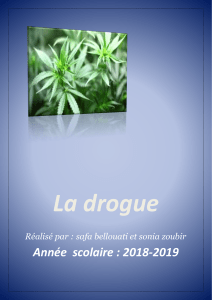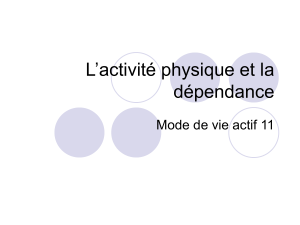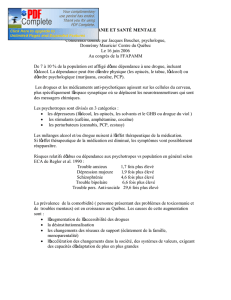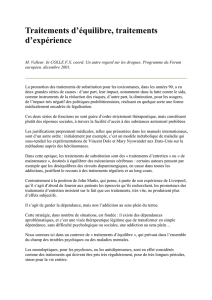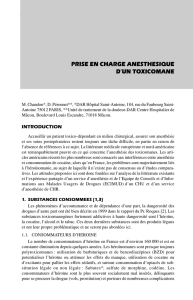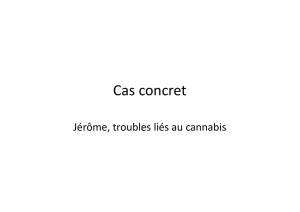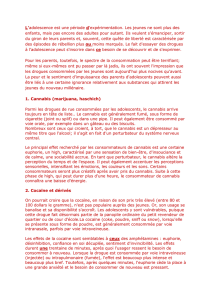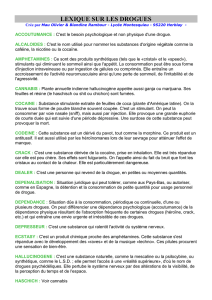Drogue: «Passons du jugement moral au jugement clinique

Texte: Quan Ly
Photos: Sedrik Nemeth
L’analyse en quatre points
Le 30 novembre, on votera sur deux objets différents
mais liés aux drogues: la révision de la loi sur les
stupéfiants et la dépénalisation du cannabis pour
les adultes. L’éclairage du professeur Jacques Besson,
53 ans, addictologue, chef du service de psychiatrie
communautaire du CHUV et fondateur du centre
spécialisé de Saint-Martin, à Lausanne.
Drogue: «Passons
du jugement moral
au jugement clinique»
Que va changer la révision
de la loi sur les stupéfiants?
«Elle offrira les bases légales pour poursuivre
un travail qui se fait depuis plus de dix ans»
Pouvez-vous rappeler ce qu’est
la politique des quatre piliers?
La prévention, la thérapie, l’aide à la
survie et la répression. C’est un plan
national de santé publique lancé
dans les années 90 pour sauver les
toxicomanes des scènes ouvertes.
Ce modèle de lutte contre la drogue
a valu à la Suisse son statut de pion-
nier au niveau international.
Quel est le pourcentage de toxi-
comanes concernés?
En Suisse, il y a 0,5% de la popula-
tion qui est injecteur de drogues,
dont l’héroïne. Grâce aux quatre
piliers, on estime que les deux tiers
ont pu accéder aux dispositifs de
soin. Dans le canton de Vaud, sur
les 3000 toxicomanes dénom-
brés, 2000 sont ainsi soi-
gnés: les trois quarts ont
recours à la substitution
à la méthadone, quel-
ques-uns sont en
sevrage dans
une unité spécialisée, d’autres béné-
ficient de séjours dans des institu-
tions à visée d’abstinence et le reste
est, malheureusement, dans la rue.
A Genève, on prescrit aussi de
l’héroïne dans une cinquantaine de
cas. Le bilan est positif: un tiers des
patients évoluent favorablement, un
autre tiers font des rechutes et le
reste nécessite un traitement à long
terme. Il faut passer du jugement
moral au jugement clinique.
Qu’est-ce que cela va changer si
la révision de la loi passe?
Il s’agit de donner toutes les bases
légales pour continuer le travail fait
depuis plus de dix ans. Si la loi passe,
c’est le statu quo: on ne fait que
confirmer le dispositif existant.
Dans le cas contraire, on reviendrait
à l’ancienne loi de 1975, alors que
la situation en matière de drogues
a évolué. La nouvelle loi, c’est une
vision globale centrée plus sur les
patients que les substances consom-
mées, qui changent tout le temps:
on garde à terme un objectif d’abs-
tinence, mais on prend d’abord les
gens tels qu’ils sont, on détermine
leurs besoins de santé et on les
accompagne en leur offrant une
palette de traitements. C’est une
action interdisciplinaire
entre le policier, l’addicto-
logue, l’éducateur, l’infir-
mier pour réinsérer à
terme le patient dans la
société.
L’autre objet de la votation est
une initiative en faveur de la
dépénalisation du cannabis
pour les adultes. Pourquoi
divise-t-elle autant les Suis-
ses?
La majorité des associations
travaillant dans le domaine des
addictions défend cette dépé-
nalisation et estiment qu’il ne
faut pas criminaliser les per-
sonnes qui cultivent, possèdent
ou consomment du cannabis.
Il faudra faire de la prévention
auprès de la jeunesse et on
espère qu’elle n’ira plus auprès
des dealers pour s’approvision-
ner. Mais il y a au sein même
de ces associations une mino-
rité qui s’y oppose car, à leurs
yeux, dépénaliser, c’est prendre
le risque de banaliser la consom-
mation. Ce qui, d’un point de
vue éducatif, n’est pas une
bonne idée. Enfin, tous ceux
qui n’osaient pas franchir le pas
le feront et la consommation
moyenne s’amplifiera inévitable-
ment. Les spécialistes de la schi-
zophrénie pensent que le nombre
de cas de psychoses augmentera
d’autant. Le problème est qu’il y a
des arguments scientifiques qui
se valent des deux côtés. Les méde-
cins de santé publique voteront
plutôt oui et les psychiatres de
santé mentale plutôt non.
Cette dépénalisation peut-elle
s’accompagner d’une protection
efficace de la jeunesse contre
les risques de consommation?
C’est bien de protéger les gens
au-dessus de 18 ans, mais on fait
quoi pour ceux qui sont au-des-
sous? Or, la plupart des problèmes
liés au cannabis arrivent large-
ment avant 18 ans. L’initiative ne
dit rien des jeunes, et c’est là que
ça se passe. C’est un argument de
plus pour les opposants. Quoi qu’il
en soit, le principe de précaution
est de faire en sorte que les jeunes
aient le moins possible accès à ce
produit dont on ne sait pas tout.
Ne doit-on pas opter
plutôt pour le sevrage?
«En cas de rechute, c’est
l’overdose immédiate»
Ne préserve-t-on pas l’ordre public
au détriment de la répression?
La police fait de gros efforts pour
définir les priorités. Une pression
est maintenue sur le grand trafic.
On ne tolère plus la consommation
de rue et le trafic visible. Le problème
est qu’il n’y a pas que l’héroïne dans
le champ des drogues illégales. Il y
a, depuis les années 2000, une épi-
démie de cocaïne qui perturbe beau-
coup les services d’addictologie. De
plus, la grande majorité des patients
sont des polytoxicomanes: une per-
sonne dépendante de l’héroïne peut
par exemple abuser de la cocaïne en
fin de semaine, avec usage excessif
d’alcool, le tout sur fond de cannabis.
Et, si elle a des angoisses, elle va
s’intoxiquer avec des tranquillisants
obtenus sur le marché noir. Or, il a
été démontré en Suisse alémanique
que la prescription médicale d’hé-
roïne a permis de diminuer la
consommation des autres substan-
ces. Au début, les injections d’hé-
roïne se faisant trois fois par jour, ils
ont un contact permanent avec des
professionnels. On amène l’héroïne
de la scène illégale à la scène de la
santé; cela a contribué à diminuer
la criminalité.
Le sevrage en vue de l’abstinence
est-il une mauvaise méthode?
Il y a un risque vital: la personne qui
fait un sevrage perd l’habitude de la
drogue; mais, si elle fait une rechute,
même modeste, et reprend la même
dose qu’avant le sevrage, c’est l’over-
dose immédiate. L’addiction est une
maladie chronique du cerveau et
cela prend du temps à traiter. A cela
s’ajoutent des problèmes de santé,
familiaux, de motivation. La philo-
sophie des addictologues est donc
plutôt la substitution, des objectifs
de rétablissement physique et men-
tal du patient, et son accompagne-
ment sur le long terme sans lui faire
courir trop de risques. Cela prend
bien sûr des années.
Pourquoi tant de bruit
autour du cannabis?
«Le problème, c’est la
protection des mineurs»
500 morts en 1990 chez les toxicomanes en
Suisse, 153 en 2007. Pourquoi une telle baisse?
«Tous les pays qui offrent des produits de
substitution o nt vu les décès diminuer»
En 1990, près de 500 personnes
mouraient chaque année à cause
de la drogue. En 2007, ce nombre
tombait à 153. Est-ce parce que
les toxicomanes sont plus pru-
dents?
Difficile à dire. Mais on a de bon-
nes raisons de penser qu’en
offrant des produits de substitu-
tion, de la méthadone dans plus
de 90% des cas, cela permet à des
gens en manque de prévenir les
overdoses. Tous les pays qui
offrent de la substitution de
manière organisée, avec le pro-
cessus d’accompagnement et de
réhabilitation psychosociale, ont
vu diminuer leur nombre d’over-
doses. Cela dit, toutes ne sont pas
liées à l’héroïne: on peut avoir des
overdoses à la cocaïne (hémorra-
gie cérébrale, arrêt du cœur, etc.),
à l’alcool (coma éthylique), ou des
overdoses dues à des mélanges
(drogues, médicaments et alcool).
3
4
2
1
L’expert
Jacques Besson insiste
sur le fait que «l’addiction
est une maladie; le
patient, qui a perdu sa
volonté, a besoin d’un
traitement à long terme».
Les cas d’overdoses ne disparaî-
tront jamais totalement.
Ces chiffres incluent-ils les victi-
mes du VIH, lié à l’utilisation de
seringues contaminées?
Ce sont des chiffres donnés par la
police lorsqu’elle trouve une per-
sonne morte avec des substances
dans son corps. Là, on ne parle que
de morts par overdose. Les gens
qui meurent du sida dans un lit
d’hôpital n’ont rien à voir avec ces
chiffres.
Le nombre de morts a certes
baissé, mais il n’en reste pas
moins qu’il y a, comme vous le
dites, d’autres drogues telles que
la cocaïne. N’est-ce pas un succès
relatif?
Effectivement, nous avons obtenu
des succès sur le champ de l’hé-
roïne. Paradoxalement, cela a créé
une offre pour d’autres produits
illégaux comme la cocaïne, pour
laquelle nous rencontrons des dif-
ficultés car nous ne disposons pas
de produit de substitution. Dans
toute société moderne où il y a des
comportements addictifs, il n’est
pas impensable que les mafias et
les dealers s’organisent pour conti-
nuer à faire des bénéfices avec
d’autres produits tels que la
cocaïne, qui touche 3 à 5% de la
population. Les besoins des toxi-
comanes sont donc très variés.
Mais, avec la politique des quatre
piliers, nous sommes en mesure
de proposer une offre diversifiée
qui nous permet de faire face à ce
problème de cocaïne. Et nous com-
mençons à avoir des résultats avec
les traitements motivationnels per-
mettant aux cocaïnomanes de
gérer leur anxiété, leur dépression.
Du coup, on voit revenir de l’hé-
roïne… Les marchés des drogues
illégales s’adaptent.
C M Y K
36 L’ILLUSTRÉ 47/08
C M Y K
L’ILLUSTRÉ 47/08 37
1
/
1
100%