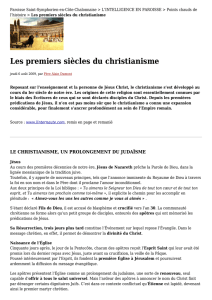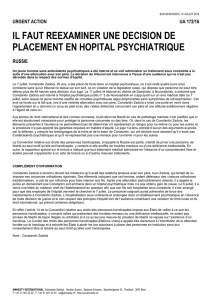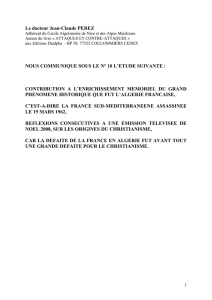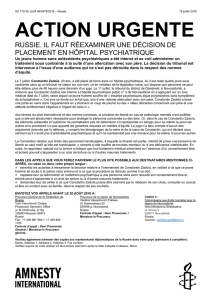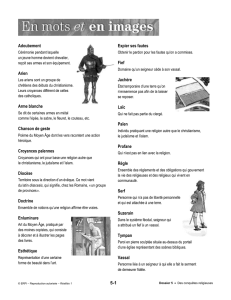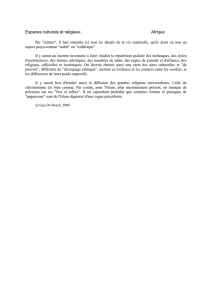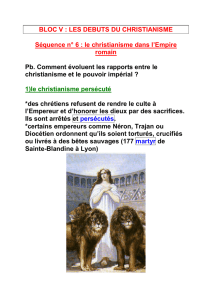PDF sample - Dimensione Agricoltura



Table des Matières
Page de Titre
Table des Matières
Page de Copyright
Dédicace
I - Le sauveur de l’humanité : Constantin
BANALITÉ DE L'EXCEPTIONNEL
BREF RÉSUMÉ DES FAITS
RÉSUMÉ DE SON ACTION
UNE TOLÉRANCE INSINUANTE
II - Un chef-d’œuvre : le christianisme
PASSION MUTUELLE, HAUTE DESTINATION
UN MOT TROMPEUR : LE MONOTHÉISME
AMOUR, CHARISME DU SEIGNEUR, MORALISME
LA RELIGION EST UNE QUALITÉ IRRÉDUCTIBLE
UN BEST-SELLER INNOVATEUR
FAISAIT-IL AUSSI PALPITER LE CŒUR ?>
III - Autre chef-d’œuvre : l’Église
VÉRITÉ EXPRESSE ET PROFESSION DE FOI
UN ORGANISME COMPLET, UNE ÉGLISE PROSÉLYTE
RELIGION RÉPANDUE DANS TOUTE LA SOCIÉTÉ
SECTE POUR VIRTUOSES OU RELIGION POUR TOUS ?>
IV - Le rêve du Pont Milvius, la foi de Constantin, sa conversion
LA SUBLIME MISSION DE CONSTANTIN
UN RÊVE BANAL, UN CONVERTI QUI NOUS SEMBLE PARADOXAL
V - Petits et grands mobiles de la conversion de Constantin
« BOÎTE NOIRE » DE LA CONVERSION
LE PETIT BOUT DE LA LORGNETTE
BONNE FOI DE CONSTANTIN

CALCUL SUPERSTITIEUX OU NORMALITÉ DE LA RELIGION ?>
BÉNÉFICES SECONDAIRES
VI - Constantin « président » de l’Église
DES DÉBUTS ÉQUIVOQUES
UN MAÎTRE ÉQUIVOQUE
ÉTABLIR L’ÉGLISE
CHEF CHRÉTIEN ET EMPEREUR ROMAIN
VII - Un siècle double : l’Empire païen et chrétien
UN SIÈCLE BIEN ROMAIN, VOIRE PAÏEN
PAS DE TOTALITARISME
TOUJOURS LE DIMANCHE
CONVERTIR LES PAÏENS OU ABOLIR LEURS CULTES ?
VIII - Le christianisme vacille, puis triomphe
LA PARENTHÈSE CHRÉTIENNE VA-T-ELLE SE REFERMER ?>
APRÈS LE PONT MILVIUS, LA RIVIÈRE FROIDE
IX - Une religion d’État partielle et mêlée. Le sort des Juifs
DIFFUSION OU RÉCEPTION ? LA NOUVELLE FOI DES HUMBLES
LE SENS RELIGIEUX EST MAJORITAIRE
MAIS LA RELIGION N’EST PAS HOMOGÈNE
LE CHRISTIANISME N’OCCUPE QU’UNE PARTIE DU TERRAIN
HÉRÉTIQUES ET JUIFS : NAISSANCE DE L'ANTISÉMITISME
LE RÉVOLUTIONNAIRE ET LA ROUTINISATION
X - L'idéologie existe-t-elle ?
L'IDÉOLOGIE N’EST PAS À LA RACINE DE L'OBÉISSANCE
UN UTILITARISME UN PEU COURT
LES ENFANTS ET LES GRANDES PERSONNES
PRAGMATIQUE, ET NON IDÉOLOGIE
UN PRÉJUGÉ : DIEU ET CÉSAR
XI - L'Europe a-t-elle des racines chrétiennes ?
EXISTE-T-IL DES RACINES DANS L'HISTOIRE ?
INDIVIDUALISME ET UNIVERSALISME ?

RELIGION ET PROGRAMME POLITIQUE FONT DEUX
SOMMES-NOUS DONC ENCORE CHRÉTIENS ?
LA PART DE VÉRITÉ : LA PRÉPARATION D’UN TERRAIN
RACINES OU ÉPIGÉNÈSE
Appendice
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%