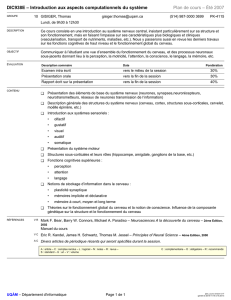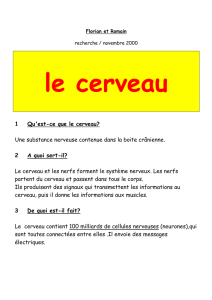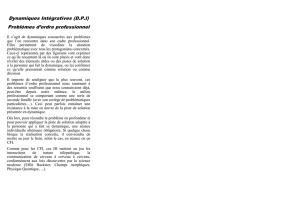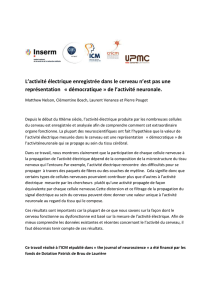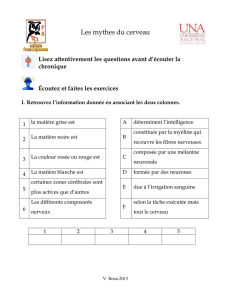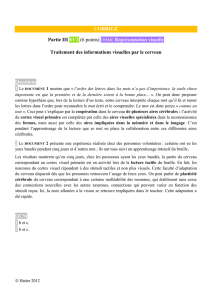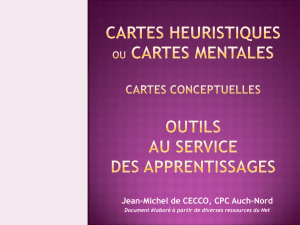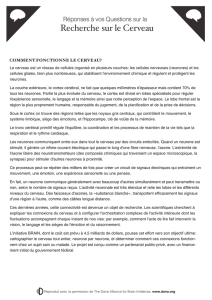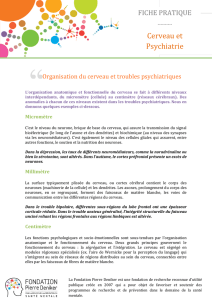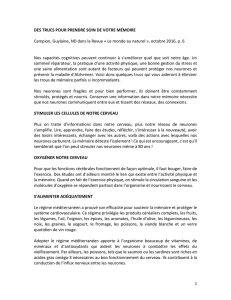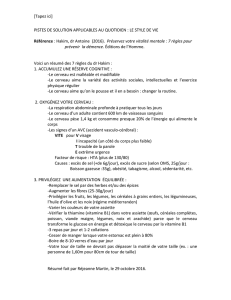l`intelligence - Mark Changizi

26 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 27
La taille et l’organisation du cerveau humain sont le fruit
d’une longue évolution guidée par le besoin de maximiser
les capacités cognitives d’une part et de minimiser le
coût énergétique d’autre part. Certains pensent que
notre intelligence aurait ainsi atteint une limite. D’autres
estiment que des voies alternatives sont imaginables.
Une énorme tête sur un corps tout menu.
C’est ainsi que sont le plus souvent
représentés les extraterrestres dans les
œuvres de science-fiction. Selon la
croyance générale la taille du cerveau
serait en effet proportionnelle aux capacités intel-
lectuelles. La réalité est plus complexe. Le cerveau
masculin est ainsi en moyenne plus volumineux de
10 % que celui de la femme. Une légère différence
exploitée au siècle dernier pour soutenir l’idée que
le « second sexe » était doté de moins de capacités
intellectuelles que le « premier »… Un argument
heureusement passé de mode et invalidé. « On pense
aujourd’hui que cette différence s’expliquerait par la
taille plus petite des femmes. Elles auraient le même
nombre de neurones que les hommes, mais plus
densément groupés », précise Jon Kaas, professeur
de psychologie et de biologie du développement à
l’Université de Vanderbilt. Au sein du règne animal,
malgré le plus grand encéphale terrestre, la baleine
n’est pas aussi intelligente que l’on pourrait imaginer.
De même, le chat aurait les mêmes aptitudes que le
lion malgré un cerveau trois fois plus petit. Enfin les
insectes possèdent une gamme de comportements
l’intelligence
l imit e s
Je pense
que le cerveau
est proche d’avoir
atteint une limite
évolutive, car plus
grand il serait
moins efficace
JON KAAS est professeur
de psychologie et de
biologie du développement
à l’Université de
Vanderbilt (États-Unis).
deLes
Découvertes
fondamentales
PAR SABINE CASALONGA

Cro-Magnon avait un cerveau
plus gros !
L’homme de Cro-Magnon, il y a environ
25.000 ans, avait un cerveau plus grand d’envi-
ron 15 % que celui de l’homme moderne, selon
la découverte récente d’une équipe française.
« Notre cerveau serait également plus court que
celui de nos ancêtres Homo Sapiens ce qui impli-
querait que certaines zones se sont rapprochées.
Cela ne signifie toutefois pas que l’homme soit
plus intelligent aujourd’hui » explique Antoine
Balzeau, chercheur au CNRS et au département
de la Préhistoire au MNHN. Mais cela prouve
que nous avons hypothétiquement la possibilité
d’un crâne plus gros.
LARS CHITTKA,
est professeur
d’écologie
comportementale
et sensorielle
au Queen Mary
College de Londres
(Royaume-Uni).
SIMON LAUGLIN
est professeur
de neurobiologie
à l’Université
de Cambridge
(Royaume-Uni).
ALEX FORNITO
est chercheur en
neurosciences
à l’Université
de Melbourne
(Australie).
ANTOINE BALZEAU est
chercheur au CNRS et
au département de la
Préhistoire du Muséum
d’Histoire Naturelle à Paris.
28 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 29
différences entre individus peuvent être expliquées
par des facteurs génétiques, les 40 % restantes étant
liés à des facteurs environnementaux, explique le
scientifique. Certaines régions, en particulier dans
le cortex préfrontal, une zone clé pour la prise de
décision, la mémoire, l’attention et la planification,
étaient à 80 % sous l’influence génétique ». En clair,
cela signifie que les cerveaux organisés d’une façon
« plus rentable » ont été sélectionnés au cours de
l’évolution.
Pour maximiser son efficacité sans dépenser
trop d’énergie, les cerveaux des mammifères, et ce-
lui de l’homme en particulier, se sont organisés en
zones spécialisées semi-autonomes. Au cœur de ces
régions les liaisons entre neurones sont nombreuses
et courtes, chaque cellule étant reliée à environ un
tiers du nombre total, pour un traitement rapide et
efficace de l’information.
plus petits ce qui risquerait d’affaiblir la qualité de la
communication. « À l’instar des puces électroniques
miniaturisées qui, bien que plus rapides, génèrent
plus de bruit et de chaleur, explique Simon profes-
seur de neurobiologie à l’Université de Cambridge,
lorsque les neurones sont plus petits ils deviennent
plus bruyants et donc moins fiables ».
UNE EFFICACITÉ CÉRÉBRALE HÉRÉDITAIRE.
D’un côté le cerveau tend à créer plus de connexions
pour accroître son efficacité et de l’autre à réduire leur
nombre afin de minimiser sa consommation d’éner-
gie. La nécessité d’équilibrer ces deux contraintes
aurait opéré comme une pression sélective au cours
de l’évolution. L’équipe d’Alex Fornito chercheur en
neurosciences à l’Université de Melbourne a démon-
tré le caractère héréditaire du rapport coût-effica-
cité du réseau de connexions neuronales. « 60 % des
MAX
Le cerveau de l’homme moderne
serait proche d’une limite évolutive.
Augmenter ses capacités cognitives
coûterait « trop cher » en énergie.
Découvertes
fondamentales
très étendue en dépit d’une cervelle lilliputienne.
« Les abeilles ont des capacités cognitives bien plus
développées que ce que l’on pensait jusqu’à présent,
indique ainsi Lars Chittka, professeur d’écologie
comportementale et sensorielle au Queen Mary
College de Londres. La taille du cerveau ne serait
donc pas suffisante pour déterminer l’intelligence
d’une espèce.
UN CERVEAU PLUS DENSE EN NEURONES.
Tout dépend bien sûr de la définition de l’intel-
ligence choisie. Et la question reste complexe et
controversée. Il est généralement admis que les pri-
mates – grands singes et hommes en tête- les cétacés
et les dauphins sont dotés des plus grandes capacités
mentales et comportementales. Chez les vertébrés, et
les mammifères en particulier, la masse du cerveau
augmente de façon linéaire à celle du corps (voir le
graphique). Mais certaines espèces, comme l’homme,
le chimpanzé et le dauphin, situés au-dessus de la
diagonale, ont un cerveau plus grand qu’attendu. Le
cerveau humain a ainsi le plus grand quotient d’encé-
phalisation avec un cerveau 7 à 8 fois plus grand qu’un
Découvertes
fondamentales
mammifère de sa taille. Une autre caractéristique
associée à l’intelligence est le nombre élevé de neu-
rones dans le cortex lié à la capacité de mémorisation.
L’homme dépasse toutes les espèces avec environ
15.000 neurones corticaux (contre 11.000 chez l’élé-
phant d’Afrique dont le cerveau est trois fois plus
gros), mais aussi par un traitement de l’information
très rapide et un nombre élevé de zones spécialisées.
Le cerveau humain pourrait-il alors grossir
encore et multiplier ses neurones pour accroître ses
capacités intellectuelles ? Il semblerait que non en
raison de contraintes thermodynamiques et phy-
siques. « Je pense que le cerveau est proche d’avoir
atteint une limite évolutive, car plus grand il serait
moins efficace, indique Jon Kaas. Des chercheurs
ont estimé qu’en doublant la taille du cerveau on
augmenterait de seulement 10 % la puissance de
calcul avec un coût énergétique élevé ». Cela cor-
respond à la loi des rendements décroissants selon
laquelle un doublement de l’énergie de départ ne
résulte pas en une performance doublée. Or, il faut
rappeler que notre cerveau qui ne représente que
2 % de notre masse totale est l’organe qui consomme
le plus d’énergie (environ 20 %).
EFFICACITÉ VERSUS COÛT ÉNERGÉTIQUE.
L’évolution du cerveau aurait en effet été guidée par
la recherche d’un équilibre entre coût énergétique
minimal et efficacité maximale. Et la forme actuelle
semblerait être la plus optimale pour ce compromis.
Explications.
Un cerveau plus grand nécessiterait davan-
tage de longues connexions entre des régions plus
éloignées, ce qui impliquerait un coût énergétique
supplémentaire et une communication plus lente.
Les cerveaux plus grands que celui de l’homme
(éléphant, baleine) sont moins efficaces parce qu’-
en dépit d’un nombre similaire de neurones- la
vitesse de traitement de l’information est réduite à
cause d’une distance plus grande entre les neurones.
Une option pour accroître la vitesse de conductivité
consiste à épaissir l’enveloppe de myéline des fibres
d’axones, mais cela exige à nouveau une consom-
mation accrue d’énergie et d’espace. « Le cerveau
humain semble donc avoir atteint un équilibre entre
la maximisation du nombre de neurones d’une part
(bon pour la mémoire) et de la vitesse de traitement
d’autre part (bon pour l’intelligence) », explique
Gerhard Roth professeur à l’institut de recherche
sur le cerveau de l’Université de Brême (Allemagne).
À l’inverse, on pourrait imaginer que le cer-
veau rétrécisse tout en conservant la même densité
de neurones ce qui aurait l’avantage de réduire le
coût énergétique et d’accroître la vitesse de commu-
nication. Toutefois cela impliquerait des neurones
Les cerveaux
organisés d’une façon
« plus rentable » ont été
sélectionnés au cours de
l’évolution

MARK CHANGIZI,
est neurobiologiste
spécialiste de
l’évolution, directeur
du laboratoire de
cognition humaine 2AI.
30 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 31
Comparaison de différents
cerveaux de mammifères
(baleine dentée, homme,
chimpanzé, chien, lièvre,
musaraigne).
Le cerveau humain est-
il vraiment unique ?
Certains pensent qu’il
se distingue de celui
des autres espèces
par la présence
d’aires spécialisées,
par exemple pour
le langage, ou un
néocortex plus dense
en neurones qu’attendu.
D’autres estiment
que la différence est
seulement quantitative
puisque nous avons le
cerveau le plus grand
proportionnellement
à notre taille. Selon
moi, l’encéphale
humain n’a pas de
caractéristique unique,
il est grossièrement
identique à celui des
autres mammifères. Si
l’on parvient à expliquer
notre intelligence sans
recourir à des traits
humains « magiques »,
c’est l’hypothèse la plus
simple.
Comment expliquer
alors nos facultés
cognitives
« supérieures » ?
Dans mon dernier
ouvrage (1) j’explique
comment Homo sapiens
-le plus intelligent
des singes- a évolué
au stade de l’homme
moderne capable
d’utiliser le langage,
l’écriture et la musique
en conservant la même
anatomie cérébrale.
Dans mon précédent
ouvrage (2) j’avais déjà
développé l’idée selon
laquelle la culture a fait
évoluer l’écriture en
quelques millénaires
seulement, pour imiter
au plus près les formes
de la nature facilement
reconnaissables par
notre système visuel.
De la même façon, je
suggère que le langage
se serait inspiré des
sons naturels humains
et des objets, tandis
que la musique
mimerait des sons liés
à des comportements
humains et des
mouvements, auxquels
notre système auditif est
le plus adapté.
Ce qui expliquerait
notre intelligence est
la façon dont notre
cerveau a exploité ses
structures neuronales et
détourné leur fonction
originelle pour en créer
de nouvelles. Mais
en réalité le cerveau
continue d’effectuer des
tâches « anciennes »,
les tâches « modernes »
ayant seulement juste
pris l’apparence des
anciennes. Quand on
lit, ou quand on écoute
de la musique, notre
cerveau pense qu’il est
en train d’effectuer une
activité primitive, c’est
une ruse !
Harnessed : how
language and music
mimicked nature and
transformed apes to men ,
BenBella Books (2011)
Vision Revolution,
BenBella Books (2010)
Interview de Mark Changizi
Découvertes
fondamentales
Découvertes
fondamentales
POUR EN
SAVOIR PLUS
Changizi
M, Neuroscientist’s
Embarrassment :
Artificial Intelligence’s
Opportunity, Brain
Behaviour and
Evolution, 2010.
Lars Chittka and
Jeremy Niven, Are
Bigger Brains Better ?,
Current Biology, 2009.
Fornito A et al,
Genetic influences
on cost-efficient
organization of human
cortical functional
networks, Journal of
Neuroscience, 2011.
Roth G, Dicke U
Evolution of the brain
and intelligence Trends
in Cognitive Sciences,
2005.
Changizi M et
al, Parcellation and
area-area connectivity
as a function of
neocortex size,
Brain Behaviour and
Evolution, 2005.
Niven J Laughlin S et
al, Energy limitation as
a selective pressure on
the evolution of sensory
systems, Journal of
Experimental Biology,
2008.
Kaas J et al, Cellular
scaling rules for primate
brains, PNAS, 2007.
L’INTÉRÊT DES ZONES CÉRÉBRALES.
À l’échelle supérieure, chaque région est elle-
même reliée à environ un tiers du total des aires
cérébrales via des liaisons plus longues. « On aurait
pu imaginer que chaque neurone soit connecté à
une fraction constante de l’ensemble des neurones.
Mais cela nécessiterait tellement de gros neurones
et de synapses que le cerveau atteindrait la taille
d’une Volkswagen ! À la place le cerveau a favo-
risé la connectivité au sein de chaque zone céré-
brale et non plus du cerveau entier, » explique
Mark Changizi, neurobiologiste théorique, auteur
et directeur de la cognition humaine dans la so-
ciété 2AI.
L’accroissement de notre cerveau et nos capa-
cités cognitives seraient donc limités par l’accès
à l’énergie, c’est-à-dire à la nourriture. « À un
certain moment, atteindre de meilleures perfor-
mances grâce à un plus gros cerveau ne serait plus
suffisamment rentable par rapport à d’autres avan-
tages comme courir plus vite ou manger moins,
explique Simon Laughlin. Je ne pense cependant
pas que nous ayons atteint une limite physique qui
nous empêcherait de devenir plus intelligents ».
Mark Changizi considère également que
l’évolution n’a pas dit son dernier mot. « Rien ne
suggère que nous approchons une limite évolutive.
Il est possible toutefois que nous ayons atteint une
impasse liée à la voie d’évolution choisie, mais
il est toujours possible d’imaginer une structure
complètement différente. » Jon Kaas se demande
ainsi « pourquoi les mammifères n’ont pas hérité
de la capacité des insectes à utiliser chaque neu-
rone pour effectuer plusieurs tâches distinctes. »
La direction de l’évolution future est cepen-
dant difficile à prédire, car elle dépend de la sélec-
tion des gènes dans une population. « Est-ce que
les personnes intelligentes auront plus d’enfants ?
Ce n’est pas certain », signale Jon Kaas. « Fina-
lement, une manière plus aisée d’augmenter la
taille de notre cerveau consiste à externaliser
l’intelligence via le langage, l’écriture et l’usage
des ordinateurs comme cela s’est produit durant
l’histoire récente de l’humanité », estime quant à
lui Gerhard Roth.
Relation entre le poids du corps et le poids du cerveau chez 10 mammifères. La taille du cerveau
de l’homme, du chimpanzé et du marsouin dévie du ratio général représenté par la ligne bleue.
Poids du cerveau (g)
Poids du corps (kg)
Opossum
Rat
Taupe
Chauve-souris
Chimpanzé Gorille
Homme
Marsouin
Éléphant
Baleine bleue
10 000
1000
100
10
1
0,1
0,01
0,001
0,001 0,1 10 1000 100 000
1
/
3
100%