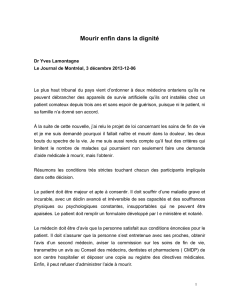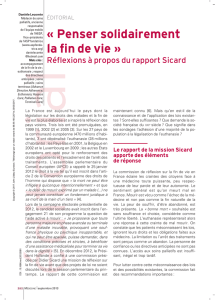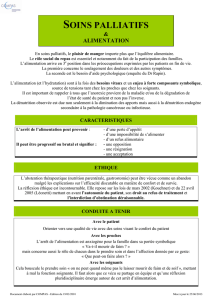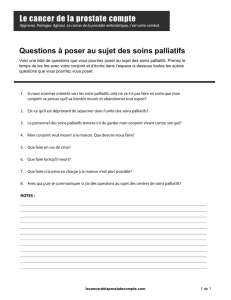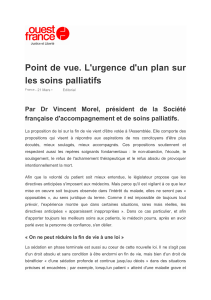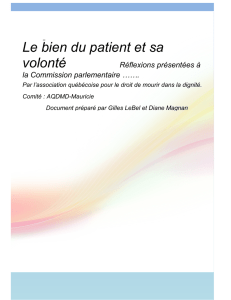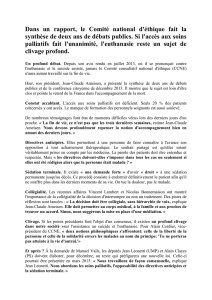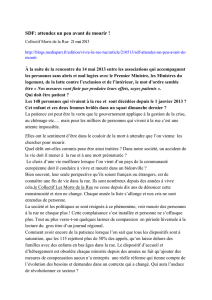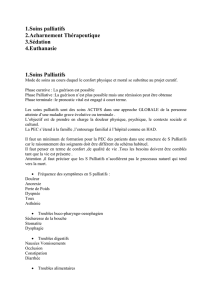mourir en France

LE CHOIX DE LA VIE
Nous sommes allés sur le terrain, dans les lieux
où l’on meurt en France: à l’hôpital, à domicile,
dans les services de néonatalogie, les maisons
de retraite… Là où le droit aux soins palliatifs
n’est pas toujours une réalité.
MOURIR
EN FRANCE
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR JOSÉPHINE BATAILLE
ZIR/SIGNATURES POUR LA VIE
LA VIE
30 OCTOBRE 2014 20
LA VIE
N
30 OCTOBRE 2014 21
020-29 LV 3609 CHOIX mourir -RC9-A-JQ.indd 20-21 21/11/14 09:53

N
C
’est à l’hôpital que 60% des Français ter-
minent leurs jours. Mais si la mort y sur-
vient, elle n’y a, sur les plans symbolique et
psychologique, pas droit de cité. «Dans la
chambre d’un mourant, on entre sur la pointe
des pieds, on n’ose plus s’attarder; tout le personnel est
en difficulté», témoigne un cadre de santé. En 2009,
l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) ren-
dait un rapport sans concession sur la mort à l’hôpi-
tal. Elle y affirmait: «Pour les acteurs hospitaliers, la
mort est vécue comme une incongruité, un échec, et à
ce titre largement occultée. Cette situation est préjudi-
ciable au confort des malades en fin de vie et à l’accueil
des proches ainsi qu’à la santé publique.» En 2012, le
professeur Didier Sicard (voir interview page 41),
ancien président du Comité consultatif national
d’éthique, dressait le même constat dans son rapport
de mission sur la fin de vie en France: «La culture
d’hyperspécialisation, qui rivalise de prouesses tech-
niques, ne supporte que difficilement l’arrêt des soins
et l’accompagnement simplement humain.»
LE SERVICE MINIMUM DES SOINS PALLIATIFS
De ces enquêtes, il ressort que les Français n’ont
aucune garantie de recevoir à l’hôpital de bons soins
de fin de vie. Pas de politique en la matière, pas de prise
en compte de la question pour les
certifications institutionnelles des
établissements, pas de savoir-faire
partagé. Sur ce plan, la promotion
des soins palliatifs s’est révélée ambi-
valente, car ils ont servi d’alibi. Et
de service minimum. «Le système
de tarification a tordu la réalité; cer-
tains soins sont codés comme pallia-
tifs pour être financés, mais rien ne
dit qu’ils ont été de qualité, et qu’ils
ont réellement été donnés. Et inversement, il y a des
patients qui reçoivent des soins adaptés à leur situation,
mais qui ne sont pas pour autant codés comme palliatifs»,
glisse la docteure Françoise Lalande, coauteure du
rapport. Le docteur Bernard Devalois, responsable
d’une unité de soins palliatifs à Pontoise, confirme:
«Le codage ne sert en rien à savoir ce que vivent les gens
en réalité. Tant qu’il n’y aura pas de volonté politique de
recueillir ces informations, on ne pourra pas dire si nos
plans de santé publique vont dans le bon sens ou pas.»
D’après ce qui est écrit dans les dossiers, tout au
moins, seuls 20% des mourants bénéficieraient de
soins palliatifs à l’hôpital ou en clinique. Et cela
concerne surtout les personnes atteintes de cancer.
«Il n’existe pas de culture palliative quand il s’agit de
personnes âgées, ou encore dans les cas d’accident vas-
culaires, note Didier Sicard. Les services cliniques vou-
draient bien écouter et prendre du temps avec les malades,
mais ils n’ont ni le temps, ni l’obligation de le faire.»
Dans les services médicaux qui accueillent des
patients en court séjour pour une maladie cardiaque,
respiratoire, rénale, etc., les conditions de la fin de
vie se révèlent donc très aléatoires, variables d’un
étage à l’autre. «Le problème, c’est que les soignants
disent qu’ils s’en occupent! En réalité, ils n’ont toujours
pas pris la mesure de tout ce qui est nécessaire à un
mourant et à sa famille. Les infirmiers s’en rendent
compte un peu plus que les médecins cependant. Mais
le problème de motivation et de sensibilisation est réel»,
commente Françoise Lalande.
DES CONDITIONS DE DÉCÈS INSATISFAISANTES
En 2008, l’étude Maho (pour «mort à l’hôpital»),
menée par le docteur Édouard Ferrand, de l’hôpital
de Suresnes, dans 200 hôpitaux français, révélait que
les infirmières jugeaient les conditions de décès insa-
tisfaisantes dans 59% des cas. En cause, la souffrance
physique, des gestes thérapeutiques inutilement
agressifs, la détresse respiratoire du patient… Mais
aussi la souffrance morale, la soli-
tude, l’absence des proches. «Cer-
tains soignants considèrent jusqu’au
bout les familles comme des gêneurs,
qui sont de trop dans un cadre tech-
nique, sans se rendre compte que la
problématique n’est plus la même à
partir du moment où le patient est
en train de mourir», a constaté
Françoise Lalande.
Idem pour la douleur. En dehors
des unités spécialisées de soins palliatifs, habituées à
mobiliser un arsenal complexe contre les douleurs
particulières liées au cancer, médecins et infirmiers
n’ont pas conscience «qu’il est nécessaire de faire mieux
et plus» pour le patient lambda. «En cas de défaillances
d’organes chroniques, les conditions de la mort sont tout
sauf satisfaisantes; mais on ne nous adresse jamais ces
patients. Ils meurent d’une crise aiguë, cardiaque ou
respiratoire, en étant mal soulagés», regrette Bernard
Devalois. Dans les hôpitaux, deux types de services
concentrent la plus grosse quantité de décès : les
urgences et la réanimation. Pour eux, la mort est deve-
nue un enjeu spécifique.’
ZIR / SIGNATURES POUR LA VIE
À l’hôpital Ici on soigne,
mais on meurt aussi Alors que plus de la moitié
des Français meurent à l’hôpital, la prise en charge de la fin de vie demeure
des plus inégales, notamment dans les services de médecine générale.
L
e débat sur la fin de vie se réduit le plus souvent
à la question de l’euthanasie. Des affaires
spectaculaires comme celle du docteur
Bonnemaison, l’urgentiste de Bayonne qui
avait accéléré le décès de plusieurs patients,
ou des déchirements familiaux, comme il s’en est pro-
duit autour de Vincent Lambert, surgissent régulière-
ment. Ces faits divers émouvants sont systématique-
ment instrumentalisés par les militants du «droit à
mourir». Soumis à la pression médiatique, mécon-
naissant le fond du sujet, poussés parfois par des consi-
dérations purement politiciennes, les gouvernants
paniquent. Début octobre, le Premier ministre pro-
mettait, dans une interview à La Croix, de «sortir (la
fin de vie) de l’arène politique». Deux semaines plus
tard, pour garder le Parti radical de gauche de Jean-
Michel Baylet dans sa majorité, il écrivait noir sur blanc
le contraire, promettant une nouvelle loi. C’est d’ailleurs
dans cette perspective que travaille la mission parle-
mentaire des députés Jean Leonetti et Alain Claeys.
Plusieurs fois repoussé,
ce projet de loi pourrait
être discuté au Parlement au mois de mars. Le rapport
de synthèse présenté la semaine dernière par le
Comité consultatif national d’éthique semble en des-
siner les contours. En retrait par rapport aux scéna-
rios maximalistes jusqu’ici évoqués, il ferme la porte
au «suicide assisté» et à l’euthanasie active –une
piqûre pour mourir. Mais il estime que la «sédation
en phase terminale», un endormissement profond
qui peut accélérer la mort, appelle à clarification.
S’agit-il d’un geste de compassion réservé à des
malades en situation extrême ou d’une euthanasie
rampante? La frontière semble ténue. Quand ni les
mots de «dignité» ni ceux «d’euthanasie» ne font
plus consensus, quand deux philosophies de la vie
s’opposent, tout compromis paraît suspect.
Polarisé, électrisé, idéologisé, le débat sur l’eutha-
nasie cache l’essentiel, que tout le monde connaît
mais dont aucun parti politique, aucun leader d’opi-
nion, aucun média ne se saisit. Si les Français récla-
ment en majorité le «droit à mourir», c’est en grande
partie parce que la médicalisation et la déshumani-
sation de la mort ont de quoi inquiéter chacun d’entre
nous. On meurt mal en France. Chacun voudrait par-
tir entouré, paisiblement et chez soi. Mais en pratique,
on agonise trop souvent seul, dans un couloir d’hôpi-
tal et en grande détresse spirituelle. D’où la demande
d’en finir par une piqûre… Radiographie sans
concession et sans précédent, l’enquête menée depuis
plusieurs mois pour La Vie par Joséphine Bataille
nous plonge dans cette réalité ou plutôt dans cette
honte nationale. Notre journal s’est depuis longtemps
engagé pour le développement des soins palliatifs.
Force est de constater que l’on fait du surplace. Trop
peu de Français y ont accès. Voilà le vrai scandale, le
vrai choix de société par défaut que nous acceptons
jusqu’ici sans broncher!
Mais, en réalité, l’enjeu ne consiste pas seulement
en une prise en compte effective de la douleur phy-
sique. C’est bel et bien une approche humaniste du
soin qu’il faut urgemment développer, afin de ne plus
se contenter de prendre en charge un corps ou, pire,
tel ou tel de ses organes, mais de prendre soin de l’être
dans sa globalité. C’est tout le sens du remarquable
essai de Damien Le Guay, le Fin Mot de la vie (Cerf).
Le philosophe, enseignant à l’espace éthique de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Paris, s’élève avec force
contre ce qu’il appelle «le mal mourir en France».
«Les soins du corps dominent sur les soins des per-
sonnes», constate-t-il, alors même que «le regard porté
sur un malade est le premier de tous les remèdes». La
médecine s’occupe excellemment du «corps biolo
-
gique», souligne-t-il. Mais dans une société toujours
plus efficace, on néglige la parole, le psychologique,
l’affectif, l’émotionnel, le spirituel, le mémoriel, ce
que l’auteur appelle joliment le «corps cordial».
Suivre ce programme, c’est réinventer radicalement
la fin de vie pour en refaire le lieu d’humanité par
excellence. On en est loin… Mais on ne part pas non
plus de zéro, comme le montre un très touchant petit
livre, Accompagner en hôpital (Chronique sociale,
2014). Odile Arvers, Pierre Kerloch, Anne Lortat-Jacob
et Guy Moraillon sont aumôniers catholiques à l’hôpi-
tal de Grenoble. Avec eux, la mort devient l’un des
moments où la vie se vit et se dit finement, profondé-
ment, fraternellement. L’espérance dont ils témoignent
avec humilité a quelque chose de contagieux. Même
tragique, la mort n’a pas le dernier mot.’
JEAN-PIERRE DENIS, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION
«Pour les acteurs
hospitaliers, la mort
est vécue comme
une incongruité,
un échec, et à ce titre
largement
occultée.»
MOURIR EN FRANCE
LA VIE
30 OCTOBRE 2014 23
MOURIR EN FRANCE
LA VIE
LE CHOIX DE LA VIE
30 OCTOBRE 2014 22
020-29 LV 3609 CHOIX mourir -RC9-A-JQ.indd 22-23 21/11/14 09:53

Médecins
et patients à l’hôpital,
miniature tirée de
l’Anonimo Gaddiano,
vers 1542
La grande majorité des gens meurent
chez eux, entourés de leur famille
ou, pour les plus nécessiteux, dans
les hospices et lieux d’asile, qui sont
du domaine de l’Église. Voici, dans
le monde médiéval, l’apparition
des laïcs. À la Renaissance, à l’issue
de la guerre de Cent Ans, l’Église
a moins de revenus. Les laïcs et les
institutions royales prennent le relais
de ce qu’on n’appelle plus charité,
mais bienfaisance. Les bourgeois
ont ouvert des établissements destinés
aux nécessiteux à partir du XVIe siècle
pour participer à l’œuvre de charité,
puisqu’il n’y a pas de service public.
Mais la religion n’en est pas moins
partout présente dans cette
représentation. La charité, c’est
un devoir pour le chrétien!
AISA/LEEMAGE
N
À
l’hôpital Saint-Antoine (Paris XIIe), les 19lits de
la réanimation médicale sont occupés en per-
manence. Une succession de chambres, murs
blancs éclatants, lit au centre, face à la porte, qui reste
toujours ouverte. Les patients y sont amenés en bran-
card, perfusés, branchés sur respirateur, et sauf exa-
mens, n’en bougent pas de leur séjour. Les paramètres
vitaux mesurés sur le «scope» sont surveillés en per-
manence depuis le poste central.
Dans cette enceinte ultratechnicisée, l’état des
malades institue un calme trompeur, n’était le brusque
emballement des alarmes. Sentiment d’étrangeté. Ici,
«le patient est souvent absent du fait de son inconscience
et de sa sédation – et donc absent en tant que personne–
et présent du fait de son corps», analyse la sociologue
Nancy Kentish-Barnes, du groupe de recherche
Famiréa. Les exigences techniques l’emportent sur
les besoins de confort des malades et d’accueil des
proches. Mais en France, c’est bien dans le cadre des
services de réanimation et de soins intensifs que 22%
des personnes décédées en établissement de soins
terminent leurs jours. Et 36% dans les seuls CHU.
Dans ce service parisien, une personne meurt tous
les deux jours. Soit 180, sur les 1000 qui y sont admises
chaque année. Si l’hôpital rejette la mort, les
réanimateurs n’ont pas le choix. La question est de
savoir quand s’y résoudre. Ici on ne s’éteint pas dou-
cement: environ deux tiers des décès résultent d’une
décision, celle d’abandonner la réanimation. «Nous
ne sommes pas confrontés aux demandes d’euthanasie.
Mais face à des situations critiques de défaillance d’or-
gane –liées à un accident ou à une maladie–, nous
sommes en première ligne sur la fin de vie. Pour moi,
ces décisions font partie intégrante de la chaîne du soin»,
déclare le professeur Bertrand Guidet, chef du service.
RÉANIMER OU S’ACHARNER
Faut-il toujours tenter une réanimation –au risque
de devoir l’arrêter?– ou prendre l’option restrictive
–au risque de faire perdre ses chances à un malade?
Ainsi se résument la tragédie, l’espoir, et parfois les
contradictions qui sont le lot de la réanimation. On
sait que les personnes âgées, sans mourir davantage
que les autres en réanimation, succombent trois fois
plus nombreuses que la population générale dans les
semaines qui suivent leur sortie. Les réanimer est-il
une forme d’acharnement? «Le passage en réanima-
tion est une agression. Passé 80ans, plus on est âgé,
moins on a de chances d’être en vie quelques mois après.
D’autres facteurs sont déterminants: une personne
dénutrie, en perte d’autonomie pour les actes de la vie
quotidienne ou atteinte d’un cancer évolutif s’en sortira
mal», révèle Bertrand Guidet. C’est d’après ces para-
mètres que se prend une décision de ne pas réanimer.
Pour tous les autres, la réanimation tient si peu
d’une science exacte qu’il est bien difficile de détermi-
ner des règles. Et les études publiées entre 2009 et 2012
par ce chercheur – ancien président de la Société de
réanimation de langue française – sur le devenir des
personnes âgées en réanimation, le montrent. «Nous
ne décidons d’admettre qu’un patient sur deux en
moyenne. Six mois plus tard, seule la moitié d’entre eux
aura survécu. Quant à ceux que nous n’avons pas admis,
20% vont survivre alors qu’ils nous semblaient perdus,
et 25% vont mourir, alors que nous pensions qu’ils
n’avaient pas besoin de nos soins. On se trompe dans les
deux sens!», constate le médecin, forcé à l’humilité.
SE REMETTRE EN QUESTION
La politique de Bertrand Guidet,
à Saint-Antoine, c’est donc d’ad-
mettre largement les patients: «Le
doute doit leur bénéficier.» La contre-
partie: s’imposer une politique de
réévaluation systématique de la
situation et une réflexion éthique
partagée au quotidien. «Si plusieurs
organes sont toujours défaillants au bout de quelques
jours, ou au contraire si un patient en état grave s’amé-
liore très vite, on sait bien s’il faut ou non continuer.»
C’est parfois un vœu pieux. Dans le service, une femme
de 85ans vient d’être réanimée après un AVC massif.
Très vite, les lésions cérébrales ayant continué de
s’étendre, il a été décidé de suspendre la ventilation
artificielle. La famille s’y est opposée, et le temps a
passé. Si bien que la malade a récupéré et a pu être
sevrée de son respirateur, donc transférée en neuro-
logie. Là, son état s’est dégradé. Retour en réanimation
où elle est décédée…
Pour le chef de service, c’est un échec. Mais il évoque
aussi cette autre femme, du même âge, rentrée chez
elle bon pied bon œil. Arrivée aux urgences avec le
tétanos –un cas de figure exceptionnel– elle avait
effrayé toute l’équipe: la maladie implique au minimum
six semaines de réanimation lourde, sous sédation et
respirateur, et six semaines de rééducation. Le profes-
seur Guidet avait décidé d’admettre cette vieille dame
qui s’était infectée en s’occupant de ses rosiers. Répu-
tée pour sa vitalité extraordinaire, elle est sortie vain-
queur de ses 12semaines de soins.
Elle aurait aussi pu connaître com-
plications sur complications; il
aurait fallu s’adapter.
Confrontés à l’échec, tous les
réanimateurs sont amenés à arrêter
la suppléance artificielle de leurs
patients. Mais certains tardent plus
que d’autres. D’après l’Igas, «des
thérapeutiques agressives et des
gestes diagnostics invasifs sont encore trop souvent
entrepris alors qu’on a perdu l’espoir d’une amélioration
clinique». Les services peuvent être saturés par la
présence de patients qu’on maintient en vie en vain.
Affaire de personnes, de cultures, et aussi, d’histoire
de services. «Y a-t-il urgence à limiter ou faut-il se
donner plus de latitude? C’est rarement la mort qui pose
problème, c’est l’absence de sens. Nous n’avons pas tous
le même ressenti au même stade», affirme Bertrand
Guidet. Le rôle des paramédicaux est déterminant.
Au plus près du patient, ils donnent l’alerte. «À partir
du moment où il y a deux ou trois personnes qui sont
LEEMAGE.COM
Pestiférés dans un
hospice à Pérouse soignés
par les franciscains,
miniature tirée
de la Franceschina,
XVe siècle
Les pestiférés sont recueillis à l’hospice
par les moines. Au Moyen Âge, seuls
les religieux tiennent des établissements
de soin. Dans les villes, les confréries
pieuses sont là pour aider au passage
du croyant; elles font œuvre tant
d’entraide sociale (préparation
des funérailles pour les plus nécessiteux)
que de soutien spirituel. Cette tradition
est héritée des confréries romaines
professionnelles, mais elle
a été christianisée par l’Église des
catacombes: l’aide n’est plus seulement
matérielle, mais spirituelle. Il s’agit
d’aider le mourant à préparer la «bonne
mort», celle qui mène au jugement
dernier et au pardon des péchés.
Il s’agira de mourir muni des sacrements,
mais aussi de nombreux préparatifs
testamentaires, legs pieux, etc.
Continuer les soins ou savoir s’arrêter:
c’est le quotidien des réanimateurs.
Réanimation,
l’art de l’incertitude
Les illustrations
de ces pages
ont été réunies
avec l’aide
de Françoise
Biotti-Mache,
historienne
du droit, membre
de la Société
française
de thanatologie.
Environ deux tiers
des décès résultent
d’une décision,
celle d’abandonner
la réanimation.
MOURIR EN FRANCE
MOURIR EN FRANCE
LA VIE LA VIE
30 OCTOBRE 2014 24 30 OCTOBRE 2014 25
LE CHOIX DE LA VIE LE CHOIX DE LA VIE
020-29 LV 3609 CHOIX mourir -RC9-A-JQ.indd 24-25 21/11/14 09:53

dérangées dans le service, il faut évidemment déclencher
la réflexion. C’est qu’il y a au moins matière à discussion.
Nous devons pouvoir nous remettre en question.»
OUVRIR LA PORTE AUX FAMILLES
Pour Marie Dethyre, l’infirmière en chef du service,
cela fait pleinement partie de sa mission. «J’admets
qu’il y a des cas où nous devons nous arrêter; la mort
fait partie de la vie; si on ne peut plus rien faire, c’est
comme ça, témoigne-t-elle. En revanche, c’est très dur
quand une personne décède en pleine réanimation, alors
qu’on savait qu’il n’y avait pas d’issue, mais qu’on a tardé
à se limiter. On se dit qu’elle aurait pu mourir accompa-
gnée, dans la douceur, et qu’elle en a été privée…»
Lorsque la médecine a décidé de se retirer, la pers-
pective soignante change. On ferme la porte de la
chambre; éventuellement, on arrête le scope et ses
clignotants. À ce stade, il n’est plus question que de
confort. Paradoxe de l’extrême: en réanimation, le
contexte est hostile, mais les compétences palliatives
sont bonnes. On sait gérer la douleur et veiller aux
symptômes. Et la sédation profonde n’est pas une
pratique taboue. «Quand on arrête des traitements, si
le patient n’est pas déjà dans le coma, et qu’il en a besoin,
on l’endort», assure le professeur Guidet.
Les services de réanimation apprennent aussi à
ouvrir leurs portes aux familles et à élargir les
horaires de visite. «On s’efface pour laisser la place
aux proches, mais on reste à leur disposition, glisse
l’infirmière. On les invite à aller prendre l’air, ou à
s’asseoir –genre de choses que certains ne s’autorisent
jamais d’eux-mêmes.»’
Mourir aux urgences. Image repoussoir. Image
médiatique aussi, qui s’est imposée lors du
procès de l’urgentiste Nicolas Bonnemaison.
Au travers de cet homme, c’est une société qui envoie
ses personnes âgées finir aux urgences qui a été jugée.
Cette réalité, la France semblait la découvrir. Elle est
connue de tous les urgentistes. C’est un état de fait,
et le symptôme d’un dysfonctionnement global.
LES LEÇONS DU PROCÈS BONNEMAISON
Les services d’urgences concentrent beaucoup de
décès. Ils sont brutaux. Ils signent l’échec du soin poussé
à son maximum, et font suite à un accident, à un infarc-
tus, à un suicide, à une chute de moto ou à une patho-
logie aiguë. Ils se produisent dans l’ambulance, dans
le camion des pompiers ou à l’arrivée à l’hôpital. Mais
désormais, ce sont des personnes dont le décès était
prévisible qui viennent grossir les rangs. Âgées et
malades, en provenance de leur domicile ou d’un ehpad
(établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes), elles arrivent aux urgences en bout de
course, sans espoir de soin, juste pour pousser leur
dernier soupir. Le procès Bonnemaison nous en a
d’ailleurs raconté les histoires. Des hommes et des
femmes extrêmement âgés, victimes de leur troisième
AVC, de leur quatrième hémorragie cérébrale, d’un
sixième cancer, d’un Alzheimer au stade grabataire;
qui avaient basculé dans le coma, et pour lesquels les
urgentistes n’avaient pu que constater qu’il était dérai-
sonnable d’entreprendre une thérapie. «Au stade de
l’agonie du patient, il n’est de toute façon plus temps de
nous l’envoyer en soins palliatifs, s’agace le docteur
Devalois. Nous devons comprendre comment il est pos-
sible, à l’heure actuelle, qu’un patient arrive aux urgences
alors qu’il est clair depuis des mois que ça va se terminer
par une urgence vitale et que cela aurait pu être anticipé,
à domicile ou dans une unité spécialisée!»
UN CORTÈGE DE QUESTIONS ÉTHIQUES
La raison d’être de l’urgentiste, c’est d’agir immé-
diatement. Pour parer au plus pressé sur le plan vital.
Puis il lui revient d’orienter les patients un peu partout,
en quête de places dans les services adaptés de l’hôpi-
tal, tandis que d’autres continuent de pousser à la
porte, s’amassent dans des boxes et en salle d’attente,
parfois dans les couloirs et sur des brancards. Alors,
ce nouveau flux de patients gra-
bataires et très âgés, en chan
-
geant le paysage, engendre un
cortège de questions éthiques.
Voilà l’histoire d’une per-
sonne âgée qui s’était cassé le
col du fémur et était partie pour
les urgences. On lui a fait une
radio; elle est restée là en atten-
dant le résultat. Et elle est
morte. Dans l’anonymat, dans
des conditions d’isolement et de stress importantes.
Cette personne n’était pas malade a priori, mais elle
était très âgée. «On aurait pu viser avant tout son
confort, en lui donnant des calmants, l’installer dans
un endroit convenable, et s’occuper de la radio dans un
second temps», glisse un médecin témoin de la scène.
Alexis Burnod est un oiseau rare: médecin des soins
palliatifs de l’Institut Curie à Paris, il est aussi urgentiste
au smur de l’hôpital Beaujon (Hauts-de-Seine). Fort
de cette double casquette, il se démène pour dévelop-
per l’approche palliative dans un milieu qui y est plutôt
insensible. Objectif: faire la distinction entre ce qui
est encore réversible et ce qui ne l’est pas. «L’âge n’est
pas un critère pour ne pas réanimer quelqu’un. Mais il
y a une différence entre un nonagénaire qui a toute sa
tête et qui, brutalement, ne respire plus –il a peut-être
une pneumonie dont il a toutes les chances de guérir– et
le même symptôme sur une personne grabataire et
démente. Celle-ci ne se relèvera pas d’une intubation!»
PRÉVENIR LES TRANSFERTS ABUSIFS
Dans un monde idéal, cette réflexion devrait s’impo-
ser dès le stade préhospitalier pour prévenir les trans-
ferts abusifs. Environ 3% des appels au samu, en effet,
concernent des personnes en fin de vie. Un chiffre qui
L’Extrême-Onction,
Nicolas Poussin, vers 1640
À l’antique et dans le style italianisant
en vogue à l’époque, Poussin glorifie
la «bonne mort», celle qui se produit
avec le secours de la religion,
afin d’édifier le peuple. La famille
est présente, mais c’est l’episcopos
qui officie – celui qui avait charge d’âme
dans les premières communautés
chrétiennes, au sein desquelles s’est
développé l’usage des sacrements.
Confrontés à un afflux de personnes âgées
en fin de vie, ces services tentent de s’organiser.
Aux urgences,
fins de vie improvisées
«Au stade de
l’agonie du patient,
il n’est de toute
façon plus temps
de nous l’envoyer
en soins palliatifs.»
LEEMAGE.COM
Léguer àl’Église catholique,
c’est un geste d’Espérance.
Legs, donations et assurances-vie.
Parlez-en àvotre curé
ou contactez votre évêché
www.legs.catholique.fr
Grâce àvous.
Demain comme aujourd’hui,
il yaura des églises
pour accueillir
les enfants de Dieu.
Création :pour CEF
N
LA VIE
30 OCTOBRE 2014 27
MOURIR EN FRANCE
LA VIE
30 OCTOBRE 2014 26
LE CHOIX DE LA VIE LE CHOIX DE LA VIE
020-29 LV 3609 CHOIX mourir -RC9-A-JQ.indd 26-27 21/11/14 09:53

Les chrétiens
s’engagent
Alors qu’une mission parlementaire
poursuit ses auditions
à l’Assemblée nationale, et après
celle des représentants des religions
dont Pierre d’Ornellas, archevêque
de Rennes, spécialiste des questions
de bioéthique, la Conférence des évêques
de France vient de lancer un groupe
de travail sur la fin de vie. Un blog
(www.findevie.catholique.fr)
est ouvert, où les internautes pourront
interagir. Un nouveau billet y sera
publié tous les 15jours – par divers
contributeurs et même des opposants
à la doctrine catholique, ont précisé
les prélats. Leur objectif : sortir
de la juxtaposition des avis propre aux
débats pour rentrer dans un véritable
«dialogue». À lire aussi sur Internet,
quelque 1¹000témoignages sur la fin
de vie, recueillis dans la rue par
des bénévoles de l’association
Alliance Vita en mai et juin dans le cadre
de la campagne «Parlons la mort»
(www.parlonslamort.fr).
N
augmente, car la prise en charge à domicile des patients
complexes augmente et que les familles sont vite prises
de panique quand elles assistent à une défaillance
cardiaque ou respiratoire. La majorité des appels sur-
viennent la nuit ou le week-end. D’où la nécessité pour
les urgentistes de chercher toute l’information dispo-
nible sur le malade et de consulter les proches pour
prendre la bonne décision. «Notre difficulté, c’est qu’à
chaque fois, on tombe sur quelqu’un
qu’on ne connaît pas. Mais l’urgence
n’est pas une excuse pour s’exonérer
d’une réflexion sur l’acharnement.
La loi Leonetti s’applique à tous»,
souligne Alexis Burnod.
SOULAGER LES SYMPTÔMES
Le cas échéant, l’urgentiste devra
alors se faire palliativiste. «Si le
patient n’est plus en état de subir de
soins invasifs à l’hôpital, nous devons nous contenter
de soulager les symptômes», assure le médecin. Moins
de 10% des urgentistes ont été formés à la prise en
charge palliative. «Certains jugent que ce n’est pas notre
travail; mais c’en est une nouvelle facette. Pour les gens,
il y a bien urgence: urgence palliative!» Sur son secteur,
les Hauts-de-Seine, le réseau de cancérologie et soins
palliatifs Scop (Soins continus de l’Ouest parisien)
s’est organisé avec le samu: à chaque fois qu’un appel
est passé par l’un des 40 patients suivis pour fin de
vie, un médecin d’astreinte connaissant le patient
oriente au téléphone l’intervention des urgentistes.
Bilan: le transfert aux urgences a été divisé par deux.
Mais les faits sont là : les patients affluent aux
urgences. «Nous n’avons pas voulu de cette responsa-
bilité, mais aujourd’hui nous sommes devenus un centre
décisionnel des choix de vie des patients», constate le
docteur Philippe Le Conte, aux urgences du CHU de
Nantes. En 2010, il a dirigé une étude dans 174 services
d’urgences français. Celle-ci révèle que le délai moyen
du décès aux urgences est de 12heures, c’est dire que
les patients y arrivent à la dernière
extrémité. Moyenne d’âge: 77ans.
La moitié des décès surviennent
dans le secteur d’accueil, sur un
brancard ou sur une table d’examen.
«On identifie très vite qu’ils sont au
bout; dans ce cas-là, on prend une
décision de limitation des soins, en
lien avec les réanimateurs, et on
essaie que ça se passe le plus paisi-
blement possible», détaille-t-il.
Les autres mourants auront le temps d’être trans-
férés aux «lits portes», dans les unités de court séjour,
juste attenantes, prévues pour les patients en attente
de transfert vers un service spécialisé. Là, ils bénéfi-
cieront au moins d’une chambre et d’un peu de calme
pour les 48heures qui leur restent. Selon les prati-
ciens, les plus chanceux auront de la morphine et des
soins de confort. Soit 10% seulement des quelque
300000personnes qui décèdent chaque année aux
urgences –estimation de l’Observatoire sur la fin de
vie. Quant aux proches, généralement absents, pris
par surprise, arrivés trop tard ou dépassés, ils feront
souvent défaut dans ce contexte…’
Vue de l’infirmerie
des filles de la Charité
durant une visite
d’Anne d’Autriche,
d’après Abraham Bosse,
vers 1640
La reine visite les malades, comme
le font d’autres grandes dames.
C’est une des actions les plus
communes. Les moines s’occupent
de l’herboristerie, les sœurs prodiguent
les soins –les draps sont changés
tous les jours. Un moine accroupi
s’affaire sur les chauffoirs; les lits sont
entourés de tentures pour conserver
la chaleur. On les tire chaque jour
pour que les malades puissent assister
à la messe –on aperçoit l’autel au fond
de cet hospice-chapelle. Les lieux
sont prestigieux – qu’on pense
aux hospices de Beaune–, même
si l’on y reçoit les plus humbles.
Ils sont bâtis avec l’argent de l’Église
et des donateurs dont on aperçoit
les portraits aux murs.
Le père Anton Drascek, aumônier catholique à l’Hôpital européen Georges-Pompidou
(Paris XVe) témoigne de son travail d’accompagnement des mourants.
« Sentir qu’on ne sera jamais abandonné
pour pouvoir s’abandonner»
Face à la mort, à la maladie ou en fin de vie,
la question n’est plus de savoir si on est croyant
ou pratiquant: les interrogations sont
les mêmes pour tous. Quels que soient son milieu
social, sa foi, sa personnalité, chacun est traversé
successivement par la révolte, par l’espérance…
et se bat avec ces questions, même s’il nie
qu’il se les pose. L’hôpital est un lieu de vérité.
Même lorsqu’on est très entouré, il y a des moments
où l’on se retrouve seul face à soi-même;
la confiance (en Dieu) ou la foi que l’on peut avoir
sont mises à l’épreuve. Nous ne rendons visite
qu’à ceux qui font appel à nous; certains croyants
ne pensent pas nécessairement à l’aumônerie.
Parfois, cela vient d’un déni de leur situation réelle.
Parfois, leurs questions se résolvent autrement.
Nous devons respecter leur liberté. Il y a beaucoup
de choses derrière la peur de la mort: la peur
de souffrir, de quitter ceux qu’on aime,
de disparaître, de ne rien laisser derrière soi…
L’aumônier essaye d’accompagner le cheminement
intérieur du mourant, de la colère et la détresse,
jusqu’à l’acceptation de la mort et l’abandon
à l’amour de Dieu. Mais pour les proches aussi
il y a quelque chose qui prend fin; il est important
pour eux de parvenir à accepter la séparation.
Et pour le mourant il est crucial de les voir
s’apaiser. Je ne saurais dire ce qui réconforte l’un
ou l’autre, chacun chemine selon son histoire.
Mais ce que je crois, c’est que pour être capable
ainsi de s’abandonner, ilfaut que jamais on ne
puisse se sentir abandonné. Il faut que jamais
on ne vous lâche la main. On peut prier ensemble,
lire la parole de Dieu, mais aussi rester dans
le silence – qui n’est pas un vide, mais un respect
du mystère. J’ai constaté que la simple présence
du prêtre a beaucoup de force, par son symbolisme.
Et que le langage non verbal est essentiel. Tout
est écrit sur le visage des gens; lorsqu’ils sont
apaisés, ils rayonnent.»’
«L’urgence
n’exonère pas
d’une réflexion
sur l’acharnement.
La loi Leonetti
s’applique à tous.»
JULIEN MUGUET/IP3
«
LEEMAGE.COM
ANTON DRASCEK est
aumônier catholique
à Georges-Pompidou depuis 2012.
MOURIR EN FRANCE
MOURIR EN FRANCE
LA VIE LA VIE
30 OCTOBRE 2014 28 30 OCTOBRE 2014 29
LE CHOIX DE LA VIE LE CHOIX DE LA VIE
020-29 LV 3609 CHOIX mourir -RC9-A-JQ.indd 28-29 21/11/14 09:53
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%