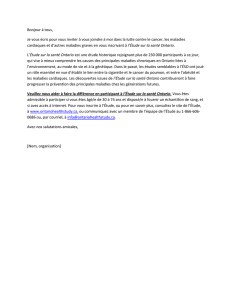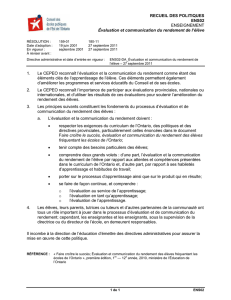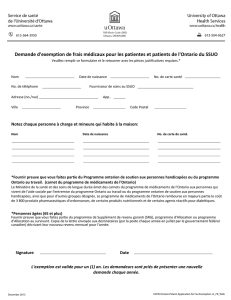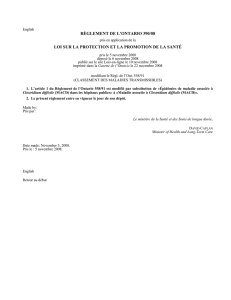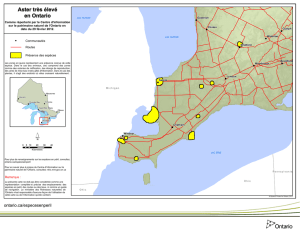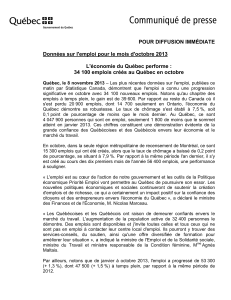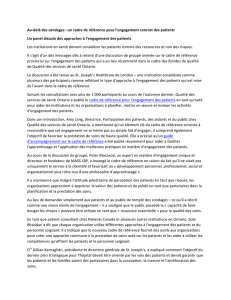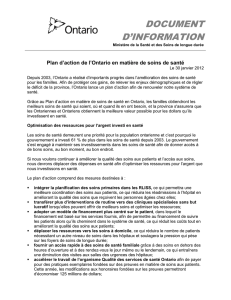1 CASSANDRE, LE DOCTEUR PANGLOSS ET SIX ENJEUX

1
CASSANDRE, LE DOCTEUR PANGLOSS
ET SIX ENJEUX ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC
Notes pour une présentation au congrès 2004 de l’ASDEQ
Québec, 6 mai 2004
Pierre Fortin
Université du Québec à Montréal
Pour discuter de la prospérité future du Québec, il faut d’abord s’entendre sur un
diagnostic de la situation économique actuelle. Il y en a deux en circulation : un
diagnostic à la Cassandre, cette figure mythologique selon laquelle tout va mal et va
continuer d’aller mal, et un autre à la docteur Pangloss, ce personnage de Voltaire selon
lequel tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mon propos va
chercher à démontrer que les Cassandre noircissent exagérément la situation, mais que,
néanmoins, les docteur Pangloss ont tort d’affirmer que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes au Québec. Je vais organiser ma critique des Pangloss en abordant
six enjeux économiques concrets du Québec.
Les exagérations des Cassandre
Les Cassandre font tout d’abord remarquer que le PIB par habitant du Québec est
parmi les plus bas en Amérique. Mais ils oublient de tenir compte que les prix, eux aussi,
sont plus bas aux Québec que partout ailleurs et qu’il y a, par conséquent, plus de vrai «
stuff » dans 1 milliard de biens et de services au Québec qu’en Ontario. Ce qui coûte 1
dollar à Montréal coûte 1,15 dollar à Toronto. Si on fait le calcul correctement, la
productivité est à peu près la même au Québec qu’en Ontario. Le fait que l’Ontario et le
Québec soient tous les deux au 40e rang des États d’Amérique du Nord en productivité
doit aussi être souligné. La faible productivité est un problème canadien, pas
exclusivement un problème québécois.
Ce qui abaisse notre PIB réel par habitant sous celui de l’Ontario, ce n’est pas une
différence de productivité, mais d’heures travaillées : les Québécois travaillent moins
d’heures par semaine, moins de semaines par année et moins d’années dans leur vie
active que les autres Nord-Américains. A-t-on raison de s’en scandaliser ? À mon humble
avis, si les gens décident librement de travailler moins et d’encaisser une baisse de revenu
afin de prendre plus de bon temps avec leurs enfants, leurs conjoints, leurs amis et de
s’adonner plus aux loisirs culturels, sportifs ou autres, ça les regarde. L’objectif de la
société est de maximiser le bien-être, pas les revenus monétaires. Il y a sans doute des
lois et des règlements qui exagèrent notre propension au loisir et à la retraite hâtive. Il est
important de les identifier et de les corriger. Mais ériger en principe que le bonheur est
dans plus de travail ne mènera nulle part.

2
Les Cassandre brandissent ensuite le faible taux de croissance de l’emploi au
Québec comme preuve de la sous-performance économique du Québec. On dirait qu’ils
n’ont jamais entendu parler de la chute dramatique de la natalité au Québec depuis 40
ans. Évidemment que, si la population de 15 à 64 ans n’augmente que de ½% par année
au Québec et de 1,5% en Ontario, l’emploi lui aussi devrait normalement progresser trois
fois moins vite au Québec! Mais, justement, ce n’est pas le cas. En proportion de la
population, l’emploi augmente plus vite au Québec qu’en Ontario depuis 20 ans. En
1982, le retard du taux d’emploi du Québec sur celui de l’Ontario était de 15%.
Aujourd’hui, il n’est plus que 5%. Ce n’est pas encore la parité, mais on s’y dirige. Les
Cassandre rétorquent que, si l’emploi allait si bien au Québec, notre flux migratoire
s’améliorerait. Ils ont parfaitement raison, et justement, il est en train de s’améliorer.
Mais cela prend du temps, et il faut admettre qu’à performance économique égale notre
langue et notre culture françaises imposeront toujours une limite à l’immigration au
Québec. C’est vrai depuis des siècles.
La confusion démographique des Cassandre se poursuit lorsqu’ils déplorent que le
poids du Québec dans l’investissement total au Canada soit plus faible que le poids du
Québec dans l’ensemble de la population canadienne. Ils n’ont pas l’air de comprendre
que, si les jeunes sont moins nombreux à entrer dans la population active au Québec
qu’ailleurs, moins d’investissement est nécessaire pour les équiper. La faiblesse relative
de notre investissement est de nature essentiellement démographique. Elle ne freine pas
notre croissance économique par habitant. En fait, si on gratte un peu dans les
statistiques, on constate immédiatement que, bien qu’encore en retard sur le reste du
pays, le stock de capital productif par habitant augmente plus vite au Québec qu’ailleurs
au Canada depuis 15 ans. C’est comme pour l’emploi : on est en arrière, mais on rattrape
peu à peu.
La complaisance du docteur Pangloss
Bon, OK, j’arrête, à la fois parce que je considère la plupart des Cassandre parmi
mes amis et parce que, dans le fond, nous poursuivons tous le même objectif : accélérer le
développement économique du Québec. Je suis en désaccord avec leur stratégie de
noircissement pour deux raisons. La première en est une de principe : ne pas dire la vérité
n’est jamais une bonne stratégie – je tiens ce précepte de ma mère. La seconde raison est
pratique : répéter sans arrêt que la performance économique du Québec est « poche »
dans toutes ses dimensions va décourager nos concitoyens d’agir plutôt que les inciter à
l’action. La bonne stratégie à mes yeux est de reconnaître que le Québec a grandement
progressé depuis 20 ou 40 ans, mais qu’il a encore des croûtes à manger et qu’il doit
prendre les moyens d’aller plus vite non plus pour rattraper l’Ontario, mais pour rejoindre
ses grands partenaires économiques du nord-est des États-Unis. La reconnaissance des
progrès accomplis est précisément ce qui justifie l’espoir que la tâche soit effectivement
réalisable. Je vais donc passer le reste du temps qui m’est imparti à jeter des pierres dans
le jardin des docteur Pangloss – tout en admettant que plusieurs d’entre eux sont aussi
mes amis.

3
1) Les méga-subventions aux alumineries
Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes au Québec. À commencer par
notre réflexe de république de bananes, hérité de Taschereau et de Duplessis, qui nous
porte à faire des méga-cadeaux aux multinationales des ressources naturelles. Le dernier
exemple en ligne est celui du projet d’expansion d’ALCOA à Deschambault. Suivant
machinalement la pratique des gouvernements précédents (libéraux comme péquistes), le
gouvernement Landry a promis à cette compagnie une subvention d’une valeur totale de
2 milliards si elle investit 1 milliard pour créer 250 emplois dans Portneuf. Il y a deux
problèmes. Le premier, c’est qu’une subvention de 2 milliards pour un investissement de
1 milliard, ce n’est pas fort comme effet de levier. Le second problème, c’est qu’une
subvention de 2 milliards pour créer seulement 250 emplois, ce n’est pas fort non plus,
quand on sait qu’en moyenne, au Canada, un montant de 2 milliards en investissement
manufacturier est capable de soutenir 20 000 emplois, soit 80 fois plus. En d’autres mots,
20 000, c’est le nombre d’emplois que nous pourrions créer en investissant les 2 milliards
ailleurs. Ça n’a tout simplement pas de bon sens de gaspiller la richesse des Québécois en
méga-subventions à des multinationales qui ne créent presque pas d’emplois et qui, au
surplus, bouffent chaque année des milliards de kilowatt-heures au moment même où
Hydro-Québec commence à flirter dangereusement avec les limites de sa capacité.
2) L’immobilisme en santé
Passons au problème national numéro un, la santé. Nous avons perdu le contrôle
de la situation dans ce secteur. La multiplication des nouvelles molécules et les progrès
de la chirurgie font augmenter les coûts à la vitesse des bottes de sept lieues. Le
vieillissement des babyboomers nous en promet encore plus d’ici 10 ans. Au rythme de
croissance actuel, carrément insoutenable, la santé bouffera dans 20 ans les ¾ du budget
du Québec. Il restera encore quelques polyvalentes à transformer en hôpitaux, et plus rien
pour aucun autre ministère. Tout cela est parfaitement prévisible. Face à cette
contradiction évidente, la seule stratégie apparente de nos gouvernements consiste à
attendre l’argent fédéral (le déséquilibre fiscal engendre l’immobilisme), à brasser un peu
les bureaucraties médicale, syndicale et administrative, et à affamer tout le reste du
secteur public pour financer la croissance en santé. La simple addition de 1 milliard au
budget de la santé cette année équivaut à une fois et demie le budget total du
développement économique.
Pourtant, plusieurs vieux pays ont connu ce type de stress bien avant nous et ont
trouvé la solution : un système dual public-privé qui garantit l’accès aux soins tout en
réprimant les excès de la demande. Pourquoi, au Québec, juge-t-on que le secteur privé
est permis et fait du bon travail en éducation, mais qu’il est interdit et dangereux en santé
? Je reconnais que le problème est tout autant canadien que québécois. Il y avait, la
semaine dernière, quelque chose de tout à fait pathétique à voir le ministre Pettigrew être
forcé de manger ses bas en public simplement pour avoir dit une vérité que personne ne
voulait entendre : que le secteur public ne pourra tout faire seul.

4
3) L’abolition suggérée des cégeps
Maintenant, l’éducation et, pourquoi pas, les cégeps. Vulnérable aux groupes
d’intérêts, le gouvernement, qui a faim d’argent, se laisse présentement tenter par une
mesure radicale récemment avancée par la Fédération des commissions scolaires et dont
nous savons tous qu’elle sourirait aussi aux dirigeants universitaires : abolir le secteur
préuniversitaire de deux ans des cégeps et le remplacer par une sixième année au
secondaire et une année supplémentaire au 1er cycle universitaire. La Fédération est allée
jusqu’à prétendre que ce brassage de structure ferait économiser 1 milliard par année au
Québec, soit l’équivalent de 80% de la subvention du MEQ aux cégeps. Non seulement
cette prétention est-elle une impossibilité mathématique, mais c’est son contraire qui est
vrai. Former un élève coûte beaucoup plus cher à l’université qu’au cégep, de sorte que
transférer 75 000 étudiants des cégeps vers le secondaire et l’université coûterait plus
cher, pas moins cher, à la société québécoise – probablement 175 millions de plus par
année à long terme, sans compter les coûts de transition à court terme.
Ce n’est pas tout. Ajouter une sixième année au secondaire donnerait 12 mois de
plus aux jeunes du Québec pour décrocher, alors que la province affiche déjà le plus haut
taux de décrochage du Canada. La vérité est que, grâce aux cégeps, presque 70% des
jeunes Québécois acquièrent aujourd’hui un diplôme postsecondaire par comparaison à
60% ailleurs au Canada, et que notre niveau de scolarisation est le plus élevé du pays
avec celui de l’Ontario, soit 15,2 années d’études à la médiane. C’est notamment au
Québec que le plus de jeunes sont formés dans la filière professionnelle et technique au
Canada. Il y a certainement beaucoup à améliorer dans cette filière en particulier et dans
les cégeps en général. Le point que je veux faire valoir ici n’est pas que tout est parfait au
Québec, mais simplement que c’est pire ailleurs et qu’il serait illogique de remplacer
notre système par un autre qui est moins performant.
Par ailleurs, bien qu’on convienne facilement que beaucoup d’enfants de familles
riches et éduquées seraient allés à l’université avec ou sans cégep, il n’en va pas de même
pour les enfants d’origine plus modeste. Sans cégep, ils seraient très nombreux à être
immobilisés durant toute leur vie avec en poche un simple diplôme du secondaire. C’est
exactement ce qu’on observe dans le reste du Canada. Bref, abolir les cégeps tels que
nous les connaissons nous ferait perdre sur tous les plans : ce serait une mesure coûteuse,
déscolarisante et inéquitable. Alors qu’on se conforte avec le statu quo dans le secteur où
il serait urgent d’agir, la santé, on se prépare à prendre un virage radical et dangereux
pour l’économie et la société dans un autre secteur, l’éducation, où construire à partir du
système actuel serait ce qu’il y a de plus intelligent à faire.
4) La crise perpétuelle du logement locatif
Au Québec, nous avons l’habitude de bloquer les prix de divers biens ou services
pour toutes sortes de raisons, principalement d’équité. La sous-tarification est évidente
pour les garderies, l’électricité, les frais de scolarité collégiaux et universitaires, l’eau,
l’usage des ponts et des routes, les logements locatifs, etc. Tout cela part d’un bon
naturel, et il n’est pas interdit de croire que le combat contre les inégalités sociales justifie

5
plusieurs de ces interventions, du moins jusqu’à un certain point. Mais il y a des
exagérations. Afin de conserver les précieuses minutes qui me sont accordées, je me
limiterai à un seul exemple, celui du logement locatif.
À prime abord, le problème paraît désespérément simple. Pour être rentable à
construire, un logement de 4 pièces et demie doit se louer 800 dollars par mois, alors que
le loyer moyen soumis aux règles de la Régie du logement n’est que 550 dollars. Tout ce
que vous avez appris en microéconomie à l’école s’ensuit. L’offre est restreinte, la
demande est forte, les chercheurs de logements jouent à la chaise musicale, les gros se
trouvent une chaise facilement (parfois en payant sous la table), les petits ont le cul à
terre, c’est la crise à chaque 1er juillet, et les associations de locataires exigent la
construction de plus de logements sociaux par le gouvernement…lequel acquiesce, mais
ne peut répondre à la commande parce qu’il est sans le sou.
Les causes du déséquilibre sont faciles à comprendre. Le mode actuel de fixation
des loyers permet les baisses de loyer, mais limite les hausses. Ça va bien dans une
période d’offre excédentaire comme 1988-1998, mais la remontée des loyers est bloquée
lorsque la demande se rétablit ensuite. En attendant, les codes de la construction
résidentielle accumulent les réglementations qui augmentent le coût de construire. Les
solutions sont faciles à trouver. Il suffirait de laisser le marché déterminer le loyer chaque
fois qu’un logement se libère (tout en conservant le contrôle pendant la durée d’une
occupation) et d’éliminer ou atténuer les réglementations inutiles ou abusives dans la
construction résidentielle. D’autres États l’ont fait, et ça marche. Transformer l’État en
grand entrepreneur et gestionnaire immobilier n’est pas la seule solution possible à notre
crise permanente du logement.
5) Le coût et le risque croissants d’investir au Québec
En matière de croissance économique, l’investissement est le nerf de la guerre.
Mais, pour avoir lieu au Québec, l’investissement doit être plus rentable à faire ici
qu’ailleurs. Or, premièrement, il est de plus en plus coûteux d’investir au Québec parce
que les coûts de construction sont plus élevés et plus imprévisibles qu’ailleurs. Est-il
normal qu’une grande surface coûte 10% plus cher à construire à Trois-Rivières qu’à
Etobicoke, alors que le salaire moyen est 10% plus bas au Québec qu’en Ontario ? Est-il
normal que les grands projets finissent par coûter systématiquement deux fois plus cher1
que prévu au départ ? Y a-t-il une stratégie pour ausculter notre industrie de la
construction, briser l’omerta qui l’entoure et comprendre ce qui ne marche pas dans le
système ? Est-ce qu’une autopsie du flop de la Gaspésia va suffire ? Est-ce que ce flop
résulte seulement des malversations de quelques mauvais garçons ou des erreurs d’un
gestionnaire incompétent, ou est-il la conséquence d’un système qui est à revoir au
complet ?
1 Un collègue de relations industrielles qui en a vu d’autres me fait part d’une nouvelle loi économique
dans le secteur de la construction au Québec : la loi de π. Elle énonce que le coût final d’un projet de
construction au Québec est égal à π fois l’estimation de coût initiale ! (Rappel : π = 3,1416…)
 6
6
 7
7
1
/
7
100%