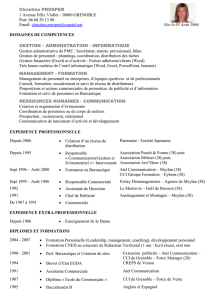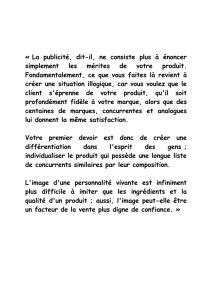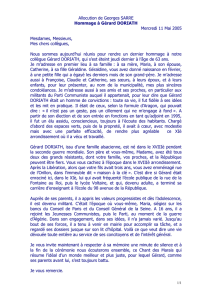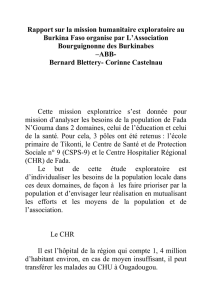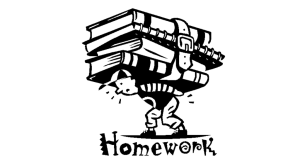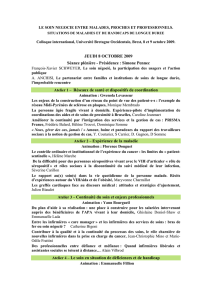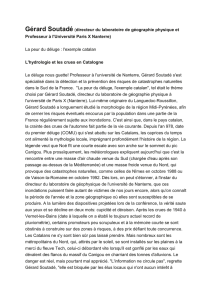Rencontre - Infirmier et acteur de cinéma

4
Infirmier et acteur de cinéma
Marseille. A gauche du vieux
port, en regardant la mer,
se succède un chapelet de ca-
lanques. A droite, des kilomètres
de docks et de zones portuaires
débouchent, tout au bout, sur le
quartier de l’Estaque. Au Bar de
la Rade, nous avons rencontré
Gérard Meylan entre deux tour-
nages. Infirmier depuis vingt-
sept ans, c’est la première fois,
après avoir tourné une douzaine
de films, qu’il a pris une dis-
ponibilité de six mois, laissant
de côté l’hôpital, pour tourner
deux nouveaux films avec Robert
Guédiguian. Le premier, intitulé
A l’attaque vient de sortir. Gérard
Meylan y joue le rôle d’un gara-
giste qu’un patron, délocalisant
son entreprise sans le payer, “met
sur la paille” et pousse au kid-
napping. «Le deuxième film doit
s’appeler La ville est tranquille,
dit Gérard Meylan. On s’en doute,
ce n’est pas tranquille du tout !
J’y joue le rôle d’un tueur à gages.
L’ histoire aborde des thèmes comme
la toxicomanie, la présence du
Front National à Marseille, les liens
enchevêtrés entre la politique et la
mafia. Il y a une intrigue, mais ce
n’est pas un polar. La trame, plus
sociale, aborde l’engagement poli-
tique. Il s’agit plus de montrer la vie
côté réalité... telle qu’elle est.»
Soins et cinéma
Parce qu’une “copine” est infir-
mière, Gérard Meylan choisit de
faire l’école d’infirmière à dix-sept
ans. «J’avais, par élan, envie de
faire quelque chose d’utile et effi-
cace », dit-il. Quelques années et
un diplôme infirmier plus tard, il
commence sa carrière, avec des
horaires de jour, dans le service de
chirurgie digestive de l’Hôtel-
Dieu, à Marseille. Ensuite, il exer-
cera en service de traumatologie,
puis, de nuit, en pneumologie.
Quant à la rencontre avec le
cinéma, elle a lieu parce que le
cinéaste Robert Guédiguian et
Gérard Meylan étaient amis d’en-
fance à l’Estaque. Jeunes, subju-
gués par le grand écran, ils han-
tent les cinémas d’art et d’essai de
Marseille et dévorent les films
néoréalistes italiens. Puis la vie
les sépare.
Robert Guédiguian “monte” à
Paris finir ses études de sociolo-
gie. Sa femme, Ariane Ascaride
(qui a joué Jeannette, et travaille
au garage Moliterno dans leur
dernier film), y fait le Conserva-
toire. Le copain resté dans le Sud
reçoit un coup de fil de son ami
en 1980. Il lui propose de jouer
dans son premier film, Dernier
été, qui retrace l’histoire de quatre
gars de l’Estaque confrontés à la
difficulté de vivre aujourd’hui.
Le personnage joué par Gérard
Meylan fait un casse chez un
brave petit vieux qui défend ses
biens et lui tire dans le dos.
Depuis, Gérard a fait une dou-
zaine de films longs métrages,
quelques moyens métrages et des
téléfilms. Une clause du règle-
ment de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Marseille permet à
ses agents d’avoir une activité de
créateur, qu’il s’agisse de pein-
ture, de cinéma ou de tout autre
moyen d’expression. Ils peuvent
avoir un autre revenu que celui
de la fonction publique hospita-
lière. Jusqu’en 1999, notre infir-
mier a fait du cinéma sur ses
temps de repos annuels et ses re-
pos compensateurs.
Restrictions
vers la qualité des soins.
Effectifs à marée basse
Gérard Meylan n’en fait pas trop
devant une caméra. Il présente
un jeu réaliste, sobre, quasi mi-
nimaliste. Et puis, le moment
venu, bang !... il vous balance de
l’émotion “gros comme ça” pour
dire l’amour, le malheur ou l’in-
dignation. Robert Guédiguian lui
écrit des rôles comme il le voit
dans la vie : un homme confronté
au quotidien, plutôt contempla-
tif, mais pouvant se révéler com-
batif ou militant. C’est d’ailleurs
sa passion qui frappe lorsque Gé-
rard Meylan parle de l’hôpital.
«Nous assistons à d’importantes
restructurations dans ce secteur !
dit-il. A Marseille, la construction
d’un méga-hôpital à vocation uni-
versitaire est envisagée dans le
quartier du Prado, assortie de la
fermeture des hôpitaux de la
Conception, de la Timone et de
Sainte-Marguerite. Avec le parc
splendide de ce dernier, j’entends
déjà les promoteurs immobiliers
Il est le héros du film Marius et Jeannette : le gardien
de cimenterie qui boite. Gérard Meylan l’est aussi dans
A l’attaque, le nouveau film de Robert Guédiguian.
Infirmier depuis 26 ans, l’acteur travaille dans un
service de pneumologie de Marseille.
Rencontre
©1997-Agat Films & Cie
Film :
Marius
et Jeannette.

5
qui s’aiguisent les ongles. On pro-
pose des préretraites aux infirmières
afin d’en diminuer le nombre, ici
comme ailleurs en France. Où va-
t-on ? Nous allons perdre des locaux
hospitaliers, des lits, des soignants
et des lieux d’apprentissage ! Tout
cela pour faire une grande usine-
hôpital ! »
Les gouvernements successifs
prétendent qu’il y a trop de lits.
Gérard Meylan ne comprend pas.
«Nous refusons des malades aux
urgences parce qu’il en manque !,
dit-il. En pneumologie, il m’arrive
de transférer des malades en am-
bulance vers des établissements pri-
vés parce que nous n’avons pas
assez de lits de réanimation ! Il est
délicat de renvoyer et promener
ainsi des malades dans un état
grave ! » A ses yeux, nous man-
quons de lits, mais aussi de chi-
rurgiens, d’anesthésistes et d’in-
firmières. Le taux idéal, le jour,
serait d’un infirmier pour huit
malades à l’hôpital. Au lieu de
cela, on compte souvent une in-
firmière pour vingt malades.
«Avec trente malades sur les bras,
la nuit, je suis seul dans le service,
dit-il. Un effectif plus adapté nous
permettrait d’avoir plus de temps
pour faire tomber les barrières et
parler aux malades. Il devrait y
avoir à peu près le même nombre
d’infirmiers la nuit que le jour. Com-
ment donner à un malade les expli-
cations nécessaires avant son départ
si le soignant est seul et qu’on l’ap-
pelle ailleurs ? »
La durée moyenne de séjour des
malades ne cesse de diminuer.
«Les protocoles de chimiothérapie,
notamment pour les mésothéliomes,
doivent s’effectuer en cinq jours,
ajoute-t-il. Or, nous sommes obli-
gés de les pratiquer en quatre jours
pour libérer des lits. Généralement,
les malades ont à peine le temps de
se stabiliser avant de partir. »
Le roulement des effectifs n’est
pas la seule difficulté. «Je dois
parfois me battre pour obtenir des
calmants dans le service, dit-il. On
ne peut laisser souffrir un malade !
J’ai dû écrire une lettre à mon chef
de service pour que l’on puisse avoir
des pompes à morphine à proposer
aux patients qui souffrent.» Son
service ne disposait pas de hotte à
flux laminaire pour prévenir les
risques lors de la préparation des
traitements anticancéreux. «Des
infirmières du service attrapaient
des dermatoses, dit-il. L’une d’elles,
qui effectuait ces préparations, se
grattait de plus en plus. Elle perdait
ses cheveux. Tout le monde connais-
sait la solution – il faut de telles
hottes au-dessus du plan de travail
– mais personne ne disait rien. Il a
fallu en réclamer ! » Le service finit
par obtenir une hotte d’occasion
lorsqu’un autre chef de service
parvient à en acquérir une neuve.
Ces économies finissent par re-
venir cher, en termes de santé,
pour la Sécurité sociale. «Je fré-
mis quand j’entends parler de coût
de la santé, dit-il. Dans un tel do-
maine, nous devrions pouvoir nous
payer le luxe de gaspiller ! La Sécu
n’a jamais eu pour vocation de faire
des profits... Comment ne pas s’em-
porter quand on nous parle de
maîtrise des dépenses de santé si l’on
sait le prix d’un seul missile utilisé en
Yougoslavie ! Il nous arrive de des-
cendre dans la rue pour notre Sécu
ou nos retraites... Mais pas assez ! »
A l’hôpital comme dans les contes
cinématographiques de l’Estaque
de Robert Guédiguian, une ac-
tion collective et solidaire ren-
drait chacun plus fort. «Elle de-
vrait aider à se sentir moins seul,
dit-il. Lorsqu’on a une idée d’amé-
lioration, il faut oser la soumettre à
son patron. Mais, de nos jours, tout
le monde a peur. Dans les entre-
prises, la première des peurs, c’est
celle de la précarité. Même à l’hôpi-
tal public, de plus en plus de soi-
gnants sont embauchés en CDD. Les
infirmières ont peur parce que le
mari a peur, parce que les enfants
ont peur, parce que la société a peur.
Nous vivons trop dans la crainte du
lendemain. »
Gérard Meylan travaille cinq
nuits de dix heures d’affilée.
A 6 h 15, le matin, il attend
l’équipe de jour et la surveil-
lante au lieu de s’en aller. «Lors-
qu’ils arrivent, nous discutons,
dit-il. En abordant des difficultés,
nous pouvons avancer des solu-
tions. Mais tout le monde est apeuré
dès qu’il s’agit d’aller les proposer à
la direction. »
Plus on éloigne les personnes les
unes des autres, moins on leur
donne la possibilité de trouver
les solutions dont elles ont be-
soin ! «Dans le service de pneumo
où je travaille, on assiste à une
déliquescence du lien entre méde-
cins, soignants, agents de service et
aides-soignantes, dit-il. Beaucoup
s’hyperspécialisent dans leurs coins,
y compris les infirmières. » Cela
contribue à cette dégradation
actuelle. «A l’hôpital comme pour
tout travail, je préfère qu’une per-
sonne milite à n’importe quel syn-
dicat plutôt que de ne rien faire,
lance-t-il. J’ai été délégué syndical !
Les infirmières venaient me trouver
pour me dire : alors qu’est-ce que tu
fais ? Rien ne bouge ? Mais rien ne
bouge du fait d’un seul individu.
Qu’il s’agisse d’éducation du patient,
d’amélioration des conditions de tra-
vail des soignants ou de qualité des
soins, il ne faut pas avoir peur d’ar-
gumenter et d’insister. Il y a des
choses dont on doit faire des éten-
dards de lutte ! »
Marc Blin
©1997-J. Riboud-Agat Films
Film :
A l’attaque.
1
/
2
100%