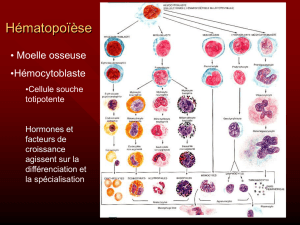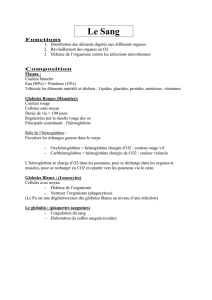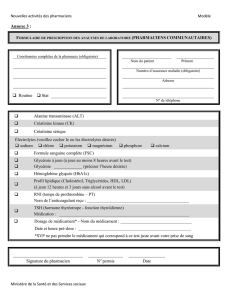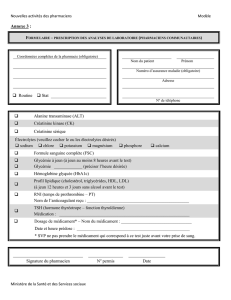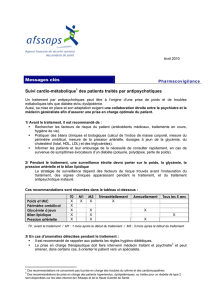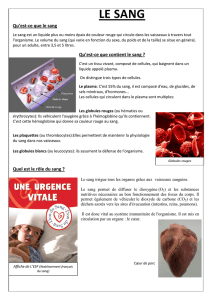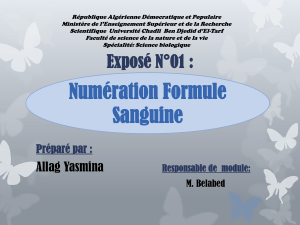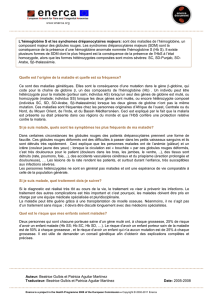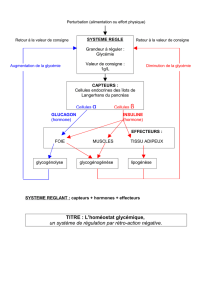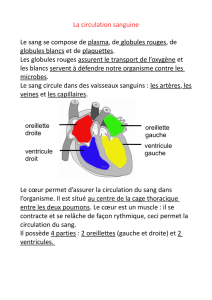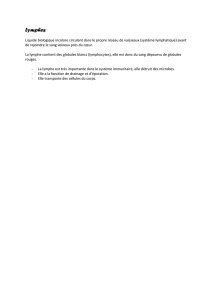Voir le carnet version consultable en PDF

QUE CHERCHE-T-ON DANS
UNE PRISE DE SANG ?

Ce carnet est la réalisation d’un groupe d’étu-
diant.e.s en soins infirmiers et d’étudiant.e.s en médecine
dans le cadre d’un concours organisé par la Mutuelle Natio-
nale des Hospitaliers (MNH) autour du thème « L’informa-
tion au patient ».
Il vous permettra de comprendre les dosages les plus
fréquemment réalisés au cours de votre hospitalisation
selon le service où vous vous trouvez.
Vous y trouverez des pages expliquant l’intérêt des dié-
rents éléments recherchés dans une prise de sang (des
logos séparent les diérents paragraphes, une légende
existe sur la page introduisant chaque partie), et vous
aurez la possibilité de vous renseigner auprès de l’équipe
soignante pour noter les résultats jour après jour et ainsi
suivre vous même votre évolution.
L’objectif principal de cet outil est surtout de vous
permettre d’engager plus facilement le dialogue avec vos
soignants, en suscitant chez vous l’envie d’en savoir davan-
tage et en vous incitant à discuter avec vos soignants.
Par ailleurs, il vous permettra de participer à votre propre
suivi ce qui augmente statistiquement l’ecacité de votre
prise en charge (diagnostic, traitement, guérison…).
Enfin, vous y trouverez quelques informations qui pourront
vous être utiles, voir essentielles, tout au long de votre
hospitalisation… et plus si anité !
N’hésitez pas à solliciter vos soignants en cas de questions.
Les informations comprises dans ce carnet ne sont pas
exhaustives.
Elles doivent toutefois vous fournir un socle de base à
partir duquel vous pourrez chercher à en savoir plus sur les
examens qu’on vous propose et/ou votre maladie.
En médecine, chaque cas étant unique, les informations
contenues dans ce carnet ne s’opposent pas aux décisions
et conclusions de votre équipe soignante.
Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous
jugerez nécessaires pour améliorer votre compréhension :
C’est aussi ça, l’information au patient !

SOMMAIRE
Comment se passe une prise de sang ?
EXAMENS COMMUNS À DIFFÉRENTS SERVICES
NUMÉRATION FORMULE SANGUINE
Globules rouges & Hémoglobine
Globules blancs (leucocytes)
Plaquettes
HEMOSTASE (TP, TCA)
IRN
CRP (C reactive protein)
IONOGRAMME SANGUIN
Sodium (Na)
Potassium (K)
HÉMOCULTURES
EXAMENS EN CARDIOLOGIE
TROPONINE
BNP & NT-pro-BNP
EXAMEN EN PNEUMOLOGIE
GAZ DU SANG
EXAMENS EN GASTRO-ENTÉRO-HÉPATOLOGIE
BILAN HÉPATIQUE
(ASAT, ALAT, PAL, GammaGT)
BILIRUBINE
EXAMENS EN ENDOCRINOLOGIE
THYROÏDE (TSH, T3, T4)
DEXTRO
Glycémie à jeun et glycémie capillaire
HÉMOGLOBINE GLYQUÉE (HbA1c)
EXAMEN EN NÉPHROLOGIE
CRÉATININÉMIE
& DÉBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE (DFG)
EXAMENS PLUS SPÉCIALISÉS
ANTICORPS
SÉROLOGIES
GROUPE RAI
BétaHCG
MARQUEURS TUMORAUX
VOS DROITS EN TANT QUE PATIENTS
MON SUIVI PERSONNALISÉ
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
33
34
37
38
38
39
39
40
41
47

Comment se passe une prise de sang ?
La prise de sang est un examen prescrit par un médecin afin
d'établir un diagnostic sur votre santé. Elle a pour but de
prélever un peu de sang, de l'ordre de 5 ml environ, soit une
cuillère à café par tube, sachant qu'un tube peut être utilisé
pour plusieurs examens. Cela n’aura donc aucun eet néfaste
sur votre santé.
Lorsqu'une prescription est établie, l'infirmière prélève un
échantillon de sang du patient. Elle assure les meilleures
conditions d’hygiène, de sécurité et le bon déroulement de
l’examen.
Où peut-on prélever ?
La prise de sang s'eectue sur n'importe quelle veine appa-
rente. Même si l'infirmière préfèrera les avant-bras. N'hésitez
pas à préciser si vous êtes droitier ou gaucher pour votre
confort.
Pour les personnes sensibles aux prélèvements, vous êtes en
droit de demander un anesthésique local que l'on placera
quelques minutes avant d'eectuer la prise de sang.
Un garrot (sorte d'élastique) vous serrera le bras : il permet de
ralentir le retour du sang des veines vers le coeur et ainsi aug-
mente le volume des veines, ce qui aide votre infirmière à
mieux les sentir. L'infirmière peut également vous tapoter le
bras, dans l’objectif d’augmenter encore un peu le volume des
veines. Une compresse imbibée d'alcool à désinfecter (Chlo-
rexidine) appliquée sur la peau durant quelques secondes
exerce le même eet.
L’infirmière procède d’abord à la désinfection en passant une
compresse imbibée de désinfectant sur votre peau, puis au
prélèvement. Votre examen est terminé. Les résultats sont
disponibles après environ 3 à 4 heures pour des examens stan-
dards.
N'oubliez pas de demander ce qu’on vous prélève
et, si vous le souhaitez, de noter vos résultats à la
fin de ce carnet.

NUMÉRATION FORMULE SANGUINE
Globules rouges & Hémoglobine
L’hémoglobine est une substance contenue dans les
globules rouges. Elle sert à transporter le dioxygène (ou
“oxygène”), nécessaire au fonctionnement du corps. En
mesurant l’hémoglobine, on a une idée plus précise du
nombre de globules rouges et de leur ecacité à trans-
porter le dioxygène.
Le taux d’hémoglobine normal chez l’adulte est pour une
femme entre 12 et 16 g/dl de sang, pour un homme entre
14 et 18 g/dl.
L’hémoglobine doit être présence en quantité susante
pour ne pas mettre en danger l’organisme. Si vous avez
récemment perdu du sang, le dosage de l’hémoglobine
permet de connaître la quantité de sang que vous avez
perdu. S’il vous reste une trop faible quantité (“anémie”),
les soignants pourront décider d’une transfusion de sang.
L’hémoglobine peut être mesurée par un petit appareil qui
donne un résultat grossier (comme par exemple lorsque
vous participez au don du sang). Sur une prise de sang
standard, elle peut être dosée à tout moment de la journée
et ne nécessite pas d’être à jeûn. Elle peut être prélevée
avant et après une transfusion, après l’administration de
certains médicaments ou tout geste qui aurait pu vous
faire saigner (ex : opération chirurgicale).
Une diminution de l’hémoglobine peut être due à de multi-
ples causes parfois entremêlées. On peut suspecter une
carence (ou manque) en fer ou en vitamines particulières
(B9 ou B12), un saignement récent, un état inflammatoire
(qui peut être lié à une maladie chronique ou une infec-
tion, par exemple), un problème hormonal, etc.. Votre
médecin déterminera la cause par l’intermédiaire d’autres
paramètres biologiques, par son examen clinique et par
d’autres explorations si nécessaires.
Plus rarement, une augmentation de l’hémoglobine peut
EXAMENS COMMUNS
À DIFFÉRENTS SERVICES
être observée dans certaines maladies du sang (ex : mala-
die de Vaquez).
Globules blancs (leucocytes)
Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont les
cellules de défense de l’organisme contre les agressions
du monde extérieur (ex : les microbes, virus, bactéries…). Il
existe plusieurs types de globules blancs portant des
noms particuliers (ex : lymphocyte, monocyte, macro-
phage…). Ces diérents globules blancs sont comptés
séparément sur les résultats de la prise de sang, et la ligne
“leucocytes” fait la somme de l’ensemble des globules
blancs.
Le nombre de globules blancs totaux (tout globule blanc
de tout type confondu) doit être compris entre 3.000 et
10.000 leucocytes/ml de sang chez l’adulte.
Le nombre de globule blancs varie d’une personne à
l’autre et selon les situations. Cela permet au médecin
d’évoquer la possibilité que vous soyez atteint d’une infec-
tion (virus, bactérie, champignon…), ou d’une maladie dite
“inflammatoire” par exemple. Quand le nombre de
globules blancs revient à la normal, cela peut être un signe
que le traitement donné est ecace (ex : antibiotiques
dans le cas d’une infection bactérienne).
Les globules blancs sont mesurés sur une prise de sang,
qui peut être eectuée à tout moment de la journée et
sans être à jeûn. La prise de sang peut être répétée tous
les jours, ou plus espacés selon les cas.
Une augmentation ou une diminution du nombre de
globules blancs peut être un signe d’une infection, d’une
maladie “inflammatoire”, ou moins fréquemment, d’une
éventuelle maladie du sang. Le nombre de globules blancs
peut aussi être abaissé ou augmenté par certains médica-
ments comme les corticoïdes ou les chimiothérapies (trai-
tement médicamenteux du cancer).
Plaquettes
Les plaquettes sont des petites cellules du sang qui inter-
viennent dans la coagulation, permettant d’interrompre le
saignement d’une coupure, par exemple. Sur une prise de
sang, leur nombre varie entre 150 à 400 milliard de
plaquettes par millilitres de sang.
Les plaquettes peuvent être dosées pour vérifier la capa-
cité de votre sang à coaguler, par exemple, dans l’optique
d’une intervention chirurgicale à venir. On mesure égale-
ment le nombre de plaquettes en cas de suspicion d’une
maladie du sang (ou de la coagulation) si vous manifestez
des “bleus” pour des chocs extrêmement minimes éven-
tuellement. Les plaquettes sont souvent dosées en même
temps que l’hémoglobine et les globules blancs de façon
systématique.
Les plaquettes se mesurent sur une prise de sang, qui peut
être eectuée à tout moment de la journée et sans être à
jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou
plus espacés selon les cas.
Une augmentation des plaquettes peut être liée à une
carence en fer, un état inflammatoire lié à une infection
(virale, bactérienne, etc.) ou une maladie dite inflamma-
toire, ou dans de rares cas à une maladie du sang. L’aug-
mentation des plaquettes augmente notamment le risque
de faire une phlébite (qui correspond à une activation de
la coagulation dans une veine, souvent de la jambe).
Une diminution des plaquettes peut être observée à la
prise de certains médicaments, dans de rares maladies du
sang ou lors d’une forte activation des phénomènes de
coagulation. Le risque principal est un saignement impor-
tant, car la coagulation sera peu ou pas ecace.
HÉMOSTASE (TP, TCA)
L’hémostase désigne la capacité du sang à coaguler, c’est
à dire, à arrêter un saignement (après une coupure ou une
prise de sang par exemple). Cette fonction dépend de
plusieurs éléments comme les plaquettes (des cellules du
sang) ou des substances particulières appelées “facteur
de coagulation” (on les désigne souvent en disant “fac-
teur” suivit d’un chire romain, ex : “facteur VIII”). Une
hémostase perturbée peut signifier que la coagulation est
défaillante, ou au contraire, s’active trop vite.
L’hémostase peut être étudiée en dosant le TP (Temps de
Prothrombine) et le TCA (Temps de Céphaline Activée),
qui sont 2 mesures de la capacité du sang à coaguler lors-
qu’il est mis en présence de diérentes substances dans
des tubes. L’hémostase ainsi réalisée permet de détecter
certaines maladies liées à une absence ou une inecacité
de certains facteurs de la coagulation, comme l’hémophi-
lie ou la maladie de Willebrand. Avant toute intervention
chirurgicale ou geste pouvant faire saigner, l’hémostase
est réalisée pour s’assurer d’un faible risque d’hémorragie
(saignement).
L’hémostase se mesure sur une prise de sang, qui peut
être eectuée à tout moment de la journée et sans être à
jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou
plus espacés selon les cas.
Une augmentation des temps (TP, TCA) de l’hémostase
peut être liée à la prise de médicaments particuliers
comme les anticoagulants ou les antiagrégants plaquet-
taires (ex : acide acétylsalicylique connu sous le nom com-
mercial d’Aspirine®), à l’anomalie de certains facteurs de la
coagulation (maladie de Willebrand, hémophilie) ou
d’autres troubles du métabolisme (ex : insusance hépa-
tique).
Une diminution de ces temps est exceptionnelle et se
rencontre en cas d’anomalie d’autres facteurs de la coagu-
lation, essentiellement.
INR
L’INR (International Normalized Ratio = Rapport Normali-
sé International) est un chire qui décrit l’ecacité du
traitement anticoagulant (pour fluidifier le sang) de la
famille des anti-vitamine K (par exemple la Warfarine ou
Coumadine®, le Fluindione ou Previscan® ...).
La valeur habituelle de l’INR chez un sujet sans traitement
anticoagulant est de 1.
On le dose pour pouvoir suivre l’ecacité du traitement
par anti vitamine K. En eet ces traitements nécessitent
une surveillance biologique stricte afin d’adapter la dose à
prendre pour chaque patient personnellement. En eet
l’objectif cible de l’INR dépend du patient et de sa maladie
(ex : fibrillation auriculaire, prothèse de valve cardiaque,
phlébite…)
Le dosage de l’INR est réalisé à partir d’une prise de sang
qui peut être eectuée à tout moment de la journée et
sans être à jeûn.
Lorsqu’on commence un traitement par anticoagulant, il
est nécessaire de contrôler toutes les 48h l’INR jusqu’à
obtenir deux INR de suite dans la cible donnée par votre
médecin (par exemple entre 2 et 3).
Ensuite une prise de sang tous les mois est recommandé
pour suivre le traitement. En cas d’anomalies, la prise de
sang pourra être contrôlée de façon rapprochée (48h
d’intervalle généralement).
Il est important d’en parler avec votre médecin traitant
pour avoir un bon suivi car les anti-vitamine K sont les
principaux médicaments en France qui entraînent une
hospitalisation et des complications parfois graves.
En cas d’augmentation de l’INR, on peut craindre une aug-
mentation du risque de saigner.
En cas de diminution de l’INR, on peut craindre que le
traitement instauré ne soit pas ecace ayant pour consé-
quence la formation de caillots de sang qui peuvent bou-
cher les vaisseaux.
CRP (C reactive protein)
La CRP est une protéine fabriquée par le foie en réponse à
une inflammation, c’est à dire une activation des capacités
de défense de l’organisme face à une agression (virus,
bactérie, champignon ou maladie…).
La CRP est donc une substance très utile pour montrer
l’existence d’une inflammation dont il faudra ensuite trou-
ver la cause. Elle s’élève rapidement après le début de
l’inflammation et persiste tant que dure cette inflamma-
tion. Elle permet donc également de suivre l’évolution des
choses sous l’eet d’un traitement (antibiotiques ou
anti-inflammatoire par exemple).
La CRP se mesure sur une prise de sang, qui peut être
eectuée à tout moment de la journée et sans être à jeûn.
La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou plus
espacée selon les cas.
Une augmentation de la CRP (supérieure à 5 mg/ml) est
synonyme d’inflammation. Cette inflammation peut avoir
de nombreuses causes dont les plus fréquentes sont les
infections (par un virus, une bactérie, un champignon…) ou
les maladies dites “inflammatoires” (ex : poussée d’ar-
throse, lupus, allergie…).
Une diminution de la CRP n’a pas de sens, sauf si la CRP
était supérieure à 5 mg/ml sur les prises de sang précé-
dentes, où elle suggère une tendance à la résolution de
l’inflammation.
IONOGRAMME SANGUIN
Sodium (Na)
Le sodium est un élément chimique. Son symbole est Na.
Les valeurs normales du sodium dans le sang (la Natré-
mie) se situent entre 135 et 145mmol/L.
La quantité de sodium dans le sang est le reflet de l’état
d’hydratation des cellules du corps humain. On parle d’hy-
dratation intracellulaire.
On peut suspecter une déshydratation intracellulaire
devant certains signes comme : une soif parfois intense,
une sécheresse des muqueuses (la face interne des joues
par exemple), une perte de poids.
Les signes d'hyperhydratation intracellulaire sont au
contraire peu spécifiques et dépendent de la valeur du
sodium dans le sang (inférieure à la norme).
La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un
horaire particulier. Une prise de sang sera réalisée réguliè-
rement pour vérifier le sodium, et donc l’hydratation des
cellules.
Il faudra bien s’hydrater si le sodium est supérieur à la
norme (on parle d’hypernatrémie) ou au contraire limiter
l’apport de boisson si le sodium est inférieur à la norme
(on parle d’hyponatrémie).
En cas d’augmentation du sodium dans le sang, on parle
d’hypernatrémie qui peut être liée à un excès d’apport (ex
: trop de sel), à un diabète insipide (maladie définie par un
problème de gestion de la quantité d’eau et de sel dans le
corps), ou à un excès de perte soit par le rein soit par le
tube digestif (vomissements, diarrhée…) ou la sueur.
En cas de diminution du sodium dans le sang, on parle
d’hyponatrémie. Elle peut être liée à des dicultés pour le
rein à éliminer l’eau en excès, ou à une augmentation de la
fabrication d’une hormone nommée ADH (Hormone
Anti-Diurétique) qui a pour eet de retenir l’eau dans le
corps.
Potassium (K)
Le potassium est un élément chimique, son symbole est le
K.
Les valeurs normales du potassium dans le sang (la Kalié-
mie) se situent entre 3,5 et 5,0 mmol/L.
De nombreuses pathologies ou médicaments sont respon-
sables d’une modification du potassium dans le sang. Une
anomalie de la concentration du potassium dans le sang
peut avoir des conséquences graves, notamment sur le
cœur. Il est donc important d’en avoir un reflet régulière-
ment (quasiment à chaque hospitalisation) et de suivre
son évolution.
La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un
horaire particulier.
En cas d’anomalie, un électrocardiogramme (ECG) peut
être réalisé pour voir l’eet sur le cœur, et une prise de
sang de contrôle sera réalisée régulièrement (voir quoti-
diennement).
En cas de maladies modifiant le potassium, le médecin
pourra le suivre régulièrement même si initialement il était
normal.
En cas d’augmentation de la kaliémie, on parle d’hyperka-
liémie qui peut être liée : à un excès d’apport, à un trans-
fert exagéré du potassium des cellules vers le sang ou à
une diminution de la capacité du rein à l’éliminer.
En cas de diminution de la kaliémie ; on parle d’hypokalié-
mie qui peut être liée à un manque de potassium dans
l’alimentation, à un transfert exagéré du potassium depuis
le sang vers l’intérieur des cellules ou à un excès de pertes
(vomissements, diarrhée…).
HÉMOCULTURES
Lors d’une infection par une bactérie ou par un champi-
gnon, l’agent infectieux (la bactérie ou le champignon)
peuvent se répandre dans l’organisme en circulant dans le
sang. On parle alors de septicémie.
Pour détecter une septicémie, on prélève un peu de sang
que l’on dépose dans des flacons particuliers qui
permettent aux agents infectieux de se multiplier au sein
de celui-ci.
Il est alors possible, au bout de quelques jours, d’analyser
le contenu du flacon pour déterminer si un agent infec-
tieux est présent, et l’identifier afin d’adapter le traite-
ment.
Les hémocultures sont indispensables en cas de fièvre,
celle-ci pourrait en eet être d’origine infectieuse.
Les hémocultures sont nécessaires pour diagnostiquer
une septicémie et déterminer l’agent infectieux respon-
sable de l’infection.
Ainsi, le traitement mis en place pourra être optimisé pour
lutter plus précisément contre l’éventuel agent infectieux
qui aura été mis en évidence dans les flacons.
Les hémocultures se réalisent comme une prise de sang
classique. Les tubes sont diérents des tubes habituels.
Les chances d’obtenir un résultat sont optimisées lorsque
les hémocultures sont prélevées au cours d’un accès de
fièvre accompagné de frissons.
Lorsque le site de l’infection initial est inconnu, deux
flacons peuvent être prélevés à diérents endroits (au
bras d’une perfusion, depuis un “port-à-cath” ou cathéter
implantable …). Dans certains cas, les hémocultures pour-
ront être prélevées chaque jour sur plusieurs jours de
suite.
Si un agent infectieux est mis en évidence, des hémocul-
tures de contrôle pourront être réalisées dans les jours
suivants et ce parfois jusqu’à ce que l’agent infectieux ne
soit plus retrouvé (prouvant la résolution de l’infection et
l’ecacité du traitement).
Des hémocultures anormales mettent en évidence un
agent infectieux et témoignent de sa circulation dans le
sang. Il existe des cas d’hémocultures anormales liées à un
défaut de désinfection lors du prélèvement.
Des hémocultures de contrôle seront réalisées pour faire
la part des choses entre une infection ou une erreur de
désinfection.
NUMÉRATION FORMULE SANGUINE
Globules rouges & Hémoglobine
Globules blancs (leucocytes)
Plaquettes
HEMOSTASE (TP, TCA)
IRN
CRP (C reactive protein)
IONOGRAMME SANGUIN
Sodium (Na)
Potassium (K)
HÉMOCULTURES
Qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi on le dose ?
Quel est le suivi ?
Quelles sont les principales causes d’anomalies ?
NUMÉRATION FORMULE SANGUINE
Globules rouges & Hémoglobine
L’hémoglobine est une substance contenue dans les
globules rouges. Elle sert à transporter le dioxygène (ou
“oxygène”), nécessaire au fonctionnement du corps. En
mesurant l’hémoglobine, on a une idée plus précise du
nombre de globules rouges et de leur ecacité à trans-
porter le dioxygène.
Le taux d’hémoglobine normal chez l’adulte est pour une
femme entre 12 et 16 g/dl de sang, pour un homme entre
14 et 18 g/dl.
L’hémoglobine doit être présence en quantité susante
pour ne pas mettre en danger l’organisme. Si vous avez
récemment perdu du sang, le dosage de l’hémoglobine
permet de connaître la quantité de sang que vous avez
perdu. S’il vous reste une trop faible quantité (“anémie”),
les soignants pourront décider d’une transfusion de sang.
L’hémoglobine peut être mesurée par un petit appareil qui
donne un résultat grossier (comme par exemple lorsque
vous participez au don du sang). Sur une prise de sang
standard, elle peut être dosée à tout moment de la journée
et ne nécessite pas d’être à jeûn. Elle peut être prélevée
avant et après une transfusion, après l’administration de
certains médicaments ou tout geste qui aurait pu vous
faire saigner (ex : opération chirurgicale).
Une diminution de l’hémoglobine peut être due à de multi-
ples causes parfois entremêlées. On peut suspecter une
carence (ou manque) en fer ou en vitamines particulières
(B9 ou B12), un saignement récent, un état inflammatoire
(qui peut être lié à une maladie chronique ou une infec-
tion, par exemple), un problème hormonal, etc.. Votre
médecin déterminera la cause par l’intermédiaire d’autres
paramètres biologiques, par son examen clinique et par
d’autres explorations si nécessaires.
Plus rarement, une augmentation de l’hémoglobine peut
être observée dans certaines maladies du sang (ex : mala-
die de Vaquez).
Globules blancs (leucocytes)
Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont les
cellules de défense de l’organisme contre les agressions
du monde extérieur (ex : les microbes, virus, bactéries…). Il
existe plusieurs types de globules blancs portant des
noms particuliers (ex : lymphocyte, monocyte, macro-
phage…). Ces diérents globules blancs sont comptés
séparément sur les résultats de la prise de sang, et la ligne
“leucocytes” fait la somme de l’ensemble des globules
blancs.
Le nombre de globules blancs totaux (tout globule blanc
de tout type confondu) doit être compris entre 3.000 et
10.000 leucocytes/ml de sang chez l’adulte.
Le nombre de globule blancs varie d’une personne à
l’autre et selon les situations. Cela permet au médecin
d’évoquer la possibilité que vous soyez atteint d’une infec-
tion (virus, bactérie, champignon…), ou d’une maladie dite
“inflammatoire” par exemple. Quand le nombre de
globules blancs revient à la normal, cela peut être un signe
que le traitement donné est ecace (ex : antibiotiques
dans le cas d’une infection bactérienne).
Les globules blancs sont mesurés sur une prise de sang,
qui peut être eectuée à tout moment de la journée et
sans être à jeûn. La prise de sang peut être répétée tous
les jours, ou plus espacés selon les cas.
Une augmentation ou une diminution du nombre de
globules blancs peut être un signe d’une infection, d’une
maladie “inflammatoire”, ou moins fréquemment, d’une
éventuelle maladie du sang. Le nombre de globules blancs
peut aussi être abaissé ou augmenté par certains médica-
ments comme les corticoïdes ou les chimiothérapies (trai-
tement médicamenteux du cancer).
Plaquettes
Les plaquettes sont des petites cellules du sang qui inter-
viennent dans la coagulation, permettant d’interrompre le
saignement d’une coupure, par exemple. Sur une prise de
sang, leur nombre varie entre 150 à 400 milliard de
plaquettes par millilitres de sang.
Les plaquettes peuvent être dosées pour vérifier la capa-
cité de votre sang à coaguler, par exemple, dans l’optique
d’une intervention chirurgicale à venir. On mesure égale-
ment le nombre de plaquettes en cas de suspicion d’une
maladie du sang (ou de la coagulation) si vous manifestez
des “bleus” pour des chocs extrêmement minimes éven-
tuellement. Les plaquettes sont souvent dosées en même
temps que l’hémoglobine et les globules blancs de façon
systématique.
Les plaquettes se mesurent sur une prise de sang, qui peut
être eectuée à tout moment de la journée et sans être à
jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou
plus espacés selon les cas.
Une augmentation des plaquettes peut être liée à une
carence en fer, un état inflammatoire lié à une infection
(virale, bactérienne, etc.) ou une maladie dite inflamma-
toire, ou dans de rares cas à une maladie du sang. L’aug-
mentation des plaquettes augmente notamment le risque
de faire une phlébite (qui correspond à une activation de
la coagulation dans une veine, souvent de la jambe).
Une diminution des plaquettes peut être observée à la
prise de certains médicaments, dans de rares maladies du
sang ou lors d’une forte activation des phénomènes de
coagulation. Le risque principal est un saignement impor-
tant, car la coagulation sera peu ou pas ecace.
HÉMOSTASE (TP, TCA)
L’hémostase désigne la capacité du sang à coaguler, c’est
à dire, à arrêter un saignement (après une coupure ou une
prise de sang par exemple). Cette fonction dépend de
plusieurs éléments comme les plaquettes (des cellules du
sang) ou des substances particulières appelées “facteur
de coagulation” (on les désigne souvent en disant “fac-
teur” suivit d’un chire romain, ex : “facteur VIII”). Une
hémostase perturbée peut signifier que la coagulation est
défaillante, ou au contraire, s’active trop vite.
L’hémostase peut être étudiée en dosant le TP (Temps de
Prothrombine) et le TCA (Temps de Céphaline Activée),
qui sont 2 mesures de la capacité du sang à coaguler lors-
qu’il est mis en présence de diérentes substances dans
des tubes. L’hémostase ainsi réalisée permet de détecter
certaines maladies liées à une absence ou une inecacité
de certains facteurs de la coagulation, comme l’hémophi-
lie ou la maladie de Willebrand. Avant toute intervention
chirurgicale ou geste pouvant faire saigner, l’hémostase
est réalisée pour s’assurer d’un faible risque d’hémorragie
(saignement).
L’hémostase se mesure sur une prise de sang, qui peut
être eectuée à tout moment de la journée et sans être à
jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou
plus espacés selon les cas.
Une augmentation des temps (TP, TCA) de l’hémostase
peut être liée à la prise de médicaments particuliers
comme les anticoagulants ou les antiagrégants plaquet-
taires (ex : acide acétylsalicylique connu sous le nom com-
mercial d’Aspirine®), à l’anomalie de certains facteurs de la
coagulation (maladie de Willebrand, hémophilie) ou
d’autres troubles du métabolisme (ex : insusance hépa-
tique).
Une diminution de ces temps est exceptionnelle et se
rencontre en cas d’anomalie d’autres facteurs de la coagu-
lation, essentiellement.
INR
L’INR (International Normalized Ratio = Rapport Normali-
sé International) est un chire qui décrit l’ecacité du
traitement anticoagulant (pour fluidifier le sang) de la
famille des anti-vitamine K (par exemple la Warfarine ou
Coumadine®, le Fluindione ou Previscan® ...).
La valeur habituelle de l’INR chez un sujet sans traitement
anticoagulant est de 1.
On le dose pour pouvoir suivre l’ecacité du traitement
par anti vitamine K. En eet ces traitements nécessitent
une surveillance biologique stricte afin d’adapter la dose à
prendre pour chaque patient personnellement. En eet
l’objectif cible de l’INR dépend du patient et de sa maladie
(ex : fibrillation auriculaire, prothèse de valve cardiaque,
phlébite…)
Le dosage de l’INR est réalisé à partir d’une prise de sang
qui peut être eectuée à tout moment de la journée et
sans être à jeûn.
Lorsqu’on commence un traitement par anticoagulant, il
est nécessaire de contrôler toutes les 48h l’INR jusqu’à
obtenir deux INR de suite dans la cible donnée par votre
médecin (par exemple entre 2 et 3).
Ensuite une prise de sang tous les mois est recommandé
pour suivre le traitement. En cas d’anomalies, la prise de
sang pourra être contrôlée de façon rapprochée (48h
d’intervalle généralement).
Il est important d’en parler avec votre médecin traitant
pour avoir un bon suivi car les anti-vitamine K sont les
principaux médicaments en France qui entraînent une
hospitalisation et des complications parfois graves.
En cas d’augmentation de l’INR, on peut craindre une aug-
mentation du risque de saigner.
En cas de diminution de l’INR, on peut craindre que le
traitement instauré ne soit pas ecace ayant pour consé-
quence la formation de caillots de sang qui peuvent bou-
cher les vaisseaux.
CRP (C reactive protein)
La CRP est une protéine fabriquée par le foie en réponse à
une inflammation, c’est à dire une activation des capacités
de défense de l’organisme face à une agression (virus,
bactérie, champignon ou maladie…).
La CRP est donc une substance très utile pour montrer
l’existence d’une inflammation dont il faudra ensuite trou-
ver la cause. Elle s’élève rapidement après le début de
l’inflammation et persiste tant que dure cette inflamma-
tion. Elle permet donc également de suivre l’évolution des
choses sous l’eet d’un traitement (antibiotiques ou
anti-inflammatoire par exemple).
La CRP se mesure sur une prise de sang, qui peut être
eectuée à tout moment de la journée et sans être à jeûn.
La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou plus
espacée selon les cas.
Une augmentation de la CRP (supérieure à 5 mg/ml) est
synonyme d’inflammation. Cette inflammation peut avoir
de nombreuses causes dont les plus fréquentes sont les
infections (par un virus, une bactérie, un champignon…) ou
les maladies dites “inflammatoires” (ex : poussée d’ar-
throse, lupus, allergie…).
Une diminution de la CRP n’a pas de sens, sauf si la CRP
était supérieure à 5 mg/ml sur les prises de sang précé-
dentes, où elle suggère une tendance à la résolution de
l’inflammation.
IONOGRAMME SANGUIN
Sodium (Na)
Le sodium est un élément chimique. Son symbole est Na.
Les valeurs normales du sodium dans le sang (la Natré-
mie) se situent entre 135 et 145mmol/L.
La quantité de sodium dans le sang est le reflet de l’état
d’hydratation des cellules du corps humain. On parle d’hy-
dratation intracellulaire.
On peut suspecter une déshydratation intracellulaire
devant certains signes comme : une soif parfois intense,
une sécheresse des muqueuses (la face interne des joues
par exemple), une perte de poids.
Les signes d'hyperhydratation intracellulaire sont au
contraire peu spécifiques et dépendent de la valeur du
sodium dans le sang (inférieure à la norme).
La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un
horaire particulier. Une prise de sang sera réalisée réguliè-
rement pour vérifier le sodium, et donc l’hydratation des
cellules.
Il faudra bien s’hydrater si le sodium est supérieur à la
norme (on parle d’hypernatrémie) ou au contraire limiter
l’apport de boisson si le sodium est inférieur à la norme
(on parle d’hyponatrémie).
En cas d’augmentation du sodium dans le sang, on parle
d’hypernatrémie qui peut être liée à un excès d’apport (ex
: trop de sel), à un diabète insipide (maladie définie par un
problème de gestion de la quantité d’eau et de sel dans le
corps), ou à un excès de perte soit par le rein soit par le
tube digestif (vomissements, diarrhée…) ou la sueur.
En cas de diminution du sodium dans le sang, on parle
d’hyponatrémie. Elle peut être liée à des dicultés pour le
rein à éliminer l’eau en excès, ou à une augmentation de la
fabrication d’une hormone nommée ADH (Hormone
Anti-Diurétique) qui a pour eet de retenir l’eau dans le
corps.
Potassium (K)
Le potassium est un élément chimique, son symbole est le
K.
Les valeurs normales du potassium dans le sang (la Kalié-
mie) se situent entre 3,5 et 5,0 mmol/L.
De nombreuses pathologies ou médicaments sont respon-
sables d’une modification du potassium dans le sang. Une
anomalie de la concentration du potassium dans le sang
peut avoir des conséquences graves, notamment sur le
cœur. Il est donc important d’en avoir un reflet régulière-
ment (quasiment à chaque hospitalisation) et de suivre
son évolution.
La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un
horaire particulier.
En cas d’anomalie, un électrocardiogramme (ECG) peut
être réalisé pour voir l’eet sur le cœur, et une prise de
sang de contrôle sera réalisée régulièrement (voir quoti-
diennement).
En cas de maladies modifiant le potassium, le médecin
pourra le suivre régulièrement même si initialement il était
normal.
En cas d’augmentation de la kaliémie, on parle d’hyperka-
liémie qui peut être liée : à un excès d’apport, à un trans-
fert exagéré du potassium des cellules vers le sang ou à
une diminution de la capacité du rein à l’éliminer.
En cas de diminution de la kaliémie ; on parle d’hypokalié-
mie qui peut être liée à un manque de potassium dans
l’alimentation, à un transfert exagéré du potassium depuis
le sang vers l’intérieur des cellules ou à un excès de pertes
(vomissements, diarrhée…).
HÉMOCULTURES
Lors d’une infection par une bactérie ou par un champi-
gnon, l’agent infectieux (la bactérie ou le champignon)
peuvent se répandre dans l’organisme en circulant dans le
sang. On parle alors de septicémie.
Pour détecter une septicémie, on prélève un peu de sang
que l’on dépose dans des flacons particuliers qui
permettent aux agents infectieux de se multiplier au sein
de celui-ci.
Il est alors possible, au bout de quelques jours, d’analyser
le contenu du flacon pour déterminer si un agent infec-
tieux est présent, et l’identifier afin d’adapter le traite-
ment.
Les hémocultures sont indispensables en cas de fièvre,
celle-ci pourrait en eet être d’origine infectieuse.
Les hémocultures sont nécessaires pour diagnostiquer
une septicémie et déterminer l’agent infectieux respon-
sable de l’infection.
Ainsi, le traitement mis en place pourra être optimisé pour
lutter plus précisément contre l’éventuel agent infectieux
qui aura été mis en évidence dans les flacons.
Les hémocultures se réalisent comme une prise de sang
classique. Les tubes sont diérents des tubes habituels.
Les chances d’obtenir un résultat sont optimisées lorsque
les hémocultures sont prélevées au cours d’un accès de
fièvre accompagné de frissons.
Lorsque le site de l’infection initial est inconnu, deux
flacons peuvent être prélevés à diérents endroits (au
bras d’une perfusion, depuis un “port-à-cath” ou cathéter
implantable …). Dans certains cas, les hémocultures pour-
ront être prélevées chaque jour sur plusieurs jours de
suite.
Si un agent infectieux est mis en évidence, des hémocul-
tures de contrôle pourront être réalisées dans les jours
suivants et ce parfois jusqu’à ce que l’agent infectieux ne
soit plus retrouvé (prouvant la résolution de l’infection et
l’ecacité du traitement).
Des hémocultures anormales mettent en évidence un
agent infectieux et témoignent de sa circulation dans le
sang. Il existe des cas d’hémocultures anormales liées à un
défaut de désinfection lors du prélèvement.
Des hémocultures de contrôle seront réalisées pour faire
la part des choses entre une infection ou une erreur de
désinfection.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%