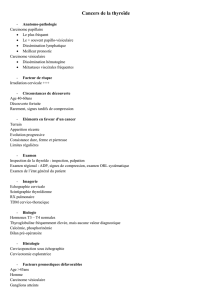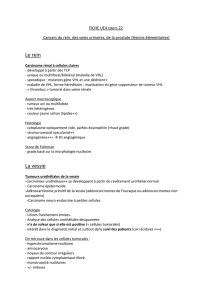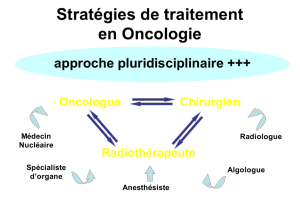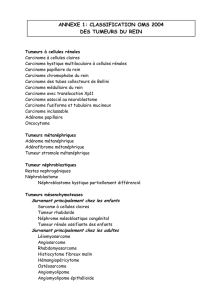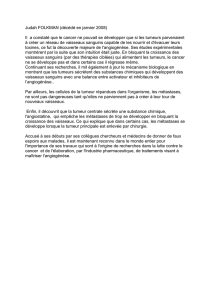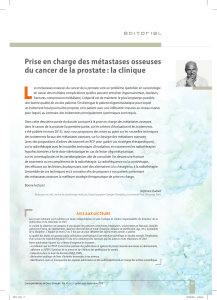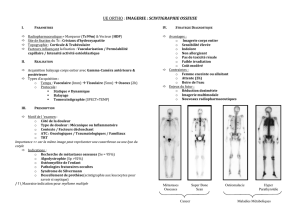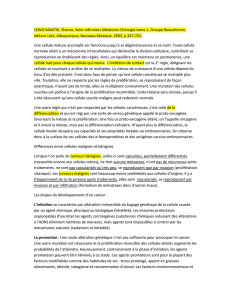Stratégie de prise en charge des métastases osseuses révélatrices

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338
Stratégie de prise en charge des métastases osseuses révélatrices
Diagnostic management of inaugurable bone metastases
Michele Tubiana-Hulina,∗, Charles de Maulmontb, Jean-Marc Guinebretière c
aDépartement d’oncologie médicale, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, 92210 Saint-Cloud, France
bDépartement de radiologie, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, Saint-Cloud, France
cDépartement de pathologie, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, Saint-Cloud, France
Accepté le 19 janvier 2008
Disponible sur Internet le 1 avril 2008
Mots clés : Métastases osseuses ; Diagnostic ; Biopsie ; Anatomopathologie
Keywords: Bone metastases; Diagnostis; Biopsy; Pathology
Bien que le diagnostic de métastases osseuses soit synonyme
d’incurabilité dans la plupart des cas, le diagnostic étiologique
a un intérêt majeur car il conditionne un traitement antitumo-
ral adapté, susceptible de contrôler l’évolution à moyen ou à
long termes, en particulier en cas de tumeurs hormonosensibles,
hémopathies, tumeurs thyroïdiennes...mais aussi dans d’autres
types de tumeurs pour lesquelles l’arsenal thérapeutique a pro-
gressé récemment : cancers du rein, du colon, hépatocarcinomes,
tumeurs neuroendocrines...
Un certain nombre de métastases osseuses surviennent en
cours de suivi d’un cancer connu et pose peu de problèmes
diagnostiques. À l’inverse, l’identification de la tumeur primi-
tive est difficile dans près de la moitié des cas lorsque la ou
les métastases sont inaugurales et de surcroît isolées : l’origine
n’est pas retrouvée dans4à10%descasseulement [1,2].La
recherche de la tumeur primitive doit comporter un examen
clinique attentif, quelques examens systématiques d’imagerie
appréciant de fac¸on conjointe l’extension tumorale et les prélè-
vements cytohistologiques de la métastase. La mise en défaut
de cette confrontation ne doit pas retarder au delà les décisions
thérapeutiques. La tumeur primitive peut être à la limite de la
détectabilité, voire même non retrouvée à l’examen autopsique
[3]. La découverte de certaines tumeurs primitives ne modifie
pas le pronostic en l’absence de traitement antitumoral actif [4]
et il est alors inutile et dommageable d’entamer une longue
procédure d’explorations radiologiques ou endoscopiques qui
∗Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (M. Tubiana-Hulin).
majorent l’inconfort et l’angoisse du patient, ainsi que le coût
économique de la prise en charge.
L’incidence des métastases osseuses révélatrices varie en
fonction des structures médicales qui les prennent en charge. Elle
est peu fréquente dans les centres de cancérologie où l’effort de
recrutement et de communication est fait sur le diagnostic pré-
coce des tumeurs les plus courantes, en particulier le cancer du
sein et de la prostate. Dans ces structures, la ou les métastase(s)
osseuse(s) révélatrice(s), s’inscrive(nt) le plus souvent dans le
suivi d’un cancer primitif connu et traité (Tableau 1).
1. Métastases osseuses révélatrices avec antécédents de
cancer
Le problème diagnostique est le plus souvent simple si trois
éléments sont présents :
•localisations osseuses multiples, aspect radiologique compa-
tible avec l’antécédent tumoral
•connu et
•élévation significative du marqueur sérique spécifique (par
exemple : localisations osseuses condensantes, PSA élevé,
antécédent de cancer prostatique, ou encore, localisations
ostéolytiques ou mixtes, élévation du marqueur CA 15-3,
antécédent de cancer du sein invasif.
La preuve histologique de la métastase apparaît alors super-
flue pour la majorité des cliniciens (94 % dans une enquête
européenne francophone conduite par le groupe Gemo) [5].
1169-8330/$ – see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.rhum.2008.01.002

M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338 333
Tableau 1
Origine des principales métastases osseuses et leur type histologique principal
identifié lors d’autopsie [28]
Site de la tumeur primitive Type histologique principal Fréquence (%)
Sein Adénocarcinome 32,6
Bronches Carcinome épidermoïde 16,8
Inconnu Variable 10,9
Prostate Adénocarcinome 7,7
ORL Carcinome épidermoïde 7,4
Rein Adénocarcinome 4,2
Peau Mélanome 1,9
Vessie Carcinome transitionnel 1,6
Cependant, une telle attitude est remise en question, en rai-
son d’une amélioration des techniques de prélèvement et du
développement des techniques immnohistochimiques et molé-
culaires pouvant influer sur la prise en charge (voir le chapitre
Pathologie).
Une deuxième situation clinique est celle où manque l’un des
éléments de ce trépied. Il existe un antécédent de cancer mais la
localisation osseuse est unique, l’aspect radiologique est inha-
bituel, les marqueurs spécifiques de la tumeur primitive connue
sont normaux. Un antécédent de cancer, même ostéophile, ne
suffit pas à affirmer la filiation. Il faut recourir au prélèvement
osseux dirigé, cytoponctions, biopsies au trocart, plus rarement
la biopsie chirurgicale.
2. Métastases osseuses révélatrices sans antécédent de
cancer
Elles sont révélées par des douleurs osseuses ou une compli-
cation, fractures spontanées ou survenant après un traumatisme
minime, compressions neurologiques, hypercalcémie... le plus
souvent chez des sujets de plus de 60 ans.
Cela explique la prise en charge habituelle en milieu rhuma-
tologique ou en médecine interne, et plus rarement, d’emblée en
chirurgie orthopédique ou neurochirurgie.
2.1. Diagnostic de métastase osseuse
Il repose sur l’imagerie et l’anatomie pathologique. Dans le
temps imparti à la réalisation de ces examens, on conduit la
recherche de la tumeur primitive par une démarche systéma-
tique, secondairement orientée par les résultats histologiques.
Le diagnostic de métastase osseuse est évoqué sur les radio-
graphies standard réalisées en première intention, de faible
sensibilité mais de bonne spécificité, montrant des lésions
d’aspect lytique, mixte ou condensant. La scintigraphie osseuse
au technétium-99 est un examen très sensible qui explore
l’ensemble du squelette, très évocateur quand les images sont
multiples et extra-articulaires ; mais, peu spécifique, rarement,
elle met en évidence une tumeur primitive osseuse méconnue.
Le scanner centré sur la zone douloureuse ou hyperfixante est
plus sensible que les radiographies osseuses et a une très bonne
spécificité. Il montre la destruction osseuse, l’envahissement des
parties molles et permet de guider un geste local biopsique ou
thérapeutique (cimentoplastie ou chirurgie). L’IRM enfin est très
sensible et montre au mieux l’extension locorégionale intramé-
dullaire, vers des parties molles et des structures neurologiques,
mais sa spécificité est moindre que les examens aux rayons X
qui apprécient la structure osseuse.
2.2. Recherche de la tumeur primitive
L’examen clinique requiert un interrogatoire soigneux, avec
une recherche des antécédents personnels et familiaux, du mode
d’apparition des troubles et un examen clinique complet en par-
ticulier de la peau, des seins, des aires ganglionnaires, de la
thyroïde, des touchers pelviens et de l’examen des testicules.
La découverte d’une anomalie conduit à réaliser des examens
complémentaires dirigés.
Il n’y a pas de consensus définitif sur l’imagerie et les exa-
mens biochimiques systématiques en l’absence de piste clinique,
ce d’autant que l’introduction de nouvelles techniques peut faire
reposer la question de l’utilité de chacun d’entre eux [6]. Ce bilan
doit répondre à plusieurs impératifs :
•il doit être efficace, susceptible de dépister les tumeurs les
plus fréquentes et surtout celles conduisant à un traitement
antitumoral spécifique ;
•il doit être rapide afin de ne pas prolonger l’hospitalisation,
majorer l’inconfort du patient et allonger le délai avant trai-
tement.
La majorité des auteurs s’accordent pour juger indispensable
la réalisation d’une mammographie chez la femme même s’il est
rare que l’examen clinique ne montre pas d’anomalie évocatrice
[7]. En effet, il s’agit d’une tumeur très fréquente, ostéophile, et
pour laquelle les possibilités thérapeutiques sont nombreuses.
La radiographie pulmonaire est classiquement demandée, car
l’origine pulmonaire de ces métastases osseuses inaugurales est
très fréquente [2,8], aussi bien chez l’homme et que chez la
femme. Mais elle doit logiquement être remplacée par le scanner
thoracique, dont l’obtention est rapide et qui accroît le taux de
détection de ces tumeurs [9,10].
Une exploration abdominale est utile ; plutôt que
l’échographie abdominale, là encore, le scanner parait
plus performant. On s’attache en particulier à l’exploration de
l’étage sus mésocolique et des reins et surrénales. La réalisation
dans un même examen, du scanner thoracoabdominopelvien
limite les désagréments pour le patient.
Si ces explorations sont négatives, seuls les examens dirigés
(par une anomalie clinique, une particularité de l’étude anatomo-
pathologique, un test biologique) apparaissent justifiés. En leur
absence, les pan-endoscopies ont une rentabilité très faible et
n’ont habituellement pas de sanction pratique.
La tomographie par émission de positron (TEP) au 18-
fluorodéoxyglucose couplée au scanner est un examen de haute
sensibilité qui permet la détection de nombreux foyers tumoraux
ayant échappés aux autres investigations. Son utilisation est de
plus en plus fréquente en pratique oncologique. Cette technique
qui détecte des processus hypermétaboliques a l’avantage d’une
résolution spatiale élevée (aux alentours de 5 mm) et de per-
mettre l’exploration du corps entier en un seul examen. Son

334 M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338
utilisation, en cas de métastase d’origine indéterminée, parait
logique et pourrait théoriquement guider toute investigation
complémentaire [9–12]. Toutefois, la sensibilité est variable
d’un type tumoral à l’autre, moindre dans les cancers pros-
tatiques, rénaux et hépatocarcinomes et globalement dans les
tumeurs faiblement prolifératives [13,14]. L’examen est plus
sensible que la scintigraphie osseuse dans les métastases ostéo-
lytiques ou mixtes, mais les métastases condensantes échappent
souvent à la détection [15].
D’autres molécules comme le fluor ou le carbone-11, encore
en expérimentation, permettraient de palier à cet inconvénient.
De nombreuses publications rapportent les résultats du TEP 18-
FDG chez des patients ayant des métastases de toute localisation
sans primitif connu, explorés préalablement de fac¸on conven-
tionnelle. Le taux de détection de la tumeur primitive a été de 35
à 50 % des cas. Seve et al. [16,17] ont colligé dix études publiées
entre 1998 et 2006 portant sur 221 patients avec une métastase
unique dans 94 % des cas ; la tumeur primitive a été mise en
évidence dans 41 % des cas (une fois sur deux un cancer pulmo-
naire). Globalement, la sensibilité de l’examen était de 91,9 %
et la spécificité de 81,9 %. D’autres métastases méconnues ont
été mises en évidence dans 37 % des cas. Les résultats de cette
exploration ont influé sur la prise en charge dans un tiers des cas
en modifiant la stadification et/ou le protocole thérapeutique. Les
tumeurs primitives de la sphère ORL paraissent bénéficier parti-
culièrement de cette détection [18], mais les métastases osseuses
révélatrices sont rares. Toutefois dans l’étude de Kole et al. [4],le
18-FDG a permis d’identifier la tumeur primitive dans un quart
des cas, mais la survie des patients chez lesquelles la tumeur été
détectée ou non n’a pas été différente.
Au total, le TEP scan fait partie des examens utiles/
nécessaires dans cette indication, d’autres traceurs à l’étude
devraient augmenter les performances de cet examen abou-
tissant à une réalisation plus précoce et une modification de
l’algorithme.
2.3. Apport des marqueurs biochimiques sériques
La grande majorité des marqueurs sériques des cancers tirent
leur intérét du suivi sous traitement des cancers métastatiques,
si l’origine est connue et le taux du marqueur élevé. Les
dosages des marqueurs sériques en routine ont pour la plupart
une trop faible sensibilité et spécificité pour avoir un intérêt
diagnostique....
En cas de métastase osseuse d’origine indéterminée, la réali-
sation d’une batterie de marqueurs sans ciblage diagnostique n’a
pas de justification. Elle est cependant de pratique courante en
raison de la facilité de demande et d’obtention de ces examens.
Un bilan biologique fait partie des examens de première
intention : un bilan ionique et rénal, un bilan phosphocalcique
et hématologique et l’electrophorèse des protides sériques à la
recherche d’une dysglobulinémie. En fonction du sexe et de
l’âge, et en l’absence d’autres orientation, la PSA chez l’homme
au delà de 50 ans serait le seul marqueur vraiment utile en pra-
tique [2,7]. Chez l’homme jeune, la sous-unité bêta de l’HCG
et l’alphafœtoprotéine ont une très bonne spécificité et seront
réalisés de principe malgré la rareté d’une présentation osseuse
d’un cancer du testicule.
Au terme du bilan clinicoradiologique et de l’étude histolo-
gique, la demande sera orientée afin de mettre en évidence un
marqueur susceptible d’aider à la surveillance du traitement [19]
(Tableau 2).
3. Apport de l’examen pathologique
L’analyse histologique est essentielle pour confirmer le diag-
nostic de métastases osseuses (m.o), pour identifier si possible la
tumeur primitive et parfois aider à la sélection du traitement. Elle
s’effectue en plusieurs étapes : étude morphologique, colora-
tions spéciales et surtout études immunohistochimiques lorsque
le type de prélèvement le permet. L’interprétation histologique
ne peut être effectuée qu’en la connaissance des données cli-
niques et radiologiques systématiquement transmises avec le
prélèvement.
3.1. Méthodes de prélèvement
Les prélèvements percutanés sont réalisés à l’aiguille ou au
trocart sous le contrôle de la TDM. Toutes les structures osseuses
du tronc sont accessibles, l’abord des os longs requiert le plus
souvent un concours orthopédique.
Une coupe axiale TDM passant par la lésion osseuse est sélec-
tionnée et permet le choix du trajet de l’aiguille qui doit être le
plus court possible, en évitant les organes vitaux. Son intro-
duction est contrôlée par de nouvelles images TDM. L’aiguille
de cytologie (21G) est un matériel adéquat lorsque l’on vise
une fenêtre de lyse de la corticale ou en cas de corticale fra-
gilisée en regard d’une lésion lytique. L’analyse du matériel
cytologique requiert de la part du pathologiste une expertise
qui assure une excellente sensibilité à cette technique mais
limite son utilisation à quelques centres [21–24]). Un examen
cytologique extemporané, à l’aide d’une coloration rapide (Diff-
Tableau 2
Principaux marqueurs sériques des cancers
Sein CA 15-3, ACE Prostate PSA
Digestifs ACE, CA 19-9 Testicule Bêta HCG totale et libre
Foie AFP, ACE, CA 19-9,NSE AFP
Anus (epid.) cyfra 21-1, SCC Poumons Cyfra 21-1, SCC
Anus (adenok) ACE, CA 19-9 ACE, NSE
Ovaires CA 125, Thyroïde TG,
T germinales Bêta HCG, AFP CT (médullaire)
Antigène carcinoembryonnaire (ACE) ; alphafoetoprotéine (AFP) ; Thyroglobuline (TG) ; enolase neurospécifique (NSE) ; hormone gonadotrophique chorionique
(HCG) ; antigène de carcinome (CA 15-3, CA19-9, CA125, CA 19-9) ; carcinome épidermoïde (SCC) ; calcitonine (CT).

M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338 335
Quik®) permet de s’assurer lors du prélèvement, de la qualité
de la ponction, et de la renouveler si nécessaire. À partir de la
ponction, sont réalisées plusieurs lames d’étalement. L’analyse
cytologique permet de déterminer la catégorie tumorale, carci-
nome, sarcome, lymphome et d’orienter vers un type particulier.
Une analyse immunohistochimique sur inclusion en cytobloc
d’une partie du matériel prélevé est possible et performante,
lorsque la cellularité est suffisante [25]. En cas de lésion conden-
sante, l’aiguille cytologique peut encore mais plus difficilement
forer la corticale fragilisée, mais plus dure, toutefois la pauvreté
cellulaire habituelle fait choisir préférentiellement un prélève-
ment biopsique (trocart de Mazabraud, trocart de Laredo). Les
prélèvements osseux guidés rapportent du matériel en quantité
suffisante pour l’étude diagnostique dans 90 % des cas de lésion
ostéolytique [7,20], de l’ordre de 75 % dans les lésions scléro-
tiques obligeant à recourir à la biopsie ouverte. Sa qualité est
déterminée par le choix du site de biopsie, qui doit concerner
des secteurs non nécrosés et représentatifs de l’ensemble de la
lésion et par le trajet de biopsie [7,20,26]. Son repérage est sys-
tématique (si l’on suspecte une tumeur primitive osseuse) pour
permettre, en cas d’intervention chirurgicale ultérieure à visée
curative, son exérèse afin de prévenir les colonisations tumorales
le long du trajet. Les lésions très vascularisées peuvent nécessiter
une embolisation préalable afin de limiter les risques hémorra-
giques. Il n’y a pas de contrôle extemporané de la représentativité
du prélèvement. Les prélèvements nécessitent une fixation (for-
mol tamponné), puis une décalcification et une inclusion en
paraffine, soit environ deux à trois jours de technique pour
obtenir les colorations standard (HES). Ainsi le choix du pré-
lèvement, cytologique ou biopsique, est décidé par l’opérateur
en fonction de la cible et de la difficulté de son abord, ainsi
que d’une orientation diagnostique éventuelle. Rarement une
biopsie chirurgicale est préférée, en cas de formes condensantes
peu cellulaires ou de lésions uniques faisant discuter le diagnos-
tic de tumeur primitive. Dans ce dernier cas, c’est la technique
de référence car elles nécessitent un volume biopsique impor-
tant, en raison de leur grande hétérogénéité histologique et de la
nécessité de conservation de fragments en tumorothèque.
3.2. Voie d’abord
Pour les vertèbres lombaires, l’abord est latéral au corps ver-
tébral en suivant le bord antérieur de l’apophyse transverse. Au
niveau dorsal, on évite le poumon par abord postérolatéral sous
la côte, ou par voie transpédiculaire. À l’étage cervical le plus
délicat, le trajet est le plus souvent antérolatéral.
Pour les os plats, et notamment l’aile iliaque, un trajet com-
mode est longitudinal dans l’axe de l’os, par voie antérieure
sous l’épine antérosupérieure en décubitus, ou par la pointe
postérieure de l’os en procubitus.
3.3. Analyse microscopique
À la différence des tumeurs osseuses primitives dont l’aspect
histologique est hétérogène, variable selon les secteurs, les
métastases sont entièrement homogènes, ce qui permet de réa-
liser leur diagnostic sur de petits fragments. Il n’existe que
Fig. 1. Abord latéral de L4 à l’aiguille de PL.
Fig. 2. Ponction de la partie postérieure de l’aile iliaque au trocart de Laredo.
peu de différences morphologiques entre la tumeur primitive et
ses localisations osseuses, parfois celles-ci apparaissent moins
différenciées, de fac¸on exceptionnelle, elles sont mieux diffé-
renciées.
(Figs. 1–3) Les grandes séries publiées ont permis d’identifier
les tumeurs primitives les plus fréquemment associées aux
métastases osseuses [27–30]. Toutefois, sont aujourd’hui
identifiées des métastases osseuses de tumeurs dont cette
localisation était considérée comme exceptionnelle. On peut
citer l’hépatocarcinome et le mésothéliome, ce qui est lié à
l’amélioration des traitements et de la sensibilité des techniques
d’imagerie osseuse.
Fig. 3. Abord antérieur d’une lésion iliague avec envahissement antérieur des
parties molles.

336 M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338
L’analyse microscopique est parfois simple car l’aspect de
quelques types histologiques apparaît caractéristique et permet
immédiatement la reconnaissance de la localisation primitive.
On peut citer quelques exemples :
•les tumeurs formées de grandes cellules à cytoplasme clarifié,
d’aspect végétal, agencées en larges plages et associées à de
nombreux petits capillaires, qui orientent vers un cancer du
rein ;
•les lésions constituées de vésicules à contenu éosinophile
acellulaire, colloïde, qui correspondent à une localisation
secondaire d’un carcinome vésiculaire de la thyroïde ;
•les lésions formées de cellules globuleuses ou fusiformes
renfermant un pigment noirâtre, mélanique permettant
d’identifier un mélanome (la découverte de la lésion primi-
tive peut être difficile en raison de la régression spontanée
possible de la tumeur primitive ou de son développement à
partir de muqueuses) ;
•une lésion associant de petites cellules rondes, à noyaux à
chromatine fine, groupées en massifs avec un fond fibril-
laire, oriente chez un enfant de moins de trois ans vers un
neuroblastome.
Mais le plus souvent, les lésions sont peu différenciées ou leur
aspect non caractéristique, nécessitant des techniques spéciales
intégrant l’analyse immunohistochimique. Elles seront combi-
nées conduisant à une analyse en plusieurs étapes qui vise à
déterminer (Tableau 3):
•le type histologique : sarcome, mélanome, lymphome, méso-
théliome, tumeurs neuroendocrines et surtout carcinome ;
•le sous-type comme par exemple épidermoïde, glandulaire ou
transitionnel pour les carcinomes, léiomyosarcome, neurosar-
come, sarcome stromal du tube digestif ou angiosarcome pour
les sarcomes.
Les carcinomes épidermoïdes reproduisent plus ou moins
bien la structure d’un épithélium de type malpighien. Ils
s’observent principalement dans les bronches, la filière ORL,
l’œsophage et le col utérin.
Le carcinome de souche glandulaire, ou adénocarcinome,
se développe à partir d’un épithélium glandulaire. Les loca-
lisations osseuses les plus fréquentes sont dues aux tumeurs
du sein, de la prostate, du poumon, du rein et de la thyroïde ;
•l’origine.
Peu de marqueurs sont en fait spécifiques d’un type histo-
logique ou d’une origine donnés, comme la thyrocalcitonine
du carcinome médullaire de la thyroïde ou le PSA pour le
carcinome prostatique. Ainsi, les récepteurs hormonaux, aux
estrogènes et à la progestérone, exprimés dans plus de 60 % des
carcinomes mammaires, sont également fréquemment positifs
dans les carcinomes de l’endomètre, de l’ovaire, des glandes
annexielles et plus faiblement dans certains carcinomes pulmo-
naires, thyroïdiens et prostatiques. Ils sont également présents
dans les méningiomes, les léiomyomes, léiomyosarcomes et
tumeurs stromales de l’utérus et certaines fibromatoses. C’est
pourquoi l’analyse doit combiner différents marqueurs choisis et
interprétés en fonction de l’aspect morphologique de la tumeur.
Pour les carcinomes, une aide importante est apportée par
l’étude des cytokératines (CK). Il s’agit de filaments intermé-
diaires présents dans le cytoplasme des cellules épithéliales
dont une vingtaine de types différents est identifiée, classés
selon leur poids moléculaire [31]. Ils sont scindés en deux
groupes dits acide et basique, un type de chacun des groupes
s’apparie dans le cytoplasme. Cet appariement est caractéris-
tique du tissu d’origine, caractéristique qui persiste également
dans les tumeurs qui s’y développent (Tableau 4).
3.4. Apport de l’immunohistochimie
Réalisable à partir de fragments (biopsies) ou cellules fixées
(cytoblocs) et inclus en paraffine, son recours est utile, outre la
reconnaissance du type et de l’origine de la tumeur, dans trois
autres circonstances.
Tableau 3
Principaux types histologiques et leurs caractéristiques histo- et immunohistochimiques
Carcinome Mélanome Sarcome T. neuroendocrines Mésothéliome Lymphome
Cytokératines PS100 Vimentine Chromogranine Vimentine CD45
EMA HMB45 Synaptophysine EMA, CK5-6 CD3
MelanA CD56 Calrétinine CD20
PLN2 TTF1 HBME1 CD30
Carcinome
Épidermoïde Glandulaire Transitionnel
CK5-6 Mucosécrétion UroIII
p63 CK5-6
p63
Adénocarcinomes
Sein Thyroïde Prostate Poumon Colon Foie Voies biliaires Ovaire
RE Thyroglobuline PSA TTF1 -caténine ␣FP CK19 RE
RP TTF1 PAP CDX2 Hépatocyte Claudine 4 CA125
GCDFp15 p504S p504S WT1
Ces marqueurs orientent vers une origine donnée qu’en cas de positivité, leur négativité ne permettant pas de l’exclure. Ainsi, le GCDFp15, présent uniquement
dans les cancers du sein et des glandes annexielles, n’est exprimé que dans seulement 30% des cas. Ces marqueurs sont associés au type histologique principal de
l’organe considéré. Les variantes histologiques plus rares peuvent comporter des marqueurs immunohistochimiques différents.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%