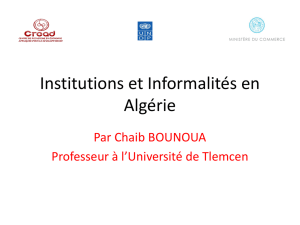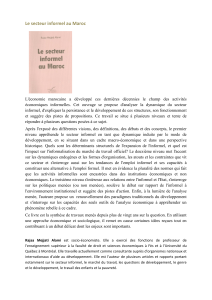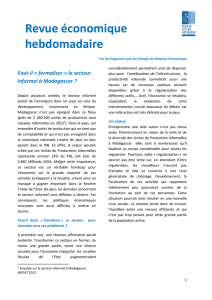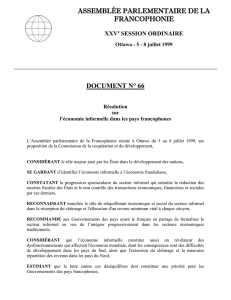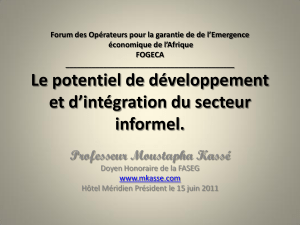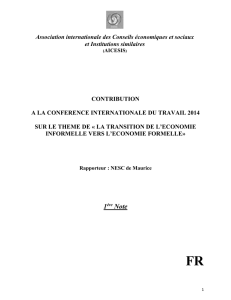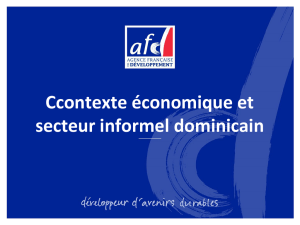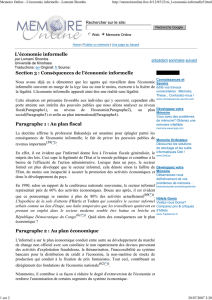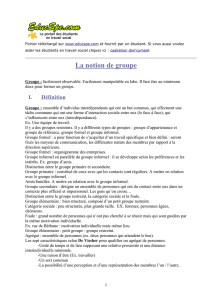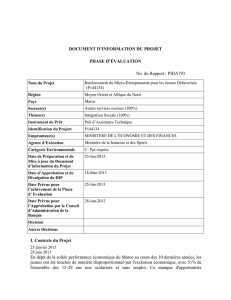Kasboui et Nechad

1
Les politiques d’intégration de l’économie informelle au Maroc : Aspects juridiques et
institutionnels
Tarik Kasbaoui1, Université Chouaib Doukkali El Jadida, Abdelhamid Nechad2, Université Hassan II-
Mohammedia, Maroc.
Résumé
Notre article pourrait s’articuler autour de deux axes principaux. Le premier traitera de l’existence des politiques
d’intégration de l’économie informelle au Maroc. En effet, il semblerait pertinent de s’interroger sur l’existence de ces
politiques en avançant les arguments de l’affirmation de cette existence mais aussi de sa négation. L’existence de ces
politiques ne dépend pas uniquement de l’attitude de l’Etat mais aussi des acteurs de la société civile. Le second axe
sera une réponse au premier. Ainsi, seront proposés les instruments juridiques et institutionnels à mettre en œuvre
afin d’intégrer l’informel.
Mots clés : économie informelle, politiques d’intégration, Maroc, Etat, instruments juridiques, instruments
institutionnels.
JEL : O1 17
The integration of the informal economy policy in Morocco: Legal and Institutional Aspects
Abstract
This article could be structured around two main axes. The first will deal with the existence of the integration of the
informal economy policy in Morocco. Indeed, it seems appropriate to question the existence of these policies in
advancing arguments asserting the existence but also its negation. The existence of these policies depends not only
on the attitude of the state but also civil society. The second axis is a response to the first. And will be offered legal
and institutional instruments to implement in order to integrate the informal sector.
Keywords : Informal Economy, integration policies, Morocco, state, legal instruments, institutional instruments.
1 Faculté Polydisciplinaire D’El Jadida. [email protected]
2 FSJES d’Ain Sebâa. nechad22@yahoo.fr

2
Introduction
Economie officieuse, économie parallèle, économie souterraine…nombreuses sont les dénominations
servant à désigner les actes économiques marchands qui échappent aux normes légales en matière fiscale,
sociale ou d’enregistrement statistique1, appelés communément l’économie informelle. Depuis son
apparition dans le fameux rapport du BIT en 1972 sous l’appellation « secteur informel », ce concept a
suscité des débats quant à la terminologie utilisée, ses origines et ses fonctions. Cette définition a connu de
fortes critiques tenant principalement à l’inadéquation des termes et des critères utilisés. La définition ainsi
proposée ne permettait guère une approche globale du secteur informel mais donnait lieu à la collecte des
données quantitatives. De même, la dénomination secteur informel fut fortement critiquée car jugée
confirmer l’approche dualiste qui oppose le secteur informel à celui dit formel. Les critiques furent
tellement nombreuses que le bureau international du travail finira par adopter, depuis la conférence
internationale de juin 2001, le concept d’économie informelle au lieu du secteur informel. Les études
récentes dans le domaine adoptent la même dénomination.
Le Maroc, à l’instar des pays en voie de développement, connut l’émergence de l’économie informelle à
partir des années 80. C’est sous l’effet conjugué de l’évolution démographique, de l’exode rural et de
l’incapacité du secteur moderne à apporter une réponse positive aux besoins sociaux que ce secteur
s’installa dans le contexte socio-économique marocain, et devint, de ce fait, une préoccupation chez les
intellectuels, les organisations syndicales mais aussi chez l’Etat. Depuis, l’économie informelle ne cessa de
croître. Elle devient une composante dynamique et durable de l’économie marocaine.
Les politiques d’intégration de l’économie informelle ne sont pas entendues comme étant les diverses
actions ou campagnes de lutte contre des formes de l’informel occasionnées par certains événements. Loin
de là, elles visent un ensemble d’actions concertées, menées par les différents départements
gouvernementaux, animées par une stratégie globale dont les axes sont clairement définis. Cette stratégie
doit, évidemment, déterminer les actions de chaque autorité, afin d’éviter tout chevauchement de
compétences, et par-là, le défaut ou l’excès d’intervention. De même, toute politique dite d’intégration de
l’économie informelle, doit nécessairement prévoir des mesures d’accompagnement au profit des parties
qui seraient touchées par la dite politique.
L’intégration peut revêtir plusieurs formes : sociale, financière, juridique, institutionnelle. Seules ces deux
formes feront l’objet de notre développement. Parmi les questions autour desquelles s’articule le débat sur
les politiques d’intégration juridique et institutionnelle de l’économie informelle au Maroc on peut avancer
celle relative à l’existence de telles politiques, d’une part, et ses modalités, d’autre part. Autrement dit, est
ce qu’il existe une politique d’intégration de l’économie informelle et quel est l’apport des instruments
juridiques et institutionnels à une telle politique ? Ainsi, on est en droit de s’interroger sur l’existence
effective de véritables politiques d’intégration de l’économie informelle au Maroc. Est-ce que les actions
menées par les différents départements découlent d’une politique générale dont les axes et les objectifs
sont tracés par le gouvernement ? Ou bien, à l’inverse, ces départements agissent, chacun dans la sphère
de ses compétences, sans dénoter une politique globale d’intégration de ce secteur ? D’autre part, il serait
légitime de tenter de savoir quelles sont les caractéristiques d’une telle politique ? Vise-t-elle l’éradication
de l’économie informelle, considéré comme une économie en marge de la légalité dont il faut précipiter la
disparition ? Ou répondent-elles à une approche sociologique de l’informel en prônant, non sa résorption,
mais son intégration en créant les conditions favorables de son développement ? Dans la seconde
hypothèse, faut-il l’intégrer dans le cadre général ou, par contre, élaborer un cadre spécifique plus adapté à
ses particularités ? Nombreuses sont donc les questions qu’on tentera d’étudier, animés par l’intérêt que
revêt ce sujet. Certes, le choix de ce thème n’est pas fortuit. Il constitue une réponse académique au
développement considérable que connaît l’informel et ce de par le monde.
1. L’intégration de l’économie informelle : Existence contestée
La contribution de l’informel au P.I.B et à l’emploi étant considérable, la recherche d’une alternative fait
partie intégrante à des politiques d’intégration de l’économie informelle. Cela étant dit, notre interrogation
quant à l’existence de ces politiques suppose la recherche des éléments d’affirmation de cette existence,
mais aussi les arguments de sa négation.

3
1.1 Existence affirmée
On pourrait, à première vue, affirmer l’existence des politiques d’intégration de l’économie informelle en
relevant le cadre réglementaire applicable à cette forme d’économie. Ce constat est d’autant plus confirmé
par l’examen de certaines mesures concrètes menées par les pouvoirs publics.
1.1.1 Affirmation par l’existence d’un cadre juridique
Juridiquement parlant, l’économie informelle n’est pas une branche distincte de droit (Rimbert, 2002, 41).
Il n’existe pas une réglementation spécifique propre au secteur informel. En effet, les dispositions
applicables aux unités de production et de commercialisation informelles sont celles qui ont trait à
l’organisation du commerce en général. Certaines spécificités sont retenues quant au fonctionnement des
petites entreprises.
1.1.1.1 Les normes relatives à l’organisation du commerce
Au Maroc, les dispositions relatives à l’organisation du commerce sont diverses. Elles se regroupent dans
ce que l’on appelle le droit des affaires qui englobe le code de commerce, la loi 17-95 relative aux sociétés
anonymes, la loi 5-96 relative à la SARL… Les règles générales se trouvent dans le code de commerce,
lequel, impose aux commerçants deux obligations loin d’être respectées par les opérateurs informels.
L’obligation de tenir une comptabilité régulière s’impose aussi bien aux grands commerces qu’aux petits.
Ainsi, l’article 19 de la loi 15-95 impose aux commerçants de tenir une comptabilité conforme aux
dispositions de la loi 9-88 relative aux obligations comptables du commerçant. Cette indifférenciation
quant à la taille de l’entreprise serait la raison principale du non-respect de cette obligation. Certes, les
petits commerçants démunis de la qualification nécessaire ne seraient en mesure de tenir une comptabilité
en bonne et due forme. Quant au registre du commerce, 87% des entreprises informelles n’y sont pas
enregistrées. Interrogés sur les raisons de non enregistrement, les opérateurs informels avancent le
caractère non obligatoire de l’enregistrement ou le manque d’information (Direction de la statistique, 2000,
106).
De même, l’enregistrement au registre du commerce ne peut être accompli que si l’unité de production
informelle a été patentée3. Démarche qui n’est effectuée que par 23% des unités informelles (Direction de
la statistique, 2000, 106). Si ces dispositions s’appliquent à tous les opérateurs économiques, certaines sont
propres aux entreprises de petite et moyenne taille.
1.1.1.2 Les normes spécifiques aux petites entreprises
Tenant compte des spécificités que peuvent représenter les petites entreprises et leur importance
qualitative mais aussi quantitative dans le tissu économique marocain, le législateur a prévu un régime
spécifique de comptabilité au profit des petites entreprises. Il est évident que les petits commerçants,
souvent d’un niveau d’instruction assez bas, ne peuvent se doter d’une comptabilité régulière. Ils se voient,
de ce fait, priver des avantages de cette comptabilité, à savoir la preuve en cas de contestation4.
Pour remédier à cette situation, les petits commerçants peuvent faire tenir leur comptabilité par des
centres de gestion de comptabilité agrées5. Ces centres, crées par la loi n° 57-90, relevant des chambres de
commerce, d’industrie et de services, tiennent la comptabilité des petits commerçants. Ces derniers, pour
les encourager à recourir à ces centres, bénéficient d’un abattement de 15% de la base imposable. De
même, ils échappent au contrôle de l’administration des fiscs (Maalal, 2001, 99). La deuxième obligation
du commerçant, étant l’inscription au registre du commerce, ne connaît aucun allégement spécifique aux
petites entreprises. Tous les commerçants, personnes physiques ou morales, marocaines ou étrangères
sont assujetties à cette inscription dès qu’ils disposent d’un local au Maroc.
L’inscription au registre local doit être effectuée, pour tous les commerçants, auprès du greffe du tribunal
de commerce. Le registre central, quant à lui, est tenu par l’office marocain de la propriété industrielle et
3 Article 76 du code de commerce
4 Article 19 al 2 du code de commerce
5 Les centres de gestion de comptabilité agrées ont été crées par la loi n° 57-90 du 12-07-1991 promulguée par le Dahir n° 1-91-
228 du 9-11-1992 (B.O.n°4183 bis du 30-12-92) institue les C.G.C.A. D’autres textes la complètent, il s’agit notamment du : -
Décret n°2-96-333 du 31-10-1997 fixe les conditions d'agrément des sociétés exploitant les C.G.C.A. - Arrêté n°167-98 du 28-09-
1998 fixe les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'agrément des sociétés exploitant les C.G.C.A.

4
commerciale6. Il a pour fonction principale la centralisation des informations relatives aux entreprises, il
est constitué grâce aux doubles des déclarations remises aux greffiers. Il permet de surveiller la tenue des
registres locaux et de donner aux administrations et aux organismes intéressés les renseignements qui leur
sont nécessaires.
1.1.
2
Affirmation par l’entreprise des démarches concrètes
"Dès lors où on adopte une position négative face à l'informel, le problème est dores et déjà mal posé (...) La question n'est d'y
voir un mal à éradiquer, encore moins un bien qui ne ferait que consacrer des pays comme le Maroc dans leurs situations
actuelles, mais un secteur qui a son importance dans le tissu économique et qu'il faut amener vers le formel" Le témoignage
est de Ahmed Lahlimi Alami, haut commissaire au plan7. Une telle déclaration révèle une prise de
conscience chez les pouvoirs publics de l’ampleur que prend l’informel et la nécessité d’une stratégie de
lutte contre ce phénomène de plus en plus grandissant. Cette prise de conscience est d’autant plus
confirmée par les actions concrètes vis à vis de l’informel. Ces actions peuvent s’analyser comme des
actions de lutte contre certaines formes de l’informel et d’intégration d’autres formes.
1.1.2.1 La lutte contre l’informel : cas de la contrebande
Juridiquement, la contrebande se définit comme étant l’introduction sur le territoire assujetti d’une
marchandise qui n’est pas passée par un bureau de douanes ou qui y a été dissimulée pour ne pas être
aperçue par les agents de douane. Est également contrebande, la non présentation de certaines
marchandises ou de documents justificatifs de leur détention régulière (Louchahi, 2003, 96) (Article 282 du
code des douanes et des impôts indirects). En pratique, la contrebande est largement exercée dans les
zones frontalières du royaume. Ainsi, dans la région de Tanger-Tétouan, elle continue de drainer une part
importante des richesses de la région, elle constitue près de 45% du produit intérieur de la zone (Abjiou,
2004, 56). Cela semble être du, entre autres, au faible développement de ces régions et la séduction
qu’exercent les produits étrangers, souvent d’une qualité meilleure que ceux nationaux et à des prix plus
compétitifs. La contrebande, phénomène en pleine expansion, ne pouvait laisser indifférents les autorités
concernées à savoir l’administration des douanes et des impôts indirects. Celle-ci a entamé une série
d’actions tant sur le plan organisationnel que sur le plan opérationnel. Si la contrebande doit, selon
l’administration des douanes, être éradiquée, certaines activités informelles ne se prêtent pas à la
suppression totale et nécessitent, par contre, une stratégie d’intégration et de restructuration. L’exemple du
commerce ambulant est, à ce niveau, plus qu’édifiant.
1.1.2.2 L’intégration de l’informel : cas du commerce ambulant
La multiplication des marchands ambulants et leur omniprésence dans le décor quotidien des villes sont
telles, que ce phénomène a tendance à s’imposer comme composante fondamentale du paysage de nos
villes. Le commerce ambulant pose actuellement de nombreux problèmes, car ne répondant pas aux
normes en matière d’urbanisme et d’exercice des activités économiques. De là, ses acteurs se trouvent en
conflit, non seulement avec les autorités locales, mais aussi avec les commerçants organisés, avec qui ils
feraient double emploi (Salahdine, 1991). De ce fait, toute stratégie d’intégration devrait tenir compte des
intérêts contradictoires des deux catégories d’acteurs. Dans ce sens, l’Etat a entrepris une série de mesures
qui s’avèrent, cependant, sans grand effet. L’approche sécuritaire étant inadéquate vu que le commerce
informel reste un secteur refuge pour les sans-emploi. Il contribue à atténuer les méfaits du chômage pour
beaucoup de personnes ayant ou non des diplômes. Ainsi, une enveloppe budgétaire qui monte à 105
millions de DH a été allouée au programme de sédentarisation des vendeurs ambulants élaboré en
collaboration avec les walis et gouverneurs. Elle sera consacrée à la construction de 130.000 locaux
commerciaux au profit des commerçants ambulants (Dref, 2009). Mais, encore faut-il que ces locaux
soient accordés aux méritants et ne soient pas abandonnés par les bénéficiaires.
On en conclura que les pouvoirs publics sont fermement déterminés à éradiquer ou intégrer, selon les cas,
le phénomène de l’informel qui constitue un véritable manque à gagner à l’économie structurée. Mais, on
peut légitimement se demander si ces actions, partiellement entamées, peuvent être qualifiées de stratégie
6 Article 31 du code de commerce tel que modifié par la loi 13-99 portant création de l’office marocain de la propriété industrielle
et commerciale.
7 M.E. Formaliser l’informel. Page consultée le 24/07/2012. http: //www.menara.ma

5
de lutte ou d’intégration de l’informel ou s’agit-il simplement de mesures conjoncturelles que le
gouvernement dévoile à l’occasion de certains incidents.
1.2 Existence infirmée
Si à travers le cadre juridique et les démarches concrètes vis à vis de l’informel, on peut espérer l’existence
des stratégies de structuration de l’économie informelle, cette aspiration se trouve démentie par la
tolérance que montre l’Etat à l’égard de certaines activités informelles. D’autant plus que les actions sus
examinés se caractérisent par un fractionnement certain.
1.2.1 Infirmation par la tolérance des pouvoirs publics
Le secteur informel est une réalité sociale, économique et politique dont il faut mesurer la portée sur le
plan de l’emploi, de la production et de la politique. Toute intervention étatique doit prendre en
considération ces dimensions et ne peut, de ce fait, s’inscrire dans une optique purement sécuritaire. De
même, dans certains cas, l’Etat se trouve dans l’impossibilité de circonscrire le phénomène dans sa
globalité.
1.2.1.1 Tolérance choisie
Si l’informel est perçu comme un manque à gagner à l’Etat, une économie en marge de la loi…il ne faut
pas oublier qu’il remplit une fonction sociale, économique mais aussi politique. En effet, les statistiques
montrent que l’informel contribue à 25% dans le PIB. De même, l’emploi dans le secteur informel
représente 48,6% de l’emploi non agricole (hors administrations et collectivités locales) dont 54,9% dans le
milieu rural. Il participe pour 39% à l’emploi non agricole total et pour 20,3% à l’emploi total. La
participation de l'informel à la production nationale est de près de 94 milliards de dirhams (Direction de la
statistique, 2007, 81).
L’informel dispose de larges capacités de régulation sociale en termes d’emploi, de revenus, de
formation…Dans un contexte de crise d’emploi dans le secteur moderne, l’informel qui dispose de marges
importantes de flexibilité peut être le réceptacle des travailleurs débauchés dans le secteur structuré ou en
quête d’un premier emploi (Ammor, 2008). De même, l’économie informelle offre aux consommateurs
des produits et des services à bas prix qui correspondent au pouvoir d’achat d’une large couche de la
société. Ces produits, bien que d’une qualité médiocre, permettent aux consommateurs défavorisés de
subvenir à leurs besoins et d’acquérir des biens auxquels ils n’auraient pas accès dans les circuits formels.
Par exemple, le logement clandestin a permis d’éponger le manque de logements fournis par le circuit
formel.
Devant cette situation, les autorités sont prises dans une contradiction entre le libéralisme et
l’interventionnisme ; d’un côté, elles cherchent à codifier, à normaliser, à légaliser les activités qui
échappent à son contrôle, qui ne payent pas les impôts, ne respectent pas le code du travail, ne répondent
pas aux normes de sécurité et de salubrité et concurrencent les systèmes industriels. Elles prennent ainsi
des mesures de déguerpissement ou d’interdiction d’activités informelles. Mais, d’autre part, elles savent
que se créent à la périphérie des habitats spontanés, des commerces non patentés (Hugon, 1990, 45)…
Dans certains cas, ces activités se multiplient à l’insu de l’Etat et par complicité d’autres acteurs.
1.2.1.2 Tolérance subie
La prolifération de l’informel n’est pas le fruit uniquement de la latitude des autorités. D’autres facteurs
viennent se greffer à celle-ci et qui se rapportent à l’attitude qu’adopte chaque composante sociale face à
l’informel. En effet, certains aspects de l’informel sont encouragés par la complicité collective des
commerçants, des transporteurs, des intermédiaires mais aussi des consommateurs, utilisateurs finaux des
produits informels (Louchahi, 2008, 76).
L’exemple classique est du commerce ambulant. Non seulement les sans emploi y ont recours, mais aussi
les commerçants du secteur structuré mettent sur place un réseau de vendeurs ambulants qui exercent
pour leur compte (Jafry, 2009). Les consommateurs, de leur part, préfèrent s’approvisionner du marché
informel vu les prix compétitifs qu’il offre par rapport aux circuits formels. L’approvisionnement auprès
de l’informel n’est pas propre aux consommateurs. Même certaines entreprises y ont recours en cas de
pénurie. D’autre part, la complaisance et l’indélicatesse de certains agents de l’administration sont
désignées du doigt comme étant la cause principale de propagation de l’informel notamment la
contrebande (Louchahi, 2008, 76). Dans ce sens, un rapport de la banque mondiale sur le développement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%