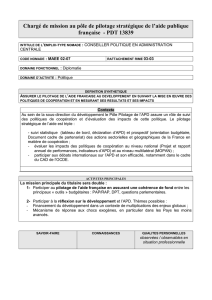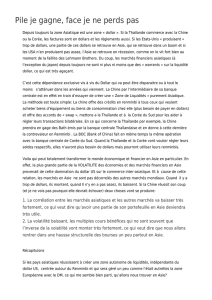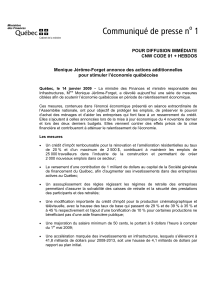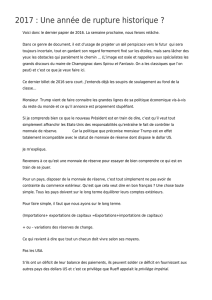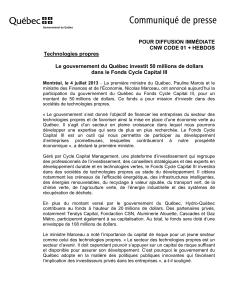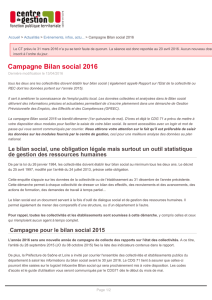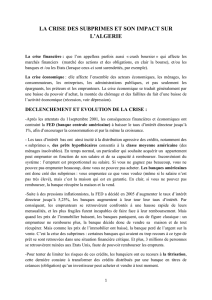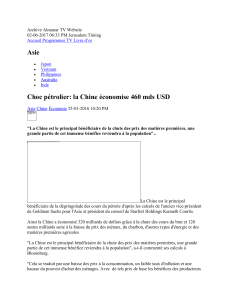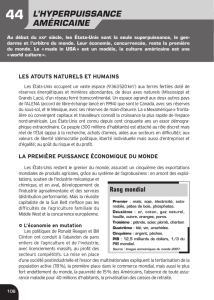emploi - Le Monde

Aide au développement :
faire plus et mieux
LE MANQUE DE COORDINATION ENTRE LES DONATEURS GÉNÈRE DES COÛTS INUTILES
UNE UTILISATION VARIÉE
LE DÉCLIN EST ENRAYÉ
L'aide publique au développement
(APD)
En milliards de dollars
(échelle de droite)
En % du revenu national brut des pays
donateurs (échelle de gauche)
Source : OCDE
Source : OCDE
Source : OCDE *prévisions
Nombre de missions dépêchées par les donateurs en 2004 Aide publique au développement
En milliards de dollars
dont :
APD brute en 2002
Aide alimentaire
au développement
Aide d'urgence
Remises de dette
APD transitant
par les ONG
61,4
APD brute versée sur le budget
des gouvernements
Transferts nets d'APD sur
le budget des gouvernements
32,5
17,4
1,3
4,4
Coopération technique
Remboursement de la dette
14,2
7,2
1,9
– 15,1
Cambodge
Vietnam
Nicaragua
Bolivie
Bangladesh
Kirghizstan
Tanzanie
Ethiopie
Maroc
Sénégal
Mozambique
Zambie
Niger
Fidji
400 400
289
250 230 230 200 200
150 140 120
90
270
30
0,35
0,30
120
100
80
60
40
20
0
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04* 05*
0,25
69
OFFRES D’EMPLOI
L
e sort des pays les plus
pauvres – grands per-
dants jusqu’à présent
de la mondialisation – a
fini par s’imposer au
sommet de l’agenda
international. Dans les réunions
du G7, le sujet figure désormais
aux côtés des exercices imposés
– croissance, parité des grandes
monnaies… – du club des pays les
plus riches du monde. Lors du der-
nier Forum économique de
Davos, antre du capitalisme mon-
dial, les « global leaders » se sont
aussi découvert de l’intérêt pour
ceux qui vivent avec moins de
2 dollars par jour. Et, il ne se passe
plus de mois, voire de semaines,
sans qu’une déclaration ou un évé-
nement officiel ne vienne rappe-
ler les engagements pris en 2000,
aux Nations unies par cent quatre-
vingt-neuf pays, en faveur des
Objectifs pour le développement
du millénaire, dont le premier
mais pas le moins ambitieux vise à
réduire la pauvreté de moitié d’ici
2015. Après une grande période
de désintéressement que les gou-
vernements des nations donatri-
ces avaient alors justifiée par une
certaine « fatigue de l’aide », le
volontarisme est du retour. Les
événements du 11 septembre
2001 ont contribué à accélérer cet-
te prise de conscience d’une néces-
saire solidarité planétaire. Le déve-
loppement et la prospérité étant
une des conditions d’une sécurité
devenue priorité numéro un des
pays menacés par le terrorisme,
au premier rang desquels les Etats-
Unis. Plus récemment, le raz de
marée qui a frappé l’Asie, fait plu-
sieurs centaines de milliers de
morts et contraint à migrer des
millions de personnes, a montré
que la générosité, non, cette fois
par intérêt, mais par compassion,
était aussi possible. Enfin, la pers-
pective de devoir se soumettre, en
septembre prochain aux Nations
unies, à un bilan d’étape sur la rou-
te tracée par l’Agenda du millénai-
re n’est pas non plus étrangère à
ce regain d’initiatives.
A dix ans de la date butoir, la
communauté internationale est
loin d’être dans les temps pour
réussir son pari. Si le déclin de
l’aide publique au développement
(APD) est enrayé depuis deux ans,
le chemin sera encore long avant
d’obtenir le doublement des verse-
ments jugé nécessaire pour attein-
dre les Objectifs du millénaire.
L’APD a atteint 69 milliards de dol-
lars en 2003, selon les chiffres
publiés en janvier par l’Organisa-
tion pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE), soit quelque 16 milliards
de plus qu’en 2001, point bas de la
générosité internationale. Il en
faudrait au minimum 50 de plus
chaque année selon les évalua-
tions du rapport remis par l’écono-
miste Jeffrey Sachs au secrétaire
général des Nations unies, Kofi
Annan.
D’autres sources de finance-
ment, viendront peut-être d’ici là
abonder la manne budgétaire, sur
laquelle repose seul aujourd’hui
l’effort de solidarité internationa-
le. Là encore les esprits ont évo-
lué. Après une longue période de
rejet des propositions venant de
la société civile, l’idée de taxation
internationale fait son chemin.
Portée par la France, l’Allemagne,
le Brésil, l’Espagne, ou encore le
Chili. Les travaux pratiques ne
sont toutefois pas pour demain.
La proposition franco-allemande
de taxer le kérosène ou les billets
d’avions vient d’être retoquée
ouvertement par les Britanniques.
Qui, de leur côté, défendent la
création d’un nouveau mécanis-
me financier – la facilité de finan-
cement international – devant per-
mettre, par le biais d’emprunts
sur les marchés financiers, de
lever des capitaux à hauteur des
besoins. La Commission chargée
par le Conseil européen de dia-
gnostiquer la faisabilité de toutes
ces propositions remettra ses
conclusions dans quelques semai-
nes. De retour de Londres, le com-
missaire européen au développe-
ment, Louis Michel, ne cachait
pas, jeudi 24 février, « avoir été
impressionné par la démonstration
du chancelier de l’Echiquier, Gor-
don Brown ».
Mais donner plus n’est pas tout.
Encore faut-il faire la démonstra-
tion que cet argent sera bien utili-
sé et qu’il ne se perdra pas, com-
me trop souvent par le passé,
dans des projets mal ficelés ou
dans les poches de dirigeants cor-
rompus. Avec le temps, le procès
dressé contre l’inefficacité de
l’aide a conduit à un partage plus
équitable des responsabilités
entre les pays donateurs et leurs
bénéficiaires. « Trop souvent si
l’aide extérieure qui arrive dans les
pays en développement relève de
bonnes intentions, elle ne fait pas
assez cas de ce que les pays souhai-
tent vraiment et n’accorde pas suffi-
samment de place à la coordina-
tion entre les donneurs, reconnais-
sent le secrétaire de l’OCDE,
Donald J. Johnson et le président
du Comité d’aide au développe-
ment (CAD), Richard Manning. Et
la pilule est parfois amère aussi
bien pour les bénéficiaires de l’aide
que pour les contribuables qui la
financent. » Réuni sous le parrai-
nage de la Banque mondiale, de
l’OCDE, des banques régionales
de développement ainsi que du
gouvernement français, le Forum
ministériel qui se tient à Bercy les
1er et 2 mars, devrait faire le bilan
des progrès réalisés pour « rendre
l’aide plus efficace » depuis l’adop-
tion en 2003 de la déclaration de
Rome en faveur notamment
d’une meilleure harmonisation
des politiques d’aide entre les
bailleurs. Car « il y a tout lieu de
penser que les différentes appro-
ches, menées à l’initiative des dona-
teurs, ne sont pas étrangères aux
médiocres performances de
l’aide », poursuivent MM. John-
son et Manning.
Autant dire cependant que, sur
ce front, les progrès sont pour
l’instant assez minces et se limi-
tent à quelques « success stories »
que, tel le Mozambique, les
bailleurs se plaisent à mettre en
avant. A Paris, les grands argen-
tiers de la solidarité internationa-
le devraient néanmoins accepter
de s’imposer une obligation de
résultat en adoptant une série d’in-
dicateurs qui à l’avenir permet-
tront d’évaluer les efforts faits par
chacun. Le CAD aura la charge,
chaque année, de distribuer les
bons points ou au contraire les
avertissements. Et, dans un milieu
habitué depuis des décennies à
cultiver jalousement ses prés car-
rés, cela ressemble déjà à une peti-
te révolution culturelle.
Laurence Caramel
FOCUS
bDepuis la loi de cohésion sociale, l’ANPE
a perdu le monopole de reclassement
des chômeurs. Le marché attire le secteur
privé dont les géants de l’intérim p. VII
bPrix du livre ressources humaines 2005 :
cinq ouvrages restent en lice avant la remise
du trophée le 8 mars p. VIII
paris accueille, les 1er et 2 mars,
un forum ministériel
sur l’efficacité
des politiques menées
À LIRE DANS LE DOSSIER
En dépit d’une
croissance en hausse,
l’Afghanistan reste
l’économie la plus mal
lotie de sa région.
Les progrès enregistrés
bénéficient
peu à la société p. IV
La remontée des taux
d’intérêt à long terme
réveille la crainte
d’un krach obligataire.
La faiblesse
des rendements inquiète
Alan Greenspan,
le patron de la Fed p. V
bDirigeants bFinance, administration,
juridique, RH bBanque, assurance
bConseil, audit bMarketing, commer-
cial, communication bSanté bIndus-
tries et technologies bCarrières interna-
tionalesbMultipostesbCollectivités ter-
ritoriales p. IX à XII
Consultez notre site : www.talents.fr
UNE RADIOGRAPHIE COMPLÈTE
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE :
173 pays passés au crible
par les journalistes du Monde,
une analyse de
l’économie française,
la revue des entreprises
et des marchés,
un dossier complet
sur l’Europe à 25.
LE BILAN DU MONDE EST EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
> L’efficacité de l’aide :
un débat aussi vieux que l’aide
elle-même p. II
> La France… peut mieux faire p. II
> Au Mozambique, les bailleurs
étrangers travaillent ensemble p. II
> Jean-Michel Severino, AFD :
« Il faut éviter aux Etats
de sombrer dans le piège
de la dépendance » p. III
> Les Etats-Unis prônent un soutien
ciblé et contractuel p. III
BOUSSOLE
Comparaison du produit intérieur
brut par habitant en 2002,
en dollars
UNE PAUVRETÉ TRÉS ÉLEVÉE
Source : PNUD
Iran
Turkménistan
Pakistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Afghanista
n
6 690
4 300
1 940
1 670
980
822
EMPLOI
« Il y a tout lieu de penser que les différentes
approches, menées à l’initiative des donateurs,
ne sont pas étrangères aux médiocres
performances »
donald j. johnson, ocde, et richard manning, cad
ECONOMIE
MARDI 1er MARS 2005

La France… peut mieux faire
sa réputation est d’être plutôt sévère et criti-
que. Chaque année, le Comité d’aide au développe-
ment (CAD) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) passe au pei-
gne fin la politique d’aide publique de ses 22 Etats
membres, plus la Commission européenne, en
faveur des pays pauvres de la planète. Le mécanis-
me est bien huilé. L’aide d’un Etat est soumise aux
experts de deux autres Etats. En 2004, l’aide publi-
que au développement (APD) de la France passait
sous les fourches caudines des examinateurs cana-
diens et néerlandais.
De ce passage en revue méthodique et rigou-
reux, il résulte que les efforts de la France pour
augmenter le volume de son aide pour atteindre
0,5 % de son produit national brut en 2007 et ten-
dre vers 0,7 % (le pourcentage recherché par la
communauté internationale) en 2012 sont jugés
satisfaisants. Mais « compte tenu des contraintes
budgétaires actuelles, la tâche ne sera pas aisée »,
constatent les deux examinateurs. Surtout que
l’accroissement de l’APD française repose pour
beaucoup sur des mesures d’allégement de la det-
te en faveur des petits pays les plus endettés. Or le
CAD note également que « le pic des opérations
d’annulation sera atteint dans un proche avenir ».
Dans ces conditions, la France devra faire preuve
d’imagination et redoubler d’efforts si elle veut
atteindre les objectifs qu’elle s’est assignés.
complexité administrative
Mais c’est pour l’essentiel sur la méthode et l’or-
ganisation de l’APD que les examinateurs interna-
tionaux concentrent leurs critiques. Sont tour à
tour pointés la complexité de l’organisation admi-
nistrative française, la multiplicité des acteurs et
les problèmes de coordination du dispositif en
vigueur. De fait, l’APD fait l’objet d’une vive concur-
rence entre le ministère de l’économie et celui des
affaires étrangères. Suite notamment aux recom-
mandations du CAD, un nouveau partage des rôles
a été esquissé avec le transfert progressif à l’Agen-
ce française du développement (AFD) – qui
dépend de Bercy – de la conduite des opérations,
tandis que le Quai d’Orsay garde la haute main sur
la stratégie globale.
L’aide française souffre aussi d’un manque de
lisibilité. Ce sont à la fois la question de « la cohé-
rence des politiques » et l’identification d’« objectifs
concrets à poursuivre » qui sont posés. En guise de
réponse, « une programmation par pays, moderni-
sée et plus sélective » doit être mise en place, assu-
rent les autorités françaises. La France promet aus-
si adapter prochainement ses méthodes de coopé-
ration en fonction de la capacité des Etats à gérer
l’aide internationale, ce qui devrait la rendre plus
efficace.
Le dernier point porte sur l’opacité financière du
dispositif. L’application de la Loi organique relative
aux lois de finances (LOLF) à l’APD devrait permet-
tre d’« introduire un processus budgétaire transpa-
rent et pluriannuel et une gestion axée sur les résul-
tats » conformes aux recommandations du CAD.
Reste qu’à l’heure actuelle, il n’y a que la moitié de
l’aide française qui apparaît dans le budget de
l’Etat car les allégements de dettes et un certain
nombre d’agrégats statistiques n’y figurent pas.
Alain Beuve-Méry
BEIRA (Mozambique),
de notre envoyée spéciale
D
ans le jargon des
agences de coopéra-
tion, la province de
Sofala, située à
1 000 kilomètres de
la capitale mozam-
bicaine Maputo, est la « province
italienne ». L’Italie a, en effet,
concentré une partie de son aide
au Mozambique dans cette région
centrale du pays. La coopération
autrichienne s’est engagée, ensui-
te, dans le sud de la zone. De la
même façon, les autres agences de
coopération se sont réparti les pro-
vinces du pays.
Particulièrement choyé par les
bailleurs de fonds depuis son pro-
cessus de paix réussi en 1992, le
Mozambique accueille une trentai-
ne d’agences internationales. Le
pays bénéficie en moyenne de
700 millions de dollars d’aide par
an, soit la moitié de son budget
national. Conséquence de cette
présence massive : les bailleurs de
fonds tentent progressivement de
rationaliser leur aide. A la réparti-
tion géographique par donateur
s’est ajoutée la création de fonds
communs par secteur de dévelop-
pement, et depuis quelques
années l’appui financier direct au
budget de l’Etat. D’inspiration nor-
dique, cette politique de verse-
ments directs dans les caisses du
gouvernement pour financer les
secteurs-clés de la lutte contre la
pauvreté (santé, eau, routes, édu-
cation, agriculture) est aujourd’hui
suivie par quinze bailleurs qui tra-
vaillent de concert, parmi lesquels
l’Union européenne et la Banque
mondiale. L’objectif est de permet-
tre au pays de « s’approprier »
l’aide en renforçant ses mécanis-
mes de gestion dans chacun des
ministères concernés. En hausse
constante, ce soutien budgétaire a
représenté 25 % de l’aide totale
accordée au pays en 2004, soit dix
fois plus qu’il y a quatre ans.
A la direction provinciale de la
santé de Sofala, on se félicite de
l’augmentation de cet appui
direct. « Cela réduit les procédures.
Avec les projets de coopération,
nous devons parfois gérer plusieurs
comptes bancaires, beaucoup de
paperasse, c’est très lourd », souli-
gne João Baptista, directeur pro-
vincial. « L’aide directe nous per-
met surtout d’avoir une plus grande
autonomie de décision sur les sec-
teurs sanitaires que nous voulons
développer », ajoute-t-il.
résultats
Au sud de la province, dans le dis-
trict agricole de Buzi, où vivent
140 000 habitants, l’évolution des
conditions de vie est sensible. S’il
reste difficile de distinguer l’impact
respectif de l’aide budgétaire et des
différents projets de terrain mis en
œuvre depuis dix ans, les résultats
sont là. « Le réseau scolaire s’est
amélioré, nous avons désormais une
quarantaine d’écoles primaires. L’hô-
pital a été rénové, il y a un bloc opé-
ratoire et un centre de dépistage du
sida. Nous avons l’électricité en conti-
nu », explique José Chifinha, insti-
tuteur dans le district. La piste qui
rejoint la bourgade est aujourd’hui
entretenue régulièrement, facili-
tant les contacts entre les agricul-
teurs, producteurs de mil, et les
centres de commercialisation. La
reprise économique liée à la fin de
la guerre civile a aussi joué un rôle :
« La tôle remplace le chaume pour
couvrir les maisons, les gens ont une
bicyclette, sans parler du téléphone
portable qui fait son apparition. »
Si beaucoup reconnaissent la
valeur pédagogique de l’aide bud-
gétaire, la montée de la corrup-
tion ouvre néanmoins une brèche
dans le système. Certes, un large
éventail d’audits et des impératifs
de bonne gouvernance sont négo-
ciés à Maputo, mais il reste diffici-
le de contrôler tous les échelons
administratifs. Jouissant d’une
réputation de pays « éthique »
dans les années 1990, ce qui a
favorisé la venue des donateurs,
le Mozambique n’a cessé de grim-
per sur l’échelle d’évaluation de
la corruption de l’ONG internatio-
nale Transparency International.
Face à cette situation, l’ONG
nationale Groupe mozambicain
de la dette (GMD) souhaite ren-
forcer le contrôle, par la société
civile, de la gestion des fonds
alloués par les donateurs. En
trois ans, la délégation du GMD
de Sofala a formé une cinquantai-
ne d’acteurs de la société civile.
Désormais capables de lire un
budget national et d’interpréter
le vaste programme de réduction
de la pauvreté lancé par le gou-
vernement en 2002, ils parcou-
rent la province. « Si l’administra-
tion construit trois écoles dans un
district, alors que le budget
annuel en planifiait six, nous infor-
mons la population pour qu’elle
puisse faire pression et obtenir ce
qui lui est dû », explique Eugenio
Fernandes, coordinateur de la
délégation.
Du côté des bailleurs de fonds,
la démarche est également pro-
gressive. Dans le cas de la
construction des routes qui néces-
site de gros investissements, on se
garde bien encore de verser tous
les fonds directement au budget
national. Pour un responsable de
la coopération autrichienne, il est,
de toute façon, nécessaire de main-
tenir les projets de terrain « pour
être sûrs que l’aide arrive aux popu-
lations les plus vulnérables ».
Fermée depuis la guerre, l’usine
de sucre du district de Buzi doit
être prochainement relancée par
des investisseurs sud-africains,
« car cela ne suffit pas d’améliorer
la vie des populations, il faut mainte-
nant que les jeunes travaillent »,
relève Manuel Salomão, président
d’une association locale. Mais tous
les districts n’ont pas la chance de
Buzi, et l’investissement privé,
deuxième phase indispensable du
développement, fait largement
défaut dans la province. « Il est
encourageant de voir tous ces
enfants aller à l’école, même dans
les endroits les plus reculés, mais
que vont-ils faire ensuite ? », s’inter-
roge un observateur.
Jordane Bertrand
la faiblesse des
investissements
et la corruption
restent
des freins
au développement
U
n répit de quatre
mois par an : c’est
ce que vient d’obte-
nir la Tanzanie de
ses donateurs étran-
gers pour interrom-
pre le ballet permanent des mis-
sions venant s’enquérir de l’état
d’avancement des projets de coopé-
ration, en négocier de nouveaux ou
passer au crible les performances
économiques du gouvernement. La
mesure peut paraître anecdotique,
mais, dans un pays pauvre doté
d’une administration peau de cha-
grin, les fonctionnaires locaux
avaient fini par passer autant de
temps à satisfaire les demandes des
experts internationaux qu’à répon-
dre à celles de leurs propres minis-
tres. La Tanzanie a reçu 230 mis-
sions étrangères en 2004. Elle ne fait
pas partie des pays les plus « visi-
tés » : le Vietnam ou le Cambodge
ont vu défiler les missions au ryth-
me de 400 l’an dernier, selon une
enquête du comité d’aide au déve-
loppement (CAD) de l’Organisation
de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Car
derrière les bonnes intentions, les
attitudes cocardières restent la
règle. Chaque pays veut pouvoir
accrocher son drapeau sur le projet
qu’il finance et, qui plus est, exige
souvent de son bénéficiaire qu’il ren-
de des comptes dans la « langue »
de son donateur. Résultat : un fonc-
tionnaire mauritanien par exemple,
devra lancer ses appels d’offres
pour la construction d’une école
selon les méthodes finlandaises si
son bailleur vient d’Helsinki, rappor-
ter selon les méthodes comptables
allemandes s’il vient de Francfort….
Environ 60 000 projets de déve-
loppement sont actuellement en
cours d’exécution sur l’ensemble de
la planète, selon la Banque mondia-
le. 85 % d’entre eux représentent un
investissement de moins de 1 mil-
lion de dollars, mais le nombre de
rapports à produire, de procédures
administratives à respecter est, dans
la plupart des cas, aussi important
que pour des investissements de
grande ampleur. Gaspillage d’ar-
gent, de temps – il faut en moyenne
cinq ans pour faire aboutir le moin-
dre projet entre la phase d’évalua-
tion et sa réalisation – pour des
résultats trop souvent décevants.
Le débat sur l’efficacité de l’aide
publique au développement (APD)
est presque aussi ancien que l’arri-
vée des premiers financements
dans ce que l’on appelait alors le
tiers-monde. Au cours des années
1990, dans le contexte de l’après-
guerre froide, l’échec des politiques
de coopération, l’ampleur de la cor-
ruption avaient jeté un discrédit
sans précédent sur l’aide. Au point,
en 1998, de faire s’interroger la Ban-
que mondiale, dans un document
resté célèbre, sur « Ce qui marche,
ce qui ne marche pas, et pour-
quoi ? » Ce travail dirigé par Joseph
Stiglitz, alors économiste en chef de
l’institution, s’était surtout focalisé
sur les raisons expliquant qu’une
politique de développement abou-
tisse, dans un cas, au succès ou, à
l’inverse, débouche, dans un autre,
sur un parfait échec. La notion de
« bonne gouvernance » avait été
mise en avant pour inciter les dona-
teurs à cibler leur aide sur les pays
jugés capables de mettre en œuvre
les politiques préconisées.
stratégies nationales
En demandant aux bailleurs de ne
plus jouer en ordre dispersé, la res-
ponsabilité a aujourd’hui changé de
camp. Mais ce n’est pas la seule
« révolution » demandée par le
CAD, qui depuis plusieurs années
orchestre ce débat. Dans la déclara-
tion de Rome adoptée en 2003, les
bailleurs ont accepté – sur le princi-
pe – de s’effacer devant les pays en
développement déclarés responsa-
bles des politiques qu’ils souhaitent
mener. Pour une raison simple,
constatée au fil des ans, par tous les
experts : les recettes imposées de
l’extérieur ont rarement été appli-
quées, même avec des millions de
dollars à la clé. « L’enjeu est énorme,
explique Simon Mizrahi, de l’OCDE,
il s’agit d’organiser un transfert de
souveraineté des bailleurs vers les réci-
piendaires dans un système marqué
par des rapports de force très iné-
gaux. » Les organisations non gou-
vernementales (ONG) se montrent
très sceptiques sur la possibilité
pour les pays pauvres d’élaborer
librement des stratégies nationales.
« Les premières expériences menées
dans le cadre des programmes straté-
giques de lutte contre la pauvreté, ont
montré, de l’aveu même du Fonds
monétaire international, que cette
idée d’“appropriation” demeurait
une fiction », affirme Régis Mabilais
de Coordination Sud.
Pour l’heure, ce vaste chantier se
concentre sur quatorze pays pilotes
dans lesquels les bailleurs s’effor-
cent de montrer qu’ils peuvent être
à leur tour des bons élèves. Au Ban-
gladesh, les vingt-sept projets en
faveur de l’éducation primaire,
financés jusqu’alors par treize dona-
teurs différents, ont ainsi été regrou-
pés dans un fonds unique sous la
responsabilité de la Banque asiati-
que de développement. Au Malawi,
les donateurs ont accepté de faire
pot commun pour soutenir la lutte
contre le sida. Et ils ont adopté les
mêmes normes d’évaluation et de
contrôle des projets. « Les choses
bougent, assure Patrice Tranchant, à
l’Agence française de développe-
ment, l’harmonisation de l’aide n’est
plus seulement un débat théorique.
Elle prend progressivement forme sur
le terrain. » Soit. Mais les expérien-
ces mises en avant comme autant
de « success stories » par les
bailleurs ne représentent encore
qu’une goutte d’eau dans un uni-
vers où toutes les réticences sont
loin d’avoir été levées.
Laurence Caramel
1
Quels sont
les Objectifs
du millénaire ?
Les Objectifs du millénaire pour le
développement adoptés et signés
par 189 pays en septembre 2000
sous l’égide des Nations unies com-
porte huit points à atteindre d’ici à
2015
Objectif 1. Réduire de moitié la
proportion de la population dont
le revenu est inférieur à 1 dollar
par jour ainsi que celle souffrant
de la faim.
Objectif 2. Assurer à tous les
enfants un cycle complet d’études
primaires.
Objectif 3. Eliminer les disparités
entre les sexes dans les enseigne-
ments primaire et secondaire
d’ici à la fin de 2005 et, si possi-
ble, à tous les niveaux de l’ensei-
gnement d’ici à 2015.
Objectif 4. Réduire des deux tiers
le taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans.
Objectif 5. Réduire des trois quarts
le taux de mortalité maternelle.
Objectif 6. Avoir stoppé la propaga-
tion du sida et commencé à inver-
ser la tendance actuelle. Avoir maî-
trisé le paludisme et d’autres gran-
des maladies.
Objectif 7. Assurer un environne-
ment durable en intégrant notam-
ment des principes de développe-
ment durable dans les politiques
nationales. Réduire de moitié la
population n’ayant pas accès à un
approvisionnement en eau pota-
ble salubre et à des services d’assai-
nissement de base.
Objectif 8. Mettre en place un par-
tenariat mondial pour le dévelop-
pement. Cet objectif implique
notamment de poursuivre la libé-
ralisation du système commercial
et financier sur la base de règles
non discriminatoires, un traite-
ment spécifique en faveur des
pays les moins avancés, un traite-
ment global de la dette des pays
en développement et une augmen-
tation de l’aide publique au déve-
loppement (APD).
2
Quel est le rôle
du Comité d’aide
au développement ?
Le Comité d’aide au développe-
ment (CAD) de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE) regroupe les
principaux donateurs de l’APD.
Créé en 1961, il examine et évalue
depuis plus de quarante ans les
efforts de ses membres en matière
d’aide. Ses recommandations ne
sont pas obligatoires, mais elles
constituent, pour les pays mem-
bres, soumis à la pression de leurs
pairs, une forte incitation au chan-
gement. Le CAD joue un rôle de
premier plan dans les efforts
déployés en vue d’harmoniser la
politique des donateurs. Ces posi-
tions sont adoptées sous formes
de « lignes directrices » Chaque
année, le CAD publie par ailleurs
un rapport intitulé « Coopération
pour le développement » qui four-
nit notamment les statistiques de
l’aide et passe en revue la politi-
que des donateurs.
3
Quels sont les pays
les plus dépendants
de l’APD ?
Dans les pays les plus pauvres,
l’aide publique au développement
(APD) représente en moyenne 12 %
du produit intérieur brut (PIB). Le
Nicaragua et la Tanzanie sont
dans ce cas. Mais, le niveau de
dépendance peut être beaucoup
plus fort. Rapportés au PIB, les
financements d’APD atteignent
24 % au Burundi, 30 % en Erythrée,
en Guinée-Bissau ou en Maurita-
nie, 47 % en Sierra Leone, 58 % au
Timor-Oriental et 60 % au Mozam-
bique. L’Afrique subsaharienne
demeure, selon l’OCDE, la seule
région où l’aide assure encore une
part majeure du revenu des bénéfi-
ciaires. Cette contribution a cepen-
dant diminué au cours de la derniè-
re décennie.
4
La France accroît-elle
le montant
de son aide ?
La France s’est engagée à porter
son volume d’aide à 0,5 % du PIB
d’ici à 2007 et à 0,7 % en 2012.
Selon l’OCDE, l’APD française s’est
élevée à 6,42 milliards d’euros en
2003 contre 5,82 milliards en 2002,
la classant au troisième rang des
pays donateurs. 70 % de cet
argent est octroyé à l’Afrique sub-
saharienne. L’APD française prend
aussi en compte les financements
accordés aux territoires d’outre-
mer. Ils représentaient 12 % envi-
ron de l’APD totale en 2003. Les
trois premiers récipiendaires hors
TOM étaient en 2003, la Républi-
que démocratique du Congo, la
Côte d’Ivoire et le Cameroun.
Selon la loi de finances 2005, l’APD
(hors TOM) s’élèvera à 7,3 milliards
d’euros. 30 % de ce montant est
constitué d’annulations de dette
accordées dans le cadre de l’Initiati-
ve pour les pays pauvres très
endettés (PPTE). Pour accroître
l’aide, la France prône l’instaura-
tion de taxes au niveau mondial.
Parmi les pistes possibles figure
une taxation des billets d’avion ou
du kérosène en faveur de laquelle
Paris milite avec l’appui du gouver-
nement allemand auprès de ses
partenaires du G7, le groupe des
sept pays les plus riches.
harmoniser
les politiques,
répondre
davantage aux
besoins : la balle
est dans le camp
des donateurs
Au Mozambique, les bailleurs étrangers travaillent ensemble
QUESTIONS-RÉPONSES
Objectifs
POUR EN SAVOIR PLUS
DOSSIER
L’efficacité de l’aide : un débat
aussi vieux que l’aide elle-même
> Coopération pour
le développement, rapport 2004
(éd. de l’OCDE, 262 p., disponible sur
le site : www.oecd.org)
> Harmoniser l’aide pour renforcer
son efficacité (éd. de l’OCDE, 2003,
140 p., disponible
sur le site : www.oecd.org)
> « Efficacité et allocation
de l’aide », Revue des débats
de Jacky Amprou et Lisa Chauvet
(novembre 2004, éd. de l’Agence
française de développement,
disponible sur le site : www.afd.fr)
> L’Afrique et les Objectifs du
millénaire pour le développement,
d’Ahmed Rhazaoui, Luc-Joël
Grégoire et Soraya Mellali
(éd. Economica, 2004, 635 p., 25 ¤).
> « The Reality of Aid 2004 »,
l’aide publique au développement
passée en revue par plus
de 40 ONG, consultable sur le site
www.realityofaid.org
II/LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005

Prôner l’harmonisation des
politiques d’aide publique au
développement (APD) suppose
que les bailleurs aient les mêmes
objectifs. Dans quelle mesure est-
ce le cas ?
Il est clair qu’il existe une grande
diversité de préoccupations dans
l’aide publique au développement,
qui vont de l’intérêt commercial
des Etats à leur influence politique.
Mais, depuis 2000, l’adoption de
l’Agenda du millénaire a introduit
quelque chose de très nouveau
dans la communauté internationa-
le. Ce consensus entre les pays en
développement et les donateurs
sur huit catégories d’objectifs tou-
chant aussi bien les aspects de reve-
nus – réduction de la pauvreté –,
d’accès aux services sociaux ou
encore de transformations sociéta-
les – la place des femmes – a permis
de mettre en ligne les bailleurs de
fonds sur des buts convergents.
Cela ne signifie pas que la totalité
de l’APD sera orientée vers la réali-
sation de ces objectifs ni que tous
les bailleurs vont s’aligner sur des
pratiques communes, mais il paraît
difficile de penser qu’à partir du
moment où ils ont souscrit à ces
objectifs un nombre croissant d’en-
tre eux n’y consacre pas un mon-
tant croissant de financements.
Pour atteindre les Objectifs du
millénaire pour le développe-
ment (ODM) à l’horizon 2015, un
doublement de l’aide est jugé
nécessaire. Ce scénario, s’il se réa-
lisait, ne modifierait-il pas radica-
lement la relation entre ldona-
teurs et pays dépendant de cette
manne financière extérieure ?
Il faut avoir conscience que ces
objectifs vont bouleverser notre
conception de l’aide. Jusqu’à pré-
sent, nous attachions beaucoup
d’importance aux équilibres macro-
économiques et financiers des pays
récipiendaires, à leur capacité à
assumer la charge de leurs dépen-
ses courantes. L’aide à chaque pays
était fixée bien entendu en fonc-
tion des ressources disponibles
mais aussi de la perception des
capacités d’absorption du pays.
Elle devait, en priorité, financer des
investissements et non des charges
récurrentes. Ce cadre, qui a connu
une érosion progressive avec la logi-
que de l’ajustement structurel
notamment, imposait d’une certai-
ne façon des limites excluant de se
fixer des objectifs qui ne soient pas
cohérents avec les possibilités des
pays. Avec les ODM, la logique, en
quelque sorte, se renverse. D’ici à
2015, il faut que les pays aient
atteint des objectifs minimaux en
matière de revenu par habitant, de
santé, d’eau potable, d’éducation
primaire.
La communauté internationale
crée un standard correspondant à
notre vision de ce dont l’homme a
besoin, au minimum, pour vivre de
manière digne. Ce minimum étant
aussi la condition d’un bon équili-
bre socio-politique de la planète.
Or faire ce choix sans se préoccuper
des capacités des pays à l’atteindre
de façon autonome signifie que
l’aide étrangère va devoir prendre
une place importante dans le finan-
cement des budgets sociaux d’un
certain nombre de pays, et ce de
façon durable. Dans le cas standard
d’un pays d’Afrique subsaharienne
où la fiscalité intérieure représente
environ 10 % du produit intérieur
brut (PIB), l’aide pourrait être por-
tée à 30 % du PIB environ pour
financer les besoins liés aux ODM.
Retarder la date butoir de dix ou
vingt ans pour les pays dont on sait
d’ores et déjà qu’ils ne seront pas
au rendez-vous de 2015 ne change-
ra pas grand-chose à l’ampleur de
l’effort que cela représentera pour
eux.
Mais le pari fait sur les ODM
n’est-il pas que, chemin faisant,
cette amélioration des standards
sociaux, des infrastructures, génè-
re plus de croissance et in fine du
développement ?
Le débat est là : une injection
massive d’aide selon ces modalités
assurera-t-elle de meilleures perfor-
mances de croissance et davantage
de moyens aux Etats pour leur per-
mettre de ne pas sombrer dans le
piège de la dépendance ? Les opti-
mistes assurent que ce scénario est
possible et qu’un certain nombre
de pays qui mènent d’ores et déjà
de bonnes politiques – ceux sur les-
quels il faudra d’ailleurs concentrer
l’aide – y parviendront. Il y aura ain-
si un nombre suffisant de success
stories pour que cette espèce de
plan Marshall génère au bout du
compte un rebond du développe-
ment. Les pessimistes, à l’inverse,
affirment que cela ne se produira
pas. L’amélioration des standards
sociaux n’entraînera pas la croissan-
ce, et, pire, l’abondance de l’aide ris-
que, selon des effets pervers bien
connus, de nuire à l’activité du sec-
teur privé et de plonger les pays
dans une dépendance sans fin.
Quel est le scénario le plus pro-
bable ?
Sans doute celui qui se situe à
mi-chemin. L’exemple du Mozam-
bique montre que croissance rapi-
de et aide élevée sont possibles.
Mais sans céder au scénario noir,
on peut aussi supposer qu’un cer-
tain nombre de pays, compte tenu
de leurs handicaps, n’entreront pas
à moyen terme dans des logiques
de rattrapage économique. Si ce
scénario est juste, alors la volonté
de réaliser les ODM dans un calen-
drier aussi serré reviendra à mettre
en place un « filet de sécurité socia-
le planétaire » à travers lequel la
communauté internationale finan-
cerait de manière récurrente les
budgets sociaux des pays les plus
pauvres. Il est permis de penser que
la nécessité d’assurer l’accompagne-
ment social de la globalisation et de
gérer les inégalités à un niveau pla-
nétaire implique de s’engager sur
ce chemin. Nous instaurerions
donc, en partie, un système de
répartition et de redistribution à
l’échelle du globe à travers l’instru-
ment de l’aide au développement.
Pourquoi pas ? Nous faisons déjà
de la redistribution à l’intérieur
d’un même pays ou à l’intérieur de
l’Union européenne par exemple,
entre les régions riches et les
régions pauvres. Mais il faut en
avoir conscience et le dire. Car à
partir du moment où la communau-
té internationale sera devenue le
payeur effectif des enseignants, des
médecins, des infirmiers… dans un
certain nombre de pays pauvres, il
sera très difficile de revenir en arriè-
re.
Il faut néanmoins faire attention
à ne pas vouloir brusquer l’évolu-
tion de certains pays, à vouloir faire
trop vite, au risque de les découra-
ger. En Afrique sahélienne, plu-
sieurs pays qui ne connaissent pas
de crise politique ni de conflits réali-
sent des performances tout à fait
honorables compte tenu du milieu
difficile avec lequel ils doivent com-
poser. Avec des taux de croissance
de l’ordre de 5 % depuis plusieurs
années, le niveau de vie s’améliore,
un secteur privé émerge. Il faut les
aider à poursuivre dans cette voie
et se méfier de notre impatience.
Cette hypothèse a pourtant été
jusqu’à présent peu évoquée,
pourquoi ?
D’abord, parce que nous devons
rester prudents. Si les donateurs ne
respectent pas leurs engagements,
le débat sur l’augmentation de
l’aide et ses conséquences devien-
dra très vite irréaliste. Ensuite, par-
ce que la plupart des profession-
nels de l’aide au développement
ont des scrupules à parler des chan-
gements et des problèmes qui pour-
raient se poser à l’avenir. Ils redou-
tent que la complexité des ques-
tions en jeu, leur charge politique,
nuisent à l’effort d’augmentation
de l’aide qui doit être fait. Tout en
étant un fervent partisan de l’ac-
croissement des financements en
faveur des pays du Sud, je crois
cependant qu’il serait malhonnête
de ne pas exposer à nos opinions
publiques, aux contribuables qui
sont sollicités, tous les scénarios
possibles.
Propos recueillis par
Laurence Caramel
G
eorge W. Bush a déci-
dé d’être présent sur
le terrain de l’aide
aux pays pauvres. Il
veut faire plus et
d’une autre manière.
La nouvelle politique américaine en
matière d’aide au développement a
un objectif clair : lutter contre la pau-
vreté en favorisant la croissance éco-
nomique. Pour que cette aide soit
efficace, le président américain a
voulu qu’elle soit distribuée avec dis-
cernement. Les financements, le
plus souvent des dons, doivent
« récompenser les nations qui met-
tent fin à la corruption, respectent les
droits de l’homme et adhèrent à la
règle de droit (…), investissent pour
améliorer le système sanitaire, l’ensei-
gnement (…) et ont des marchés plus
ouverts ainsi que des politiques budgé-
taires solides », avait expliqué
M. Bush devant la Conférence des
Nations unies sur le financement du
développement à Monterrey, en
2002.
Créé un an plus tard et présenté
comme le programme d’aide exté-
rieure le plus ambitieux depuis le
plan Marshall, le Millenium Challen-
ge Account (MCA) ou Fonds pour
les défis du millénaire est l’instru-
ment destiné à mettre en œuvre cet-
te politique. Contrairement à ce que
son appellation pourrait faire croi-
re, ce dispositif d’aide n’a pas été
spécialement conçu pour atteindre
les Objectifs du millénaire. Déjà
16 pays pauvres ont été retenus par-
mi les 63 pays éligibles, à savoir
ceux dont le revenu annuel par habi-
tant est inférieur à 1 435 dollars et
qui peuvent bénéficier des concours
de l’Agence internationale de déve-
loppement, affiliée à la Banque
mondiale. Pour l’Afrique, le Bénin,
le Cap-Vert, le Ghana, le Lesotho,
Madagascar, le Mali, le Mozambi-
que et le Sénégal sont les bons élè-
ves, qui ont réussi la sélection por-
tant sur des critères relatifs à la bon-
ne gouvernance, l’activité économi-
que et la politique sociale. De
même, la Bolivie, le Honduras, le
Nicaragua, la Mongolie, le Sri Lanka
et Vanuatu ont été qualifiés ainsi
que, pour l’Europe, l’Arménie et la
Géorgie.
Ces pays dont le nombre est appe-
lé à grossir – le Maroc a réussi l’exa-
men pour 2005 – n’ont toutefois pas
encore vu tomber une pluie de dol-
lars. Il leur faut d’abord négocier et
conclure un contrat établissant un
partenariat avec la Millenium Chal-
lenge Corporation (MCC), nouvel
organisme qui gère le MCA. L’entiè-
re responsabilité est laissée au réci-
piendaire pour arrêter ses projets
d’investissement. « Les pays eux-
mêmes vont chercher à stimuler la
croissance économique dans les
domaines qu’ils jugent être les plus
importants », a expliqué Paul Apple-
garth, le patron de la MCC.
Ce travail de conception des pro-
jets n’est pas toujours facile. Les
montants en jeu peuvent être impor-
tants. A titre d’exemple, le gouverne-
ment sénégalais, qui souhaite désen-
gorger Dakar en créant une zone
économique et industrielle à une
trentaine de kilomètres de la capita-
le, espère décrocher 548 millions de
dollars. Structure légère sans anten-
ne sur le terrain, celle-ci devra faire
la preuve de son efficacité, puisque
le choix a été fait de contourner
l’USaid (l’Agence américaine pour
le développement international),
pourtant rompue aux subtilités de
l’aide extérieure qu’elle a en charge
depuis plus de quarante ans.
A ce jour, pas le moindre dollar
n’a encore été décaissé par l’admi-
nistration américaine et le MCA n’a
pas reçu les fonds promis. Alors
que, en 2002, George W. Bush vou-
lait que les Etats-Unis, montrant
l’exemple, augmentent de 50 % leur
aide publique sur les trois années à
venir, de sorte que, à partir de 2006,
5 milliards de dollars soient alloués,
chaque année, au MCA, on est
aujourd’hui loin du compte. Pour
l’année 2004, le MCA n’a reçu que
1 milliard de dollars contre les 1,7
promis. Et cette année, le budget
adopté ne s’élève qu’à 1,5 milliard
de dollars contre 3,3 milliards
annoncés initialement.
En son temps, Bill Clinton avait
prôné la doctrine du « Trade but
not aid » pour l’Afrique et initié
dans ce cadre l’AGOA (African
Growth and Opportunity Act), loi
qui permet un accès libre de droits
de douane au marché américain
pour certains produits africains.
Mais l’AGOA, que M. Bush a
d’ailleurs maintenue, n’a guère
dopé les exportations africaines, en
dehors de l’industrie textile. Le ris-
que est maintenant que les pays pau-
vres soient à nouveau déçus avec le
Fonds pour les défis du millénaire.
Brigitte Breuillac
CHRONIQUE
Réveil en sumoland
le fonds
pour les défis
du millénaire
a retenu 16 pays
Jean-Michel Severino, directeur général de l’AFD
« Il faut éviter aux Etats de sombrer
dans le piège de la dépendance »
f2001 Jean-Michel Severino est
nommé directeur général de l’Agence
française de développement (AFD).
f1996 Inspecteur des finances ayant
fait toute sa carrière dans les milieux
de la coopération depuis sa sortie
de l’ENA en 1984, il rejoint la Banque
mondiale à Washington. Un an plus tard,
il devient vice-président pour l’Asie.
f1994 Directeur du développement
au ministère de la coopération.
par Serge Marti
S'engager dans la vie quotidienne, s'impliquer pour faire vivre
de grandes idées… décidément, ça vous ressemble !
En intégrant l'EN3S, l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale,
vous deviendrez l'un des acteurs de l'évolution du service public de
la Sécurité sociale. Durant votre scolarité, rémunérée, vous y serez
formé(e) aux différents métiers de la Protection sociale. En mettant
votre enthousiasme et vos talents au service de la Sécurité sociale,
vous contribuerez à assurer l'avenir de 60 millions de personnes.
Que serait une grande idée sans talents
pour la faire vivre ?
CONCOURS D'ENTRÉE 2005
Retrait des dossiers avant le 21 mars 2005.
En savoir plus ? Ecrivez à l’EN3S, Service
des concours, 27 rue des Docteurs Charcot,
42031 St-Étienne Cedex 2. Tél. : 04 77 81 15 15
www.en3s.fr
S’engager pour changer les choses
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE SÉCURITÉ SOCIALE
JEAN-MICHEL SEVERINO
Les Etats-Unis prônent un soutien ciblé et contractuel
nippon ni mauvais. On peut ne
pas être très fier de ce jeu de mots
trop facile et admettre qu’il colle
bien à l’interprétation possible du
repli de 0,1 % du produit intérieur
brut (PIB) japonais au dernier tri-
mestre 2004, annoncé à la
mi-février. Ajouté à la révision à la
baisse de la croissance pour les
trois mois précédents (transformée
en un repli de 0,3 % au lieu d’une
hausse initialement estimée à
0,1 %), il plaçait l’économie de l’Ar-
chipel en situation technique de
récession en fin d’année – caractéri-
sée par une contraction du PIB pen-
dant deux trimestres consécutifs.
Pour désagréable qu’elle soit au
moment où les pouvoirs publics
s’efforcent de convaincre leurs
administrés, comme leurs partenai-
res extérieurs, que le soleil s’est
levé à nouveau sur l’ex-empire, cet-
te contre-performance mérite
d’être relativisée. D’abord parce
que le Japon a récemment revu son
outil statistique – un domaine où le
pays patauge depuis des années –
si bien que les variations infinitési-
males du PIB de part et d’autre de
la ligne jaune, ont peu de significa-
tion. Ensuite parce qu’il est indénia-
ble que la deuxième économie mon-
diale va beaucoup mieux que ne le
laissent apparaître ces données
conjoncturelles de la fin 2004.
La matérialisation de ce redresse-
ment était perceptible en fait
depuis le dernier sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du
G7-G8 qui s’est tenu à Sea Island,
aux Etats-Unis en juin 2004 et au
cours duquel, pour la première fois
depuis longtemps, le premier minis-
tre, Junichiro Koizumi, n’a pas eu à
subir, tête baissée, les rappels à l’or-
dre en faveur d’une meilleure ges-
tion de l’économie nippone réguliè-
rement infligés à ses prédécesseurs
par la délégation américaine. Au
demeurant, venant d’une super-
puissance qui, ces derniers temps,
collectionne des déficits abyssaux,
un endettement colossal et une
monnaie en piqué – un triplé qui,
sous d’autres cieux, aurait valu aux
Etats-Unis un programme d’ajuste-
ment structurel du Fonds monétai-
re international (FMI) – ces admo-
nestations suscitaient naturelle-
ment quelques sourires ironiques
autour du tapis vert.
encéphalogramme plat
Qu’en est-il réellement de la situa-
tion ? Indépendamment du « trou
d’air » de la fin de l’année et grâce
aux excellentes performances des
premiers mois, la croissance de l’éco-
nomie japonaise aura été de 2,6 %
en termes réels en 2004, un résultat
qui tranche avec l’encéphalogramme
plat auquel Tokyo nous avait habi-
tué tout au long de la « décennie
perdue ». En ce qui concerne la défla-
tion qui a caractérisé cette période,
constituée de courtes récessions sui-
vies par autant de reprises avortées,
le débat demeure tout en s’atté-
nuant. Si certains, tel Haruo Shima-
da, président du Centre de recher-
che économique affilié à l’Institut
de recherche Fujitsu et, proche du
gouvernement en place, considè-
rent que 2005 sera encore une
année de déflation, de plus en plus
d’économistes anticipent la fin du
phénomène, soulignant que l’en-
semble des prix, exception faite de
ceux des services publics, repartent
à la hausse.
Contrairement à la reprise précé-
dente de 1999-2000 qui s’était rapi-
dement essoufflée après avoir spo-
radiquement stimulé l’industrie, le
rebond en cours s’est amplement
diffusé dans ce secteur, mais en
s’étendant aussi à l’ensemble des
services. Du coup, c’est l’ensemble
des entreprises japonaises qui ont
affiché au cours de leur dernier exer-
cice fiscal, des bénéfices en forte
hausse, parfois de 50 % sur l’année
précédente alors que reprennent
les fusions-acquisitions. Témoin le
mariage que viennent de sceller
Mitsubishi Tokyo Financial Groupe
et UFJ, qui fait de cet ensemble le
numéro un bancaire, en termes
d’actifs, devant l’américain Citi-
group. Et un nouveau sumo dans le
cercle étroit des leaders mondiaux.
DOSSIER
« A partir du moment où la communauté
internationale sera devenue le payeur effectif
des enseignants, des médecins,
des infirmiers… dans un certain nombre
de pays pauvres, il sera très difficile de revenir
en arrière »
« Récompenser les nations qui mettent fin
à la corruption, respectent les droits
de l’homme (…), investissent pour améliorer
le système sanitaire, l’enseignement (…)
et ont des marchés plus ouverts (…) »
george w. bush, à monterrey en 2002
LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005/III

U
ne économie qui se
redresse lentement
après vingt-trois
ans de guerre et de
chaos, sans pour
autant que cette
amorce de croissance soit équitable-
ment partagée. L’Afghanistan reste
largement à la traîne, tant au regard
des Etats voisins que d’autres
nations plus lointaines, elles aussi
en mal, développement ; c’est ainsi
que peuvent être résumées les
conclusions du volumineux rapport
– le premier du genre concernant ce
pays – sur le développement
humain que le Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) vient de publier. Un
Etat qui, après s’être débarrassé du
régime des talibans, en 2001, suite à
l’intervention militaire d’une coali-
tion dirigée par les Etats-Unis, est
entré dans un processus de transi-
tion vers la démocratie après l’élec-
tion présidentielle d’octobre 2004 –
la première dans l’histoire de
l’Afghanistan –, marquée par la vic-
toire du président Hamid Karzaï.
Sous l’autorité du pouvoir post-
talibans, le produit intérieur brut
(PIB), excluant les activités liées à la
production et à l’exportation
d’opium qui restent la principale
source de revenus (elles représen-
tent 32,8 % du PIB), a atteint l’équi-
valent de 4,05 milliards de dollars en
2002, soit une progression de 25 % à
30 % sur 2001. Le secteur agricole,
qui représente environ 52 % du PIB
« officiel », a contribué à lui seul à
une bonne moitié du résultat final.
Pour l’année 2003, les estimations
faites par les auteurs du rapport
tablent sur une croissance de 16 %.
Ce pourcentage devrait se mainte-
nir autour de 10 % à 12 % par an au
cours de la prochaine décennie,
selon leurs projections. Pour positif
qu’il soit, ce retour de la croissance
n’a pas atténué les inégalités qui
demeurent. En 2003, les Afghans les
plus pauvres, qui représentent enco-
re 30 % d’une population évaluée à
quelque 24 millions d’habitants,
n’ont recueilli que 9 % du revenu
national, le tiers de la population la
plus aidée en accaparant 55 %. Cet-
te dernière tranche se trouve en
priorité à Kaboul, la capitale, et en
milieu urbain en général, là où rési-
dent 28,8 % de la population.
Avec 822 dollars de revenu
annuel par habitant (en parités de
pouvoir d’achat), l’Afghanistan est
sans doute le plus mal loti de la
région, y compris par rapport à d’ex-
Républiques soviétiques comme le
Tadjikistan (980 dollars). Mais c’est
au vu de l’indicateur de développe-
ment humain établi par le PNUD
que la photographie sociale du pays
est la plus sombre. Selon la version
2004 de cet indice, l’Afghanistan se
situait encore au 173erang mondial
sur un total de 178 pays recensés.
Seules quelques nations subsaha-
riennes sont encore plus mal
notées. Un Afghan sur deux peut
être considéré comme pauvre,
selon les critères des Nations unies
(moins de 2 dollars par jour), un
peu plus de 20 % de la population,
essentiellement rurale, consom-
mant moins de 2 000 calories par
jour, la moitié de cette même popu-
lation souffrant chroniquement de
la sécheresse. Dans ces conditions,
il ne faut pas s’étonner que l’espé-
rance de vie soit seulement de
44,5 ans en Afghanistan, soit vingt
ans de moins que la moyenne des
pays environnants. Hommes et fem-
mes sont sur ce point quasiment à
égalité.
Au chapitre de la santé, une fem-
me meurt en couches toutes les
30 minutes et un enfant sur cinq
meurt avant l’âge de 5 ans, un des
taux de mortalité infantile les plus
élevés au monde. Le décès d’un
enfant sur huit est dû aux maladies
résultant de l’eau contaminée. Les
auteurs du rapport soulignent toute-
fois les progrès accomplis en matiè-
re de prévention et de vaccination
contre les maladies infantiles. Pour
ce qui est des femmes afghanes,
leur sort est encore peu enviable,
seul celui de leurs homologues du
Niger ou du Burkina-Faso étant
pire, selon un indicateur spécifique
établi par le PNUD en fonction du
sexe. Les habitudes culturelles, mais
aussi les années de discrimination
et de pauvreté, les ont particulière-
ment affectées. Illettrées pour 87 %
d’entre elles, les femmes afghanes
sont encore très souvent victimes
de malnutrition, de viols et de vio-
lences domestiques, de mariages
forcés et d’exclusion de la vie publi-
que. Cela en dépit de l’incontestable
effort accompli depuis deux ou trois
ans pour leur permettre d’accéder à
l’éducation et à l’espace public, la
nouvelle Constitution stipulant que
les hommes et les femmes ont
désormais des droits et des devoirs
égaux. Quelques sièges sont ainsi
réservés aux femmes à l’Assemblée
nationale.
Grâce aux efforts entrepris par les
Afghans eux-mêmes sur la voie de
la démocratisation, d’une meilleure
sécurité intérieure et d’un respect
des droits humains et avec le
concours de l’aide internationale
(les bailleurs de fonds se sont enga-
gés à verser près de 6 milliards de
dollars pour les six prochaines
années), l’Afghanistan peut espérer
un développement plus harmo-
nieux. Mais il lui faut compter avec
l’afflux de réfugiés encouragés par
la normalisation de la situation.
Depuis la chute des talibans, plus de
1,8 million d’Afghans sont revenus
du Pakistan, auxquels se sont joints
600 000 compatriotes en provenan-
ce d’Iran. Il en résulte un besoin
massif d’intégration qui s’ajoute au
problème posé par un million de
personnes déplacées que compte le
pays, le chiffre le plus important au
monde derrière celui du peuple
palestinien.
Serge Marti
le pays se situe
encore
au 173erang
mondial (sur 178),
selon
l’indicateur
de développement
humain du pnud
UN CHIFFRE
43,9
c’est, en milliards d’euros,
la part versée aux ménages
en 2003 au titre de la famille
et de la maternité
pays émergents
PIB par habitant et par région, en 2002 (UE 25 = 100)
Les dix plus élevés
LA PAUVRETÉ SE CONCENTRE À L'EST
Les dix plus bas
315
234
213
188
176
174
162
160
158
158
Londres
Bruxelles
Luxembourg
Hambourg
Ile-de-France
Vienne
Berkshire,
Buckinghamshire,
Oxfordshire
Bolzano
Stockholm
Oberbayern
Lublin
Basses-Carpates
Warmie-Mazurie
Podlachie
Sainte-Croix
Nord de la Hongrie
Opole
Nord de l'Alföld
Slovaquie de l'Est
Lettonie
R.-U.
Belg.
Lux.
All.
Fr.
Autr.
R.-U.
Ital.
Suèd.
All.
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Pol.
Hong.
Pol.
hong.
Slov.
32
33
34
35
36
37
37
38
39
39
Source : Eurostat
innovation
L’économie afghane en progrès, la société à la traîne
Illettrées pour 87 % d’entre elles, les femmes
afghanes sont encore très souvent victimes
de malnutrition, de viols et de violences
domestiques, de mariages forcés
et d’exclusion de la vie publique
Les ménages ont bénéficié en
2003 de 43,9 milliards d’euros,
soit 2,8 % du produit intérieur
brut, au titre de la famille et de
la maternité. Selon une étude
de la Drees (ministère de l’em-
ploi et de la famille), ce chiffre
place la France dans une posi-
tion « moyenne au sein de
l’Union européenne ».
Depuis une quinzaine d’an-
nées, l’effort en faveur des
familles est resté stable. L’Hexa-
gone se situe « au septième
rang, derrière le Danemark
(3,8 %), la Finlande (3 %), la Suè-
de (2,9 %), le Luxembourg
(3,4 %), l’Allemagne (3 %) et
l’Autriche (2,9 %) », mais devant
« l’Irlande, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni » (1,8 % du PIB
consacré à la famille) et bien
avant les pays d’Europe du Sud
(0,5 à 1,2 % du PIB pour l’Espa-
gne, l’Italie et le Portugal).
Les 43,9 milliards d’euros se
répartissent entre les presta-
tions de protection sociale du
risque famille (allocations fami-
liales, compléments familial,
allocations de rentrée sco-
laire...), soit 38,2 milliards
d’euros, et celles au titre du
risque maternité (5,8 milliards
d’euros en soins de santé,
indemnités journalières de
maternité et de paternité, allo-
cation pour jeune enfant...)
Taux de variation du PIB, par an, en %
REGAIN DE CROISSANCE AU MEXIQUE
Source : Ministère des finances mexicain
–1
0
1
2
3
4
5
6
7
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04
5,2
6,8
5,0
3,6
6,6
– 0,2
0,8
1,3
4,4
europe/industrie
Valeur ajoutée dans l'industrie automobile en 2001, en pourcentage du total de l'UE25
LES DÉLOCALISATIONS RESTENT LIMITÉES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
Source : Eurostat Grèce et Luxembourg : données non disponibles
Allemagne
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suède
Belgique
Autriche
Pologne
Pays-Bas
République tchèque
Hongrie
Portugal
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Slovénie
Chypre
Estonie
Lituanie
Malte
47,1
14,3
10,7
6,2
5,8
4,1
2,7
1,7
1,7
1,5
1,3
0,9
0,7
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0
0
0
Lettonie
0
0
europe/régions
Principaux domaines concernés par des solutions en mode ASP*,
en % d'entreprises
LA MONTÉE DES SOLUTIONS LOGICIELLES EXTERNALISÉES
Source : Markess International * Application Service Provider ( fournisseur d'applications logicielles hébergées)
Echantillon : 60 entreprises du périmètre grands comptes ouvertes aux solutions en mode ASP
Oui, c'est déjà le cas En projet d'ici 2006
Achats
Collaboratif
Ressources humaines
Ventes / marketing
relations client
Prod. et exploitation
informatique
45
45
35
33
30
38
33
25
22
20
BOUSSOLE
Dernier mois
connu
LES INDICATEURS FRANÇAIS
Source : Insee, Douanes
* Solde de réponses, CVS, en % ** en glissement
Consommation des ménages
Taux d'épargne
Pouvoir d'achat des ménages
(en milliards d'euros)
Créations d'entreprises
Variation
sur un an
4 094
(août 04)
+ 7,8 %**
24 995
(janv. 05)
+ 3,7 %**
– 1,89
(déc. 04)
– 6,9 %
0,3
%
(T3/04)
– 0,1 %
(T3/04 - T4/03)
Enquête mensuelle sur le moral
des ménages * –25
(janv. 05)
–3%
Enquête mensuelle dans l'industrie
*
Opinion des chefs d'entreprise
sur les perspectives générales de production
–4
(janv. 05)
–17%
(entre sept. 04
et janv. 05)
Défaillances d'entreprises
par date de publication
Commerce extérieur
15,6 %
(T3/04)
+ 1,5 %
(jan. 2005)
+ 3,8 %
– 0,2 %
(T3/04 -T4/03)
Comparaison du produit intérieur brut par habitant en 2002, en dollars
UNE PAUVRETÉ ENCORE TRÈS ÉLEVÉE
Source : PNUD
Iran
Turkménistan
Pakistan
Ouzbékistan
Burkina Faso
Tadjikistan
Afghanistan
Niger
Guinée-Bissau
Sierra Leone
6 690
4 300
1 940
1 670
1 100
980
822
800
710
540
aLE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT a progressé de 4,4 % en 2004, contre 1,3 %
l’année précédente, selon le ministère des finances mexicain. L’activité a
été la plus dynamique dans le secteur des services (4,8 %).
aCE REGAIN DE CROISSANCE s’est accompagné d’un flux d’investissements
directs étrangers (IDE) en hausse de 46 % en 2004. D’un montant de
1,49 milliard de dollars, ils représentent pour l’économie nationale une
source de financement aussi importante que les capitaux envoyés par les
Mexicains vivant à l’étranger. Les Etats-Unis sont à l’origine de 48 % des
IDE et l’Espagne y contribue pour 34,7 %
aEN 2001, LA VALEUR AJOUTÉE de l’industrie automobile
s’élevait à près de 122 milliards d’euros dans l’Union
européenne à vingt-cinq (UE25). Cette industrie est très
concentrée dans un petit nombre de pays au sein de
l’UE : la plupart des Etats membres, en particulier les dix
nouveaux adhérents, qui ont perdu l’essentiel de leur
capacité de production autonome, apparaissent essen-
tiellement comme des marchés de consommation.
aL’ESSENTIEL DE LA VALEUR continue d’être créé dans
les Etats d’origine des grandes firmes automobiles :
l’Allemagne, qui en concentre à elle seule 47,1 %, sui-
vie de loin par la France (14 %), le Royaume-Uni
(11 %) et l’Italie (6 %).
aEN 2001, PLUS DE 2 MILLIONS de personnes tra-
vaillaient dans l’industrie automobile, dont plus de
la moitié dans le secteur de la construction de véhi-
cules automobiles. La fabrication d’équipements
automobiles représentait près de 40 % de l’emploi
dans cette branche.
aCONTRAIREMENT à ce que pourrait laisser croire l’am-
pleur des délocalisations, ce sont les pays d’origine de
cette industrie qui continuent de concentrer l’essen-
tiel de la main-d’œuvre : l’Allemagne (près de 40 %),
la France (13 %), le Royaume-Uni (10 %), l’Italie et l’Es-
pagne (8 % chacun), alors que la République tchèque
et la Pologne n’en occupent que 4 % chacune.
aEN 2002, LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) par habitant
des 254 régions de l’UE25, exprimé en standards de
pouvoir d’achat, était près de quatre fois plus faible
dans la région la plus pauvre, en Pologne, que dans la
plus riche, la région de Londres.
aPARMI LES 37 RÉGIONS dépassant le seuil de 125 % de
la moyenne de l’UE, 7 se situaient au Royaume-Uni,
6 en Allemagne et en Italie, 4 aux Pays-Bas et en Autri-
che, 2 en Belgique et en Finlande, et 1 en République
tchèque, en Espagne, en France, en Irlande et en Suè-
de, ainsi que dans le grand-duché de Luxembourg.
Parmi les nouveaux Etats membres, la seule région
concernée était Prague, en République tchèque.
aPARMI LES 59 RÉGIONS disposant d’un PIB par habitant
inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE, 16 se situaient
en Pologne (dont les 5 moins riches), 7 en République
tchèque, 6 en Hongrie ainsi qu’en Allemagne, 5 en
Grèce, 4 en Italie et au Portugal, 3 en Slovaquie, 2 en
Espagne, etc.
aDANS CERTAINES RÉGIONS, le niveau du PIB par habi-
tant peut être surestimé en raison du flux de tra-
vailleurs frontaliers, qui accroissent la production
d’une région (Inner London par exemple) mais rési-
dent dans une autre (Outer London, Kent et Essex).
De même, une proportion élevée de retraités peut se
traduire par un PIB régional par habitant plus faible.
aLA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSEIL Markess International a interrogé
60 grandes entreprises françaises qui recourent aux services d’héber-
geurs d’applications informatiques (en anglais « application service pro-
vider », ASP), une solution qui permet d’externaliser le fonctionnement,
et le coût, d’une application logicielle. C’est dans le domaine des achats
et du travail collaboratif que le recours aux ASP est le plus fréquent.
aDANS LE DOMAINE DE LA GESTION des ressources humaines, les fonctions
concernées sont, par ordre décroissant, le recrutement, la paie, la gestion
des compétences, la gestion des plannings et la formation.
IV/LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005

NEW YORK
de notre correspondant
G
eorge W. Bush n’a
pas fait allusion, à
l’occasion de son
voyage en Europe,
du 21 au 24 février, ni
lors de ses discours
d’investiture, en janvier, pas plus
qu’à l’occasion de son message sur
l’état de l’Union, en février, aux pro-
blèmes monétaires. Pourtant, ils
pourraient bien un jour se rappeler
à lui. La récente rechute du dollar
illustre la nervosité des cambistes. Il
a suffi que la Banque centrale de
Corée du Sud évoque, le 23 février,
une diversification de ses réserves
de change au détriment du billet
vert pour provoquer un début de
panique. « Si les marchés financiers
perdent confiance dans le dollar car
l’administration ne montre aucune
volonté de réduire le déficit budgétai-
re, alors la question monétaire pour-
rait bien empoisonner le second man-
dat de M. Bush et même les relations
internationales », estime Ashraf Lai-
di, responsable des études de chan-
ge du MG Financial Group.
La baisse du billet vert, de 35 %
depuis trois ans face à l’euro et de
25 % face au yen, est déjà une sour-
ce de tensions entre les Etats-Unis
d’un côté et l’Europe et l’Asie de
l’autre. Il y a un mois, Hervé Gay-
mard, le ministre français des finan-
ces, soulignait que « l’Europe a payé
jusqu’à aujourd’hui une part trop
importante au réajustement monétai-
re ». Son homologue allemand,
Hans Eichel, demandait « aux Etats-
Unis de réduire leurs déficits, chacun
doit jouer son rôle ».
A la fin de l’année 2004, le pre-
mier ministre chinois Wen Jiabao
avait été plus direct. Se plaignant de
la baisse du dollar, il s’était interro-
gé : « Est-ce que les autorités compé-
tentes pourraient faire quelque chose
à ce sujet ? » Les Chinois se mon-
trent d’autant plus critiques qu’ils
font l’objet de pressions de Wash-
ington pour abandonner le lien rigi-
de entre le yuan et le dollar. Le défi-
cit commercial américain avec la
Chine a atteint, en 2004, le niveau
sans précédent de 161 milliards de
dollars. Mais Pékin résiste dans la
crainte de casser sa croissance.
En Asie comme en Europe, la
capacité et surtout la volonté des
dirigeants américains d’organiser
l’économie mondiale dans l’intérêt
commun sont mises en doute. Il y a
vingt ans, les Etats-Unis et les gran-
des puissances étaient capables
d’adopter les accords du Plaza pour
contrôler les évolutions monétaires.
Des secrétaires au Trésor de poids
comme le républicain James Baker
et ultérieurement le démocrate
Robert Rubin étaient à même de
limiter l’envolée du dollar dans les
années 1980 et de faire face aux cri-
ses monétaires des années 1990 en
Amérique latine, en Asie et en Rus-
sie. Mais le Trésor américain a per-
du une bonne partie de son influen-
ce et de son prestige, aux Etats-Unis
et à l’étranger.
M. Bush manifeste un intérêt limi-
té pour les problèmes économiques
mondiaux et ses secrétaires au Tré-
sor ne pèsent pas sur les décisions
de l’administration. Cela a un prix.
L’échec de Washington à contrain-
dre la Chine à adopter des taux de
change flottants et à rallier d’autres
pays pour faire pression sur Pékin
illustre une perte de pouvoir écono-
mique. « Chacun doit s’adapter à
une situation où on ne peut plus
compter sur l’Amérique », souligne
Hideo Kumano, économiste de Dai-
Ichi Life « C’est d’autant plus dange-
reux que, le passé l’a prouvé, l’égoïs-
me des nations peut transformer des
crises financières, anodines à l’origi-
ne, en catastrophes », ajoute-t-il.
bouc émissaire
Le président américain et son
secrétaire au Trésor, John Snow, ne
voient pour le moment que des
avantages à la baisse du dollar. Elle
permet, au moins en théorie, de
réduire le déficit commercial et de
soutenir les entreprises américaines
sans avoir pour le moment trop de
conséquences négatives sur le finan-
cement des déficits. M. Snow consi-
dère que l’économie américaine
continue à faire l’envie du reste du
monde, et qu’il n’y a pas de risques
de voir les investisseurs étrangers
cesser de prêter 600 milliards de dol-
lars par an aux Etats-Unis pour
financer le trou de la balance des
paiements.
Le secrétaire au Trésor laisse
entendre que l’Europe a trouvé un
bouc émissaire facile à son incapa-
cité à avoir une croissance plus for-
te. « Le niveau actuel des déficits est
trop important, ils doivent diminuer
et ils vont diminuer, explique
M. Snow. Mais les Etats-Unis restent
un modèle de réussite »
Ignorant toute contrainte exté-
rieure, l’administration entend ren-
dre définitives les baisses d’impôts
et faire adopter par le Congrès la
réforme du système de retraite, qui
contraindra l’Etat fédéral à emprun-
ter dans les prochaines années
entre 1 000 et 2 000 milliards de dol-
lars. Cela revient, selon les calculs
de plusieurs économistes, à pérenni-
ser le niveau du déficit budgétaire
pour une décennie. Si le gouverne-
ment américain parvient à ses fins,
le billet vert pourrait alors vraiment
décrocher. Une perte de confiance
soudaine dans la devise américaine,
une envolée des taux d’intérêt et
une dégringolade de la Bourse pour-
raient provoquer une récession.
Le risque est d’autant plus réel
qu’il n’y aura plus, à partir de jan-
vier 2006 à la tête de la Réserve fédé-
rale américaine, la présence rassu-
rante d’Alan Greenspan. A 79 ans,
le banquier central le plus respecté
de la planète prendra une retraite
méritée. Or, les crises monétaires à
répétition des années 1990 ont don-
né deux leçons : elles sont toujours
liées aux conditions de finance-
ment de plus en plus précaires d’un
pays et elles sont impossibles à pré-
voir.
« Le financement du déficit des
paiements des Etats-Unis s’est passé
nettement mieux au cours des derniè-
res années que ne le pensaient un cer-
tain nombre d’experts », écrit Roger
Kubarych, ancien économiste en
chef de la Bourse de New York et
membre aujourd’hui du Council on
Foreign Relations (Conseil des rela-
tions extérieures). « Cela ne veut
pas dire que la stabilité du marché
doit être considérée comme garantie
pour toujours », ajoute-t-il.
Eric Leser
HISTOIRES DES MATIÈRES PREMIÈRES
L’élasticité
du caoutchouc
le trésor
américain a perdu
une bonne partie
de son influence
aux états-unis
et à l’étranger
F
aut-il craindre une
remontée généralisée
des taux d’intérêt à long
terme dans le monde ?
Le président de la Réser-
ve fédérale américaine
(Fed), Alan Greenspan, vient en
tout cas de prouver qu’il demeure,
de très loin, la personnalité la plus
influente de la planète en matière
financière. Quelques mots pronon-
cés par lui, mercredi 16 février, ont
suffi à semer le trouble et à provo-
quer une vive remontée de rende-
ments obligataires aux Etats-Unis
mais aussi en Europe (en France,
celui de l’emprunt d’Etat à dix ans
est passé de 3,50 % à près de
3,80 %).
« Pour le moment, le comporte-
ment largement inattendu des mar-
chés obligataires mondiaux reste une
énigme », a-t-il déclaré devant le
Congrès. Aux yeux de M. Greens-
pan, l’énigme réside dans le fait
que, au cours des derniers mois, les
rendements des obligations ont
continué à reculer malgré le resser-
rement de la politique monétaire
américaine. Pendant que la Fed aug-
mentait son taux d’intervention de
1 %, le taux du bon du Trésor améri-
cain à dix ans reculait dans les
mêmes proportions.
Ce sont ces mouvements de sens
opposé qui perturbent M. Greens-
pan. « Ce développement contredit
largement l’expérience qui suggère
qu’une hausse des taux d’intérêt à
court terme est généralement accom-
pagnée par une hausse des rende-
ments à long terme, a souligné
M. Greenspan. Les mouvements des
prix des obligations pourraient être
une aberration à court terme, mais il
faudra du temps avant que nous puis-
sions mieux comprendre les forces
sous-tendant l’expérience récente. »
De fait, la perplexité de
M. Greenspan rejoint celle que de
nombreux économistes ont depuis
longtemps « Y a-t-il quelque chose
de pourri au royaume du crédit ? »,
s’interrogeait le lundi 21 février,
dans le quotidien Les Echos, Valérie
Plagnol, chef stratégiste de CIC-
Marchés. Pas encore, mais il est peut-
être temps de s’en inquiéter. Car un
constat s’impose : deux ans après le
début d’une solide reprise économi-
que mondiale et malgré six hausses
consécutives de taux d’intérêt direc-
teurs de la Fed, la ruée vers les obliga-
tions continue ». Mme Plagnol souli-
gne que « le phénomène concerne
non seulement la dette publique amé-
ricaine et européenne, mais aussi la
dette obligataire des entreprises et cel-
le des grands pays émergents ».
Plusieurs pistes sont avancées
pour expliquer cette apparente ano-
malie. La première est la conviction
des investisseurs qu’un retour de
l’inflation dans un horizon prévisi-
ble est impossible compte tenu de
la nouvelle donne économique. La
mondialisation, avec l’ouverture
des économies et la concurrence de
pays à bas coût de main-d’œuvre
qu’elle implique, constituerait un
rempart infranchissable contre
l’augmentation des prix dans les
nations industrialisées. Dans ces
conditions, l’achat d’emprunts
deviendrait un placement presque
sans risque (l’inflation au contraire
dévalorise les obligations dans la
mesure où elle érode la valeur des
coupons versés annuellement). De
surcroît, en l’absence de tensions
inflationnistes, les banques centra-
les pourraient continuer à mener
des politiques monétaires relative-
ment accommodantes.
A cet élément s’ajoute le fait que
les banques centrales asiatiques,
pour freiner la baisse du billet vert,
achètent massivement des bons du
Trésor américain. Ces acquisitions
permettent le maintien de taux d’in-
térêt à de bas niveaux. D’autres esti-
ment qu’il est vain de chercher des
explications rationnelles à ce mou-
vement. Le marché obligataire
serait victime d’une bulle spéculati-
ve, comme l’avait été le marché
boursier à la fin des années 1990.
C’est ce que laisse entendre
M. Greenspan, qui affirme que
«l’Histoire nous dit que les gens qui
connaissent une longue période de
stabilité sont enclins aux excès ».
« Les acteurs des marchés financiers
semblent très confiants dans l’avenir
(…) et plutôt disposés à prendre des
risques ». Si tel est le cas, il faudrait
alors s’attendre au pire, c’est-à-dire
à un krach obligataire comme il
avait pu s’en produire un en 1992.
Avec des conséquences économi-
ques graves, et notamment le risque
qu’une vive remontée des taux d’in-
térêt à long terme entraîne dans son
sillage un krach immobilier.
En France, la hausse des prix des
maisons et des appartements s’est
nourrie des conditions d’emprunts
historiquement avantageuses. Les
taux des crédits immobiliers sont à
leur plus bas niveau depuis vingt
ans. En février, le taux applicable
pour un prêt d’une durée de quinze
ans était de 3,60 % alors que, en jan-
vier 2000, il était de 5,70 %. Parallèle-
ment à ce reflux des rendements, la
durée des prêts s’est allongée, pou-
vant atteindre jusqu’à trente ans.
L’Etat français lui-même vient de
porter cette logique d’allongement
des échéances à un degré qui n’avait
jamais été atteint dans le monde en
lançant, le 18 février, un emprunt de
6 milliards d’euros à cinquante ans.
Avec succès, preuve de la confiance
– excessive ? – des investisseurs.
Pierre-Antoine Delhommais
par Philippe Chalmin
« les prix du caoutchouc
sont trop élastiques ! » La célèbre
remarque de l’un des personnages
dessinés en son temps par Plantu
à la « une » du Monde a certes fait
mouche mais elle s’applique au
fond assez mal à la sève de l’hé-
véa, l’arbre qui pleure ! Non pas
que l’histoire du caoutchouc ne
soit faite de crises et de rebondis-
sements, de déplacements d’un
continent à l’autre, de Manaus au
Liberia en passant par les sortilè-
ges malais et indochinois. Mais
dans la période la plus récente, le
marché du caoutchouc, concentré
pour l’essentiel en Asie du Sud-
Est, a fait l’objet d’un contrôle rela-
tivement efficace d’abord dans le
cadre d’un accord international
puis directement par les produc-
teurs eux-mêmes.
On connaît l’histoire du caout-
chouc : « découvert » par La Conda-
mine au XVIIIesiècle, utilisé de
manière industrielle grâce aux
découvertes de Macintosh et
Goodyear, suivies par les innova-
tions de Dunlop et de Michelin.
On le sait aussi exploité par les
seringueiros de la forêt amazonien-
ne, « volé » en 1876 par un plan-
teur britannique qui parvint à fai-
re germer quelques graines en
Angleterre avant que de les
envoyer à Ceylan et de là d’essai-
mer dans toute l’Asie du Sud-Est.
De l’épopée brésilienne, il ne res-
te plus que la légende de Manaus
et de son opéra. En Afrique, la célè-
bre plantation de 400 000 hecta-
res de Firestone, au Liberia, n’est
plus que décombres. La produc-
tion de caoutchouc est aujour-
d’hui, pour l’essentiel, asiatique :
les vieilles exploitations malaisien-
nes et indochinoises ont cédé le
pas aux producteurs thaïlandais
et indonésiens, qui disposent
d’une main-d’œuvre plus abon-
dante.
main-d’œuvre féminine
C’est que la culture de l’hévéa et
la récolte du latex sont peu méca-
nisables et font traditionnelle-
ment appel à une main-d’œuvre
importante, souvent féminine.
Contrairement aux cartes postales
jaunies des vieilles plantations
coloniales, plus des trois quarts de
la production asiatique sont le fait
de petits planteurs familiaux.
Elastique, le marché du caout-
chouc le fut dès l’origine, lié très
étroitement aux aléas conjonctu-
rels de son principal débouché, le
secteur automobile. En 1922, on
assista à un premier effort de
contingentement de la production
dans le cadre du plan Stevenson,
mis en place dans les colonies bri-
tanniques ; mais il fut emporté
par la crise de 1929, qui provoqua
un véritable effondrement des
cours. En 1934, ce fut la signature
du premier véritable accord inter-
national entre producteurs qui
visait à réguler production et
exportations. La seconde guerre
mondiale provoqua sa disparition
et par ailleurs fut l’occasion du
développement des caoutchoucs
synthétiques, qui représentent
aujourd’hui à peu près 60 % de la
consommation mondiale d’élasto-
mères.
L’idée de la stabilisation fut
reprise dans les années 1970 dans
le cadre du programme intégré
des produits de base lancé lors de
la réunion de la Conférence des
Nations unies pour le commerce
et le développement (Cnuced) à
Nairobi en 1976. Le caoutchouc
naturel fut en fait le seul produit
pour lequel on parvint à signer un
nouvel accord de stabilisation fon-
dé sur un mécanisme de stock
régulateur. Négocié en 1979, il put
encore bénéficier de la présence
des Etats-Unis, quelques mois
avant le virage radical de leur poli-
tique en ce domaine et le début de
l’isolationnisme libéral reaganien.
fourchette de stabilisation
Durant ses vingt années de fonc-
tionnement – un record –, l’accord
international eut une efficacité rai-
sonnable : pendant six ans seule-
ment les prix se situèrent à l’exté-
rieur de la fourchette de stabilisa-
tion de l’accord : au-dessus en
1980, 1988 et 1994-1995, au-des-
sous en 1982 et 1985. L’action du
stock régulateur était, il est vrai,
appuyée par la cohésion entre les
trois grands producteurs, Malai-
sie, Indonésie, Thaïlande. En 1999,
cependant, le stock se révéla inca-
pable d’enrayer la baisse des prix
faute de financements supplémen-
taires. L’accord sur le caoutchouc
était alors le dernier survivant de
tous les accords de stabilisation
des marchés de matières premiè-
res : en ces temps d’économie de
marché triomphante, ce n’était
vraiment plus une problématique
à la mode, et on jugeait le méca-
nisme du stock peu efficace et
trop coûteux. En février 1999, la
Thaïlande décida de se retirer, et,
le 30 septembre 1999, il fut décidé
de mettre fin à l’accord internatio-
nal et de liquider le stock, qui était
alors de 135 000 tonnes.
Les deux années suivantes, le
marché du caoutchouc fut particu-
lièrement déprimé, subissant le
contrecoup de la récession mon-
diale de 2001-2002. En
juillet 2001, les trois grands pro-
ducteurs, qui pesaient 62 % de la
production mondiale, décidèrent
la création d’un conseil tripartite,
transformé en octobre 2003 en
International Rubber Company. A
l’origine, il s’agissait de réduire la
production (de 4 %) et les exporta-
tions (de 10 %). Par la suite, le
consortium devait pouvoir interve-
nir directement sur les marchés.
L’occasion ne s’est pas présentée
puisque, depuis 2003, les prix du
caoutchouc ont été particulière-
ment soutenus du fait de la repri-
se mondiale et de la dynamique
chinoise, dont la demande a aug-
menté de 75 % entre 1999 et 2005.
Les producteurs se sont dotés
d’un outil de coordination et d’in-
tervention qui devrait à l’avenir
leur permettre de modérer l’élasti-
cité des prix d’un produit sensible
aussi bien aux fluctuations du
pétrole (pour le caoutchouc syn-
thétique) qu’à l’apparition de nou-
veaux producteurs comme le Viet-
nam : un exemple à méditer pour
nombre d’autres matières premiè-
res et qui montre bien qu’un mini-
mum de collaboration entre pro-
ducteurs ne nuit pas à l’efficacité
des marchés.
Philippe Chalmin est professeur
associé à l’université Paris-Dau-
phine.
Jusqu’à présent, la chute du dollar
n’inquiète pas Washington
FOCUS
pour le patron
de la réserve
fédérale
américaine,
alan greenspan,
le comportement
des marchés
reste une énigme
La remontée des taux d’intérêt à long terme
réveille la crainte d’un krach obligataire
La mondialisation, avec l’ouverture
des économies et la concurrence de pays
à bas coût de main-d’œuvre qu’elle implique,
constituerait un rempart contre l’augmentation
des prix dans les nations industrialisées
Taux de l'emprunt d'Etat français à dix ans, en %
UNE HAUSSE BRUTALE
Source : Bloomberg
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
2004 2005
3,754
4,199
Le 23 février
Septembre Octobre Décembre Janvier FévrierNovembre
LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005/V
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%