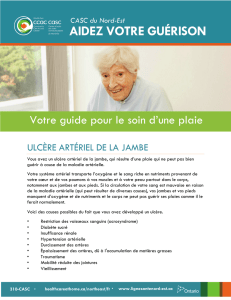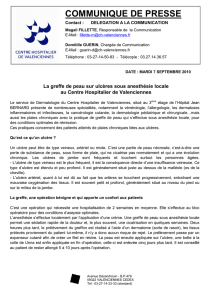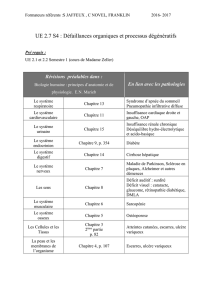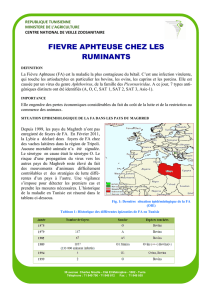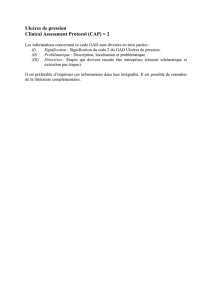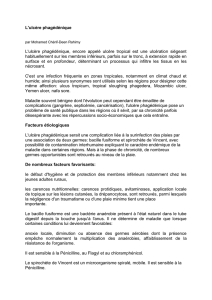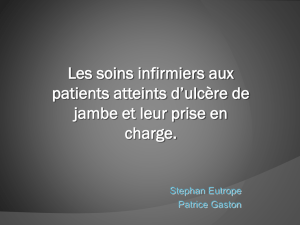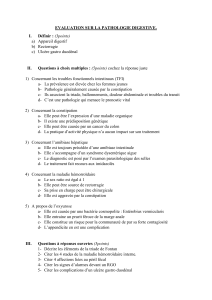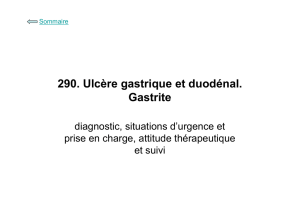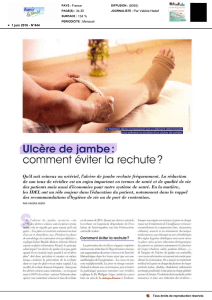Commentaires personnels

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
25
26
la pathoI
Les ulcères de jambe
36
le matérielI
Les compléments nutritionnels oraux pour adulte
39
la prépI
Des gélules pédiatriques de topiramate
40
le point sur…I
Manger équilibré pour un adulte
42
l’ordoI
Ajout de lévothyroxine au Thyrozol chez une
patiente atteinte de la maladie de Basedow
SAVOIR
1. Un ulcère de jambe est
considéré comme une plaie
chronique :
a. vrai ;
b. faux.
2. Les ulcères de jambe sont
dus à une maladie vasculaire
des membres inférieurs dans :
a. 50 % des cas ;
b. 70 % des cas ;
c. 90 % des cas.
3. La compression médicale
est un traitement de :
a. l’insuffisance veineuse ;
b. l’ulcère veineux ;
c. l’ulcère mixte à prédominance
veineuse ;
d. l’ulcère artériel.
4. L’ulcère artériel est causé
par :
a. une artériopathie des membres
inférieurs ;
b. un défaut d’apport d’oxygène
et d’éléments nutritifs aux tissus
en aval de l’artère bouchée ;
c. une destruction des tissus par les
toxines qui ne sont plus évacuées.
5. L’ulcère veineux a un aspect :
a. acéré avec des bords abrupts
et bien délimités ;
b. superficiel avec des bords
irréguliers.
6. L’ulcère mixte :
a. est dû à l’association
d’une insuffisance veineuse
et d’une artériopathie ;
b. est caractérisé par la présence
d’une artériopathie modérée
qui n’explique pas à elle seule
l’altération cutanée.
7. Une coloration jaune
du fond de l’ulcère :
a. est due à la présence de fibrine ;
b. est plus caractéristique
d’un ulcère veineux ;
c. est plus caractéristique
d’un ulcère artériel.
8. L’exercice physique,
et notamment la marche :
a. est contre-indiqué en cas
de compression veineuse ;
b. est indispensable à l’activation
de la pompe musculaire en plus
de la compression veineuse.
Que savez-vous sur les ulcères de jambe?
Après avoir lu les pages suivantes, vous aurez 100 % de bonnes réponses. Mais avant ?
1. a ; 2. c ; 3. a, b et c ; 4. a et b ; 5. b ; 6. a et b ; 7. a et b ; 8. b.
Réponses :

la patho
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
27
la patho
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
tème veineux ramène le sang vers le cœur et
l’empêche de redescendre malgré l’effet de
l’apesanteur grâce à :
> la contraction des muscles, principalement au
niveau du mollet (pompe musculaire), surtout
lors de la marche ;
> l’action de valvules présentes dans la lumière
des veines qui servent de clapets anti-reflux.
Une défaillance de la pompe musculaire ou du
système anti-reflux laisse le sang redescendre
dans la veine, où il stagne et provoque une
hyperpression veineuse (voir infographie).
nFormation de l’ulcère. Les déchets produits
par l’activité cellulaire, ou toxines, ne sont plus
évacués et éliminés normalement via le système
veineux et diffusent autour de l’hyperpression
veineuse. Ils s’attaquent aux tissus environnants,
qui se nécrosent d’abord en profondeur jusqu’à
l’ouverture de la plaie en surface de la peau.
Ulcère artériel
En lien avec une artériopathie, l’ulcère artériel
concerne le plus souvent les hommes de plus
de 50 ans présentant des facteurs de risque d’ar-
tériopathie oblitérante chronique des membres
inferieurs (AOMI, voir Dico+) : tabagisme, hyper-
cholestérolémie, hypertension artérielle, diabète,
insuffisance rénale chronique, antécédents fami-
liaux de maladie coronarienne précoce.
nUn défaut de perfusion artérielle. L’ulcère arté-
riel est directement en rapport avec le dévelop-
pement de lésions d’athérosclérose dans la
lumière des artères, qui entraînent une diminu-
tion de la perfusion sanguine au niveau du
membre atteint. L’ulcère artériel est la principale
complication cutanée de l’AOMI.
nFormation de l’ulcère. Le défaut d’apport de
sang artériel engendre un défaut d’apport d’oxy-
gène et des éléments nécessaires à sa nutrition.
Comme l’ulcère veineux, l’ulcère artériel débute
La maladie
Définitioni
Un ulcère de jambe correspond à une plaie
chronique située entre le genou et le pied. La
perte de substance cutanée, d’étendue et de
profondeur variables, concerne l’épiderme, le
derme et parfois l’hypoderme.
Il peut survenir à la suite de traumatismes plus
ou moins importants, comme un choc avec un
objet dur, la morsure d’un animal ou la friction
exercée par une chaussure trop serrée sur une
saillie osseuse. Parfois, la pathologie sous-jacente
peut à elle seule provoquer une destruction des
tissus et la formation d’un ulcère.
Étiologiesi
90 % des ulcères de jambe ont une origine vas-
culaire : veineuse, artérielle ou mixte (voir info-
graphie). Les 10 % restants relèvent d’autres étio-
logies très variées.
Les ulcères d’origine veineuse et/ou artérielle
sont classiquement répartis en 70 % d’ulcères
veineux purs, 20 % d’ulcères mixtes et 10 % d’ul-
cères artériels. Ces proportions ne sont plus vrai-
ment représentatives. La part d’ulcères purement
veineux diminue en effet grâce à la prévention
des maladies thrombotiques, tandis que celle
des ulcères artériels ou mixtes augmente.
Physiopathologiei
Ulcères d’origine vasculaire
Ulcère veineux
Il est la conséquence d’une insuffisance vei-
neuse sous-jacente et concerne plus souvent
les femmes de plus de 50 ans (trois femmes
pour deux hommes).
nUne insuffisance veineuse sous-jacente. Le sys-
26
Les ulcères de jambe
Les tissus ne sont plus
suffisamment perfusés.
Ils sont détruits par manque
d’oxygène et d’éléments
nutritifs, et sont à risque
de survenue d’un ulcère
artériel au niveau
du membre atteint.
Ulcère veineux
Une défaillance
de la pompe
musculaire
par manque
d’exercice
physique
et surtout
de marche.
L’artériopathie, qui obstrue
les artères, entraîne
un défaut d’apport
de sang artériel.
Et/ou une défaillance
du système anti-reflux.
La valvule est
défectueuse, le sang
stagne et provoque
une hyperpression
veineuse.
Les tissus se nécrosent
d’abord en profondeur
jusqu’à l’ouverture d’un
ulcère veineux en surface.
Ulcère mixte
Ulcère artériel
Les toxines produites
par les cellules ne sont
plus évacuées via
les systèmes veineux
et lymphatique.
Les toxines
altèrent
les tissus
environnants.
Il est lié à l’insuffisance
veineuse.
En cause :
Il est causé par
des pathologies
veineuses et artérielles
associées.
Il est lié à une artériopathie.
(1) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance maladie pour 2014, rapport de la CNAMTS du 11 juillet 2013.
En France(1)
– Population concernée :
60 000 à 500 000 personnes.
– 115 000 personnes
souffriraient d’un ulcère veineux
ou mixte.
– 71 ans en moyenne.
– 2/3 sont des femmes.
– La prévalence augmente
avec l’âge : 1 % à 60-70 ans,
2 à 5 % pour les plus de 80 ans.
1
Un ulcère de jambe est une plaie chronique ne cicatrisant
pas depuis plus de quatre à six semaines. Il apparaît après
un choc, même minime, ou spontanément.
L’ulcère se situe entre le genou et le pied, souvent sur le tiers inférieur de la jambe.
2
Dans 90 % des cas, l’ulcère de jambe a une origine vasculaire.
Il peut être veineux, artériel ou mixte, à la fois veineux et artériel.
3
La durée moyenne de cicatrisation des ulcères veineux ou mixtes est très variable.
Elle est estimée à 210 jours.
75 % de l’ensemble des ulcères de jambe cicatrisent en moins de 35 semaines(1).
Photos : CHU de Besançon Dermato CTAPC.
L’origine artérielle se manifeste
par la présence de nécrose
noire (tissu mort).
La fibrine (jaune) est plus abondante
dans les ulcères veineux.
Dans l’ulcère veineux, les bords sont
comme une carte routière, imprécis.
L’ulcère mixte peut ressembler
à un ulcère veineux. Ici, les bords
creusés reflètent la participation
artérielle.
A A
B
B
C
E
D
© Conception : Thierry Pennable – Illustration : Franck Lhermitte
Info+
> Tous les ulcères
peuvent apparaître
spontanément, même
si l’ulcère artériel
débute souvent
à partir d’un petit
traumatisme.
Les ulcères
de jambe
Les ulcères de jambe sont les plaies chroniques les plus fréquentes
en ville. Dans la majorité des cas, ils ont pour origine une maladie
veineuse et/ou artérielle qui oriente les choix thérapeutiques.
Leur cicatrisation s’obtient par l’association du traitement
de la maladie vasculaire et celui, local, de la plaie.

la patho
la patho
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
Index de pression systolique
L’index de pression systolique (IPS, voir Info+
p.30) est le rapport entre la pression artérielle
systolique (PAS) aux membres inférieurs,
mesurée à la cheville, et la PAS aux membres
supérieurs, mesurée au bras. En temps normal,
la PAS est la même pour les membres inférieurs
et supérieurs. Le rapport, l’IPS, est alors égal à 1.
En cas d’ulcère :
nsi l’IPS est compris entre 0,9 et 1,3 : ulcère
veineux pur ;
nsi l’IPS est inférieur à 0,9 : ulcère artériel pur ;
nsi l’IPS se situe entre 0,7 et à 0,9 : ulcère mixte.
Évolutioni
nL’ulcère artériel peut cicatriser lorsque le trai-
tement étiologique est possible (voir Traitement).
Dans les artériopathies sévères, l’amputation du
membre est parfois nécessaire à cause d’un
risque de gangrène suite à une infection (voir
Traitement de l’infection).
nL’ulcère veineux
> En cas de reflux dans les veines superficielles,
l’ulcère évolue le plus souvent favorablement,
avec une cicatrisation dans les trois à six mois,
si les traitements étiologique et local sont bien
conduits. Il existe un risque de récidive et de
passage à la chronicité.
> En cas de reflux dans les veines profondes
(syndrome post-thrombotique), l’ulcère est plus
compliqué à cicatriser, notamment en raison
de la difficulté d’un traitement étiologique.
Suivii
> La prise en charge de l’ulcère de jambe relève
du médecin traitant et du médecin vasculaire
ou du dermatologue.
> Dans le cas de l’ulcère veineux, la prévention
des récidives passe par un traitement curatif de
l’insuffisance veineuse et, dans tous les cas, par
le port d’une compression élastique de classe 3,
ou 2 si la classe 3 n’est pas supportée.
> Une surveillance spécialisée régulière est
nécessaire.
Son traitement
Objectifi
La prise en charge vise une cicatrisation com-
plète de la plaie.
Stratégiei
La prise en charge associe le traitement local
de la plaie et le traitement de la maladie vascu-
laire. Ce dernier est indispensable pour aboutir
à la cicatrisation de l’ulcère de jambe.
Traitement étiologiquei
En cas d’ulcère veineux
Le traitement de l’insuffisance veineuse se
fait par :
nla compression médicale élastique et non élas-
tique (voir page suivante);
nla suppression des veines superficielles : abla-
tion thermique, sclérothérapie ;
nla chirurgie, lorsqu’elle est possible. Elle cor-
rige l’hyperpression veineuse et diminue le
risque de récidive d’ulcères ;
nla suppression de veines variqueuses par injec-
tion d’un produit sclérosant (sclérothérapie).
En cas d’atteinte du réseau veineux profond, la
compression est souvent le seul traitement. La
chirurgie, complexe, est alors réservée en cas
d’échec du traitement médical.
En cas d’ulcère artériel
L’artériopathie est traitée par :
nune revascularisation locale lorsqu’elle est
possible : pontage, endartériectomie (voir Dico+
p.31), angioplastie (voir Dico+ p.31)… La revas-
cularisation rétablit une perfusion artérielle
suffisante pour cicatriser l’ulcère ;
ndes antiagrégants plaquettaires, acide acétyl-
salicylique, clopidogrel … dans le traitement de
l’ulcère artériel, mais aussi en prévention du
risque d’accidents ischémiques : infarctus du
myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC)…
29
28
Signes cliniquesi
Ulcère veineux
nLocalisation. Ulcère souvent unique et situé
au bas de la jambe, entre la malléole et le tiers
inférieur du mollet.
nAspect. Plaie ovale, superficielle et de grande
taille. Les bords sont irréguliers, on parle de
«contours géographiques ».
nAutres. Des signes cliniques de maladie vei-
neuse sont possibles : varices, œdème, coloration
marron de la peau (dermite ocre), plaque
cutanée dépigmentée (atrophie blanche)…
Ulcère artériel
nLocalisation suspendue, sur les faces anté-
rieure ou latérales de la jambe, ou distale, sur
la face dorsale du pied ou les orteils. Les zones
les plus vulnérables sont le tibia, le tendon
d’Achille, les malléoles internes et externes.
nAspect. Généralement de petite taille avec
un aspect acéré, creusant, dit « à l’emporte-
pièce », des bords abrupts et un fond parfois
nécrotique (zone noire).
nAutres signes : abolition d’un ou plusieurs
pouls périphériques (pédieux, tibial).
Ulcère souvent très douloureux avec des signes
d’insuffisance artérielle chronique : peau péri-
ulcéreuse froide, décolorée, lisse et dépilée.
Ulcère mixte
nAspect. Il est de plus en plus fréquent dans
une population âgée concernée par les ulcères
de jambe et peut avoir l’aspect d’un ulcère vei-
neux au premier abord.
nCertains signes évoquent une participation
artérielle à l’origine de l’ulcère :
> la présence d’une zone noire constituée de
tissus nécrosés dans le lit de la plaie ;
> un aspect creusé de la plaie ;
> des douleurs spontanées ou de décubitus.
Diagnostici
Examen clinique
Les éléments cliniques (voir ci-dessus) apportent
des informations.
Examens paracliniques
Écho-doppler veineux
Il confirme l’origine veineuse de l’ulcère et en
précise le mécanisme physiopathologique :
reflux dans les veines superficielles (varices)
ou dans les veines profondes (syndrome post-
thrombotique).
Écho-doppler artériel
Il objective la participation artérielle à l’ulcère
et la présence de sténoses dans les artères, dont
il précise l’importance et la localisation.
par une destruction des tissus internes, qui ne
sont plus suffisamment nourris avant l’appari-
tion de la plaie.
Ulcère mixte
Il a pour origine des atteintes artérielle et vei-
neuse associées, ce qui est fréquent chez les
patients âgés. Les deux pathologies s’entretien-
nent mutuellement. La baisse du débit artériel
intensifie la stase veineuse et l’œdème d’origine
veineuse augmente le resserrement de la lumière
artérielle, déjà obstruée par l’artériopathie.
L’ulcère mixte, le plus souvent à prédominance
veineuse, survient en présence d’une AOMI
modérée qui n’explique pas à elle seule l’alté-
ration cutanée.
Angiodermite nécrotique
Elle est due à une occlusion artériolaire des
vaisseaux du derme (artériolosclérose). Elle sur-
vient surtout chez la femme après 60 ans dans
un contexte d’hypertension artérielle ou de dia-
bète. Très douloureuse, sa prise en charge est
urgente pour éliminer une ischémie critique
ou une infection.
Ulcères par vascularites
Les vascularites regroupent plusieurs maladies
qui entraînent une inflammation de la paroi
vasculaire. Rares, ces ulcères concernent :
> les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
ou autres maladies auto-immunes comme le
lupus érythémateux ;
> les embolies cutanées de cholestérol causées
par un embol détaché d’une plaque d’athérome
d’une artère, souvent à l’occasion d’une inter-
vention endovasculaire, tel un cathétérisme arté-
riel, et/ou de la mise en route d’un traitement
anticoagulant.
Ulcères non vasculaires
Plusieurs causes non vasculaires peuvent être
à l’origine de ces ulcères, parmi lesquelles :
ndes hémopathies : hypercoagulabilité, ané-
mies hémolytiques (drépanocytose, thalassé-
mies…), syndromes myéloprolifératifs ou lym-
phoprolifératifs… ;
ndes neuropathies : sclérose en plaques, para-
plégie, poliomyélite… ;
ndes affections dermatologiques : maladies bul-
leuses auto-immunes… ;
nle diabète : hyperglycémie, artériopathie dis-
tale… ;
ndes infections : mycobactérioses (tuberculose,
syphilis…), parasitoses (leishmaniose…),
mycoses profondes ;
ndes cancers : carcinomes, mélanomes, lym-
phomes… ;
nla prise prolongée d’Hydréa, chimiothérapie
anticancéreuse.
Info+
> Les ulcères d’origine
polyfactorielle sont
de plus en plus
fréquents, mêlant, par
exemple, problèmes
orthopédiques,
artériopathie, œdèmes
d’origine cardiaque
et infection chez
des patients
immunodéprimés. Ces
situations complexes
sont en lien avec le
vieillissement de la
population et l’âge
avancé des patients.
Info+
> L’artérite des
membres inférieurs
ou artériopathie
oblitérante des
membres inférieurs
(AOMI), le plus
souvent conséquence
de l’athérosclérose,
est une maladie
dégénérative
caractérisée par
une perte d’élasticité
des artères due à la
sclérose (durcissement)
engendrée par des
plaques d’athérome
sur la face interne
de la paroi artérielle.
Le rétrécissement
du calibre des artères
(artériosclérose)
qui irriguent les
membres inférieurs
va de la simple
plaque d’athérome
à l’oblitération du
vaisseau (thrombose).
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
Dico+
> Ischémie :
diminution ou arrêt de
l’apport de sang dans
une partie du corps.
« En dépit de ce que prétendent les fabricants,
la force de compression dépend de la tension
exercée au moment de la pose. Il est possible
d’obtenir une compression de force 3 avec
une bande donnée pour une force 1 ou 2.
Et inversement, avoir une force de pression
moindre avec une bande donnée pour une
force 3 ou 4, malgré les étalonnages de pose.
C’est la même chose avec les bandages
multitypes, qui n’évitent pas les erreurs de
pression. Il est donc d’autant plus important
que les opérateurs soient formés à la pose de
bande. Avec une formation et de l’expérience,
une infirmière sait quelle tension exercer pour
obtenir la pression adaptée à la situation.
Sachant que l’objectif de pression, par exemple
30 mmHg pour un ulcère veineux, autorise
un léger dépassement, et qu’un bandage
peut perdre jusqu’à 40 % de sa force de
compression au cours de la journée. »
Docteur
Didier Rastel,
médecin vasculaire,
chargé d’enseignement
DU de phlébologie,
Paris VI Pitié-Salpêtrière.
>L’avis du spé
La force de compression
dépend de la pose
“”

la patho
la patho
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
et compresses, sont pris en charge par l’Assu-
rance maladie pour les plaies malodorantes. Ils
sont le plus souvent employés sur les ulcères
sales et malodorants, en particulier d’origine
cancéreuse : Actisorb, Askina Carbosorb.
Gestion de la douleuri
La douleur est associée à de nombreux ulcères
de jambe, veineux ou artériels, même si les
ulcères artériels sont réputés plus douloureux.
La douleur est variable, constante ou intermit-
tente. Elle peut atteindre son paroxysme lors des
soins de plaie. Le retrait du pansement et la déter-
sion sont considérés comme les moments les
plus douloureux par les patients. La douleur doit
être repérée, évaluée et soulagée. Quand elle est
induite par les soins, elle doit être anticipée.
Crèmes anesthésiques
nSpécialités : crèmes à base de lidocaïne et de
prilocaïne (Emla 5 % crème, Anesderm 5 %
crème, Lidocaïne prilocaïne Biogaran 5 %
crème).
nIndication : «L’anesthésie topique des ulcères
de jambe afin de faciliter le nettoyage méca-
nique/débridement chez les adultes unique-
ment »(3). En agissant directement sur les nerfs,
ces anesthésiques locaux bloquent la conduc-
tion nerveuse.
nMode d’administration : pour une application,
la dose est de 1 à 2 g par surface de 10 cm2, avec
un maximum de 10 g par application (deux
tubes). L’utilisation est limitée à huit applications
pour le traitement d’un ulcère. Par exemple, une
fois par semaine durant huit semaines. La crème
est appliquée en couche épaisse sur la zone à
traiter, sans masser, et en périphérie de la plaie
si les bords sont douloureux au contact.
nDélai et durée d’action. La crème est appliquée
30 minutes avant le début de la détersion d’un
ulcère et couverte d’un pansement adhésif her-
métique. La durée d’anesthésie après retrait de
la crème est d’environ 30 minutes.
nEffets indésirables : érythème, rash, irritation
de la peau et prurit, sensation de brûlure, der-
matite, bénins et toujours réversibles. Les effets
systémiques sont peu probables compte tenu
des faibles concentrations circulantes.
nRisque exceptionnel de surdosage en cas de
mésusage, par exemple lors d’applications simul-
tanées sur un nombre élevé de sites pendant
une période prolongée. Les signes d’intoxication
systémique sont : vertiges, vomissements, som-
nolence, convulsions, mydriase, bradycardie,
arythmie et choc. En ce cas, une surveillance
en milieu spécialisé devra être maintenue plu-
sieurs heures après le retrait du médicament,
en raison de l’absorption retardée des anesthé-
siques locaux.
En cas d’ulcère mixte
Le plus souvent, l’étiologie est dominée par la
participation veineuse. Le traitement de l’ulcère
mixte est avant tout celui d’une insuffisance
veineuse avec :
nla compression non élastique ;
nou la compression élastique mais qui
impose une réévaluation régulière du rapport
bénéfice/risque, avec un IPS compris 0,6 et 0,9.
Elle est contre-indiquée si l’IPS est inférieur
à 0,6(1).
Traitement locali
Principes généraux
Un ulcère de jambe est une plaie chronique
et sa prise en charge consiste à :
> maintenir une humidité qui favorise la cicatri-
sation ;
> retirer les tissus non vascularisés, les bactéries
et les cellules gênant le processus de cicatrisa-
tion, c’est la détersion ;
> traiter une infection clinique objectivée
(prouvée) qui entrave la cicatrisation ;
> assurer des berges saines sur le pourtour, à
partir desquelles se développe l’épidermisation
de la plaie.
Lavage fréquent de la jambe
Il est primordial pour contenir le nombre de
germes présents sur la plaie et prévenir une
infection. Le lavage s’effectue de préférence à
l’eau savonneuse, avec un savon doux, liquide,
sans parfum et sans conservateur.
Détersion
Elle consiste en l’élimination la plus complète
et la moins traumatique possible de la nécrose,
c’est-à-dire les tissus non vascularisés, et de la
fibrine, protéine filamenteuse produite lors de
la coagulation sanguine. Elle vise à nettoyer la
plaie des fragments de tissus dévitalisés, qui
entraînent un risque infectieux important et
empêchent une cicatrisation optimale(2). Elle
se fait surtout de façon mécanique.
nDétersion mécanique. Elle est effectuée à l’aide
de compresses, curettes, pinces à disséquer,
ciseaux ou bistouris, qui nécessitent une cer-
taine maîtrise. Attention ! Un IPS inférieur à
0,7 signe une participation artérielle et interdit
la détersion mécanique de la nécrose sèche.
Dans ce cas, les tissus n’étant pas nourris à cause
d’un manque d’oxygène, retirer la nécrose
reviendrait à la laisser se reconstituer plus en
profondeur. La plaie se creuserait alors.
nDétersion avec certains pansements actifs qui
renforcent la détersion enzymatique naturelle.
Hydrocolloïdes, hydrogels et alginates sont
recommandés par la Haute Autorité de santé
(Les pansements, indications et utilisations
recommandées, Bon usage des technologies
médicales, 2011). En pratique, les hydrofibres et
les hydrocellulaires sont aussi utilisés.
Gestion des exsudats
Elle est primordiale(2). La gestion des exsudats
(voir Dico+ p.31) se fait avec un pansement. En
général, l’ulcère veineux est plus exsudatif que
celui artériel. Le choix d’une classe de panse-
ments dépend de la quantité des sécrétions.
Plaies exsudatives
nLes hydrocellulaires (HC) sont distingués en
fonction de leur capacité d’absorption :
> les HC « à absorption moyenne » indiqués
pour les plaies faiblement exsudatives : Allevyn
Gentle Border Lite, Biatain Silicone Lite, Urgotul
Lite… ;
> les HC « à absorption importante » pour les
plaies plus exsudatives : Aquacel Foam, Askina
Dressil, HydroTac, Mepilex, Suprasorb P… ;
> les HC « superabsorbants » pour les plaies très
exsudatives : Mextra Superabsorbant, Resposorb
Super, Sorbact Superabsorbant, Vliwasorb Pro…
nLes hydrocolloïdes sont recommandés pour les
plaies peu à moyennement exsudatives : Comfeel
Plus, Duoderm, Suprasorb H, Urgomed…
nLes alginates, compresses ou mèches, sont
caractérisés par leur capacité d’absorption et
leurs propriétés hémostatiques : Algostéril, Mel-
gisorb, Sorbalgon…
nLes hydrofibres, compresses ou mèches, sont
utilisés en pansement primaire (couvert d’un
pansement secondaire) sur plaies très exsuda-
tives : Aquacel, Biosorb, Urgoclean.
Plaies peu ou pas exsudatives
nLes hydrogels, compresses imprégnées et
plaques, adhésives ou non, sont employés sur
les plaies sèches pour assurer leur humidifica-
tion et faciliter la détersion : Askina Gel, Hydro-
clean, Normlgel, Suprasorb G…
nLes pansements vaselinés, compresses impré-
gnées d’une substance grasse neutre non adhé-
rente (vaseline, paraffine…), maintiennent l’hu-
midité sur plaie sèche ou faiblement exsudative :
Adaptic, Jelonet, Lomatuell H, Tulle gras…
nLes pansements interfaces, compresses ou
mèches, sont indiqués sur les plaies très peu
exsudatives. Ils sont associés à un pansement
secondaire pour les maintenir et absorber
l’excès d’exsudats : Hydrotul, Mepitel, Mepitel
One, Physiotulle, Urgotul.
nLes pansements à base d’acide hyaluronique,
compresses imprégnées, crèmes ou sprays, sont
particulièrement intéressants pour relancer la
cicatrisation des plaies atones : Effidia, Ialuset.
Plaies malodorantes
Les pansements à base de charbon actif, plaques
Antalgie générale
Quand l’anesthésie locale est insatisfaisante,
la prescription d’un antalgique par voie orale,
voire d’un anxiolytique à court délai d’action,
est à discuter avec le médecin. Chaque antal-
gique a un délai d’action propre, mais assez
fréquemment le médicament administré une
heure avant le soin sera efficace. Les produits
de palier 1 (paracétamol) sont souvent insuf-
fisants. Les paliers 2 peuvent être utilisés :
codéine et tramadol, souvent associés au para-
cétamol. Le recours d’emblée aux antalgiques
de palier 3 peut être justifié par l’intensité de
la douleur ; les morphiniques à libération
immédiate ont un délai d’action d’environ
une heure.
Traitement de l’infectioni
Infection locale
Signes cliniques
Les signes classiques de l’infection des plaies
– rougeur, chaleur, douleur, présence de pus,
d’abcès ou d’odeur – ne sont pas toujours pré-
sents dans le cas d’un ulcère, hormis la douleur,
fréquente. L’infection est souvent marquée par
une augmentation des exsudats, la stagnation
d’une plaie qui évoluait bien jusqu’alors ou une
plaie atone (voir Dico+ p.32).
Traitement
nAntiseptiques locaux. Outre le lavage fréquent
de la jambe, des antiseptiques locaux peuvent
être employés sur des temps courts, quinze
jours maximum, sur prescription médicale. Les
antiseptiques à large spectre (chlorhexidine,
dérivés chlorés, dérivés iodés) sont recom-
mandés. Le respect de la flore bactérienne, qui
participe à la détersion, contre-indique le
recours à des antiseptiques en l’absence de
signes avérés d’infection.
nLes pansements à l’argent. Ils peuvent être
utilisés, sur prescription médicale, dans les
mêmes conditions que les antiseptiques (infec-
tion locale objectivée et durée limitée). Ces
31
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
30
Info+
> Un enjeu
économique. En 2011,
la prise en charge
des ulcères veineux
ou mixtes a représenté
272 millions d’euros
uniquement en soins
de ville, dont 42,4 %
consacrés aux soins
infirmiers (115 M€) et
33 % aux compresses
et pansements (90 M€).
Source : Améliorer la qualité
du système de santé et maîtriser
les dépenses : propositions
de l’Assurance maladie pour
2014, rapport de la CNAMTS
du 11 juillet 2013.
> L’index de pression
systolique est mesuré
par l’angiologue avec
un coût faible et une
durée de quelques
minutes. Elle est
relevée par de rares
médecins en ville
par manque d’intérêt
de la mesure…
Dico+
> Endartériectomie :
ablation de l’endartère,
tunique interne de
l’artère, réalisée sous
anesthésie générale,
afin de restituer un
bon débit à l’artère.
> Angioplastie :
intervention consistant
à réparer, à dilater
ou à remodeler un
vaisseau déformé,
rétréci ou dilaté. Ici, un
ballonnet est introduit
dans l’artère pour
élargir sa lumière. Et
un stent peut être posé.
> Exsudat : ensemble
des sécrétions
produites par une
plaie. Il résulte des
éléments moléculaires
et cellulaires qui
s’accumulent dans
les tissus interstitiels.
Son volume diminue
normalement durant
la cicatrisation mais
peut rester important
lorsque la plaie ne
cicatrise pas et
demeure bloquée au
stade inflammatoire.
Toute plaie évolue en trois grandes phases successives avant
de se fermer.
> Phase inflammatoire et vasculaire : un caillot de protéine
filamenteuse, la fibrine, se forme dans la plaie, dont des cellules
inflammatoires assurent le nettoyage, ou détersion.
> Phase proliférative de bourgeonnement et épidermisation : elle
permet la réparation tissulaire dermique et épidermique de la plaie.
> Phase de remodelage et de maturation de la cicatrice : elle se
rapproche le plus possible de la structure originelle des tissus lésés
par la plaie.
>Rappels de cicatrisation

la patho
la patho
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
> une bande Biflex 17 + Pratic (Thuasne) per-
mettrait d’obtenir une force 3 avec un recou-
vrement à la moitié de la bande, et une force 4
avec un recouvrement aux deux tiers de la
bande.
nAvantages : les bandes de compression per-
mettent de prendre en compte l’évolution de
l’œdème et de la taille de la jambe pour adapter
la pression exercée.
nInconvénients : la technique de pose d’une
bande de compression n’est pas toujours bien
maîtrisée par les professionnels de santé non
formés à ce geste. C’est encore plus compliqué
pour le patient qui voudrait remettre en place
une bande qui a glissé.
Indications(1)
> Insuffisance veineuse dès la présence de
varices de plus de 3 mm d’épaisseur.
> Œdème chronique.
> Ulcère ouvert ou cicatrisé.
Contre-indications(1)
nRelatives. Une réévaluation régulière du rap-
port bénéfice/risque s’impose en cas d’AOMI
avec indice de pression systolique (IPS) compris
entre 0,6 et 0,9 (risque d’aggraver l’AOMI) ; de
neuropathie périphérique évoluée ; de derma-
tose suintante ou eczématisée ; d’intolérance
aux fibres utilisées.
nAbsolues : AOMI avec IPS < 0,6 ; microangio-
pathie diabétique évoluée pour une compres-
sion > 30 mmHg (classe 3 ou 4 pour les bas de
compression) ; phlegmatia cœrulea dolens, ou
« phlébite bleue », phlébite compliquée de
spasmes artériels avec œdème douloureux, cya-
nosé, peau froide et état général profondément
altéré ; thrombose septique.
Recommandations de la HAS
nEn cas d’ulcère ouvert : bandages multitypes
en première intention (si IPS > 0,8) ; ou bandes
sèches inélastiques ou à allongement court ;
ou bandes enduites ; ou bas (chaussettes, bas-
cuisses, collants) > 36 mmHg (classe 4).
Appliqué jusqu’à cicatrisation complète.
nEn cas d’ulcère cicatrisé : bas (chaussettes,
bas-cuisses, collants) de 20 à 36 (classe 3) ou
> 36 mmHg (classe 4) ; ou bandes sèches à
allongement court.
Conseils
aux patients
Observancei
Compression
nSuperposition de bas. Dans une indication de
Mode d’action
La compression médicale consiste en l’appli-
cation de bandages au niveau des membres
inférieurs pour exercer une pression sur la
jambe. Cela renforce l’efficacité de la pompe
musculaire du mollet et favorise la remontée
du sang veineux vers le cœur.
nLa compression inélastique ou non élastique,
encore appelée contention (voir Info+ p. 34), est
obtenue avec des bandes, le plus souvent 100 %
coton, dont l’allongement maximal est inférieur
à 10 % (voir Dico+ p.32). La compression est
très faible au repos et forte lors de la marche,
associée à la contraction musculaire.
nLa compression élastique est obtenue avec des
bas de compression ou des bandes élastiques
à allongement long (> 100 %). La pression est
exercée aussi bien à l’effort qu’au repos. Il est
généralement conseillé de les retirer la nuit.
Dispositifs de compression
Bas de compression
Plusieurs modèles de dispositifs existent : les
bas, chaussettes s’arrêtant sous le genou, les bas-
cuisses s’arrêtant à la racine de la cuisse et les
collants(5).
nAvantages : une fois le bas posé, la pression
est toujours standardisée et homogène sur la
jambe du patient.
nInconvénients : la pose peut être très difficile,
voire impossible, en fonction du pansement et
de l’état de la plaie.
En cas de difficulté d’enfilage, la recherche d’une
pression efficace peut justifier la superposition
de plusieurs bas ou l’utilisation d’un enfile-bas
(voir Conseils aux patients). Autre inconvénient,
en présence d’œdème, les bas sont rapidement
mal adaptés compte tenu de la diminution de
l’œdème, et donc de la taille de la jambe. Ils sont
plus facilement employés lorsque l’œdème est
contrôlé et que la cicatrisation de la plaie a
évolué vers l’épidermisation.
Bandes de compression
nObjectif : dans le cadre d’un ulcère veineux,
une pression comprise entre 30 et 40 mmHg à
la cheville doit être obtenue, ce qui correspond
à une force 3 ou 4(6).
nMatériel : sont utilisés les bandes de com-
pression élastique et les bandages multitypes,
qui comprennent au moins deux types de
bande (Profore, Urgo K2 ou Coban 2)(7).
Les bandes sont classées par force de compres-
sion allant de 1 à 4 en fonction de la tension
exercée (voir avis du spé p.29). Par exemple :
>une bande Biflex 16 + Pratic (Thuasne) per-
mettrait d’obtenir une force 1 avec un recou-
vrement à la moitié de la bande à chaque tour
de spire et une force 2 avec un recouvrement
aux deux tiers de la bande ;
33
mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr
32
pansements contiennent de l’argent sous
forme d’ions Ag+ bactéricide, nanocristaux ou
sulfadiazine argentique (bactériostatique). L’ar-
gent est associé à différentes classes de pan-
sements : hydrocellulaires (UrgoCell Ag, Biatain
Ag), hydrofibres (Aquacel Ag), interfaces
(Urgotul Ag), alginates (Biatain Alginate Ag).
La Haute Autorité de santé (HAS) relève tou-
tefois un niveau insuffisant de preuve de leur
efficacité, et des bactéries résistantes ont été
identifiées.
Infection généralisée
L’infection peut s’étendre aux tissus musculaires
et osseux et se généraliser, notamment sous
forme de :
nlymphangite : inflammation des vaisseaux
lymphatiques caractérisée par des stries rouges,
douloureuses, sous la surface de la peau sur le
trajet du vaisseau ;
nadénopathies : hypertrophie de ganglion(s)
lymphatique(s) avec possible fièvre, voire bac-
tériémie ou septicémie.
Le traitement repose sur la prescription d’une
antibiothérapie adaptée.
Complications graves
Érysipèle
C’est une infection cutanée due à une bactérie
de type streptocoque, plus rarement staphylo-
coque ou pseudomonas. L’érysipèle se mani-
feste toujours par une fièvre élevée, des plaques
érythémateuses – la peau devient luisante et
rouge –, un œdème, des douleurs importantes
et des ganglions hypertrophiés. L’érysipèle est
traité par des antibiotiques et des antalgiques.
Le patient doit rester alité jusqu’à la disparition
de l’inflammation. Une surveillance médicale
quotidienne est impérative et une hospitalisa-
tion peut être envisagée.
Fasciite nécrosante
Cette infection peut être causée par des strep-
tocoques A et être une évolution d’un érysipèle
mal traité. Les symptômes et le traitement sont
similaires à ceux de l’érysipèle.
Gangrène gazeuse
Elle survient lors d’une infection des plaies
par Clostridium perfringens ou certains strep-
tocoques. La zone infectée est gonflée, chaude
et douloureuse. Pâle dans un premier temps,
elle devient rouge puis bronzée, pour devenir
vert noirâtre. Cette forme de gangrène se pro-
page très vite et peut être rapidement fatale.
Le traitement combine les antibiotiques à une
chirurgie de débridement large des tissus
infectés, et ce afin d’empêcher toute propaga-
tion ultérieure.
Tétanos
L’ulcère de jambe est la principale porte d’en-
trée du tétanos, toujours présent en France. La
mise à jour de la vaccination antitétanique est
le seul moyen de se protéger de cette maladie
grave, souvent mortelle. Chez l’adulte, les rappels
sont recommandés tous les dix ans à partir de
65 ans, aux âges fixes de 65 ans, 75 ans, 85 ans,
etc., avec un vaccin DTP : diphtérie, tétanos,
poliomyélite.
nSi la personne est à jour de ses vaccinations :
pas d’injection, préciser la date du prochain
rappel.
nSi la personne n’est pas à jour : injection d’im-
munoglobuline tétanique humaine 250 UI dans
un bras et administration d’une dose de vaccin
dans l’autre bras(4).
Compression médicalei
Pierre angulaire du traitement de l’insuffisance
veineuse et des œdèmes, la compression est
également le traitement étiologique indispen-
sable des ulcères veineux ou mixte à prédomi-
nance veineuse. En améliorant la stase sanguine
et l’hyperpression veineuse à l’origine de l’ul-
cère, elle contribue à sa cicatrisation. Dans le
cadre d’un ulcère de jambe, la compression
médicale ne traite que la pathologie veineuse
et pas la maladie artérielle, qui peut même la
contre-indiquer.
Objectif thérapeutique
Améliorer le retour veineux, l’oxygénation et
la nutrition des tissus pour :
> soulager ou prévenir les symptômes de jambes
lourdes aux stades précoces de l’insuffisance
veineuse ;
> éviter ou diminuer un œdème de jambe ;
> aider à la cicatrisation d’un ulcère ;
> traiter et/ou prévenir une thrombose veineuse.
Peut-on se passer d’une bande ?
« Même s’il faut commencer par des bandages
pendant la réduction de l’œdème ou en cas
de pansement complexe, il est préférable
de passer aux bas de compression dès
que la situation le permet. Dans le cas
d’un petit ulcère inférieur à 5 cm2, le bas
doit être privilégié d’emblée. D’autant que
les pansements sont aujourd’hui beaucoup
plus minces, avec une surface externe
plus glissante pour passer le bas. »
Docteur
Didier Rastel,
médecin vasculaire,
chargé d’enseignement
DU de phlébologie,
Paris VI Pitié-Salpêtrière.
>L’avis du spé
Passer au bas dès
que possible
“”
Dico+
> Plaie atone (= qui
manque de vie,
d’énergie) : lorsque
le tissu de granulation
inflammatoire est
déficient, ce qui
entraîne un bourgeon
de granulation
atrophique pauvre en
capillaires sanguins.
La plaie atone est
souvent jaunâtre,
sèche, ou au contraire
légèrement brillante
avec des bords
faiblement enroulés
vers l’intérieur.
> L’allongement
maximal d’une bande
est le pourcentage
d’étirement de la
bande par rapport
au repos.
En savoir+
> Documents
Prise en charge des
plaies chroniques,
pied diabétique
exclu,Docteur
Brigitte Faivre, sur
www.chu-besancon.fr
Document complet,
explicite et illustré
pour la prise en
charge des ulcères de
jambe (et escarres).
La compression
médicale dans les
affections veineuses
chroniques et
limitées,Haute
Autorité de santé,
décembre 2010.
Fiche synthétique avec
les principaux critères
pour un bon usage.
Guide pratique
de la compression
par bas et bandes
des affections
veineuses des
membres inferieurs,
Dr Didier Rastel,
angio-phlébologue
à Grenoble (38).
Clair et didactique.
Sur www.drrastel.fr
> Site Internet
www.ulcere-de-
jambe.com
Rédigé par un
pharmacien soutenu
par un comité
scientifique de
spécialistes, ce site
est une mine
d’informations
accessibles pour les
professionnels de
santé et les patients.
 6
6
1
/
6
100%