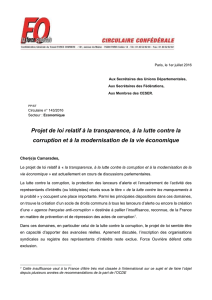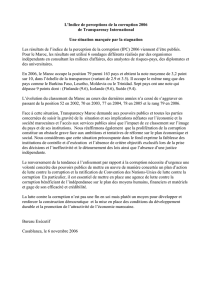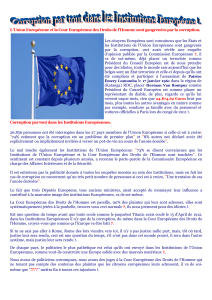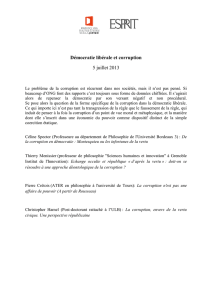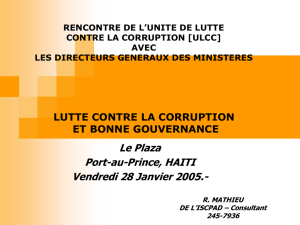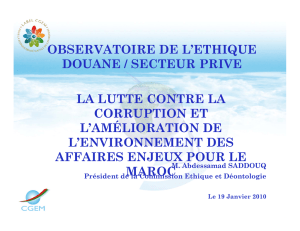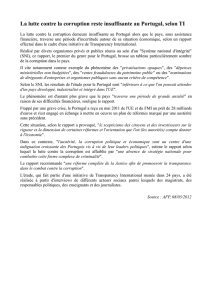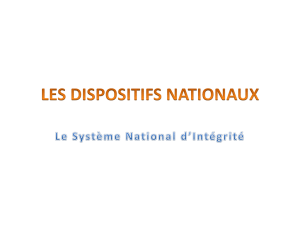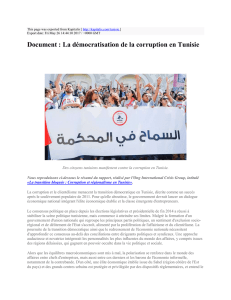La construction de l`objet corruption en Afrique

Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=AFCO&ID_NUMPUBLIE=AFCO_220&ID_ARTICLE=AFCO_220_0137
La construction de l’objet corruption en Afrique
par Olivier VALLÉE
| De Boeck Université | Afrique contemporaine
2006/4 - n° 220
ISSN 0002-0478 | ISBN 2-8041-5119-5 | pages 137 à 162
Pour citer cet article :
— Vallée O., La construction de l’objet corruption en Afrique, Afrique contemporaine 2006/4, n° 220, p. 137-162.
Distribution électronique Cairn pour De Boeck Université.
© De Boeck Université. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

137
corruption en Afrique
La construction de l’objet corruption
en Afrique
Olivier VALLÉE 1
INTRODUCTION
Dans le contexte africain, la corruption est longtemps apparue comme
un trou noir qui absorbe l’énergie de la matière. Encore dans les années
1980, la conceptualisation et la dénonciation de nombreux symptômes de
la corruption, comme le détournement de fonds ou la fuite des capitaux,
sont impensables. Une des explications de cette vacuité du discours et de la
mesure de la corruption tient, bien sûr, qu’à l’exception des historiens en-
gagés et des mouvements anti-impérialistes, la corruption et le politique
sont séparés dans l’événement
post
colonial. Une école relativiste d’ailleurs
s’étonne encore aujourd’hui de l’attention excessive à la corruption dans la
structure de l’État africain, en rappelant qu’elle est une composante de sa
généalogie, partout dans le monde. Ainsi, la corruption ne fut pas immédia-
tement « qualifiée » dans beaucoup de sociétés européennes où l’État incar-
ne l’instauration d’abord d’un pouvoir avant d’apparaître comme l’autel de
la chose publique. À Florence, aux XVII
e
et XVIII
e
siècles (
cf.
Waquet, 1984),
si les gestionnaires des greniers publics achètent le grain en le surfacturant
et en revendent une partie à leur profit, alors qu’ils devaient le préserver en
cas de famine, leur faute est politique et non judiciaire ou morale. Les his-
toriens ont apprécié le fait corrupteur dans son contexte et avec des don-
nées provenant de registres ou de chroniqueurs. Aujourd’hui l’approche des
faits prend peut-être une autre couleur dès que, par exemple, les idées de
bien collectif ou de démocratie sont considérées comme des prémisses de
leur recensement et de leur délimitation.
1. Économiste consultant.

■
Afrique contemporaine
■
138
PROBLÉMATIQUES
On voudrait d’abord rappeler, en parlant de construction de la corrup-
tion, que sa forme et son objet sont des enjeux qui existent avant que des
enquêtes, des jugements et des institutions ne les encadrent et leur confè-
rent une quasi-immanence. Il faut aussi prendre en compte que la mesure
et la condamnation de la corruption sont des processus qui sont liés, comme
dans toute classification et pénalisation des phénomènes sociologiques.
C’est dans cette relation par associations de notions qui glissent ou qui sont
utilisées par des acteurs qui interagissent, que se définit, en partie au moins,
le « pathologique » et le « normal ». Nous souhaitons montrer comment à tra-
vers ces recompositions, les enquêtes et les discours trouvent des ressources,
des balises, mais aussi dessinent souvent les contours des problématiques.
Les enjeux préexistent
Le cortège de notions qui gravite autour d’un récit de la corruption com-
me facteur explicatif de désordres sociaux et politiques et comme espace de
mise en œuvre de mesures de correction, doit au moins être introduit. Ainsi,
l’incivisme fiscal, qui peut se retourner en corruption, fut perçu assez tôt com-
me un problème critique par le colonisateur : « En 1935, le nombre de chefs
accusés [par l’administrateur] d’avoir dilapidé les fonds recueillis [des im-
pôts] augmenta » (Mbembe, 1984). L’événement postindépendance pose la
question du mal-développement où la responsabilité des anciens colonisa-
teurs comme des nouvelles élites pèse lourd. La corruption se décline alors,
dans ce nouveau répertoire, en contradiction ou en continuité avec des no-
tions comme celles de coopération, sous-développement, construction de
l’État nation, tribalisme, népotisme, valeurs et cultures africaines.
L’introduction d’autres thèmes plus récents (gouvernance, démocratie)
2
mais aussi l’énonciation, ténue, puis répétée et dispersée, de la corruption
comme intrinsèque à la pratique sociale mais aussi à l’organisation de la so-
ciété, cernent peut-être davantage l’enjeu et l’objet. Les enquêtes et les étu-
des vont contribuer à la formalisation de champs, de fréquences, de classes,
en relation avec la corruption. Les recensements d’avis et de sentiments du
projet Madio (Razafindrakoto et Roubaud, 1996), lié à la statistique malga-
che à la fin des années 1990, aident à percevoir les différences d’épaisseur
sociale
3
et de périmètres du champ de la corruption. Les préconstruits sur
2. Razafindrakoto et Roubaud, 2005a.
3. Foucault, 2004.

■
La construction de l’objet corruption en Afrique
■
139
la corruption tracent des pistes, et les impressions des observés, des sondés
et des enquêtés forment des ensembles qui paraissent cohérents après coup.
Cette rationalisation a l’intérêt de laisser comme impensée toute la partie
non éclairée, non décrite, et ainsi d’inciter à d’autres recherches.
Il y a donc des fractions de la corruption, elles-mêmes redessinées par les
différences des approches. En effet, les appareils de mesure de la corruption
sont utilisés sur des spectres différents et avec des méthodologies adaptatives.
On pourrait distinguer une aire majeure, celle de l’enquête avec une pré-
tention macro-économique. Celle-ci relie, d’une certaine façon, indices de
productivité et indicateurs de corruption en tenant compte d’avis d’experts.
Par contre, le pivot sociologique se retrouverait davantage dans des sonda-
ges où le vécu qualitatif, narratif et sensible est important et concerne plus
des non-experts. Il ne s’agit pas de privilégier un domaine par rapport à un
autre mais d’essayer de restituer leurs contributions évolutives, soit à des pa-
radigmes (ce que n’est pas la corruption) ou à des continuités (les séquences
du phénomène de la corruption). Cet article voudrait montrer à partir de
quelques exemples du discours scientifique sur la perception de la corrup-
tion, comment elle se définit comme objet, avec l’insertion d’autres récits
d’origine diverse et multiple, dans leur forme comme dans leur contenu.
Statistiques, analyses et théories désignent le phénomène de la corruption
à travers les expériences subjectives et les faits, mais elles les soumettent en
même temps à leurs grilles. Enfin, n’occultons pas que ce
corpus
de prati-
ques, de données et de réflexions se trouve réutilisé dans un cadre prescrip-
tif, celui de la lutte contre la corruption.
Décentrages et écarts
Un premier écart entre experts et ménages dans leurs réponses aux en-
quêtes, pourrait s’expliquer par le fait qu’ils ne parlent pas de la même cor-
ruption, mais surtout qu’elle ne s’inscrit pas dans le même horizon. Les
enquêtes auprès des ménages en Afrique sub-saharienne et en Amérique
latine (Herrera, Razafindrakoto et Roubaud, 2005) sont centrées sur la pe-
tite corruption. Mireille Razafindrakoto et François Roubaud poursuivent :
« Les indicateurs reflètent une perception assez commune du phénomène
de la corruption, même si elle ne correspond pas à la réalité. Mais il con-
vient de les coupler à une nouvelle génération d’indicateurs basés sur des
mesures objectives afin d’apprécier les phénomènes corruptifs dans toute
leur complexité » (Razafindrakoto et Roubaud, 2005b). Cependant, le dépla-
cement vers un regard extérieur, comme répondant à la parole locale, induit

■
Afrique contemporaine
■
140
aussi une déformation de la perception. Ainsi, les avis d’experts sembleraient,
selon Mireille Razafindrakoto et François Roubaud, évaluer la gravité de la
corruption nationale au prisme de la mauvaise réputation du pays « hôte »
aux yeux du monde extérieur, en matière de bonne gouvernance économi-
que. En effet, la corruption est souvent couplée, pour certains producteurs de
nomenclatures, à l’échec économique et au besoin de se justifier devant
l’étranger : « La corruption constitue un frein à la croissance économique,
elle décourage l’investissement privé étranger et réduit les ressources dispo-
nibles pour le développement. Elle rend par conséquent le pays plus pauvre
encore. D’où l’urgence de doter la Commission (anticorruption) des moyens
de son ambition »
4
.
Une fois construite, la mauvaise réputation du mauvais sujet doit être ins-
crite dans un classement, un
rating
, selon la terminologie bancaire, qui la
hiérarchise, du médiocre au pire. La Banque mondiale prescrit une batterie
d’indicateurs de gouvernance dont le curseur est animé par la collecte d’avis
indépendants.
Transparency International
(TI) dresse un palmarès mondial
de la corruption et, avec ses correspondants dans chaque pays, se tisse une
toile de dénonciations et de compromis avec les gouvernements mis au pi-
lori.
Pourtant, on pourrait faire l’hypothèse qu’il y a, au sens d’Althusser, de la
bévue dans les enquêtes auprès des ménages, comme des fulgurantes cota-
tions de TI en matière de corruption. La perspective qui est tracée n’appré-
hende pas le sens de la rupture de pans entiers d’activités d’avec un régime
fiscal et légal étatique. Cet inframonde relève d’un autre répertoire, peut
suggérer des conduite qui procèdent d’un autre contexte que celui de la cor-
ruption. En effet, la contrebande, la fraude, le banditisme, qui peuvent être
trop rapidement rattachés à la racine d’une corruption institutionnalisée,
donc étatique, véhiculent d’autres sens et posent les questions de l’historici-
té et de la transitivité de la différence entre légal et illégal. Le refus, de plus
en plus fréquent et organisé, de céder au prélèvement étatique paraît s’an-
crer dans une autre rationalité que celle des corruptions. L’extension de
l’économie souterraine, la généralisation d’un domaine privatif, reflètent
sans doute d’autres choses qu’un laissez faire de l’État incapable et inéquita-
ble. C’est ce que Janet Roitman (2005) a identifié comme une désobéissance
fiscale, ce que l’on pourrait appeler une sécession d’avec l’économie du pou-
voir.
4. La Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion n’a été saisie d’aucun cas
de corruption. Est-elle en train de faillir à sa mission ? Quoi qu’il en soit, la profonde léthargie dans laquelle elle se trouve
n’a rien de rassurant. Ndakhté M. Gaye, Dakar, Sénégal (WAL FADJRI), 13 septembre 2005.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%