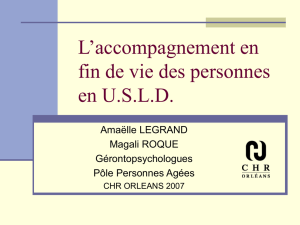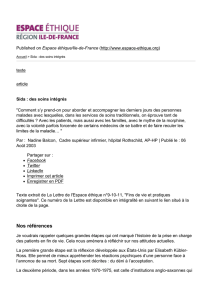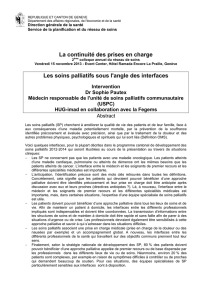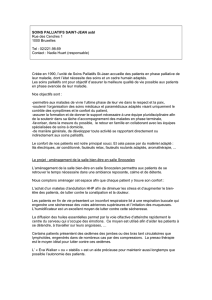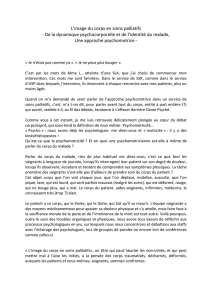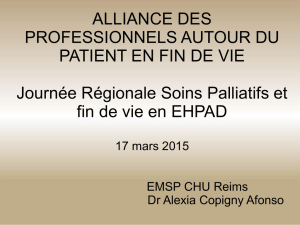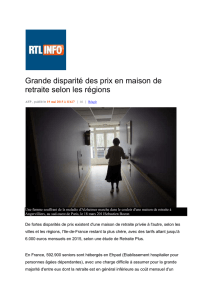La Fin de Vie en EHPAD

1
Dr SERRA Francis-Pierre
______________________
LA FIN DE VIE EN EHPAD
Une Unité de Soins de Confort
Mémoire pour le diplôme
Universitaire de Soins Palliatifs
CHRU de Lille 2014-2015

2
REMERCIEMENTS
Le Diplôme universitaire de soins palliatifs au CHRU de Lille reste une belle expérience
d’apprentissage en matière de qualité d’enseignement de « technique médicale », mais aussi
d’approche psychologique de la fin de vie.
Pour sa bonne humeur et son accueil, je remercie Monsieur le Docteur F.X.
DEROUSSEAUX responsable pédagogique.
Pour leur disponibilité, leur écoute et aussi la transmission de leur savoir, Monsieur le
Dr Blond référent universitaire, les médecins du Comité pédagogique Madame de Dr M.
PIERRAT, Les Dr J.P. CORBINEAU, V. GAMBLIN, et P. LEVEQUE. A ces remerciements
je voudrais associer toutes les personnes, médecins, infirmières, assistantes sociales, bénévoles
dont le dévouement, la simplicité et l’humilité ont permis à l’ensemble des étudiants de
conserver une excellente motivation, tout au long de cette année.
J’ai personnellement beaucoup apprécié le discours toujours juste et passionnant de
Monsieur le Dr REICH qui m’a réconcilié avec l’enseignement de la psychologie et dont la
démarche thérapeutique de la souffrance des personnes, a séduit beaucoup de participants au
DU.
Merci au Dr François Wuydin de l’Unité de Soins Palliatifs de la Polyclinique de
Grande-Synthe, où j’ai réalisé mon stage, pour son accueil, ses conseils et ses encouragements
à poursuivre sur le terrain l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille.
Mes remerciements vont aussi à mon épouse qui m’a toujours encouragé et a dû
redoubler de patience du fait de mes absences. Absences déjà importantes en raison du cumul
de mes activités professionnelles multiples.

3
PLAN
I) INTRODUCTION
II) UN ETAT DES LIEUX EN EHPAD
III) L’ACTUALITE, LE LEGISLATEUR ET LES REALITES DU TERRAIN
IV) LES RELATIONS MEDECINS ET FAMILLES
V) L’OBSTINATION DERAISONNABLE UNE REALITE QUOTIDIENNE
VI) UNE EXPERIENCE DE TENTATIVE DE REPONSE A LA FIN DE VIE EN
EHPAD : L’USC
VII) UN CAS CLINIQUE TRAITE PAR L’USC
VIII) LES DIFFICULTES IDENTIFIEES DE L’USC
IX) LES SOLUTIONS APPORTEES
X) CONCLUSION

4
I) INTRODUCTION
Médecin généraliste depuis 37 ans, j’ai eu la chance d’exercer une médecine variée et
riche d’expériences humaines multiples touchant toutes les générations et toutes les couches
sociales.
Peu de jeunes médecins généralistes peuvent évoquer les merveilleux souvenirs de la
pratique d’accouchements en maternité mais aussi parfois à domicile, la joie partagée des
naissances avec les familles et le bonheur caché d’avoir participé à l’arrivée d’une nouvelle vie.
Donner la vie, accompagner une vie qui s’éteint, c’est un contraste saisissant pour le
médecin que l’on a choisi d’être.
A la fin des années 70 le diagnostic de « maladie grave et incurable » était le plus
souvent tacitement caché, l’expression de la finitude était « tabou » et les médecins se
contentaient d’essayer de soulager la douleur physique. C’était une époque où la prescription
des morphiniques était réalisée sur un carnet à souches délivré par le Conseil de l’Ordre des
Médecins. Il s’appelait « Carnet de toxiques ». Le terme toxique n’engageait pas beaucoup les
patients à recevoir les morphiniques, ni les médecins à les prescrire. Il n’était pas rare qu’un
médecin de cette époque ne possédait pas ce fameux carnet.
En effet beaucoup rechignaient à le commander ou à utiliser ces antalgiques toxiques
qu’ils « réservaient » aux dernières heures de la phase ultime.
En 2003, j’ai fait le choix d’une médecine mixte libérale et institutionnelle, dans le cadre
d’une coordination en EHPAD, en même temps qu’une formation gériatrique et de prise en
charge des démences.
Au fil des années, j’ai assisté à l’évolution légitime des exigences d’une population en
matière de fin de vie et tout en gardant les yeux ouverts, j’ai constaté les carences multiples de
nos décisions et de nos interventions. Tant sur le plan de l’évaluation des situations cliniques et
des soins apportés, que du soutien et de l’information redevable au patient et à sa famille.
De ces constats répétés la décision mûrit. Nous nous devions d’améliorer les conditions
de l’accompagnement de fin de vie de nos patients et de nous former afin de tenter d’obtenir la
maîtrise médicale et technique nous permettant de nous concentrer sur la dimension
d’accompagnement.
En 2013 j’ai, avec l’aide de soignants volontaires, posé les bases de la création d’une «
unité de soins de confort » à l’intérieur de l’EHPAD. Les fiches de postes ont été modifiées, un
crédit interne minimal a été alloué et les premiers soins ont pu être apportés à la grande
satisfaction des personnes âgées et de leurs familles.
C’est cette expérience quelque peu novatrice dans sa conception pour une maison de
retraite, que je voudrais faire partager.

5
II) UN ETAT DES LIEUX EN EHPAD :
Parmi les prérogatives et obligations du médecin coordonnateur se trouve la formation.
Depuis 2003 j’ai été amené à privilégier la transmission de la connaissance médicale à
travers des formations diverses, mais toutefois adaptées au personnel ASH, AS, infirmières et
parfois même à destination de mes confrères que je conviais le soir, dans le cadre de la
sensibilisation à la gériatrie.
Plusieurs thèmes abordés suscitaient des interrogations et mettaient à jour les carences
de nos pratiques et le décalage entre la théorie et la réalité quotidienne des difficultés
rencontrées.
Parmi ces chantiers à entreprendre il y avait la prise en charge des démences.
Et ce fut mon premier choc celui d’être confronté au désarroi du personnel devant les
situations d’agitation et surtout des cris. Tiraillés entre la détresse affective réelle, le manque
de formation pour y faire face et la peur de se faire réprimander par un directeur soucieux du
calme qui se devait de régner dans l’établissement. Les soignants y tenaient le plus mauvais
rôle, dans la pire des situations : assister impuissants à la misère de la démence, en tentant d’y
apporter une réponse affective malheureusement insuffisante et source d’épuisement physique
et moral.
La mise en place progressive de plans de soins personnalisés et une prise en charge non
médicamenteuse des troubles du comportement, ont permis de donner une réponse qui
correspondait aux exigences des bonnes pratiques et qui de surplus valorisait les compétences
et le travail du personnel.
Le deuxième problème était le fruit de la dépendance croissante des personnes
accueillies. Le résultat du jusqu’au-boutisme du maintien à domicile et du manque de moyens
accordés aux institutions.
Du GIR 5 accueilli il y a quinze ans, nous sommes passés au GIR 2 grabataire et dément.
Escarres après hospitalisation à soulager en EHPAD, Cancer en phase terminale à accompagner
avec les moyens du bord. Ceux qui ne trouvent plus de place à l’hôpital ou qui représentent une
charge trop importante pour leurs proches à domicile.
Des patients qui conservent un espoir de vivre sans souffrance, des familles qui
culpabilisent, s’en remettent au monde médical, et se font de plus en plus pressantes pour
espérer une réponse en adéquation avec « le droit des malades » dont ils ont entendu parler.
Ce droit aux soins palliatifs, ce droit à ne plus souffrir, ce droit à une mort dans la
dignité….
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%