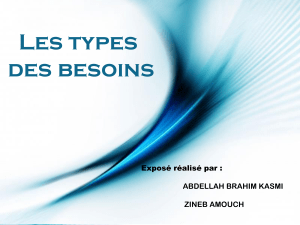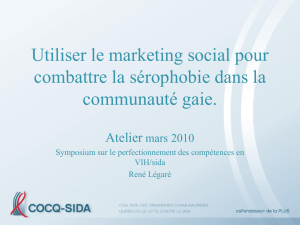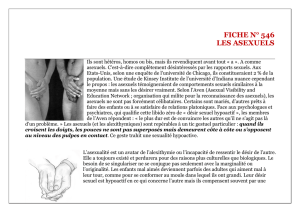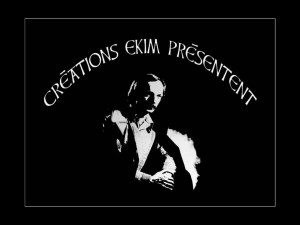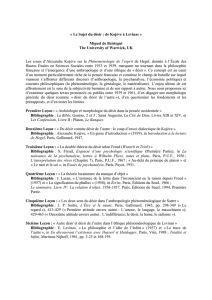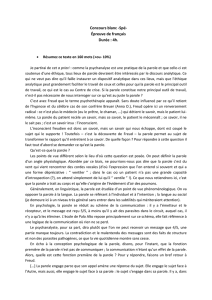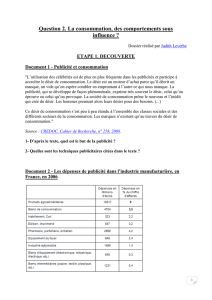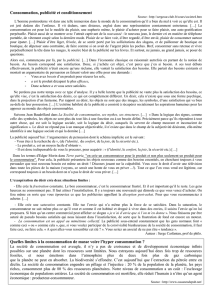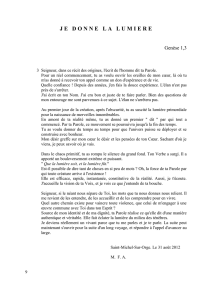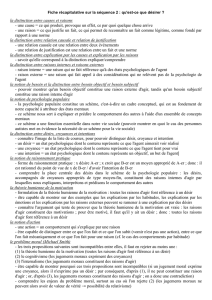Le sujet

1ère partie :
Le sujet
La conscience – L’inconscient – Le désir – Autrui [TES]
Chap. I. Le sujet
Chap. II. Conscience ou inconscient ?
Questions :
La conscience se passe-t-elle "dans la tête" ?
Qu'est-ce que penser/douter ?
Qu'est-ce que le moi ?
Qu'est-ce qu'un sujet ?
Qu'est-ce qu'un objet ?
Qu'est-ce qu'agir ?
La philosophie peut-elle ignorer la psychanalyse ?
« L’intuition est l’affaire des sens, penser, celle de l’entendement. Or penser, c’est unir des représentations dans
la conscience... L’union des représentations en une conscience, c’est le jugement. Penser, c’est donc juger. »
(Kant, Prolégomènes)
1. Position des problèmes
« Et remarquant que cette vérité : je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes
suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de l’ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour
le premier principe de la philosophie que je cherchais. » (Descartes, Discours de la méthode)
« L'homme est conscience de soi. Il est conscient de soi, conscient de sa réalité et de sa dignité humaines, et c’est en
ceci qu’il diffère essentiellement de l’animal, qui ne dépasse pas le niveau du simple sentiment de soi. » (A. Kojève,
Introduction à la lecture de Hegel)
« Les choses de la nature n’existent qu’immédiatement et d’une seule façon, tandis que l’homme, parce qu’il est
esprit, a une double existence; il existe, d’une part, au même titre que les choses de la nature, mais, d’autre part, il
existe aussi pour soi : il se contemple, se représente à lui-même, se pense, et n’est esprit que par cette activité qui
constitue un être pour soi. » (Hegel, Esthétique)
« Deuxièmement, l’homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu’il est poussé à se trouver lui-
même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s’offre à lui extérieurement. Il
y parvient en changeant les choses extérieures, qu’il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne
retrouve que ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur
son caractère farouchement étranger et pour ne jouir des choses que parce qu’il y retrouve une forme extérieure de sa
propre réalité... [L’homme] satisfait [son] besoin de liberté spirituelle d’un côté, intérieurement, en faisant être pour
soi ce qui est, mais aussi en réalisant extérieurement cet être pour soi. » (Hegel, op. cit.)
2. Quelques repères classiques
a. La conscience morale
« Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au delà » (Pascal, Pensées, Fg. 294 Br.)
« Mais, quel que soit le nombre des méchants sur la terre, il est peu de ces âmes cadavéreuses devenues
insensibles, hors leur intérêt, à tout ce qui est juste et bon. L’iniquité ne plaît qu’autant qu’on en profite ;
dans tout le reste on veut que l’innocent soit protégé. Voit-on dans une rue ou sur un chemin quelque acte de
violence et d’injustice ; à l’instant un mouvement de colère et d’indignation s’élève au fond du coeur, et
nous porte à prendre la défense de l’opprimé : mais un devoir plus puissant nous retient, et les lois nous
ôtent le droit de protéger l’innocence. Au contraire, si quelque acte de clémence ou de générosité frappe nos
yeux, quelle admiration, quel amour il nous inspire ! Qui est-ce qui ne se dit pas : J’en voudrais avoir fait
autant ? Il nous importe sûrement fort peu qu’un homme ait été méchant ou juste il y a deux mille ans ; et
cependant le même intérêt nous affecte dans l’histoire ancienne, que si tout cela s’était passé de nos jours.
Que me font à moi les crimes de Catilina ? ai-je peur d’être sa victime ? Pourquoi donc ai-je de lui la même
horreur que s’il était mon contemporain ? Nous ne haïssons pas seulement les méchants parce qu’ils nous
nuisent, mais parce qu’ils sont méchants. Non seulement nous voulons être heureux, nous voulons aussi le
1

bonheur d’autrui, et quand ce bonheur ne coûte rien au nôtre, il l’augmente. Enfin l’on a, malgré soi, pitié
des infortunés ; quand on est témoin de leur mal, on en souffre. Les plus pervers ne sauraient perdre tout à
fait ce penchant ; souvent il les met en contradiction avec eux-mêmes. Le voleur qui dépouille les passants
couvre encore la nudité du pauvre ; et le plus féroce assassin soutient un homme tombant en défaillance.
On parle du cri des remords, qui punit en secret les crimes cachés et les met si souvent en évidence. Hélas !
qui de nous n’entendit jamais cette importune voix ? On parle par expérience ; et l’on voudrait étouffer ce
sentiment tyrannique qui nous donne tant de tourment. Obéissons à la nature, nous connaîtrons avec quelle
douceur elle règne, et quel charme on trouve, après l’avoir écoutée, à se rendre un bon témoignage de soi. Le
méchant se craint et se fuit ; il s’égaye en se jetant hors de lui-même ; il tourne autour de lui des yeux
inquiets, et cherche un objet qui l’amuse ; sans la satire amère, sans la raillerie insultante, il serait toujours
triste ; le ris moqueur est son seul plaisir. Au contraire, la sérénité du juste est intérieure ; son ris n’est point
de malignité, mais de joie ; il en porte la source en lui-même ; il est aussi gai seul qu’au milieu d’un cercle ;
il ne tire pas son contentement de ceux qui l’approchent, il le leur communique.
Jetez les yeux sur toutes les nations du monde, parcourez toutes les histoires. Parmi tant de cultes inhumains
et bizarres, parmi cette prodigieuse diversité de moeurs et de caractères, vous trouverez partout les mêmes
idées de justice et d’honnêteté, partout les mêmes notions de bien et de mal. L’ancien paganisme enfanta des
dieux abominables, qu’on eût punis ici-bas comme des scélérats, et qui n’offraient pour tableau du bonheur
suprême que des forfaits à commettre et des passions à contenter. Mais le vice, armé d’une autorité sacrée,
descendait en vain du séjour éternel, l’instinct moral le repoussait du coeur des humains. En célébrant les
débauches de Jupiter, on admirait la continence de Xénocrate ; la chaste Lucrèce adorait l’impudique
Vénus ; l’intrépide Romain sacrifiait à la Peur ; il invoquait le dieu qui mutila son père et mourait sans
murmure de la main du sien. Les plus méprisables divinités furent servies par les plus grands hommes. La
sainte voix de la nature, plus forte que celle des dieux, se faisait respecter sur la terre, et semblait reléguer
dans le ciel le crime avec les coupables.
Il est donc au fond des âmes un principe inné de justice et de vertu, sur lequel, malgré nos propres maximes,
nous jugeons nos actions et celles d’autrui comme bonnes ou mauvaises, et c’est à ce principe que je donne
le nom de conscience. » (J.-J. Rousseau, Émile, L. IV, « Profession de foi du vicaire savoyard », extrait)
« La société est la fin éminente de toute activité morale. Or, 1° En même temps qu'elle dépasse les
consciences individuelles, elle leur est immanente ; 2° Elle a tous les caractères d'une autorité morale qui
impose le respect » (E. Durkheim, Sociologie et philosophie, P.U.F., 1967, p. 61)
b. Conscience et théories de la connaissance
« Toute conscience empirique a un rapport nécessaire à une conscience transcendantale (qui précède toute
expérience particulière), je veux dire à la conscience de moi-même en tant qu'aperception originaire » (Kant,
Critique de la raison pure, « Déduction des concepts de l’entendement », P.U.F., p. 131, note)
« Toute conscience, Husserl l’a montré, est conscience de quelque chose. Cela signifie qu’il n’est pas de
conscience qui ne soit position d’un objet transcendant, ou, si l’on préfère, que la conscience n’a pas de «
contenu » (...) Une table n’est pas dans ma conscience, même à titre de re-présentation. Une table est dans
l’espace, à côté de la fenêtre, etc. » (Sartre, L’Être et le néant, p. 17)
« La conscience et le monde sont donnés d’un même coup extérieur par essence à la conscience, le monde
est, par essence, relatif à elle. C'est que Husserl voit dans la conscience un fait irréductible qu’aucune image
physique ne peut rendre. Sauf peut-être, l’image rapide et obscure de l’éclatement. Connaître, c’est «
s’éclater vers », s’arracher à la moite intimité gastrique pour filer là-bas, par-delà soi, vers ce qui n’est pas
soi, là-bas, près de l'arbre et cependant hors de lui, car il m’échappe et me repousse et je ne peux pas plus me
perdre en lui qu’il ne se peut diluer en moi. » (Sartre, « Une idée fondamentale de Husserl :
l’intentionnalité », in Situations I)
c. Le concept freudien d’inconscient
« Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre... Dieu met au dedans toutes
les pièces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle respire... » (Descartes, Traité
de l’homme)
« La nature m’enseigne... par ces sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement
logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire, mais, outre cela, que je lui suis conjoint très
étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un seul tout avec lui. Car, si cela n’était,
lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu’une chose qui
pense, mais j’apercevrais cette blessure par le seul entendement. » (Descartes, Méditations métaphysiques)
« Certains actes en apparence non intentionnels se révèlent, lorsqu’on les livre à l’examen psychanalytique,
comme parfaitement motivés et déterminés par des raisons qui échappent à la conscience... Font partie de
cette catégorie les cas d’oubli et les erreurs (qui ne sont pas l’effet de l'ignorance), les lapsus linguae et
calami, les erreurs de lecture, les méprises et les actes accidentels. » (Freud, Psychopathologie de la vie
2

quotidienne)
3. La révolution psychanalytique
a. La conscience selon la théorie freudienne
« [...] dans le domaine psychologique, conscience ne serait pas synonyme d’existence, mais seulement
d’action réelle ou d’efficacité immédiate, et l’extension de ce terme se trouvant ainsi limitée, on aurait moins
de peine à se représenter un état psychique inconscient, c’est-à-dire, en somme, impuissant. » (H. Bergson,
Matière et mémoire, Chap. III, De l’inconscient)
b. Une théorie nouvelle du sujet : les deux topiques
Le schéma de l’œil (Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse) : schéma de la seconde topique, encore approximatif à ses yeux,
montrant la dynamique conflictuelle des pulsions à laquelle obéit le psychisme, en même temps que la difficulté avec laquelle la perception
consciente émerge de l’inconscient.
c. L’inconscient comme mode de fonctionnement psychique
« Si le rêve est obscur, c’est par nécessité et pour ne pas trahir certaines idées latentes que ma conscience
désapprouve. Ainsi s’explique le travail de déformation qui est, pour le rêve, un véritable déguisement. »
(Freud, Le rêve et son interprétation)
4. Le procès de l’inconscient au XXe siècle
a. La critique d’Alain
« Il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d’inconscient. La plus grave de ces erreurs est de
croire que l’inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses ; une sorte de
mauvais ange, diabolique conseiller. Contre quoi il faut comprendre qu’il n’y a point de pensées en nous
sinon par l’unique sujet, Je. Cette remarque est d’ordre moral. » (Alain, Éléments de philosophie)
b. La conscience de mauvaise foi sartrienne
Chap. III. Le désir
Questions :
Qu'est-ce qu'un désir ?
Qu'est-ce que le plaisir ?
Qu'est-ce que la volonté ?
Qu'est-ce qu'un sentiment ?
Qu'est-ce qu'une passion ?
Qu'est-ce que l'amour ?
1. Désir et besoin
a. Avoir besoin et désirer : quelle différence ?
« Le Désir humain doit porter sur un autre Désir. Pour qu’il y ait Désir humain, il faut donc qu’il y ait tout
d’abord une pluralité de Désirs (animaux). Autrement dit, pour que la Conscience de soi puisse naître du
Sentiment de soi, pour que la réalité humaine puisse se constituer à l’intérieur de la réalité animale, il faut
3

que cette réalité soit essentiellement multiple. L’homme ne peut donc apparaître sur terre qu’à l’intérieur
d’un troupeau. C’est pourquoi la réalité humaine ne peut être que sociale. Mais pour que le troupeau
devienne une société, la seule multiplicité des Désirs ne suffit pas ; il faut encore que les Désirs de chacun
des membres du troupeau portent - ou puissent porter - sur les Désirs des autres membres. Si la réalité
humaine est une réalité sociale, la société n’est humaine qu’en tant qu’ensemble de Désirs se désirant
mutuellement en tant que Désirs. Le Désir humain, ou mieux encore : anthropogène, constituant un individu
libre et historique conscient de son individualité, de sa liberté, de son histoire, et, finalement, de son
historicité - le Désir anthropogène diffère donc du Désir animal (constituant un être naturel, seulement
vivant et n’ayant qu’un sentiment de sa vie) par le fait qu’il porte non pas sur un objet réel, « positif », donné,
mais sur un autre Désir. Ainsi, dans le rapport entre l’homme et la femme, par exemple, le Désir n’est
humain que si l’un désire non pas le corps, mais le Désir de l’autre, s’il veut « posséder » ou « assimiler » le
Désir pris en tant que Désir, c’est-à-dire s’il veut être « désiré » ou « aimé » ou bien encore : « reconnu »
dans sa valeur humaine, dans sa réalité d’individu humain. De même, le Désir qui porte sur un objet naturel
n’est humain que dans la mesure où il est « médiatisé » par le Désir d’un autre portant sur le même objet: il
est humain de désirer ce que désirent les autres, parce qu’ils le désirent. Ainsi, un objet parfaitement inutile
au point de vue biologique (tel qu’une décoration, ou le drapeau de l’ennemi) peut être désiré parce qu’il fait
l’objet d’autres désirs. Un tel Désir ne peut être qu’un Désir humain, et la réalité humaine en tant que
différente de la réalité animale ne se crée que par l’action qui satisfait de tels Désirs : l’histoire humaine est
l’histoire des Désirs désirés. » (A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Coll. Tel, 1985, p.
13)
« La forme différente que prend la vie matérielle est chaque fois dépendante des besoins déjà développés, et
la production des besoins, tout comme leur satisfaction, est elle-même un processus historique que nous ne
trouvons jamais chez un mouton ou chez un chien » (K. Marx, L’Idéologie allemande, première partie,
Éditions Sociales, p. 98)
« Le désir se rapporte généralement aux hommes, en tant qu’ils ont conscience de leurs appétits et peut, pour
cette raison, se définir ainsi : le Désir est l’Appétit avec conscience de lui-même ». (Spinoza, Éthique, III,
Proposition 9, scolie)
b. Les objets du besoin et du désir ; le nécessaire et le désirable
« Étant fils de Poros [= l’Expédient] et de Pénia [= la Pauvreté], l’Amour en a reçu certains caractères en
partage. D’abord il est toujours pauvre, et loin d’être délicat et beau comme on se l’imagine généralement, il
est dur, sec, sans souliers, sans domicile ; sans avoir jamais d’autre lit que la terre, sans couverture, il dort en
plein air, près des portes et dans les rues ; il tient de sa mère, et l’indigence est son éternelle compagne. D’un
autre côté, suivant le naturel de son père, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon; il est brave,
résolu, ardent, excellent chasseur, artisan de ruses toujours nouvelles, amateur de science, plein de
ressources, passant sa vie à philosopher, habile sorcier, magicien et sophiste. Il n’est par nature ni immortel
ni mortel ; mais dans la même journée, tantôt il est florissant et plein de vie, tant qu’il est dans l’abondance,
tantôt il meurt, puis renaît, grâce au naturel qu’il tient de son père. Ce qu’il acquiert lui échappe sans cesse,
de sorte qu’il n’est jamais ni dans l’indigence, ni dans l’opulence et qu’il tient de même le milieu entre la
science et l’ignorance, et voici pourquoi. Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il
l’est ; et, en général, si l’on est savant, on ne philosophe pas ; les ignorants non plus ne philosophent pas et
ne désirent pas devenir savants ; car l’ignorance a précisément ceci de fâcheux que, n’ayant ni beauté, ni
bonté, ni science, on s’en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d’une chose, on ne
la désire pas. » (Platon, Le Banquet, 203c-204a)
« On peut se flatter peut-être de t’initier, toi aussi, Socrate, à ces mystères de l’amour (ta; ejrwtikav) ; mais
pour le dernier degré, la contemplation, qui en est le but, pour qui suit la bonne voie, je ne sais si ta capacité
va jusque-là. (...) Quiconque veut, dit-elle [= Diotime], aller à ce but par la vraie voie, doit commencer dans
sa jeunesse par rechercher les beaux corps (ta; kala; swvmata). Tout d’abord, s’il est bien dirigé, il doit
n’aimer qu’un seul corps et là enfanter de beaux discours. Puis il observera que la beauté d’un corps
quelconque est sœur de la beauté d’un autre ; en effet, s’il convient de rechercher la beauté de la forme
(to; ejp j ei[dei kalovn), il faudrait être bien maladroit pour ne point voir que la beauté de tous les corps est
une et identique (e{n te kai; taujtovn). Quand il s’est convaincu de cette vérité, il doit se faire l’amant de tous
les beaux corps, et relâcher cet amour violent d’un seul, comme une chose de peu de prix, qui ne mérite que
dédain. Il faut ensuite qu’il considère la beauté des âmes (to; ejvn tai'" yucai'" kavllo") comme plus
précieuse que celle des corps, en sorte qu’une belle âme, même dans un corps médiocrement attrayant, lui
suffise pour attirer son amour et ses soins, lui faire enfanter de beaux discours et en chercher qui puissent
rendre la jeunesse meilleure. Par là il est amené à regarder la beauté qui est dans les actions et dans les lois, à
voir que celle-ci est pareille à elle-même dans tous les cas, et conséquemment à regarder la beauté du corps
comme peu de chose. Des actions des hommes, il passera aux sciences et il en reconnaîtra aussi la beauté ;
ainsi arrivé à une vue plus étendue de la beauté, il ne s’attachera plus à la beauté d’un seul objet et il cessera
d’aimer, avec les sentiments étroits et mesquins d’un esclave, un enfant, un homme, une action. Tourné
désormais vers l’Océan de la beauté et contemplant ses multiples aspects, il enfantera sans relâche de beaux
et magnifiques discours et les pensées jailliront en abondance de son amour de la sagesse, jusqu’à ce
4

qu’enfin son esprit fortifié et agrandi aperçoive une science unique, qui est celle du beau dont je vais parler.
(...) pour aboutir des sciences à cette science qui n’est autre chose que la science de la beauté absolue et pour
connaître enfin le beau tel qu’il est en soi. (...) Songe donc, ajouta-t-elle, quel bonheur ce serait pour un
homme s’il pouvait voir le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, et contempler, au lieu d’une beauté
chargée de chairs, de couleurs et de cent autres superfluités périssables, la beauté divine elle-même sous sa
forme unique (aujto; to; qei'on kalovn ... monoeidev"). » (Platon, Le Banquet, 210a-211e)
« L’homme est fondamentalement désir d’être... Le sens du désir est en dernier recours le désir d’être Dieu »
(Sartre, L’Être et le néant, p. 654)
2. Articulation des notions de besoin et de désir : la notion de passions
« Ainsi, je crois que la vraie générosité, qui fait qu’un homme s’estime au plus haut point qu’il se peut légitimement
estimer, consiste seulement partie en ce qu’il connaît qu’il n’y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre
disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu’il en use bien ou mal et partie en
ce qu’il sent en soi-même une ferme et constante résolution d’en bien user. » (Descartes, Les passions de l'âme)
« Une affection qui est une passion cesse d’être une passion, sitôt que nous nous en formons une idée claire et
distincte... Une affection est d’autant plus en notre pouvoir, et l’âme en pâtit d’autant moins, que cette affection nous
est plus connue. » (Spinoza, Éthique)
« Le sauvage vit en lui-même ; l’homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l'opinion des autres ; et
c'est pour ainsi dire de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence » (J.-J. Rousseau, Second
Discours, Gallimard, Pléiade, 1964, p. 193)
« L’homme qui produit quelque chose de valable y met toute son énergie. Il n’est pas assez sobre pour vouloir ceci ou
cela ; il ne se disperse pas dans une multitude d’objectifs, mais il est totalement voué à la fin qui est sa véritable
grande fin. La passion est l’énergie de cette fin et la détermination de cette volonté. C’est un penchant presque animal
qui pousse l’homme à concentrer son énergie sur un seul objet. Cette passion est aussi ce que nous appelons
enthousiasme. » (Hegel, La Raison dans l’histoire)
« Rien ne s’est fait sans être soutenu par l’intérêt de ceux qui y ont participé et, appelant l’intérêt une passion, en tant
que l’individualité tout entière, en mettant à l’arrière-plan tous les autres intérêts et fins que l’on a et peut avoir, se
projette en un objet avec toutes les fibres intérieures de son vouloir, concentre en cette fin tous ses besoins et toutes
ses forces, nous devons dire que d’une façon générale rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion. »
(Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire)
« L’intérêt particulier de la passion est donc inséparable de l’activité de l’universel. C’est le particulier qui s’entre-
déchire et qui, en partie, se ruine. Ce n’est pas l’idée universelle qui s’expose à l’opposition et à la lutte, ce n’est pas
elle qui s’expose au danger ; elle se tient en arrière, hors de toute attaque et de tout dommage. C’est ce qu’il faut
appeler la ruse de la raison : la raison laisse agir à sa place les passions, si bien que, seul, le moyen par lequel elle
parvient à l’existence passe par des épreuves et des souffrances. » (Hegel, La Raison dans l’histoire)
3. Désir et psychanalyse
a. Curiosité sexuelle, désir et savoir
5
 6
6
1
/
6
100%