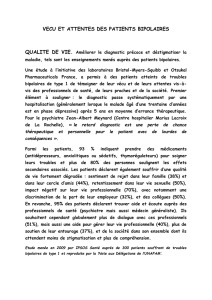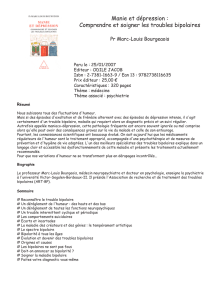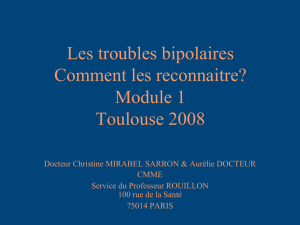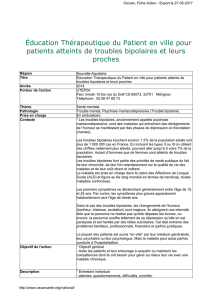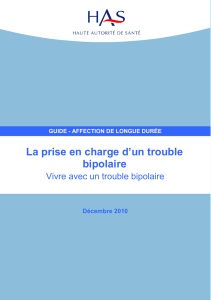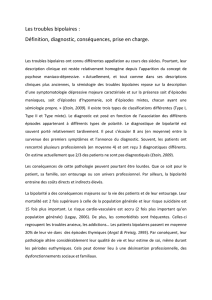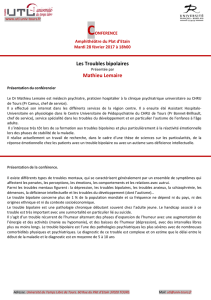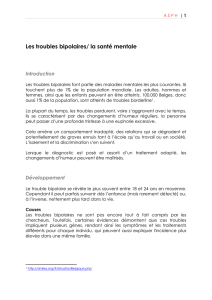Courrier international - n° 820 - 20 juil. 2006 Débat / Le marketing

Courrier international - n° 820 - 20 juil. 2006
Débat / Le marketing de la santé mentale
La psychiatrie sous l’emprise des labos
L’industrie pharmaceutique invente-t-elle ou redéfinit-elle des maladies
dans le but de vendre toujours plus de médicaments ? Le psychiatre David
Healy en est convaincu, comme de plus en plus de ses collègues médecins
et chercheurs.
Les premières images du spot télévisé montrent une femme débordant
de vie qui fait la fête et danse toute la nuit. “Votre médecin ne vous voit
jamais comme cela”, dit la voix off. Sur le plan suivant, la même femme
apparaît, le corps tassé et le visage triste : “Il vous voit comme cela.” Tout
de suite après on la voit en train de faire ses courses, pleine de
vitalité. “Voilà pourquoi tant de personnes qui souffrent de troubles bipolaires
suivent un traitement contre la dépression et ne vont pas mieux : la dépression
n’est que la moitié de l’histoire.” La femme revient à nouveau, l’air abattu,
des factures à la main. Puis un autre plan la montre en train de
repeindre son appartement avec beaucoup d’énergie. “La femme
dynamique, capable de faire la fête toute la nuit, qui parle vite et réagit au quart
de tour ne va probablement jamais chez le médecin”, reprend la voix off.
Cette publicité a été diffusée à la télévision américaine en 2002. Les
téléspectateurs étaient encouragés à se rendre à l’adresse Internet ,
qui conduit sur le site Bipolar Help Center. En regardant au bas de la
page d’accueil, on apprend qu’il appartient au groupe pharmaceutique
Eli Lilly. On y trouve un “questionnaire sur les troubles de l’humeur”. La
publicité à la télévision montrait la femme en train de remplir ce
questionnaire, et les téléspectateurs étaient encouragés à en faire
autant. “Faites ce test et apportez-le à votre médecin, il peut changer votre vie.
Un diagnostic correct est le premier pas à faire pour traiter les troubles
bipolaires. Aidez votre médecin à vous aider.” On peut voir cette publicité
comme un véritable effort pour informer les personnes qui ne savent
pas qu’elles souffrent d’une des maladies psychiatriques les plus
graves et les plus invalidantes qui soient : la psychose
maniaco-dépressive, répertoriée parmi les troubles bipolaires. Ceux
qui en sont atteints connaissent une alternance de phases de
dépression profonde et d’épisodes d’exaltation ou d’euphorie [dits
maniaques] tout aussi extrêmes, qui peuvent détruire leur vie. On
peut aussi voir ce spot comme un exemple de disease mongering : le fait

d’inventer une nouvelle maladie pour développer un nouveau marché
et vendre des médicaments. Elle pousse les gens à considérer toute
fluctuation de l’humeur comme le symptôme d’une maladie qui
nécessite un traitement. Aucun médicament n’est mentionné sur le site
web, mais on y insiste sur l’importance d’un traitement
médicamenteux de longue durée. Au moment de la diffusion du
spot, l’olanzapine (Zyprexa), du laboratoire Eli Lilly, venait juste d’être
autorisée par la Food and Drug Administration (FDA), l’agence de
sécurité sanitaire américaine, pour traiter les épisodes maniaques, et
des essais étaient en cours afin de l’instaurer comme “régulateur de
l’humeur” ou “thymorégulateur”, un terme que personne ou presque
n’avait jamais entendu avant 1995. [L’humeur, en psychiatrie, possède
un sens très fort, défini de manière négative : les troubles de l’humeur
désignent toutes les formes de dépression ou de manie. Le mot est
synonyme de thymie, du grec thumos, le siège des passions.] Cette
autorisation faisait suite à une campagne de sensibilisation lancée par
l’industrie pharmaceutique sur le thème de la nécessité de “réguler
l’humeur”. Elle avait débuté justement en 1995, l’année où la FDA a
autorisé les laboratoires Abbott à utiliser un antiépileptique, le
valproate de sodium (Dépakine), pour traiter les épisodes maniaques.
Aux Etats-Unis, le feu vert de la FDA permet aux laboratoires de faire
de la publicité pour les usages qu’elle a autorisés. Dans ses publicités
destinées aux médecins, Abbott s’est donc mis à décrire le valproate
de sodium comme un “thymorégulateur”, ce qui a sans doute incité
beaucoup de praticiens à penser que le médicament pouvait non
seulement traiter les épisodes maniaques, mais aussi les autres
troubles de l’humeur. Six ans plus tard, en 2001, le qualificatif
"thymorégulateur” s’appliquait désormais aussi à des antipsychotiques.
Pourtant, ces médicaments sont avant tout indiqués pour le traitement
de la schizophrénie. Et les articles des revues scientifiques disent
clairement qu’il n’y a pas de consensus parmi les psychiatres sur ce
qu’est exactement un “thymorégulateur”. On assista à peu près au
même moment à un autre glissement. Car, si on peut accepter le
recours aux antipsychotiques pour traiter les épisodes maniaques,
c’est-à-dire sur le court terme, il n’existe pas le moindre consensus sur
le bien-fondé de leur utilisation comme traitement de longue durée des
troubles bipolaires. Pourtant, depuis 2000, les laboratoires Eli Lilly,
Janssen et AstraZeneca se sont rués sur ce nouveau terrain et ont
entamé des démarches afin de faire agréer leurs antipsychotiques non
seulement pour les épisodes maniaques, mais aussi comme

“régulateurs de l’humeur” de longue durée. Résultat : les personnes
souffrant de troubles bipolaires se voient aujourd’hui
systématiquement prescrire un cocktail de médicaments qui coûtent
très cher et qu’ils doivent prendre de façon permanente. Les
laboratoires, souvent avec le soutien enthousiaste des psychiatres, ont
réussi à ancrer profondément dans les esprits l’idée que ces troubles
requièrent un traitement préventif pendant toute la vie, et pas
seulement lors de la survenue des épisodes maniaques ou dépressifs.
On peut ainsi lire sur le site Bipolar Help Center d’Eli Lilly qu’il est
“capital de suivre un traitement de longue durée. Sans les médicaments, les
symptômes réapparaîtront et la maladie s’aggravera.” Les informations
fournies par Janssen, qui commercialise la rispéridone sous le nom de
Risperdal, vont dans le même sens : “Les médicaments ont une importance
cruciale dans le traitement des troubles bipolaires. Les études réalisées ces vingt
dernières années montrent de façon incontestable que les personnes qui
prennent les médicaments appropriés se portent mieux sur le long terme que
celles qui n’en prennent aucun.” Il existe cependant beaucoup moins de
preuves qu’on ne le pense pour appuyer ces affirmations. Et les rares
qui sont disponibles ne portent que sur la forme la plus grave de la
maladie. [Les troubles bipolaires sont classés en deux catégories : les
types I et II, du plus grave au plus léger, et des formes limites
appelées troubles cyclothymiques.] Les données manquent à peu près
complètement sur le type II ou la cyclothymie étant donné que les
essais cliniques ont surtout été effectués sur des personnes souffrant
de troubles bipolaires de type I. Or ces derniers ne correspondent qu’à
un dixième des cas. En fait, à l’exception peut-être du lithium [le
traitement de référence pour cette maladie, découvert il y a plusieurs
dizaines d’années] pour les troubles bipolaires de type I, aucun essai
randomisé contrôlé ne montre que les sujets atteints de troubles
bipolaires qui prennent des médicaments se portent mieux sur le long
terme que ceux qui n’en prennent pas. L’olanzapine d’Eli Lilly a été
autorisée par la FDA pour le traitement de longue durée des troubles
bipolaires en janvier 2004 sur la base d’un essai randomisé contrôlé.
Mais cet essai n’a duré qu’un an et les rechutes les plus évidentes sont
survenues juste après que les patients eurent cessé de prendre le
médicament, ce qui laisse penser qu’ils souffraient en fait de
symptômes de sevrage. Même les preuves apportées pour démontrer
l’efficacité du lithium sont controversées. Il est vrai que ce manque de
preuves est dû aux difficultés qu’il y a à mener des essais durant plus
de quelques semaines pour des pathologies aussi complexes que les
troubles bipolaires. Mais les preuves d’efficacité ne doivent pas faire

oublier leurs dangers. La toxicité potentielle du lithium est bien
documentée, et de nombreuses données montrent que le risque de
mortalité est plus élevé chez les personnes qui prennent des
antipsychotiques de façon régulière sur le long terme. Cette
conséquence ainsi que d’autres effets secondaires connus des
antipsychotiques ne sont pas visibles dans les essais relativement
courts destinés à démontrer l’efficacité d’un traitement en psychiatrie.
Les essais sur l’utilisation des antipsychotiques dans les cas de
schizophrénie montrent également que le taux de suicide est
nettement plus élevé parmi ceux qui prennent le médicament que
dans le groupe placebo. Par ailleurs, on peut se demander si les
bienfaits censément démontrés lors des essais cliniques se retrouvent
véritablement dans l’activité thérapeutique. Il y a un siècle, dans le
nord du pays de Galles, les personnes atteintes de troubles bipolaires
de type I étaient hospitalisées en moyenne quatre fois par décennie.
Aujourd’hui, malgré les énormes progrès médicaux et
pharmacologiques, les patients atteints du même mal sont hospitalisés
quatre fois plus souvent ! Ce n’est pas ce qui se passe lorsqu’un
traitement “marche”, mais c’est assez souvent ce qui se passe lorsqu’il
a des effets secondaires. Ceux qui “promeuvent” les troubles
bipolaires insistent sur le taux effrayant de suicide chez les personnes
qui en souffrent. [On estime que 20 % des malades souffrant de
troubles bipolaires de type I ou II décèdent par suicide.] L’enjeu est
immense, mais la controverse l’est aussi. [David Healy a récemment
mis en évidence que les antidépresseurs, dans certaines conditions,
augmentaient le risque de suicide chez les personnes déprimées. Healy
a affirmé en 2002 que 25 000 personnes s’étaient suicidées
uniquement à cause du Prozac.] Le débat sur le rôle des
antidépresseurs dans le suicide a récemment pris un nouveau tour :
celui de l’erreur de diagnostic. Les antidépresseurs causeraient des
suicides s’ils sont prescrits à tort, dans le cas de troubles de l’humeur.
Si le médecin avait vu que le patient était bipolaire, argumente-t-on, il
n’aurait pas fait l’erreur de prescrire un antidépresseur. [On considère
que le trouble bipolaire est sous-diagnostiqué : jusqu’à 40 % des
dépressifs pourraient être en fait des maniaco-dépressifs et prennent
donc un traitement inapproprié.] Du fait de ce risque de suicide, la
plupart des psychiatres auraient des scrupules à ne pas prescrire de
médicaments à un patient atteint de troubles bipolaires. Pourtant les
éléments disponibles montrent que les médicaments ne servent à rien.
Jitschak Storosum et ses collègues du Comité néerlandais d’évaluation

des médicaments ont analysé les quatre essais randomisés contrôlés
en double aveugle sur l’efficacité de “régulateurs de l’humeur” dans la
prévention des épisodes maniaco-dépressifs, qui leur ont été soumis
entre 1997 et 2003. Ils ont comparé le risque de suicide chez les
patients prenant divers médicaments et dans le groupe contrôle. Parmi
les 943 sujets qui prenaient un médicament, il y a eu deux suicides et
huit tentatives de suicide. Il n’y a eu que deux tentatives et aucun
suicide parmi les 418 patients du groupe placebo. Si l’on se fonde sur
ces chiffres, les actes suicidaires sont 2,2 fois plus fréquents chez les
personnes sous “régulateur de l’humeur” que chez celles sous placebo.
Si l’efficacité des “régulateurs de l’humeur” est douteuse et s’ils
augmentent le risque de suicide, il faudrait logiquement être très
prudent en ce qui concerne la généralisation de leur utilisation. Or on
assiste actuellement aux Etats-Unis à une forte hausse des diagnostics
de troubles bipolaires chez les enfants. Aujourd’hui, on donne même
de l’olanzapine et de la rispéridone à des enfants d’âge préscolaire.
Pourtant, ces enfants ne remplissent pas les critères habituels des
troubles bipolaires de type I. Les troubles bipolaires chez les enfants
ne sont d’ailleurs pas reconnus en dehors des Etats-Unis. Les
chercheurs affirmaient encore très récemment que la maladie
maniaco-dépressive n’apparaît que très rarement avant l’adolescence.
Pourtant, certains spécialistes sont désormais prêts à envisager de
détecter les premiers signes de troubles bipolaires dans des
comportements hyperactifs de l’embryon dans l’utérus. Rien que
chez les adultes, il existe déjà un fort potentiel pour créer une
“épidémie” artificielle de troubles bipolaires parce que les diagnostics
se fondent sur des jugements subjectifs, et non pas sur des critères
objectifs comme une hospitalisation ou un arrêt de travail d’un mois.
Avec les enfants, ce risque est encore plus grand parce que le
diagnostic se fonde principalement sur les dires des parents et parce
que la plupart des pratiques cliniques font très peu de cas du contexte
dans lequel les parents élèvent leurs enfants. A une époque où les
deux parents ont souvent de longues journées de travail et où les
services de garde d’enfants rejettent les enfants “difficiles”, les
médicaments peuvent être le moyen le plus simple de faire face à un
problème de comportement. Certaines études menées dans ce
domaine aggravent encore la situation. Des établissements réputés
pour leur sérieux, comme le Massachusetts General Hospital à Boston
[l’un des hôpitaux les plus prestigieux des Etats-Unis], ont testé
l’olanzapine et la rispéridone sur des enfants âgés en moyenne de 4
 6
6
 7
7
1
/
7
100%