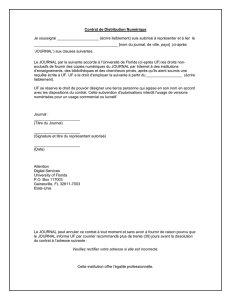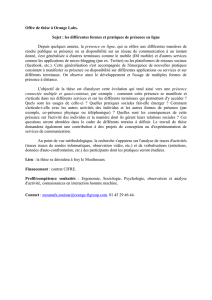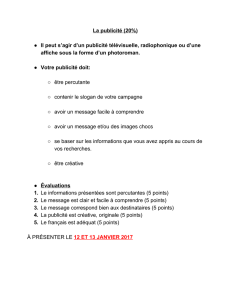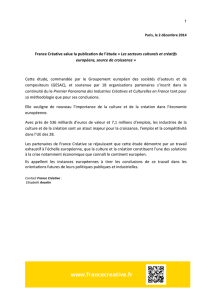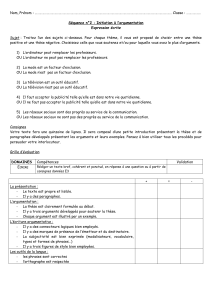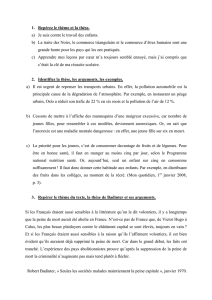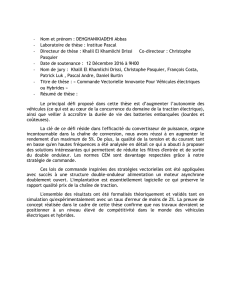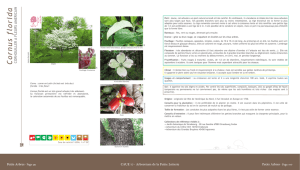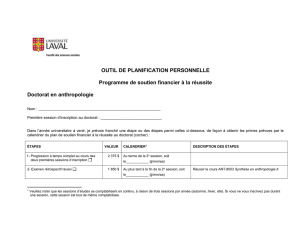La thèse de la «classe créative»: son incidence sur l`analyse des

Revue Interventions économiques
Papers in Political Economy
37 | 2008
La compétitivité urbaine et la qualité de vie
La thèse de la « classe créative » : son incidence
sur l’analyse des facteurs d’attraction et de la
compétitivité urbaine
Sébastien Darchen et Diane-Gabrielle Tremblay
Édition électronique
URL : http://
interventionseconomiques.revues.org/503
ISBN : 1710-7377
ISSN : 1710-7377
Éditeur
Association d’Économie Politique
Référence électronique
Sébastien Darchen et Diane-Gabrielle Tremblay, « La thèse de la « classe créative » : son incidence sur
l’analyse des facteurs d’attraction et de la compétitivité urbaine », Revue Interventions économiques [En
ligne], 37 | 2008, mis en ligne le 01 février 2008, consulté le 30 septembre 2016. URL : http://
interventionseconomiques.revues.org/503
Ce document a été généré automatiquement le 30 septembre 2016.
Les contenus de la revue Interventions économiques sont mis à disposition selon les termes de la
Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

La thèse de la « classe créative » : son
incidence sur l’analyse des facteurs
d’attraction et de la compétitivité
urbaine
Sébastien Darchen et Diane-Gabrielle Tremblay
Introduction
Cet article a pour objectif d’identifier les concepts sur lesquels s’appuie la thèse de la
classe créative développée par Richard Florida quant à l’analyse des dynamiques
économiques contemporaines, notamment en ce qui a trait à sa définition du capital
humain (ou des talents, pour reprendre ses termes) en tant que facteur déterminant du
développement économique en milieu urbain. Pour ce faire, nous nous intéressons à deux
points en particulier, soit l’origine de la théorie et son apport en ce qui concerne les
facteurs d’attraction des populations en milieu urbain et le thème de la compétitivité
urbaine. Nous rappelons comment cette approche du développement économique se
rattache à un courant en économie urbaine qui a depuis longtemps fait le lien entre d’une
part, le potentiel créatif d’un espace géographique ou d’une catégorie de la population en
particulier et d’autre part, l’innovation nécessaire au développement économique. Nous
revenons également sur la méthodologie utilisée par Richard Florida pour justifier son
approche du développement économique en milieu urbain, l’objectif étant de clairement
identifier les principes, les indices et les indicateurs à partir desquels cette thèse est
construite. Nous énumérons les critiques faites à l’encontre de la thèse en question, mais
soulignons également ses mérites, notamment en ce qui a trait au fait de repenser les
initiatives en termes de développement économique en s’appuyant sur la valorisation du
capital humain. Nous revenons également sur les applications de cette thèse qui ont déjà
eu lieu dans un certain nombre de villes en Amérique du Nord et exprimons certaines
La thèse de la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des facteurs...
Revue Interventions économiques, 37 | 2008
1

réserves quant à son application dans le cadre de politiques de développement urbain qui
ne se baseraient que sur cette dernière afin de favoriser la compétitivité des villes.
Fondements d’une thèse d’inspiration sociologique sur
le développement économique en milieu urbain
La thèse de Richard Florida s’est fait connaître suite à la publication de trois ouvrages
successifs, publiés chez des éditeurs « grand public »: The Rise of the Creative ClassandHow
It’s Transforming Work Leisure and Everyday Life (2002), The Flight of the Creative Class: the New
Global Competition for Talent (2005a) et Cities and the Creative Class (2005b). Ce dernier
ouvrage insistant particulièrement sur le lien entre la définition du capital humain de
Florida et les éléments qui font qu’une ville soit attrayante pour la catégorie de la « classe
créative » en particulier, nous faisons ici principalement référence à cet ouvrage. Il
convient également de préciser que la thèse a également été promue par le biais de
l’entreprise de Florida, Catalyx, par un autre organisme qu’il dirige, appelé Creative Class
Group, et par de nombreuses entrevues dans les médias et des conférences destinées à un
public majoritairement composé de décideurs politiques et d’acteurs de la sphère
économique.
Les fondements de la thèse de Florida se rapprochent de la notion d’idéal-type de Weber.
Le lien entre l’économie urbaine et l’émergence d’une classe sociale en particulier a en
effet été mis en évidence par d’autres travaux avant ceux de Florida. Veblen (1899) et
Mills (1951) avaient déjà identifié l’émergence d’une certaine classe sociale en fonction de
l’évolution économique en milieu urbain. L’analyse de Veblen (1899)1 en particulier est
très proche de la thèse de Florida. Veblen (1899) aurait en effet anticipé la théorie de la
croissance endogène en démontrant que le changement technologique était
essentiellement un processus de transformation culturelle et notamment que cette
faculté à instituer le changement est détenue par une certaine classe de la société (
Interventions économiques, 2007 ; Brette, 2002). La thèse de Florida s’inscrit également dans
la tradition des théories sociales héritées de l’École de Chicago qui mettent en valeur
l’influence du mode de vie urbain sur la personnalité des individus (Lang, 2006, p. 317).
Florida s’appuie donc sur un courant de pensée déjà existant ; il réactualise l’idée que la
ville est le lieu de la créativité et de l’innovation, de par sa diversité culturelle et sociale
(Roy-Valex, 2006, p. 325). En ce sens, la thèse de Florida renvoie également aux approches
de Jane Jacobs (1961, 1992), voire de Lewis Mumford (1970), qui considèrent que les
centre-villes sont les berceaux de l’innovation du fait que ceux-ci abritent une diversité
accrue en termes de population par rapport à des environnements qui ne sont pas de type
urbain. La thèse de Florida s’inscrit également dans la continuité des travaux de
chercheurs de l’université de Lund, en Suède, qui ont mis en valeur lors des décennies
1970 et 1980 le fait qu’un milieu urbain créatif – sur le plan artistique, de même qu’en ce
qui concerne la science et la technologie – est le produit de plusieurs facteurs qui sont
réunis dans un même espace géographique et dans un même espace temps (ex : Florence
au XIIIe et XVe siècle, Vienne entre les années 1880 et 1927 ; New York durant les années
1950 et 1960) (Andersson, 1985 ; Törnqvist, 1978). Andersson (1985) identifie un certain
nombre de facteurs qui correspondent à ces milieux favorables à l’innovation. Entre
autres, ceux-ci doivent réunir les facteurs suivants : une stabilité sur le plan financier, des
infrastructures de transport efficaces afin de faciliter les communications, ainsi qu’une
certaine instabilité en ce qui concerne l’avenir technologique et scientifique, qui est une
La thèse de la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des facteurs...
Revue Interventions économiques, 37 | 2008
2

condition du développement d’un milieu créatif. En ceci le critère d’Andersson (1985)
concernant une diversité du milieu – il ne précise cependant pas à quoi se réfère cette
diversité – rejoint l’un des critères de Florida (2005b) qui a trait à la notion de diversité
qu’il mesure à l’aide du Melting Pot Index – les indices gai et bohémien sont également pris
en compte – ; selon lui cet indicateur serait fortement en corrélation avec la
concentration en entreprises de haute technologie pour une région, cette concentration
étant considérée comme favorable à l’innovation. Enfin, ajoutons que Florida reprend
certains éléments d’une autre enquête réalisée dans les années 80 par Ray et Anderson
aux États-Unis auprès d’environ 100 000 personnes. Dans leur livre intitulé « L’émergence
des créatifs culturels. Enquête sur les acteurs d’un changement de société », Ray et
Anderson (2001) présentent les résultats de cette étude qui identifie une évolution
radicale et un profond changement de société fondé sur la présence des créatifs du
secteur culturel (Tremblay et Pilati, 2007a).
La thèse de Florida s’inscrit dans un certain courant de pensée en études urbaines qui fait
le lien entre le potentiel d’innovation d’un certain milieu (en l’occurrence urbain) qui se
caractérise par un certain capital humain et la croissance économique. Ceci dit, la thèse
de Florida a suscité de nombreuses critiques tant sur le fond qu’en ce qui concerne la
méthodologie qui sert d’assise à cette approche du développement économique. Pour
certains, le fait qu’une concentration d’une population dite créative engendre
l’innovation et la croissance économique a été considéré comme une extrapolation sans
véritable assise empirique appuyée par une méthodologie solide (Lang, 2006 ; Shearmur,
2006 ; Malanga, 2005, 2004 ; Kotkin, 2004).
La thèse du développement économique de Richard Florida s’oppose aussi à des théories
qui placent le territoire comme facteur générateur de l’innovation, par exemple la
théorie des milieux innovateurs de Philippe Aydalot (Darchen et Tremblay, 2007). Florida
soutient finalement le fait que le développement économique n’est pas tant induit par le
progrès technologique que par le capital humain, c’est-à-dire par la présence de cette
catégorie de professionnels, source à la fois de l’innovation technologique et de richesse
(Peck, 2005, p. 743.). Cependant, c’est à partir de la conception que Florida a du capital
humain que sa thèse tout entière est construite et ce, sans que son extrapolation de la
notion de capital humain ne se vérifie empiriquement. Glaeser (2005, p. 596) montre en
effet, en s’appuyant sur les indices proposés par Florida (patents per capita, l’indice gay et
l’indice bohémien) et sur les exemples de 242 régions métropolitaines, que l’indice
concernant le niveau d’éducation (personnes détenteurs d’un baccalauréat) demeure
l’indicateur le plus significatif quant au lien avec les plus hauts taux d’emploi dans les
secteurs dits super-créatifs, considérés dans la thèse de Florida comme le moteur de la
croissance économique. Lorsqu’il s’agit de défendre sa version du capital humain qui fait
intervenir les indices gay et bohémien, Florida ne peut donc apparemment pas le faire à
l’aide de données empiriques solides ; Glaeser (2005) montre en fait que la population
qualifiée demeure le facteur clé du développement économique en milieu urbain.
Florida procède donc rapidement au lien entre sa définition du capital humain et les
attributs qu’une ville doit posséder pour attirer la catégorie de professionnels qu’il
qualifie comme la « classe créative ». La ville devient, selon l’auteur, un lieu qui doit
s’adapter aux besoins de cette catégorie de professionnels afin de l’attirer, car elle est
nécessaire au développement économique. Cette part de la force de travail est estimée
par Florida à 38 millions de personnes et représenterait 30 % de la main-d’œuvre totale
aux États-Unis (Peck, 2005, p. 743). Toujours selon Florida, cette classe de personnes
La thèse de la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des facteurs...
Revue Interventions économiques, 37 | 2008
3

s’identifierait davantage au lieu où elle habite qu’à l’emploi qu’elle occupe. L’auteur s’est
donc efforcé d’identifier les critères qu’une ville doit réunir afin d’attirer cette classe de
personnes en particulier.
L’organisation de la thèse de Florida : les principes
La thèse de Florida est organisée autour de l’idée que les entreprises – notamment celles
des secteurs de la haute technologie – sont attirées par la présence d’une certaine
« classe » d’individus précisément nommée « classe créative » par l’auteur. Le
développement économique est donc dépendant de la présence de cette catégorie de la
population active. Cette « classe » comprend autant des artistes (écrivains, musiciens,
peintres) – que Florida qualifie de bohémiens – que des scientifiques (ingénieurs,
informaticiens, professeurs) que l’auteur qualifie de « classe super-créative » (Suire, à
paraître, p. 10). Selon Florida, le secteur créatif comprend en fait quatre grandes
catégories d’emplois qui forment l’acronyme « TAPE » ; elles correspondent au secteur
Technologique, aux activités des Arts et de la culture, aux activités Professionnelles et
managériales et aux activités d’Éducation. Le secteur créatif regroupe ainsi non
seulement des individus du secteur artistique, que l’on identifie souvent au secteur
créatif, mais aussi des individus travaillant dans les milieux de l’information et les
sciences de la vie, dans le domaine informatique et mathématiques, mais aussi bien sûr
dans d’autres domaines tels que l’architecture, le design, les arts et le divertissement.
L’objectif premier de la thèse de Florida (2005b) est donc d’identifier les facteurs qui
contribuent à cette attraction du capital créatif2. Dans son étude qui fait appel à des
entretiens semi-dirigés et à des focus group, Florida (2005b, 2002) en arrive à la conclusion
que la « classe créative » est attirée par des villes qui privilégient la tolérance et la
diversité. Afin de mesurer cet indice de diversité et de tolérance, Florida (2005b) utilise
trois indices finalement réunis en un seul indice nommé Composite Diversity Index (CDI),
celui-ci comprend l’indice bohémien, l’indice gai et le pourcentage de personnes nées à
l’étranger. Florida (2005b) trouve une corrélation très forte entre cet indice de diversité
et de tolérance et la concentration en entreprises dans les secteurs de la haute
technologie à l’échelle d’une région métropolitaine, ce que l’auteur considère comme un
facteur déterminant de la croissance économique future. La thèse de Florida repose
finalement sur une définition particulière de la notion de capital humain, dont certains
diront qu’elle n’apporte rien de plus (Shearmur, 2006). Ainsi, Florida (2005b) se démarque
de la notion de capital humain habituelle, qui repose plus souvent sur le niveau
d’éducation de la population en question ; nous nous référons ici aux recherches qui font
le lien entre la présence d’un capital humain dans une ville et sa croissance sur le plan
économique (Glaeser et Saiz, 2004 ; Shapiro, 2003 ; Simon, 1998).
Florida (2005b) procède également à une hiérarchisation des régions métropolitaines les
plus innovantes en utilisant un indice composite nommé Creativity Index, qui fait
intervenir trois indices en particulier : le High-Tech Index qui mesure le potentiel d’une
région en ce qui concerne une économie dans les secteurs de la haute technologie3 ; l’
Innovation Index qui prend en compte le nombre de brevets émis pour une région en
considérant une population de 10 000 habitants ; l’indice de créativité tient enfin compte
du degré de « tolérance » d’une région, mesurée en considérant les indices gai et
bohémien (Florida, 2005b, p. 156). En considérant quinze régions métropolitaines des
États-Unis, l’auteur établit qu’il existe une corrélation significative entre les régions
La thèse de la « classe créative » : son incidence sur l’analyse des facteurs...
Revue Interventions économiques, 37 | 2008
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%