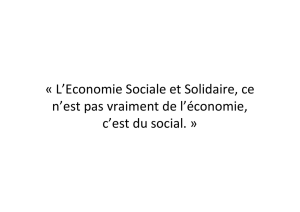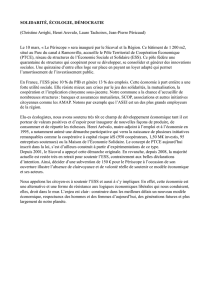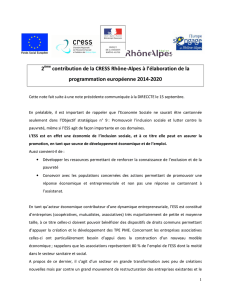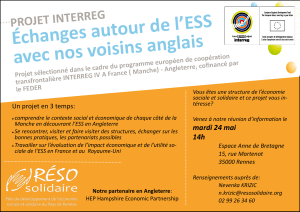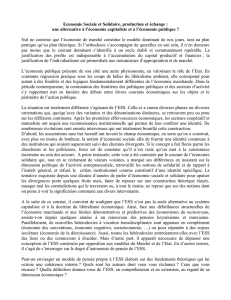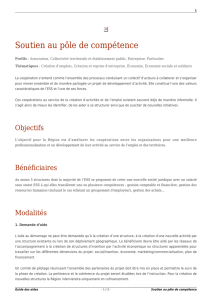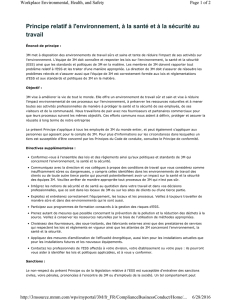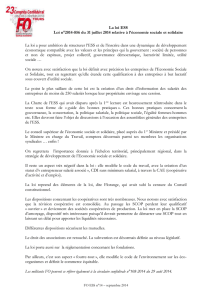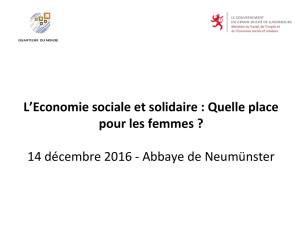L`ESS appelle à une pluralité d`indicateurs de richesse

L’ESS appelle à une pluralité d’indicateurs
de richesse
Publié le 24 novembre 2016
Les insuffisances et les limites du Produit Intérieur Brut, mesure unique de la richesse, sont
désormais argumentées par un nombre croissant d’experts (économistes, comptables,
sociologues, environnementalistes, etc.). Se doter d’indicateurs complémentaires nécessite de
poursuivre le large débat de société entamé ces dernières décennies, en impliquant davantage
les citoyens. L’économie sociale et solidaire est une partie prenante essentielle de cet enjeu
décisif.
La question a commencé à être soulevée au cours des années 1970, avec notamment le premier rapport
du Club de Rome sur les limites de la croissance . [1] En France, on cherchait à mieux mesurer la
qualité de vie au-delà des questions économiques, notamment grâce aux propositions de Jacques
Delors sur les "indicateurs sociaux". Mais la crise qui a suivi a focalisé à nouveau l’attention sur la
croissance, l’inflation, le chômage et les comptes extérieurs, « le "carré magique" censé mesurer la
santé d’un pays ». [2] Dans les années 80, il n’y a toujours pas d’indicateur alternatif macro-socio-
économique dans le débat public ; dix ans plus tard, leur nombre est passé à deux, puis à une quinzaine
dans le courant des années 1990 et à une trentaine aujourd’hui. L’objectif n’est pas ici d’en rendre
compte de façon exhaustive.
Le Programme des Nations unies de développement (PNUD) a construit un indicateur qui a participé à
ouvrir le débat internationalement à des dimensions plus qualitatives : l’Indice de développement
humain (IDH). Pour cela, le PNUD s’est appuyé sur les travaux d’économistes, en particulier ceux
d’Amartya Sen, Prix Nobel en 1998. Il a pris le parti de proposer un indicateur reposant sur : « la
capacité de bénéficier d’une vie longue et saine » (santé et espérance de vie), « la capacité d’accès à
l’éducation et aux connaissances » (taux d’alphabétisation des adultes et taux de scolarisation) et « la
capacité d’accéder aux ressources matérielles indispensables pour accéder à un niveau de vie décent »
(sur la base du revenu national brut par habitant). L’IDH est une mesure du niveau moyen atteint dans
ces trois dimensions. Imparfait, il a le mérite d’avoir permis de modifier la hiérarchie des nations en
matière de développement.
S’inspirer de l’ESS pour piloter l’action publique
Patrick Viveret, économiste, professeur de philosophie, cofondateur du collectif Roosevelt et
administrateur du Labo de l’ESS, a participé à différentes missions en France visant à redéfinir
les indicateurs de richesse. En 2002, alors conseiller référendaire à la Cour des Comptes, il rédige
un rapport intitulé « Reconsidérer la richesse ». [3] Il y propose notamment au Parlement et à la
Commission européenne d’élaborer un rapport européen sur les indicateurs de développement humain,
couplée avec « une initiative spécifique concernant l’élaboration d’indicateurs de destruction pour
permettre d’envisager une activation massive de dépenses de réparation vers le soutien à une économie
de la prévention et du recyclage ».
De plus, les associations et ONG subissent la comptabilisation actuelle de la richesse, dans le sens
qu’elle ignore les activités bénévoles. Il préconise également à la recherche publique de se nourrir de

la floraison des initiatives de l’ESS, qui intègrent souvent les facteurs écologiques et humains, pour en
faire des outils opérationnels dans le pilotage de leur action.
En 2008, la Commission Stiglitz sur la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social
avait pour objectif d’engager : « une réflexion sur les moyens d’échapper à une approche trop
quantitative, trop comptable de la mesure de nos performances collectives ». Aux côtés de
l’économiste Joseph Stiglitz, on retrouvait Amartya Sen, ainsi que Jean-Paul Fitoussi, directeur de
recherche à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Si ses conclusions ont
apporté une légitimité supplémentaire aux critiques anciennes sur le PIB, il a été reproché à la
commission l’absence d’inclusion de la société civile dans ses réflexions.
C’est à la suite qu’a été créé le Forum pour d’autres indicateurs de richesses (FAIR), composé
d’acteurs des territoires, de chercheurs de plusieurs disciplines, de militants associatifs et syndicaux,
réfléchissant tous à cette question. Le forum est présidé par Florence Jany-Catrice, économiste,
spécialisée notamment en évaluation des actions publiques et Dominique Méda, sociologue,
philosophe, dont les domaines d’expertise sont entre autres, le développement durable et les politiques
sociales. Elles nous livrent leur tribune commune dans ce Focus.
La « loi Sas » du 13 avril 2015 impose désormais à l’État de publier des données construites autour de
dix nouveaux indicateurs apportant un contrepoids au PIB. Ils ont été présentés en juin 2015 : taux
d’emploi, effort de recherche, endettement, espérance de vie en bonne santé, satisfaction dans la vie,
inégalité des revenus, pauvreté en condition de vie, sorties précoces du système scolaire, empreinte
carbone, artificialisation des sols. Au printemps 2016, France Stratégie et le Conseil économique et
social ont conduit une consultation citoyenne pour se saisir d’indicateurs alternatifs. Désormais,
l’évaluation de quelques unes des mesures phares en cours de mise en œuvre se fera au regard de ces
nouveaux indicateurs.
Des initiatives alternatives sur les territoires
Les collectivités territoriales ne sauraient saisir la pluralité des aspects de la vie et des richesses de leur
territoire, au moyen d’un simple PIB. Les indicateurs complémentaires peuvent alors devenir de
véritables alliés au service des politiques publiques. Villes, départements, régions grandissent les rangs
des acteurs qui osent lancer des expérimentations à l’échelle locale, participant à la déconstruction de
la représentation statistique traditionnelle de la réalité. On en recense aujourd’hui une dizaine. Le
Grand Lyon est la première commune à avoir mis en place une initiative pour calculer son empreinte
écologique. Le Nord-Pas-de-Calais était la première région à lancer l’indicateur régional de santé
social (ISS), toutes deux en 2003. Autres collectivités engagées : les régions Ile-de-France, Centre,

Pays-de-la-Loire, Bretagne et Aquitaine ; les départements Midi Pyrénées et Meurthe et Moselle ou
encore la ville de Marseille. [4] En Ile-de-France, l’Indice de développement humain alternatif - IDH2,
retient : l’espérance de vie à la naissance, la part de la population de plus de 15 ans non scolarisée
diplômée, et la médiane des revenus fiscaux des ménages par unité de consommation.
Les acteurs de l’ESS doivent pouvoir mettre en œuvre une grille commune d’indicateurs, en
s’appuyant sur la « loi Sas », pour rendre compte à l’échelle du territoire, de leur empreinte
démocratique spécifique, de leurs empreintes sociale et environnementale. A ce titre, les représentants
de l’ESS sont invités à adopter et adapter le Guide des bonnes pratiques de l’ESS. Ce guide encourage
à un questionnement multidimensionnel sur six axes (gouvernance, stratégie, territorialisation des
emplois, politique salariale, santé et sécurité, diversité, égalité hommes / femmes…), auxquels
s’ajoutent les questions environnementales et d’éthique.
Les entreprises de l’ESS peuvent également effectuer des démarches d’évaluation de l’utilité sociale.
C’est ce propose des structures spécialisées, comme la pionnière Trans-Formation Consultants à
retrouver dans notre rubrique d’initiatives inspirantes. Pour l’économiste Jean Gadrey : “Est d’utilité
sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a pour résultat constatable et, en
général, pour objectif explicite, au-delà d’autres objectifs éventuels de production de biens et de
services destinés à des usagers individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la
réduction des inégalités), à la solidarité (nationale, internationale, ou locale : le lien social de
proximité), à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions collectives du développement humain
durable (dont font partie l’éducation, la santé, l’environnement, et la démocratie).” [5] En s’appliquant
au niveau micro, les indicateurs complémentaires participeront ainsi à faire changer d’échelle l’ESS et
à « polliniser » l’économie.
"La richesse autrement est publié à l’initiative du Forum
pour de nouveaux indicateurs de richesse (FAIR). Ce collectif réunit des universitaires et chercheurs qui
n’ont pas attendu le rapport Stiglitz pour s’interroger sur ce que sont les vraies richesses et comment les
compter." Retrouvez la publication en ligne.
[1] The Limits to Growth, rapport Meadows, Club de Rome, 1972.

[2] Les nouveaux indicateurs de richesses, par Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice. Coll. Repères, éd. La
Découverte, 2005.
[3] Reconsidérer la richesse, Mission « Nouveaux facteurs de richesse », Rapport réalisé par Patrick VIVERET
Conseiller référendaire à la Cour des Comptes A la demande de Guy HASCOËT Secrétaire d’Etat à l’économie
solidaire, Janvier 2002.
[4] « D’autres indicateurs de richesse au service des politiques publiques : les collectivités territoriales s’en
saisissent »
Publié le 11/04/2012 • Mis à jour le 04/12/2014 • Par Aude Raux dans La Gazette des communes.
[5] GADREY Jean, “L’utilité sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire”, rapport de synthèse
pour la DIIESES et la MIRE, septembre 2003.
1
/
4
100%