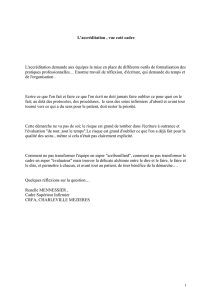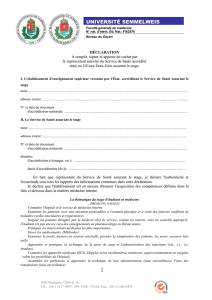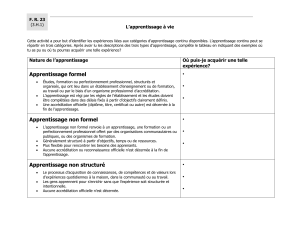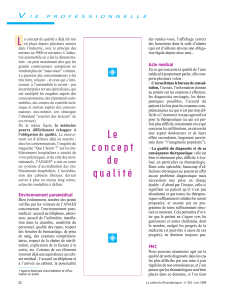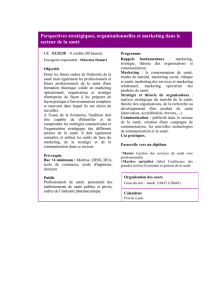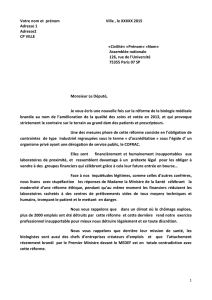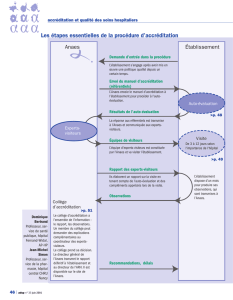manuel d`accréditation V2

EXTRAIT DU MANUEL D’ACCRÉDITATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Deuxième procédure d’accréditation
Version expérimentale
Selection psychiatrie
Du baqhp-psy
Document de travail
Novembre 2003

1
POLITIQUE ET QUALITE DU MANAGEMENT
Introduction
La prise en charge de la qualité du service rendu au patient est une priorité. Assurer cet
objectif requiert une politique et une organisation de l’établissement, et de ses
différents secteurs d’activité, notamment en lien avec leur environnement (partenaires
extérieurs inclus).
Manager l’établissement consiste d’abord à définir les orientations stratégiques ou le
projet d’établissement permettant de satisfaire les besoins des patients. La mise en
place d’actions, pour remplir ces objectifs, nécessite des conditions optimales de
qualité et de sécurité, l’implication et la coordination de tous les professionnels.
L’implication des dirigeants et des différents acteurs concernés est donc un enjeu
déterminant pour le succès de ces démarches.
La mise en place de cette politique repose, de ce fait, sur l’existence d’un
management* impliquant l’ensemble des dirigeants concernés, dans une approche en
réseau, afin d’être au plus près des besoins du patient pour répondre plus rapidement à
ses attentes, et d’être opérationnel dans des conditions optimales de sécurité. Les
responsables* opérationnels exercent leurs responsabilités en maillage avec les
différents services (pluridisciplinarité, pluriprofessionnalisme). La gouvernance* est
donc collective.
Les références relatives à ce référentiel sont divisées en deux thèmes distincts :
– la politique : elle aborde les conditions d’élaboration des orientations stratégiques
de l’établissement et les grandes lignes de sa politique.
– la qualité du management : elle constitue un élément essentiel de la réussite des
missions de l’établissement. L’objectif ne consiste pas à évaluer les responsables*
mais à appréhender la manière dont ces derniers, qu’ils soient gestionnaires, médecins
ou soignants, remplissent, à leur niveau, la composante managériale de leur mission,
caractérisée par cinq fonctions : prévoir, organiser, décider, motiver et évaluer.
A. POLITIQUE
Référence 1
L’établissement dispose d’orientations stratégiques pour la
prise en charge et la promotion de la santé du patient.
1.a. Les orientations stratégiques répondent aux besoins de la population en termes
de soins, d’éducation et de prévention pour la santé.
L’analyse des besoins permet la définition des orientations stratégiques.
L’établissement développe et hiérarchise l’ensemble de ses projets en fonction de
ses orientations stratégiques définies, en référence au SROS. Spécifiquement, les
politiques ou les projets concernés sont : le projet médical et de soins, le projet
social, le projet du système d’information*, le projet qualité et gestion des risques,
le projet hôtelier, ainsi que ceux ayant trait à l’enseignement et la recherche, le cas
échéant.

Les orientations stratégiques concernent les activités* de soins et les activités de
promotion de la santé. La promotion de la santé permet au patient de mieux
contrôler les déterminants de la santé et ainsi d’améliorer sa propre santé (Ottawa
Charter for Health Promotion, WHO, 1986). L’établissement, outre les soins de
qualité qu’il doit fournir, développe une organisation et une culture allant dans le
sens de la participation active des patients et du personnel.
1.b. Les orientations stratégiques s’appuient sur les résultats des évaluations
menées dans l’établissement et ont été établies à partir de données factuelles.
Le diagnostic interne peut s’appuyer, entre autres, sur les résultats du bilan de
l’exercice précédent en termes de performances, l’analyse des résultats des
enquêtes de satisfaction des usagers, l’adéquation des compétences aux nouvelles
activités*, s’il y a lieu, les données de la veille technologique (progrès scientifiques,
évolutions des pratiques, les données du comité de coordination de la qualité et
des risques.
Se référer au guide L’Autodiagnostic de la qualité du management* en
établissements de santé.
1.c. Les orientations stratégiques intègrent la réflexion sur la participation de
l’établissement aux réseaux de santé.
Le réseau de santé* a pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la
continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de
celles qui sont spécifiques à certaines populations (ex. : personnes âgées fragiles),
pathologies (ex. : pathologies neurologiques), ou activités* sanitaires
(ex. : intégration du service d’urgences au réseau hospitalier et de médecine de
ville).
1.d. La direction et les instances jouent pleinement leur rôle dans la définition et le
suivi des orientations stratégiques.
1.e. Les professionnels sont associés à l’élaboration des orientations stratégiques
qui sont connues de tous, y compris des professionnels correspondants exerçant
hors établissement.
Les correspondants sont les professionnels extérieurs, en lien régulier avec
l’établissement.
1.f. Les modalités de suivi, d’évaluation et d’ajustement des orientations
stratégiques sont prévues.
Référence 2
Les orientations stratégiques accordent une place primordiale à
la participation du patient et de son entourage.
2.a. Le respect des droits et de l’information du patient est inscrit dans les priorités
de l’établissement.
2.b. L’écoute du patient et de son entourage est organisée.
Lieux d’écoute, colloque singulier, recueil et gestion des commentaires et des
plaintes, identification* des soignants.
2.c. La prévention de la maltraitance* du patient est organisée.
2.d. Une réflexion éthique autour de la prise en charge du patient est favorisée.
Exemples de sujets d’éthique : conflits d’intérêt, activités promotionnelles, refus de

consentement, participation à des activités de recherche, affectation des
ressources, prise en charge des derniers moments de la vie, respect des choix du
patient en fin de vie, don d’organes.
Modalités de réponse : actions de formation, communication autour des problèmes
rencontrés, définition et mise en place de processus* d’enquête.
Modalités d’appréciation : décrire les principaux problèmes d’éthique et de
déontologie rencontrés au cours des deux dernières années, par exemple.
2.e. Les projets de recherche respectent les droits du patient.
2.f. Le don d’organe est favorisé.
Comment l’établissement a-t-il organisé la prise en compte du consentement
préalable, l’information du patient et de l’entourage, la formation des professionnels
à la demande de consentement, l’information sur les critères d’identification* des
candidats potentiels, la systématisation de la demande, le signalement
systématique des décès aux organismes concernés, les difficultés liées au don par
des donneurs vivants.
2.g. L’implication du patient et de son entourage est favorisée dans la planification,
le suivi, l’évaluation et l’amélioration des services rendus.
Actions de formation des patients, participation à divers comités dont notamment le
conseil d’administration, le CLIN, comités de patients, représentants des usagers,
etc.
Référence 3
L’établissement a défini une politique d’amélioration de la
qualité et de gestion des risques.
Cette politique vise à améliorer le service médical rendu au patient, la sécurité des
personnes, la satisfaction du patient et des autres parties prenantes, la satisfaction
des professionnels et l’efficience* de l’établissement.
Cette politique intègre les différents domaines de risque, cliniques et non cliniques.
3.a. Les priorités et les objectifs de l’établissement, en matière d’évaluation et
d’amélioration de la qualité, et de gestion des risques, sont définis au regard
des orientations stratégiques de l’établissement.
Cette définition repose sur l’analyse de la littérature, les enquêtes ou directives
nationales ou régionales, les résultats de recherche, le recueil de l’information
disponible définissant les meilleures pratiques, les études de satisfaction du patient
et des professionnels, etc.
3.b. Les professionnels sont associés à l’élaboration des priorités de l’établissement
en termes d’évaluation et d’amélioration de la qualité, et de gestion des risques,
et sont régulièrement informés.
3.c. Le développement d’une culture d’amélioration de la qualité et de gestion des
risques est favorisé.
Référence 4

Une politique du dossier du patient est définie collectivement
pour l’ensemble des secteurs d’activité*.
4.a. Le regroupement des informations concernant chaque patient est organisé.
4.b. La confidentialité* des dossiers et des informations concernant le patient est
assurée.
4.c. Les règles de gestion et de communication des dossiers du patient sont définies
et connues des professionnels concernés.
Ces règles concernent la tenue, le format, les délais, l’accès, les modalités de
conservation et de destruction.
4.d. Les instances s’assurent que l’évaluation périodique de la tenue du dossier est
réalisée.
B. QUALITE DU MANAGEMENT
Se référer au guide L’autodiagnostic de la qualité du management* en
établissements de santé.
Référence 5
La direction et les instances prévoient les évolutions en y
associant les acteurs concernés.
Référence 6
La direction et les instances organisent les missions et les
activités* de l’établissement en favorisant la prise de
responsabilité des acteurs.
Référence 7
La direction et les instances décident des actions à mettre en
œuvre en impliquant les acteurs concernés.
Référence 8
La direction et les instances motivent les acteurs en favorisant
leur adhésion et leur implication.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
1
/
45
100%