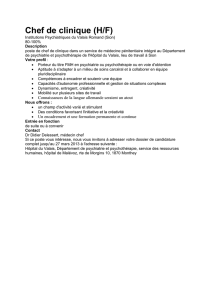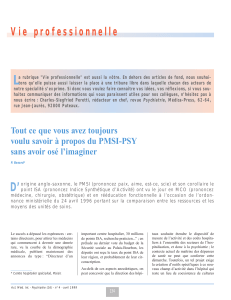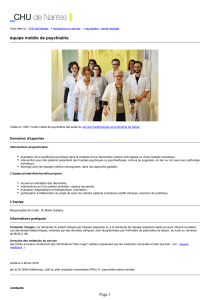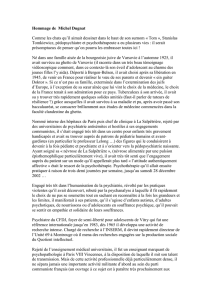Lire l'article complet

249
“Souvent, un philosophe se déclare pour
la vérité, sans la connaître. Il voit une opinion
qui, jusqu’à lui, a été abandonnée,
et il l’adopte, non parce qu’elle lui paraît
meilleure mais dans l’espérance
de devenir le chef d’une secte. En effet,
la nouveauté d’un système a presque toujours
été suffisante pour en assurer
le succès.”
Condillac (1)
La notion de qualité des soins n’est pas,
en soi, une préoccupation nouvelle pour
les équipes de soins en général et de santé
mentale en particulier. Dans le cadre de
la psychothérapie institutionnelle, dont
Philippe Kœchlin indiquait qu’elle per-
met “l’analyse permanente et collective
des opérateurs institutionnels”, l’ambition
de la démarche est l’amélioration continue
des éléments intervenant dans les disposi-
tifs de soins. Ainsi, nombre d’entre nous
faisaient, comme Monsieur Jourdain de la
prose, de la qualité sans le savoir.
Aujourd’hui, le concept revient sous une
forme particulière et selon des modalités
qui créent une ambiguïté, un flou, voire
une méfiance, dont il est difficile de se
déprendre, ce qui est pourtant nécessaire
si on souhaite intégrer ces nouveaux pro-
cessus, ces nouveaux concepts que sont
indicateurs, procédures, protocoles, ges-
tion de la qualité, définition des besoins et
surtout accréditation, préalable à la mise
en œuvre de toute démarche.
Vaincre les réticences
Genèse et ambiguïtés de la démarche
Vo lontariat ou obligation réglementée
Parmi les éléments qui concourent à créer
l’ambiguïté intervient la genèse même de
la procédure.
On sait que l’accréditation est venue
d’outre-Atlantique, du Canada, où elle
repose sur le volontariat. Ici, bien que le
questionnement sur ces démarches soit
plus ancien, elle s’intègre dans les ordon-
nances de 1996 qui ont pour visée de régle-
menter le domaine de la santé, et ce pour
des raisons essentiellement économiques.
Si on ne peut que comprendre, et accep-
ter, ce souci louable du politique de bien
gérer la santé dans toutes ses dimensions,
on peut se demander ce qu’il restera du
volontariat quand la démarche a un carac-
tère obligatoire et que ses résultats seront
transmis à l’Agence régionale de l’hospi-
talisation, dispensatrice des crédits.
Ve rs la certification des pratiques ?
Un autre élément contribue également à
créer la suspicion : c’est la crainte que,
comme dans l’industrie d’où la
démarche/qualité est d’ailleurs issue, elle
ne conduise à des procédures de certifica-
tion qui sont déjà à l’œuvre, par exemple,
dans les services de restauration de nos
hôpitaux.
L’évaluation des pratiques de soins
concerne naturellement ces pratiques
elles-mêmes ainsi que les pratiques pro-
fessionnelles spécifiques. Mais cette
notion d’évaluation, associée aux Réfé-
rences médicales opposables ou aux
recommandations édictées par l’ANAES,
laisse, au mieux, dubitatif : y aura-t-il à
terme une certification des professionnels,
une création de normes qui viendraient
régir et réglementer l’ensemble du pro-
cessus diagnostique et thérapeutique ?
Vise-t-on l’homéostasie ?
Dans ces conditions, tout ce dispositif
Selon l’OMS, la qualité est
“une démarche qui doit per-
mettre de garantir à chaque
patient l’assortiment d’actes dia-
gnostiques et thérapeutiques qui
lui assureront le meilleur résul-
tat en termes de santé, confor-
mément à l’état actuel de la
science médicale, au meilleur
coût pour un même résultat, au
moindre risque iatrogène et pour
sa plus grande satisfaction en
termes de procédures, de résul-
tats et de contacts humains à l’in-
térieur du système de soins.” En
prenant au mot l'ANAES (valori-
sez ce qui fonctionne et faites
participer tout le monde à l’amé-
lioration de ce qui doit l’être,
selon vos propres critères et sans
abuser des protocoles et autres
procédures), quelles interroga-
tions suscite une telle démarche
quand elle est engagée dans nos
établissements ?
* Praticien hospitalier,
CHS du Bon-Sauveur, Saint-Lô.
les mots et
Les mots et les hommes
La tentation de Procuste : subversion du sujet, la démarche-qualité,
et dialectique d’un désir, soutenir le travail institutionnel
et la psychiatrie de secteur
P. Alary*
ACTUALITÉ PSY SEPTEMBRE 05/08/02 12:02 Page 249

les mots et
Les mots et les hommes
250
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 7, septembre 2000
viserait-il autre chose qu’une homéostasie
du système soignant, homéostasie obses-
sionnelle évitant toute confrontation pul-
sionnelle dans l’espace qui nous intéresse,
les mouvements subjectifs et la singula-
rité de la différence ? Rappelons, pour
mieux les repérer, quelques symptômes
obsessionnels (2) :idée obsédante (manie
de la perfection, de la vérification, tendance
à la répétition), compulsion, rite conjuratoire
(suite d’obligations, d’interdictions, de régle-
mentations et de ritualisation), soumission à
l’autorité, angoisse devant la séparation et le
manque…
Si le but est de créer des processus asepti-
sés, uniformes plus qu’homogènes, on com-
prendra que la réticence se transformera
alors vite en résistance. Ce terme est entendu
ici dans son acception psychanalytique,
c’est-à-dire en obstacle au déroulement du
processus lui-même, cette résistance s’op-
posant à l’émergence collective des pro-
blèmes effectifs qu’il faudrait régler, tuant
dans l’œuf la démarche et son ambition qui
sont d’améliorer le dispositif de soins.
Dans cette hypothèse doit être évoqué le
risque non négligeable de dérive bureaucra-
tique que souligne Jean-Claude Pénochet (3),
l’homéostasie trouvant refuge dans “le foi-
sonnement de procédures trop détaillées et
non pertinentes contraires à la règle d’or du
management de la qualité : montrer la néces-
sité du changement au lieu de l’imposer”.
Normes et processus psychiques
L’ existence même de normes fait poser la
question de leur ajustement aux mouve-
ments psychiques qui sont, par définition,
en constante adaptation. On sait, en l’occur-
rence, comme il est difficile de faire émer-
ger les positions inconscientes, qu’elles
soient individuelles ou collectives. Mais
cette difficulté est le préalable à l’affirma-
tion de positions subjectives, souci de toute
équipe de santé mentale.
Les principes de base
de la psychiatrie de secteur
Or, la psychothérapie institutionnelle a été
conçue par ses fondateurs comme un
moyen pour chacun, soignant ou soigné,
de savoir “où il en est de sa folie”. Cela
permet la “construction d’un instrument
continuel de transformation avec ses
caractéristiques de structure, de définition,
de médiateur relationnel. Avec une struc-
turation de l’espace et du temps et cette
mainmise indispensable sur le gestionnel
et l’économique (4)”.
On retrouve dans ces principes fonda-
mentaux un certain nombre d’éléments qui
pourraient être visés par la démarche/qua-
lité et la procédure d’accréditation. On en
rappellera quelques-uns :
– le respect de l’éthique professionnelle,
qui place réellement le patient au cœur de
notre dispositif de soins ;
– l’affirmation de la nécessité de l’exis-
tence des secteurs comme base de la psy-
chiatrie publique, le dispositif sectoriel
garantissant la continuité des soins, la
mobilisation de tous les acteurs du secteur,
la proximité des soins ;
– la juste évaluation des besoins de la
population en matière de santé mentale, de
la qualité des soins que nous délivrons à
nos patients et des moyens à mettre en
œuvre pour répondre à ces besoins et assu-
rer effectivement cette qualité des soins ;
– favoriser l’accès aux soins des plus
démunis qui en sont souvent les moins
demandeurs ;
– la prise en charge et le traitement de la
maladie mentale dans ses formes fonda-
mentales que sont la psychose, les troubles
de l’humeur et les névroses graves, dans
leur expression la plus sévère et la plus
invalidante, c’est-à-dire la plus préjudi-
ciable à nos patients et à leurs proches ;
– la déstigmatisation de la maladie men-
tale ;
– la coopération dans tous les domaines
où elle est possible avec les autres acteurs
du soin, les membres du réseau. Cette
coopération doit respecter les limites de
notre champ de compétences, qui est prio-
ritairement celui du soin et de la préven-
tion, et celles de nos partenaires.
De plus, en psychiatrie, les hommes sont
importants et constituent notre plateau
technique : quand nous parlons de moyens
et de qualité des soins, c’est donc en pre-
mier lieu à eux que l’on doit penser. Or,
force est de constater que, même si la visée
officielle de ces nouvelles démarches est
de mettre l’homme au centre du disposi-
tif, le sentiment que nous avons souvent
est que la place est prise par l’administra-
tion ou la bureaucratie.
Mise en route de la démarche
Des méthodes chronophages
Le temps qu’il reste
Le premier constat, quand on entreprend
une démarche d’amélioration continue
de la qualité, est celui de son caractère
chronophage. De ce point de vue,
nombre de paradoxes ne sont pas éluci-
dés :
– le temps consacré à l’élaboration et à
la mise en place de procédures, pour peu
que l’on souhaite que celles-ci soient
acceptées par tous, est de plus en plus
important ;
– cette remarque concerne en premier
lieu les procédures garantissant la sécu-
rité des personnes et des biens qui ont un
caractère impératif ;
– le temps passé à remplir des formu-
laires, des protocoles, à répondre aux
questions de nos confrères contrôleurs de
la CPAM, à rédiger des rapports va éga-
lement croissant. On sait que l’écrit est le
seul document opposable : il faut y atta-
cher le plus grand prix. Aujourd’hui, un
coup de téléphone pour régler un pro-
blème ne suffit plus, il faut qu’il en existe
une trace écrite. Or, dans le PMSI que
l’on nous annonce pour 2001 ou 2002, où
sont les éléments de quantification de ce
temps qui est loin d’être interstitiel ?
ACTUALITÉ PSY SEPTEMBRE 05/08/02 12:02 Page 250

251
– ces différents documents, ces données
codées, ces résumés standardisés de sor-
tie, ces classifications, CIM X ou DSM IV
ne sont que des modes de représentation
de nos réalités cliniques et thérapeutiques.
Pourtant, c’est sur cette illusion de notre
réalité quotidienne que vont s’appuyer
nombre de décisions ;
– que deviennent les rapports annuels de
secteur, qui décrivent l’augmentation des
files actives sans que personne ne s’in-
terroge sur le temps passé par les prati-
ciens, les secrétaires, les infirmiers, à
mettre en forme ces évaluations ?
– ce temps ne serait-il pas mieux utilisé à
soulager la souffrance des patients, celle-
ci devant de plus en plus être “objectivée”
par des échelles appropriées…
Qui nous donnera le temps ?
Les Grecs différenciaient Kronos, père
d’un âge d’or pour les hommes qui dévo-
rait ses enfants, et Khronos, le temps. Qui
jouera le rôle de Rhéa, substituant aux
enfants de Saturne des cailloux et redon-
nant à ceux qui œuvrent dans la dimen-
sion du soin le temps qui leur est de plus
en plus compté ?
Sera-ce l’ARH, à l’heure où l’écono-
mique et la démarche qualité sont plus
intimement liés qu’on ne veut bien le dire.
Le temps investi
L’accréditation est une procédure qui vise
à apprécier et à améliorer la qualité des
soins. Elle doit permettre un diagnostic
objectif de l’état des lieux et la recon-
naissance externe du niveau de qualité des
soins dans les établissements de santé en
favorisant la confiance du public.
Le temps consacré par un établissement à
la démarche/qualité sera considérable.
Il faut informer largement et quasi exhaus-
tivement sur la démarche, permettre à cha-
cun de s’approprier ces nouveaux
concepts, en particulier ceux du manuel
d’accréditation, base de l’autoévaluation.
Le processus suppose la constitution d’un
comité de pilotage, où chacun pourra se
sentir réellement représenté, y compris les
acteurs très éloignés du soin que sont les
personnels des services généraux ou de
l’administration, et la mise en place de for-
mations diverses.
Il est indispensable de s’assurer que les
ressources dont l’établissement dispose
pour conduire l’ensemble de la démarche
sont bien à la mesure des ambitions que
suppose cette démarche.
Une évaluation interne devra précéder la
mise en place de démarches/qualité. Il fau-
dra construire des instruments de mesure,
puisqu’il n’y a pas d’évaluation sans
mesure, déterminer des indicateurs de qua-
lité, puisqu’ils sont censés être internes,
propres à l’établissement et adaptés au
contexte et aux problèmes à résoudre. Ces
indicateurs permettront de piloter les
actions d’amélioration de la qualité et
d’évaluer leur suivi. Il faudra encore déter-
miner la méthodologie de l’autoévaluation,
faire une synthèse du travail de toutes les
équipes.
Il faudra enfin conduire des démarches/qua-
lité qui supposeront, comme le rappelle
Jean-Claude Pénochet (3), “le changement
de pratiques bien ancrées, touchant un grand
nombre d’acteurs et constituant, même s’il
produit des dysfonctionnements, un sys-
tème équilibré”.
Il faudra, en particulier, veiller à éviter “l’im-
mobilisme et la multiplication du développe-
ment de procédures formelles qui ne portent
pas sur l’essentiel, le risque non négligeable
d’hypertrophie du sommet stratégique, hyper-
trophie qui provoque immanquablement l’ap-
parition d’une résistance aux décisions”.
Le pari est que l’on aboutisse, au cours de
ce long processus, à du temps gagné, à une
période d’ouverture et de dialogue, à un tra-
vail collectif d’échanges qui soit une occa-
sion d’informations et de transparence. Cela
permettra alors de mettre en valeur ce qui
fonctionne, d’ouvrir un temps de réflexion
et de critique positive, le tout portant sur
l’ensemble des activités de l’établissement.
Quelles références ? Quel savoir ?
L’une des autres questions posées par cette
démarche est celle de ses références, en par-
ticulier au savoir. Au nom de quel savoir,
concept mouvant, constamment réélaboré,
proposer des critères qui permettront d’éva-
luer la démarche ?
Le savoir, disait Michel Foucault dans
l’Archéologie du savoir, c’est “l’espace dans
lequel le sujet peut prendre position pour
parler des objets auxquels il a affaire dans
son discours… C’est aussi le champ de
coordination et de subordination des énon-
cés où les concepts apparaissent, se défi-
nissent, s’appliquent et se transforment”.
Platon décrivait deux dimensions au savoir,
dimensions en constant rapport dialectique :
la “technê”, savoir théorique, et la “phrenê-
sis”, savoir pratique. Le discours clinique
comporte aussi ces deux dimensions et ce
même mouvement dialectique, qu’il
s’agisse du discours médical, infirmier ou
psychothérapique.
Savoir et désir
Le psychiatre sait que le savoir et le désir
ont partie liée. Quel désir sous-tend notre
démarche, s’il est bien vrai qu’il ne s’agit
pas seulement de demande, toujours à repro-
duire, ou de besoin, toujours à satisfaire, ce
que l’on peut craindre… ?
Socrate disait à Agaton (5) : “Cet homme
donc, comme tous ceux qui désirent, désire
ce qui n’est pas actuel ou présent ; ce qu’on
n’est pas, ce qu’on n’a pas, ce dont on
manque, voilà les objets du désir et de
l’amour.” Quoi que l’on produise, il man-
quera toujours quelque chose : le risque zéro
n’existe pas, la mort finira toujours par
intervenir.
La place de la parole
Reste à énoncer ce savoir. La parole doit
être prudente si l’on en croit Lao-Tseu (6) :
“Celui qui sait ne parle pas.
Celui qui parle ne sait pas.”
En psychiatrie, la parole a une place cen-
trale. Comme les Indiens, nous passons
les mots et
Les mots et les hommes
ACTUALITÉ PSY SEPTEMBRE 05/08/02 12:02 Page 251

les mots et
Les mots et les hommes
252
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) n° 7, septembre 2000
beaucoup de temps en palabres et en
silences. Ces temps sont essentiels, struc-
turants, tant du point de vue individuel que
de l’institution. Ils permettent l’émergence
de positions subjectives et intersubjectives
qui conditionnent le soin.
Mais l’émergence de cette parole suppose
un cadre. Quelle que soit la qualité des
prestations proposées, il faudra, pour
qu’émerge un Sujet du manque, un déca-
lage par rapport à un idéal supposé, les
normes, ainsi qu’un refus et une distance
par rapport à la toute-puissance d’une
hypothétique perfection thérapeutique.
Cette émergence d’un Sujet est la finalité
du soin. Sortir de l’aliénation, rendre à une
personne les rênes de sa propre vie, c’est
au fond ce que Condillac proposait dans
sa dissertation sur les libertés (7) : “La
liberté consiste dans des déterminations
qui sont une suite des libérations que nous
avons faites, ou que nous avons eu le pou-
voir de faire. Confiez la conduite d’un
vaisseau à un homme qui n’a aucune
connaissance de la navigation, le vaisseau
sera le jouet des vagues. Mais un pilote
habile en saura suspendre, arrêter la
course, avec un même vent, il en saura
varier la direction ; et ce n’est que dans la
tempête que le gouvernail cessera d’obéir
à sa main.”
Éloge de l’ignorance et de l’erreur
Il nous faut aussi travailler avec l’igno-
rance qui, plus qu’on ne le croit, est
féconde et facteur de progrès. Jankélévitch
(8) nous le rappelle : “Non seulement la
méconnaissance n’est pas, comme on
serait tenté de le croire, une connaissance
incomplète et trouée de lacunes, mais il se
pourrait bien que la méconnaissance fût
paradoxalement, du moins dans certains
cas, une connaissance tout à fait complète,
un savoir auquel il ne manque absolument
rien.”
L’ignorance, en institution, au sens analy-
tique rappelé par Lacan (9), est non pas
“absence de savoir mais à l’égard de
l’amour et de la haine, comme une passion
de l’être”. Elle conduit à ce que la soif de
savoir est “subtile et aveugle comme le
montre le destin d’Œdipe, passion où s’est
réfugié le désir de l’homme”. Cette soif
de savoir, comme le montre Freud chez
Léonard de Vinci (10), “possède toutes les
caractéristiques de la passion (ténacité,
continuité et pénétration), absorbant le
reste”. L’activité d’investigation est en
revanche “à l’origine de toutes les inhibi-
tions et les subit”, si on suit Freud. Si la
pulsion d’investigation ne se limite pas à
une sublimation des pulsions sexuelles
inhibées, “le désir de savoir trouvera une
heureuse issue, ce qui passe par la recon-
naissance de la réalité”. Cette reconnais-
sance de la réalité, dans l’institution et
pour l’institution, c’est le but principal que
l’on peut assigner à la démarche, pour peu
qu’elle soit clairement repérée par l’en-
semble des partenaires.
Toutefois, il n’est pas assuré que cette
reconnaissance doive viser à l’exhaus-
tivité : “Henry James disait que si vous
décrivez une maison trop complètement,
trop concrètement, objectivement, solide-
ment, dans le moindre détail, il devient
alors impossible pour l’imagination de
concevoir ce qui pourrait bien y survenir
(11).”
Science sans conscience… Comment
définir des références, point essentiel
en matière d’accréditation ?
L’une des discussions va donc porter sur
la définition des références, concept
essentiel en matière d’accréditation. La
référence est censée donner un cadre et des
critères permettant de relever, par l’obser-
vation, d’analyser et de hiérarchiser des
faits. Mais, dès qu’il s’agit d’analyser des
faits, on retrouve ce que René Thom consi-
dère comme le divorce entre la science et
la philosophie : “Se limiter aux faits ne
peut qu’amener à l’accumulation de
connaissances dépourvues de toute orga-
nisation interne, une connaissance chao-
tique et anarchique… Si l’on veut organi-
ser les données de l’expérience, il faut
nécessairement procéder d’une manière
plus théorique (12).”
Ne pourrait-on proposer ici l’instrument
théorique de la psychothérapie institu-
tionnelle dont notre expérience est theory-
laden, imprégnée de théorie ?
Jusqu’où définir ?
Pour prendre un exemple, si l’on se réfère
au manuel d’accréditation, il est nécessaire
de définir des profils de poste, puisque le
“recrutement doit en tenir compte et don-
ner lieu à une vérification des conditions
d’exercice.”
Dans un album célèbre de Lucky Luke
(13), le héros rencontre l’inénarrable
pilote de la Daisy Belle, Ned, et Sam, “le
meilleur verseur de café du Mississipi et
du Missouri réunis”. Ce que le visiteur
Lucky Luke peut vérifier, c’est que le pro-
fil de poste de Sam est souple, simple,
adaptatif, et que la Daisy Belle est plutôt
un steamer qui avance, malgré les traque-
nards et les embûches…
Existe-t-il alors plus parfait et plus concis
profil de poste que celui de Sam : “Café
Boss… Yes Sam” ?
Évaluation et dispositifs
La démarche/qualité, l’accréditation, sup-
posent que l’on puisse évaluer.
De plus, cette évaluation est censée être
vérifiable. Or, “vérifier un fait, pour la
science, c’est retrouver dans une intuition,
en dernier ressort sensible, un abstrait
exprimé dans un énoncé (14)”.
Dans l’état actuel de la démarche, on peut
penser que le manuel d’accréditation est sus-
ceptible d’évoluer dans un sens qui n’est pas
nécessairement défavorable à nos préoccu-
pations de terrain et qui prenne en compte
les spécificités de la psychiatrie hospitalière.
Mais, de ce point de vue, rien n’est assuré,
puisqu’il existe, au sein même de l’ANAES,
un département visant à mettre en place des
protocoles, protocoles qui pourraient avoir,
à terme, un caractère obligatoire auquel il
serait impossible de se soustraire.
ACTUALITÉ PSY SEPTEMBRE 05/08/02 12:02 Page 252

253
On pensera en particulier aux dispositifs
touchant à la mise en chambre d’isole-
ment. La régulière surveillance par un
médecin des patients isolés suppose préa-
lablement que les médecins existent en
nombre suffisant pour assurer cette sur-
veillance. Le protocole ne prévoit pas que
le nombre de médecins doive être adapté
aux nécessités de l’isolement. Faudra-t-il
alors renoncer à tout dispositif d’isolement
et, par là même, s’exposer à la violence du
patient contre lui-même, contre les autres
patients ou le personnel, mettant ainsi en
danger la sécurité de l’ensemble du dis-
positif de soins ?
Les écueils
La mise en chambre d’isolement est donc
l’objet de recommandations. Dans notre
expérience, deux simples principes ont
permis la mise en place, de manière infor-
melle et sans protocole écrit, d’une série
d’actions qui répondent, a posteriori, aux
recommandations de l’ANAES :
– l’isolement est l’un des dispositifs du
soin prescrits par le médecin ;
– même dans les moments où c’est le plus
difficile, le respect de la dignité du
patient est primordial.
Faut-il formaliser plus avant et mettre en
place une procédure “MCI” qui, du
simple fait de son existence, risque de
rigidifier le dispositif actuel, souple et
évolutif, y compris au regard de la régle-
mentation qu’il respecte scrupuleuse-
ment ? Ne risque-t-on pas plutôt de déres-
ponsabiliser les équipes et d’arriver à un
“simulacre de qualité creusant l’écart
entre le discours et la pratique (3)” ? Ou
faut-il continuer de faire appel à la res-
ponsabilité, aux capacités d’initiative et
de création des soignants ?
De la procédure au procès
Il faut introduire ici un autre tiers, le juge.
Le “non-respect” d’un protocole non
rédigé, d’un “processus non maîtrisé”,
expose au procès, à la plainte. On sait vers
quels excès cela conduit outre-Atlantique.
Faudra-t-il, par crainte des complications
médico-légales et des effets secondaires
adversifs judiciaires, renoncer aux effets
primaires pourtant positifs d’actions ou de
traitements ? Et quelles garanties, en
matière de qualité de soins, nous apporte-
rait une hypertrophie bureaucratique pro-
duite par la crainte de ce tiers ?
Des indicateurs à foison
De la même manière, pour piloter la
démarche/qualité, faudra-t-il multiplier les
indicateurs, au motif qu’il faut disposer
d’un tableau de bord complet, et ainsi
prendre le risque d’un pseudo bon fonc-
tionnement qui viserait non à améliorer la
qualité, mais les constantes du tableau de
bord ?
Un cahier des charges complet et des
contrôles qualité performants, on les
connaît dans l’automobile. Les voitures
sont aujourd’hui plus sûres, plus perfor-
mantes, plus rapides, moins chères… mais
toutes semblables. Dans cet éternel jeu de
la bobine, faut-il opter pour la répétition
du même qui crée l’illusion de la maîtrise
et de la sécurité ?
L’homéostasie, c’est en fait un non-chan-
gement, et, avec la pulsion de mort à
l’œuvre, c’est donc l’opposé de la qualité.
L’élargissement des missions
Sommes-nous toujours compétents ?
Aujourd’hui, et non sans crainte pour
l’avenir, nous voyons s’accroître nos mis-
sions de manière inversement proportion-
nelle à la courbe des praticiens. Nous inter-
venons ainsi de plus en plus dans des
domaines dans lesquels nous n’avons reçu
aucune formation, gestion, administration,
management, réglementation… au détri-
ment de ceux que nous avons choisis, aux-
quels nous avons été formés et dans les-
quels nous sommes censés être “per-
formants”, puisque notre monde est celui
de la performance.
Quelles conséquences sur la qualité des
soins ?
Nous sommes aussi appelés, mais il est
vrai que nous y avons prêté la main, à
intervenir dans le domaine de la préven-
tion, du “réseau”, avec les ambiguïtés de
ces concepts et de leurs applications qu’il
convient, là aussi, de formaliser. Allons-
nous devenir des pompiers ou des tra-
vailleurs sociaux, dont les actes seraient
ainsi plus faciles à évaluer et à contrôler ?
Bref, si ces nouvelles missions, éloignées
du registre du soin, entrent dans nos
domaines d’intervention, de quel temps
disposerons-nous pour les accomplir en
plus de nos tâches actuelles, et seront-elles
prises en compte dans les “évaluations des
pratiques de soins” ?
Enfin, y aura-t-il assez de praticiens pour
les rendre effectives ?
Le patient au cœur
du dispositif
Il n’est probablement pas inutile ici de rap-
peler la vocation de tout soignant, quelle
que soit sa position dans la hiérarchie du
soin : “La vie de l’homme est sujette à tant
de sortes de maux, d’infortunes et de tra-
vers qu’il serait presque toujours consumé
d’ennui et de déplaisir si personne n’était
sensible à ses peines et ne prenait soin de
les adoucir : la providence a pourvu à son
soulagement d’une manière admirable par
les différentes liaisons qu’elle a établies
entre les hommes… (15)”
Cette réflexion, qui n’est pas d’aujour-
d’hui, est un repère éthique auquel nous
devons référer nos actions.
Le contrat de soins
Le patient doit être placé au cœur du dispo-
sitif de soins. Mais de qui s’agit-il en fait ?
les mots et
Les mots et les hommes
ACTUALITÉ PSY SEPTEMBRE 05/08/02 12:02 Page 253
 6
6
 7
7
1
/
7
100%