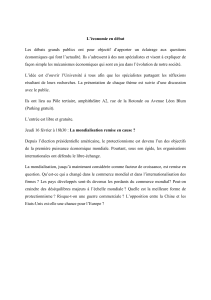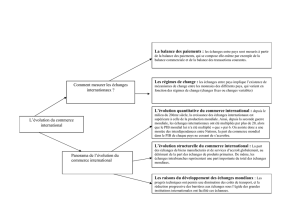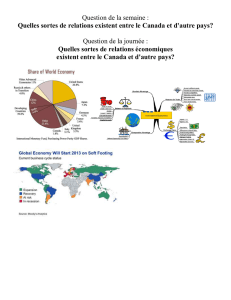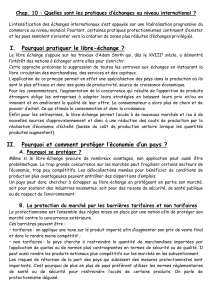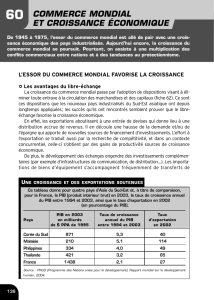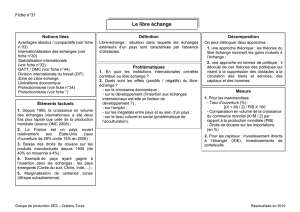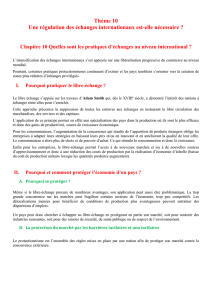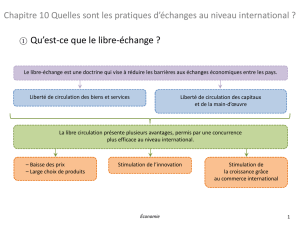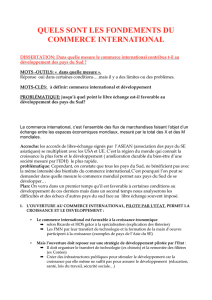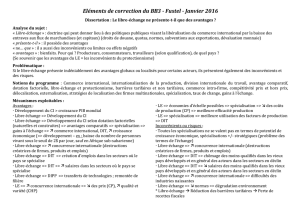Les fondements des échanges internationaux

www.fr.wikipedia.org/wiki/acceuil
(rubrique société)
39
@
INTERNET
Les fondements
des échanges
internationaux
I Le libre-échange
A. Les théories traditionnelles du commerce international
B. Les nouvelles théories du commerce international
C. Le libre-échange en débat
II Le protectionnisme
A. Les instruments du protectionnisme
B. La justification du protectionnisme
C. Les coûts du protectionnisme
Chapitre 2
D
epuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ouverture des économies
aux échanges internationaux s’est accompagnée d’une phase de
croissance économique sans précédent. Les faits semblent ainsi vérifier
les effets positifs quant au bien-être mis en avant par les théoriciens
du libre-échange.
Ces auteurs vont fournir diverses explications complémentaires
sur l’intérêt de la spécialisation et ses effets sur l’économie mondiale.
Pourtant, malgré de nettes avancées, le libre-échange n’est pas encore
une pratique totalement généralisée, même parmi les pays les plus
libéraux comme les États-Unis.
Le protectionnisme a été et reste préconisé par d’autres auteurs.
Il est généralement présenté comme un moyen nécessaire à la mise
en place d’une politique de développement dans les pays du tiers-monde
ou à la reconversion de secteurs industriels dans les pays développés.
De nombreuses controverses subsistent sur les avantages et
les inconvénients respectifs de ces deux politiques.

Les fondements des échanges internationauxChapitre 2 40
1. Quel est l’avantage reconnu
au libre-échange ?
2. Bénéficie-t-il à tous les pays
de manière identique ?
3. Des freins au libre-échange
existent-ils toujours ?
Le libre-échange
Le libre-échange est une doctrine économique qui préconise la liberté
des échanges internationaux de biens, de services et de capitaux. Il
s’oppose donc à toutes formes d’entraves qui limiteraient le commerce
international. Selon cette théorie, la spécialisation qui en résulte per-
met aux différents pays d’être plus efficients et contribue à la richesse
des nations.
A Les théories traditionnelles du commerce international
Ces théories considèrent que les nations se spécialisent dans
les productions pour lesquelles les coûts sont les plus bas.
La division internationale du travail qui en résulte permet
de parvenir à une situation optimale.
1. La théorie des avantages absolus (A. Smith)
Les avantages de la spécialisation et de l’échange international ont été mis
en évidence à la fin du
XVIII
esiècle par Adam Smith (1723-1790), auteur
classique anglais. Il fonde son analyse sur les avantages absolus de coût
qu’un pays peut posséder sur un autre pays :
–Un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour
lesquels ses coûts de fabrication sont plus faibles qu’à l’étranger et à
importer ceux pour lesquels ses coûts sont plus élevés.
– Cette spécialisation permet la réalisation d’une production mondiale opti-
male puisque les biens sont produits là où les coûts sont les plus bas, et
met en place une division internationale du travail (DIT) entre les diffé-
rentes nations.
La théorie des avantages absolus comporte cependant un inconvénient
majeur : comment un pays dont les coûts de production sont plus élevés
pour tous les biens peut-il commercer ?
2. La théorie des avantages comparatifs (D. Ricardo)
Un autre économiste anglais, David Ricardo (1772-1823), complète la
théorie de Adam Smith :
–Un pays a toujours intérêt à se spécialiser dans la production pour
laquelle il possède un avantage relatif, c’est-à-dire un avantage le plus
élevé en termes de coût ou un désavantage le moins élevé.
– La spécialisation et le commerce international sont expliqués par des coûts
et donc des techniques de production différentes.
– Les nations obtiennent, grâce à l’échange international, une quantité de
biens plus importante que celle dont elles disposaient sans échange. Elles
bénéficient ainsi d’un gain de bien-être.
3. La théorie des dotations de facteurs (Heckscher et Ohlin)
Deux auteurs suédois, Eli Heckscher (1919) et Bertil Ohlin (1930), pour-
suivant la théorie ricardienne, ont cherché à expliquer la configuration
des échanges.
Selon eux, les avantages comparatifs ne proviennent pas uniquement de la
productivité du travail mais de l’ensemble des facteurs de production
(capital, terres, ressources minérales) dont dispose un pays.
Les Canadiens exportent, par exemple, des produits forestiers vers les États-
Unis, non parce que les bûcherons canadiens sont plus efficaces que les bûche-
rons américains, mais parce que le Canada est richement doté en ressources
forestières.
CP
1
I
David Ricardo
(1772-1823)
Économiste classique anglais,
auteur Des principes de l’économie
politique et de l’impôt (1817).
Théoricien de l’économie de
marché, il développe les travaux
de son prédécesseur, Adam Smith.
Sa théorie de l’échange
international demeure
le pilier du libre-échangisme.
En écho à la fameuse «main
invisible» de Smith, il écrivait :
«Dans un système de parfaite liberté
du commerce, chaque pays consacre
naturellement son capital et son
travail aux emplois qui lui sont
le plus avantageux. La recherche
de son avantage propre s’accorde
admirablement avec le bien
universel.»
1
© Rue des Archives.

Les relations économiques internationalesPartie I41
Les coûts comparatifs
Pour démontrer sa théorie, D. Ricardo présente la situation
suivante qui exprime les conditions de production de deux produits
– le vin et le drap – par deux pays – le Portugal et l’Angleterre :
•
Le Portugal a besoin de 80 heures de travail pour produire une unité
de vin et de 90 heures pour fabriquer une unité de drap.
•
L’Angleterre a besoin de 120 heures de travail pour produire une unité
de vin et de 100 heures pour fabriquer une unité de drap.
PRATIQUE
1. Montrez que la théorie des avantages absolus ne
peut être explicative d’échanges internationaux
dans le cas présent.
2. Calculez le coût total de production d’une unité
de vin et de drap pour chacun des pays, puis le
coût total pour les deux pays, dans l’hypothèse
d’une absence de spécialisation et d’échanges.
3. Expliquez pourquoi le Portugal va se spécialiser
dans le vin et l’Angleterre dans le drap.
4. Calculez le coût total de production de deux
unités de vin par le Portugal et de deux unités
de drap par l’Angleterre, puis le coût total
pour les deux pays dans l’hypothèse d’une
spécialisation et d’échanges internationaux.
5. Déduisez de ces calculs les gains que permet
l’échange international.
6. Comment ces gains peuvent-ils se répartir
entre les deux pays ?
Production Production
d’une unité de vin d’une unité de drap
Portugal 80 heures de travail 90 heures de travail
Angleterre 120 heures de travail 100 heures de travail
La problématique du libre-échange
L’essor des échanges internationaux ces vingt dernières
années, deux fois plus rapide que celui du PIB mondial
réel (6 % contre 3 %), a accéléré l’intégration économique
et relevé les niveaux de vie. Beaucoup de pays en dévelop-
pement ont pris part à ce processus, qui leur a permis de
resserrer l’écart qui les sépare des pays riches et de devenir,
en tant que groupe, un acteur important du commerce
mondial. Leurs échanges ont augmenté plus vite que ceux
des autres groupes et leurs relations commerciales ont
profondément changé par rapport au schéma traditionnel
Nord-Sud.
Ils assurent désormais près d’un tiers du commerce mon-
dial, beaucoup d’entre eux ont fortement accru leurs
exportations de produits manufacturés et de services, et
40 % de leurs exportations vont aujourd’hui à d’autres
pays en développement. Toutefois, bon nombre de pays à
faible revenu n’ont toujours pas intégré l’économie mon-
diale – sous l’effet conjugué de contraintes externes et
internes – et les plus pauvres d’entre eux ont même vu
leur part des échanges mondiaux diminuer. En dépit de
cet acquis, le système commercial mondial doit encore
relever de formidables défis.
Premièrement… la protection restera
élevée et concentrée sur des domaines qui
présentent un intérêt particulier pour les
pays en développement. Dans l’agriculture,
seuls des progrès limités ont été accomplis
dans la réduction des droits élevés et des
subventions qui faussent les échanges.
Deuxièmement, suite aux progrès de l’in-
tégration économique et au recul des tarifs
douaniers et des restrictions quantitatives à
l’importation, l’attention s’est déplacée vers
d’autres obstacles au commerce qui tou-
chent aux politiques nationales, tels que les
subventions industrielles, les droits de la
propriété intellectuelle ou, plus récemment,
l’investissement et la politique de la concur-
rence. ■
Anne MCGUIRK, « Le programme de Doha »,
Finances et développement, septembre 2002.
[
Le commerce a été un moteur
de la croissance au cours
du demi-siècle écoulé…
]
1

Les fondements des échanges internationauxChapitre 2 42
1. Que signifie « avoir des dotations
factorielles peu différentes » ?
2. Définissez les notions de commerce
international interbranche
et intrabranche.
3. Relevez et expliquez les phénomènes
économiques qui ne sont pas pris en
compte par les théories traditionnelles
du commerce international.
1. Définissez la notion d’économie
d’échelle et illustrez-la en recourant
au tableau ci-contre.
2. Expliquez le mécanisme qui permet
une amélioration du bien-être par
le biais des échanges internationaux.
3. En supposant qu’en autarcie les
niveaux de production nationaux,
compte tenu du marché intérieur,
soient de 5 gadgets pour la
Grande-Bretagne et de 10 gadgets
pour les États-Unis, décrivez
le mécanisme qui se mettra en œuvre
en cas d’ouverture des frontières.
Les pays vont se spécialiser et exporter des produits qui nécessitent des
facteurs de production relativement abondants chez eux (et donc peu
coûteux) et importer des produits recourant à des facteurs de production
relativement rares (et donc onéreux).
B Les nouvelles théories du commerce international
Ces nouvelles théories se démarquent des théories traditionnelles
et cherchent à expliquer les échanges de produits similaires
entre les pays. L’existence d’économies d’échelle et la recherche
de différenciation de firmes oligopolistiques, l’unification croissante
du marché mondial et les stratégies des firmes multinationales
en sont les déterminants principaux.
Il apparaît de plus en plus que les théories traditionnelles sont incapables
d’expliquer les caractéristiques du commerce international actuel.
En particulier, la théorie des coûts comparatifs est explicative des échanges
dits « interbranches » alors qu’aujourd’hui, plus de la moitié des échanges
sont « intrabranches ».
À la suite de nombreux autres auteurs, Paul R. Krugman met particulièrement
l’accent sur les économies d’échelle et la différenciation des produits pour
expliquer ces échanges.
1. Économies d’échelle et commerce international
Les économies d’échelle (ou rendements croissants) expriment une réduction
du coût moyen du produit lorsque la quantité fabriquée augmente.
Les firmes les plus efficaces dans un type de production ont donc intérêt
à se spécialiser, à accroître leur volume de production pour réduire leur
coût. Elles se trouvent alors plus compétitives et peuvent exporter leur
production.
À terme, seules les plus grosses firmes resteront efficientes et formeront un
marché mondial oligopolistique.
2. Marchés oligopolistiques et différenciation des produits
Sur ces marchés oligopolistiques, les firmes cherchent à différencier leurs
produits pour bénéficier d’une situation de monopole. De la sorte, des pro-
duits de variétés différentes peuvent être proposés aux consommateurs et
font l’objet d’échanges intrabranches : certains consommateurs français achè-
teront des véhicules Renault mais d’autres préféreront Fiat ou BMW… ; des
consommateurs italiens ou allemands achèteront des véhicules Peugeot…
3. La stratégie des firmes multinationales
L’influence des firmes multinationales est absente des analyses tradition-
nelles du commerce international.
Or, le développement des firmes multinationales a un impact important sur
les échanges internationaux en générant des flux déterminés par les stratégies
mises en œuvre :
– Lorsqu’il s’agit d’assurer une présence sur les marchés étrangers,
l’implantation d’une firme aura pour effet de réduire les flux d’échanges
internationaux initiaux (production sur place et réduction des exportations
du pays d’origine).
– Toutefois, aujourd’hui, les échanges entre les filiales de groupes multi-
nationaux représentent plus du tiers du commerce mondial. Les raisons sont
multiples : taux d’imposition différents selon les pays, spécialisation des
filiales, coût de la main-d’œuvre, etc.
2
3
2
4
méthodo
3

Les relations économiques internationalesPartie I43
Les insuffisances des
théories traditionnelles
◗Contrairement aux enseignements de la théorie tradi-
tionnelle, le commerce international se développe le plus
entre les nations les plus développées dont les dotations
factorielles sont peu différentes. Il s’agit donc d’un
commerce entre nations très peu différenciées les unes
des autres, alors que la théorie traditionnelle met au
contraire en avant le rôle des caractéristiques différentes
des nations pour expliquer l’échange international.
◗La part du commerce international intrabranche, qui
existe lorsqu’un pays importe et exporte simultanément
les mêmes biens dans le commerce mondial, est très
significative et est la plus dynamique. La théorie tradition-
nelle n’a pas d’explication à proposer d’un tel phénomène
qui est incompatible avec sa vision de la spécialisation
internationale.
◗La théorie traditionnelle ne laisse aucune place aux firmes
multinationales et au commerce intrafirme dans son
schéma, puisque ce sont les nations et elles seules qui
échangent. Cependant, les échanges entre des filiales de
firmes multinationales implantées dans des pays diffé-
rents représentent plus du tiers du commerce mondial
de marchandises dans les années 1980.
M. R
AINELLI
,
La Nouvelle Théorie du commerce international,
coll. « Repères », La Découverte, 2003.
2
Économie d’échelle et commerce international
E
n pratique beaucoup d’in-
dustries sont caractérisées
par des économies d’échelle (on
parle aussi de rendements crois-
sants) : la production est alors
d’autant plus efficiente que
l’échelle sur laquelle elle est
faite est importante. Lorsqu’il
y a des économies d’échelle, le
fait de doubler les intrants(1)
dans une industrie augmente
la production de cette indus-
trie de plus du double…
Nous pouvons utiliser cet
exemple pour voir comment
les économies d’échelle don-
nent naissance à un échange
international. Imaginons un
monde composé de deux pays,
l’Amérique et la Grande-
Bretagne, qui ont tous deux
la même technologie pour la
production de gadgets. Sup-
posons en outre qu’au départ
chaque pays produit 10 gad-
gets. Le tableau montre que
ceci demande 15 heures de tra-
vail dans chaque pays : dans le
monde entier, 30 heures de
travail sont utilisées pour pro-
duire 20 gadgets. Supposons
maintenant que nous concen-
trions la production mondiale
de gadgets dans un seul pays,
par exemple l’Amérique, où
nous continuons à employer
30 heures de travail. Dans un
seul pays, ces 30 heures de tra-
vail peuvent produire 25 gad-
gets. Ainsi, en concentrant la
production en Amérique, l’éco-
nomie mondiale peut, avec la
même quantité de travail,
produire 25% de gadgets en
plus. ■
P. R. KRUGMAN, M. OBSTFELD,
Économie internationale,
De Boeck Université, 1996.
1. nda : intrants = facteurs de production.
Relation des intrants à la production dans une industrie hypothétique
3
5
10
15
20
25
30
10
15
20
25
30
35
2
1,5
1,33
1,25
1,2
1,16
Production Intrants de travail (heures) Intrant moyen de travail
Le commerce international est dit interbranche
si la nation considérée exporte des biens
différents de ceux qu’elle importe, par exemple
le vin et le drap dans l’exemple de
David Ricardo. En revanche, l’importation et
l’exportation simultanées de vin (ou de drap)
est une situation de commerce intrabranche.
Les études empiriques menées dans ce domaine
montrent premièrement que la part du commerce
intrabranche atteint, dans les années
quatre-vingt, environ 50 % du commerce
international des pays développés et
deuxièmement que ce pourcentage a cru
significativement depuis les années 1960.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%