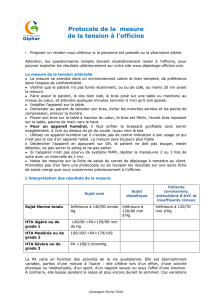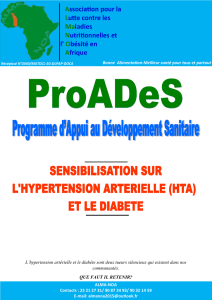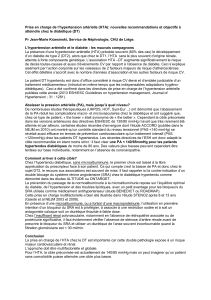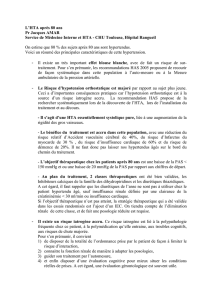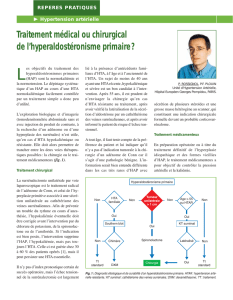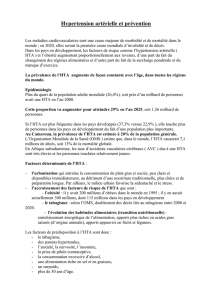Hypertension artérielle essentielle (130a)

Hypertension artérielle essentielle (130a)
Docteur Jean-Philippe BAGUET, Professeur Jean-Michel MALLION
Août 2002 (Mise à jour Janvier 2005)
Pré-Requis :
• Connaître l’anatomie du cœur et des vaisseaux
• Connaître la physiologie de l’artère
• Savoir définir un facteur de risque cardiovasculaire
• Connaître la pharmacologie des traitements anti-hypertenseurs
Résumé :
L’hypertension artérielle (HTA), définie par des valeurs cliniques de pression artérielle
(PA) > 140/90 mmHg, est une pathologie fréquente. Elle représente la première cause
de morbi-mortalité cardiovasculaire dans notre pays (notion de facteur de risque). Dans
la majorité des cas, et malgré un interrogatoire, un examen clinique et des examens
complémentaires adaptés, aucune cause n’est retrouvée (notion d’HTA essentielle).
La mesure clinique de la PA doit être parfaitement réalisée avant que des valeurs
pathologiques ne fassent retenir le diagnostic d’HTA. En cas de doute diagnostique, une
mesure ambulatoire (Holter) ou une automesure à domicile peuvent être réalisées.
L’HTA retentit sur certains organes (notion d’organe cible) dont le cœur (hypertrophie
ventriculaire gauche, insuffisance cardiaque ou coronarienne), les reins (albuminurie,
insuffisance rénale), le cerveau (accident vasculaire, démence, encéphalopathie) et les
vaisseaux.
La prise en charge de l’HTA doit tenir compte non seulement du niveau de PA mais aussi
des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le traitement associe des règles hygiéno-
diététiques et des molécules anti-hypertensives dont il existe sept classes. L’objectif
thérapeutique doit être obtenu avec un traitement personnalisé, en commençant par une
monothérapie séquentielle, parfois par une association faiblement dosée. La surveillance
du traitement se fait sur son efficacité mais aussi sur ses effets indésirables. Le
traitement de l’urgence hypertensive est spécifique.
Index :
Hypertension artérielle, facteur de risque, mesure, organe cible, traitement.
Références :
• ANAES 2000. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension
artérielle. Recommandations cliniques et données économiques.
• J.W. Hurst. Le cœur. Editions MASSON.
• L'encyclopédie "L'HTA de A à Z". Professeur J.M. MALLION. En collaboration avec
Les laboratoires Solvay Pharma.
Exercices :
1. Introduction
L’hypertension artérielle (HTA) est définie par l’O.M.S. comme une pression artérielle
systolique (PAS) ≥ 140 mmHg et/ou une pression artérielle diastolique (PAD) ≥ 90 mmHg.
Sa prévalence, de 10 à 15 % dans les pays industrialisés (en France 5 à 7 millions
d’hypertendus), augmente avec l’âge : de l’ordre de 5 % à 20 ans et de 50 % après 60 ans.
Elle représente la principale cause de morbi-mortalité cardiovasculaire. Le traitement a réduit
notablement l’incidence de ses complications. Ainsi, l’HTA pose un problème de santé
publique par le nombre de sujets concernés. La prise en charge des patients hypertendus
(dépistage, bilan, surveillance et traitement au long cours) est une entreprise lourde qu’il
convient de justifier.

2. La mesure de la pression artérielle
2.1. Méthodes
• Directe : c’est la référence. Elle nécessite une ponction artérielle (humérale, fémorale)
et un cathéter relié à une tête de pression. C’est un examen invasif et coûteux qui n’est
pas réalisable à grande échelle.
• Indirectes : moins précises mais ont l’avantage de pouvoir être répétées à l’infini.
o Méthode palpatoire, du pouls radial ou huméral. Permet uniquement de
connaître la PAS avec une précision limitée.
o Méthode auscultatoire, la plus utilisée, se réfère aux bruits artériels de
Korotkoff perçus en aval du brassard, le plus souvent au pli du coude. Des 5
phases décrites, la phase I (apparition des premiers bruits) détermine la PAS, la
phase V (disparition des bruits) détermine la PAD.
o Les autres méthodes, oscillométriques ou ultrasoniques, sont utilisées par
certains appareils de mesures automatiques, au lit du patient, en automesure à
domicile et en ambulatoire.
Notes : La pratique de la méthode auscultatoire, qui doit comporter 3 gonflages successifs
avec mesure de la pression artérielle (PA) aux deux bras à la recherche d’une anisotension,
présente quelques causes d’erreurs : dégonflage trop rapide - mauvais positionnement du
brassard et/ou du pavillon du stéthoscope - taille de brassard inadaptée à la circonférence du
bras - arythmie complète rendant la mesure de la PAS difficile par sa variabilité - persistance
de bruits audibles jusqu’au zéro (états hyperkinétiques, sujets jeunes, athérosclérose évoluée)
conduisant à retenir la phase 4 (atténuation des bruits) pour fixer la PAD. Il est impératif de
mesurer de façon simultanée la fréquence cardiaque (FC).
Cas particuliers : l’enfant. Habituellement due à une cause précise, l’HTA de l’enfant doit être
recherchée avec un brassard de taille adaptée et évaluée en référence à des abaques de
normalité en fonction de l’âge.
2.2. Circonstances de mesures et résultats
• La mesure usuelle au cabinet médical : sujet au repos depuis plus de 5 minutes, assis
ou couché, méthode auscultatoire, manomètre à mercure et dans un proche avenir
manomètre électronique. Réalisée en dehors de toute interférence (effort physique,
café, tabac dans les minutes précédentes). Répétée au cours de la consultation pour
apprécier la variabilité. La distribution des chiffres de PA dans une population témoin
dessine une courbe en cloche. La PAS tend à s’élever avec l’âge, tandis que la PAD
s’infléchit au-delà de 60 ans (élévation de la pression pulsée par augmentation de la
rigidité artérielle).
• La mesure en orthostatisme : fait suite à la mesure couchée. Réalisée 1 à 2 mn après
un orthostatisme actif, accompagnée de la mesure de la FC. Elle permet de dépister
une hypotension orthostatique définie par une chute de la PAS > 20 mmHg.
• La mesure par le patient lui-même ou automesure : un appareil automatique mesure la
PA du patient à sa demande à domicile.
• La mesure en ambulatoire : elle est réalisée sur 24 heures avec un appareillage portatif
qui effectue selon un programme préétabli un grand nombre de mesures de PA (prés
de 80 mesures sur 24 heures). Met en évidence un rythme circadien avec des valeurs
de PA plus basses la nuit (moins 15 à 30 mmHg). Définit la charge tensionnelle
d’activité, plus proche témoin des signes de retentissement viscéral. Les valeurs de
référence à prendre en compte, en ambulatoire le jour ou en automesure à domicile,

sont toujours inférieures à celles notées au cabinet médical : < 135/85 mmHg. Ceci
peut s’expliquer pour une part par ce qui est appelé la réaction d’alarme ou effet
« blouse blanche ».
Diagramme : mesure ambulatoire (Holter)
(Tous droits réservés)
• La mesure d’effort : au cours d’un effort dynamique sur bicyclette ergométrique (paliers
de 3 mn de 25 watts chacun) ou sur tapis roulant. Permet de définir un profil tensionnel
d’effort par rapport à un profil établi sur une population témoin (il existe une relation
linéaire entre l’évolution de la FC et celle de la PAS à l’effort).
3. Conséquences de l’HTA
3.1. L’HTA est un facteur de risque
Impliquée dans les complications cérébrales et coronaires à travers des lésions athéromateuses
et des lésions artériolaires (artériosclérose), l’HTA n’est pas le seul facteur de risque
cardiovasculaire. L’hypercholestérolémie, le diabète, le tabac, l’obésité sont des facteurs de
risque indépendants des mêmes complications, qui se potentialisent entre eux.
3.2. Retentissement de l’HTA
Quatre organes en sont essentiellement la cible :
• Le cœur : Hypertrophie ventriculaire gauche identifiée par l’ECG et l’échocardiographie.
Evolution : dilatation des cavités, altération des fonctions systolique et diastolique,
insuffisance cardiaque. Conséquence locale de l’atteinte vasculaire : insuffisance
coronaire (angor, infarctus).
• Les reins :
o Lésions artériolaires de la néphroangiosclérose. S’exprime d’abord par une micro-
albuminurie puis une macroalbuminurie, parallèlement à une baisse de la clairance
glomérulaire. L’insuffisance rénale est souvent tardive. Rarement rapidement
évolutive (HTA maligne accélérée).
o Lésions secondaires à une atteinte des artères rénales (ischémie rénale).
• Le cerveau : Evolution et clinique dépendent de la topographie des lésions. Accidents
lacunaires (un cas sur 5) par petits ramollissements sous-corticaux résultants de
l’occlusion d’artérioles dont la paroi a été altérée par l’HTA (nécrose hyaline) – Démence
vasculaire ou de type Alzeihmer par addition des séquelles de chaque accident ischémique
ou hémorragique – Hémorragie cérébrale par rupture d’anévrisme développé sur les
artérioles – Encéphalopathie hypertensive : syndrome aigu où une HTA sévère
s’accompagne de céphalées vomissements, troubles de conscience.
• Les vaisseaux : Grosses artères = Artériopathie oblitérante et anévrisme. Petits vaisseaux
= atteinte des organes sensoriels (rétinopathie, atteinte cochléo-vestibulaire)
4. Classification de l’HTA
Tableau : Définitions et Classifications des niveaux de pression arterielle
Selon les dernières recommandations de l’OMS 1999
(1999 Guidelines for Management of Hypertension.J Hypertens 1999; 1 : 151-183)

• On retient maintenant la notion d'HTA systolique isolée qui est surtout présente chez
le sujet âgé.
• Pour évaluer le pronostic, on prend en compte l'existence des autres facteurs de risque.
Tableau : Stratification DU RISQUE POUR QUANTIFIER LE PRONOSTIC
(1999 Guidelines for Management of Hypertension. J Hypertens 1999; 1 : 151-183)
5. Etiologies de l’hypertension essentielle
95 % des HTA n’ont pas de cause retrouvée. On parle alors d’HTA essentielle. Plusieurs
facteurs peuvent favoriser l’apparition d’une HTA : hérédité, médicaments ou toxiques
(réglisse, vasoconstricteurs), excès pondéral (25 % des sujets en surpoids sont hypertendus),
facteurs nutritionnels ou environnementaux (consommation sodée, alcool, sédentarité, stress).
6. Le bilan de l’hypertendu
6.1. Affirmer le caractère permanent de l’HTA
Eliminer une élévation accidentelle liée aux conditions de mesures (émotion, stress, absence
de repos). Disposer de 3 mesures élevées à 2 consultations différentes sur un mois (définition
OMS).
6.2. Le bilan de l’hypertension
• Antécédents familiaux, facteurs aggravants (café, tabac, alcool, sédentarité, mode de
vie…).
• Interrogatoire dirigé vers une origine secondaire (cf. chapitre HTA secondaires).
• Examen clinique et plus particulièrement cardiovasculaire avec palpation, auscultation
des vaisseaux, recherche de souffle abdominal (sténose artérielle rénale), palpation
lombaire.
• Examen biologique systématique de première intention : créatininémie, kaliémie sans
garrot, glycémie à jeun, cholestérol total, triglycérides, HDL et LDL cholestérols,
recherche d’albumine (et de sang) dans les urines par bandelette.
• ECG
• Autres examens selon orientation :
• Fond d’œil, échographie rénale
• Echocardiographie, échographie vasculaire, radiographie thoracique
• Holter PA, épreuve d’effort
7. Le traitement de l’hypertension artérielle essentielle
7.1. Les médicaments
• Six classes de médicaments antihypertenseurs sont utilisables en première intention et
se distinguent par leur efficacité en monothérapie
o Diurétiques (thiazidiques, dose faible au départ : 12,5 mg
d’hydrochlorothiazide). Agissent en augmentant l’excrétion de sel par le rein et
en modifiant la réactivité vasculaire.

o Béta-bloquants. Modifient la réactivité vasculaire par action sur le système
sympathique.
o Inhibiteurs de l’enzyme de conversion. Bloquent la production d’angiotensine
II.
o Inhibiteurs calciques. Ont une action vasculaire vasodilatatrice directe
(dihydropyridines, vérapamil, diltiazem)
o Alpha-bloquants. Provoquent une vasodilatation artérielle par blocage des
récepteurs α1. .
o Inhibiteurs de l’angiotensine II. Bloquent de façon directe et sélective les
récepteurs AT1.
• En deuxième intention, il est possible de prescrire un antihypertenseur central
(clonidine, méthyldopa, imidazolés).
7.2. Objectif et stratégie thérapeutique dans l’hypertension
artérielle
Le but premier de tout traitement antihypertenseur est d’atteindre un niveau de PA cible qui,
chez les patients présentant une HTA essentielle non compliquée est maintenant bien défini en
référence à des recommandations aussi bien nationales qu’internationales. Les valeurs de la
PA doivent être inférieures à 140 mmHg pour la PAS et inférieure à 90 mmHg, pour la PAD.
Les niveaux de PA optimale doivent même être plus bas lorsqu’il existe certaines affections à
risque tel que diabète ou insuffisance rénale.
En première intention, le traitement peut reposer sur l’instauration d’une monothérapie par
palier ou d’une association fixe à faible dose.
7.2.1. Monothérapie par palier
Le traitement antihypertenseur utilisant l’approche par palier est celui qui a été proposé en
premier et qui reste toujours préconisé en référence aux recommandations. Jusqu’à une
période récente, les diurétiques et les bêtabloquants étaient les seules classes
médicamenteuses ayant fait leur preuve de leur efficacité chez les hypertendus dans les essais
contrôlés au long court. Les plus récentes recommandations pour le traitement de l’HTA ont
élargi l’éventail des possibilités en incluant non seulement les diurétiques et les bêtabloquants
mais également les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les
antagonistes des récepteurs AT 1 et les alphabloquants. Dans une première étape, il est
recommandé d’utiliser une posologie faible puis d’augmenter ensuite cette posologie si la
réponse au traitement n’est pas suffisante. Ceci a conduit au concept « de monothérapie
séquentielle ». On débute par un premier traitement antihypertenseur dont on adapte la
posologie. Si il n’y a pas de normalisation tensionnelle ou d’effet tensionnel satisfaisant après
4 à 6 semaines de traitement maximal, on passe à un autre médicament appartenant à une
autre classe d’antihypertenseur. A l’extrême, tous les types de monothérapie peuvent être
essayés. On peut considérer que tous les médicaments antihypertenseurs ont un effet sur les
valeurs de la PA sensiblement identique et que le pourcentage de répondeurs est également
identique, de l’ordre de 50%. Des études plus récentes sembleraient montrer que ceci n’est
pas toujours le cas. Par exemple, dans l’HTA systolique du sujet âgé, les calcium-bloquants et
les diurétiques seraient plus efficaces que les inhibiteurs d’enzyme de conversion et les bêta-
bloquants.
Par ailleurs, il a été proposé de regrouper les médicaments en deux paniers thérapeutiques : le
premier regroupant les bêtabloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les
antagonistes de l’angiotensine II, le deuxième panier regroupant les antagonistes calciques et
les diurétiques. Lors du changement de famille thérapeutique, il est proposé, si le sujet n’était
pas répondeur, d’utiliser un médicament de l’autre famille.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%