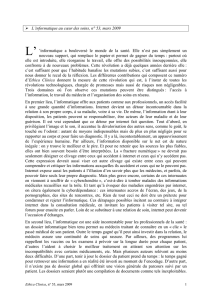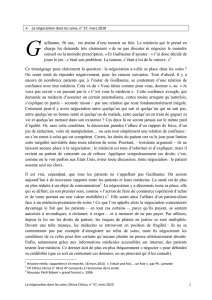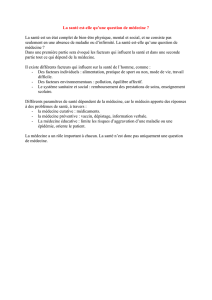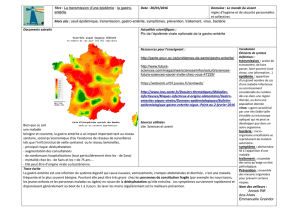Tout est-il permis pour lutter contre les risques d`épidémie

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015
Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015
Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?
euxquiveulentsavoircequ’ilnefautsurtoutpasfaireencasdecontagiongrave,maisque
l’onfaitquandmême,n’ontqu’àrelirelesrécitsdestroisdernièresgrandesépidémies
internationalesdecedébutduXXIesiècle.En2003,leSRASserépandrapidementàpartir
d’uneprovincedusuddelaChine.Pendantplusieurssemaines,entreautrespouréviterles
pertesfinancièresqu’engendreraitunetellenouvelle,lesautoritéschinoisesnientl’évidence,cequi
favoriselapropagationduvirusdanslemondeentier.En2009,l’OMStirelasonnetted’alarme:elle
annonce,defaçonquelquepeuprécipitée,quelevirusAH1N1menacedirectementl’Occident:
c’estlapaniquegénéralisée.Certainesfirmespharmaceutiquesreniflentlabonneaffaire.Aprèsavoir
prisdesmesurespoursedéchargerdetouteresponsabilitéencasdeproblèmeavecleursvaccins,
ellespassentdejuteuxcontratsavecdesEtats,dontlaBelgiqueetlaFrance,pourdesmillionsde
dosesquiresterontfinalementinutilisées.Décembre2013,levirusEbolasepropageenAfriquede
l’Ouest.L’OMS,cettefois,tardeàalerterlesinstancesmondiales.LesEtatsoccidentaux,dansun
premiertemps,semontrentpeuconcernés.Ilfaudraqu’ilssesententeux‐mêmesmenacéspourque
finalement,uneaidesoitdégagée.Etpendantquecescomportementspeuglorieuxoccupentle
devantdelascène,chaqueannée,danslespaysduTiers‐Monde,de6à7millionsdepersonnes
décèdentsilencieusementdusida,dupaludismeetdelatuberculoseréunis,dansunerelative
indifférence.
Solidaritéintéressée,fuiteenavant,déni,précipitation,recherchedeprofitsoupeurde
perdredel’argent:lorsquelamortdemasseseprofile,labassessehumainesedévoile.Sagrandeur
aussi.Carondoitbienleconstater,ceuxquicontribuentàlavictoiresurlesépidémiesontd’autant
plusdeméritequ’ilsluttent,parfoisaurisquedeleurvie,contredeuxfléaux:levirus…etlabêtise
decertains,quielleaussipeutserévélermortellementcontagieuse.
Celadit,quecesoitauniveauinternationaloulocal,dansleslieuxdevieexposéscommeles
hôpitaux,lesmaisonsdereposoulescrèches,laconfrontationaurisqued’épidémie,etlecombaten
casd’épidémieavéréeposentdenombreusesquestionséthiques.Nousenévoqueronsquatreen
guised’ouverturedecedossier.
Lapremière,incontournable,netrouveraaucunesolutionsatisfaisante:uneépidémie
justifie‐t‐ellequelesdroitsdesindividus–lalibertédeconsentiràdessoinsetdedisposerdeson
corps–soientrelativisés,voiresuspendus,auprofitdubiendelacollectivité?L’isolementoulamise
enquarantaineainsiquelestraitementspeuvent‐ilslégitimementdevenircontraignants?Onnevoit
pascomment,dansdescasavérésdemenacesparticulièrementgraves,onpourraitagirautrement.
Toutefois,pourquecette«violence»imposéeauxindividusdevenusdangereuxrestelaplus
humainepossible,ilfautsansdoutequetroisconditionssoientrencontrées.Premièrement,quele
dangerréelsoitparticulièrementélevéetqu’iln’yaitaucuneautrealternative.Deuxièmement,que
laprivationdelibertérencontreaussilesintérêtsdel’individucontraint,enétantpourluilaseule
façondepouvoirêtreprisenchargeetd’avoirunechanced’êtresoigné.Troisièmement,queles
dommagesquelepatientpeutéventuellementsubirenraisondestraitementsouvaccinsimposés
contresongréengagentlaresponsabilitéjuridiquedesfirmespharmaceutiquesoudesEtatsquiy
recourentenconnaissancedecause.Maisquoiqu’ilensoit,mêmedansdessituationsultimes,on
doitgarderconsciencequesacrifierlavolontédespatientsreste–etdoitrester–unedécision
éthiquementproblématique.
C

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015
Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015
Secondedifficulté:commentapprécierquecertainesinstitutionsdesoinsidentifientleurs
patientscontagieuxàl’aided’unsignedistinctifcommeunbraceletnominatifdecouleur?
L’intentionestlouable:ils’agitdeprotégerlesautrespatientsetsurtoutlepersonnelsoignanten
casd’intervention.Maisl’ontransgresseallègrementledroitàlaconfidentialité.Onpeutaussise
demandersilespatientssaventcequesignifiecebraceletqu’ilsportent.Etparailleurs,les
institutionsconcernéesacceptent‐ellesqu’ilspuissentrefuserdeporteruntelsigne?Cedébat
débordeducadrelimitédesinstitutions:aujourd’hui,lapossibilitédestigmatiserunpays,une
région,uneville,ungroupedepersonnesestdevenued’autantplusréellequed’unepart,onpeut
techniquementremonterjusqu’àl’individuquiestàl’originedelapropagationd’uneépidémie–«le
caszéro»–etqued’autrepart,lesmédiasdiffusentmondialementl’informationendirect,photo
d’identitéenappui.Ainsiapprendra‐t‐on,en2003,queleSRASs’estrépanduparl’intermédiaire
d’unmédecindeCantonâgéde64ansqui,le21février2003,contaminelesclientsdel’hôtel
MétropoledeHongKongdanslequeliloccupelachambre911.Encoreaujourd’hui,n’importequi
peutretrouversurinternetlenomdecemédecin.Uneépidémie,quelquesoitsondegréde
dangerosité,justifie‐t‐ellelenon‐respectdelavieprivéeetlevioldusecretprofessionnel?
Troisièmedilemmeinsoluble:selonlesscénarios,ilpeutarriverquel’onnedisposepas
d’embléedetraitementssuffisantspourprotégertouteunepopulationd’uneépidémiedébutante.
D’oùlaquestionquis’imposeauxpolitiquescommeauxsoignants:quiprivilégier?Leprincipe:
«Premiersarrivés,premiersservis»est‐ilimmoral?Est‐ilplusacceptabledesélectionnerlesjeunes
enâgedesereproduire,oucellesetceuxquiontdelourdesresponsabilités,ousontlesplus
fortunés?Bref,faut‐illaisserfairelehasard,oudonnerunechanceàl’avenir,ourécompenserle
mériteindividuel?Quelquesoitlecritèreretenu,ouquelquesoitl’ordredanslequelon
hiérarchiseracesprincipes,aucunesolutionnepourraêtrejugéesatisfaisante,puisquetoutes
consistentàcondamnervolontairementcertainsgroupesd’individus.
Enfin,commententendrelacraintedessoignantspourleurpropresécurité?Enl’absencede
volontairesennombresuffisant,faudrait‐ilcontraindrecertainsd’entreeux–etsioui,lesquelsetsur
quelscritères?–àsemettreendangerpoursauverousimplementaccompagnerlespatients?Dira‐
t‐onqu’ilsdoiventassumerlesrisquesdeleurmétier,aumêmetitrequelespompiersoules
policiers?Mais,àraisonnoussemble‐t‐il,l’assistanceàpersonneendangern’impliquepas,dansle
droitbelge,quel’ondoivemettresavieenpéril.
Tousceuxquitravaillentdanslesinstitutionsdesoinsouleslieuxdeviesaventqu’ilssont
exposésauxrisquesd’épidémie,graveounon.Auniveauinternational,onditnepasêtreàl’abri
d’uneépidémiefulguranteetmeurtrière,àl’instardelagrippeespagnolede1918,quifitplusou
moins100millionsdemorts,d’aprèslesdernièresestimations.Lapeuretlecoûtfinancierengendré
pardetelsfléauxnepeuventpasjustifiern’importequelleattitude.
Jean‐MichelLongneaux
1
/
2
100%
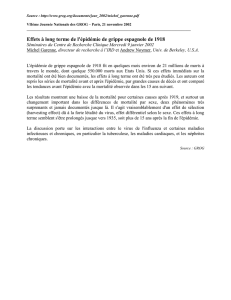
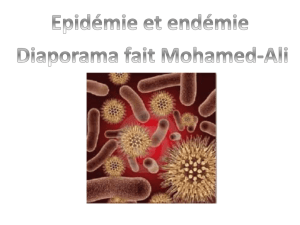
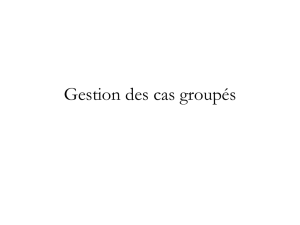
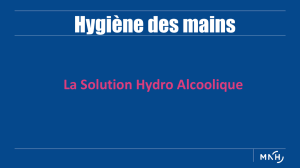


![EPIDEMIE DE GASTRO-ENTERITE relu CD [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000997647_1-3ee6c85c0e3f98f7fa2ef35f398bb839-300x300.png)