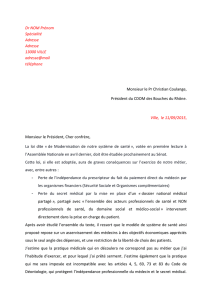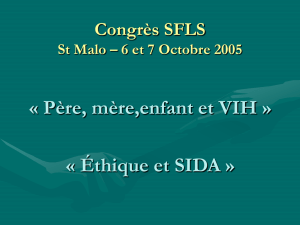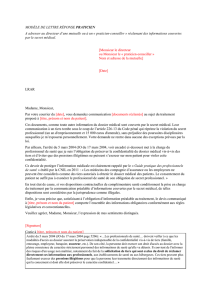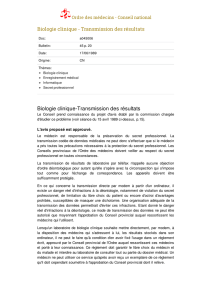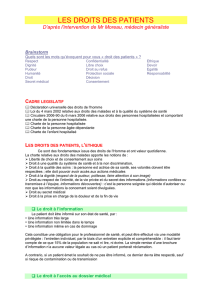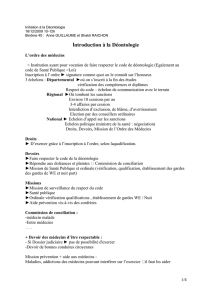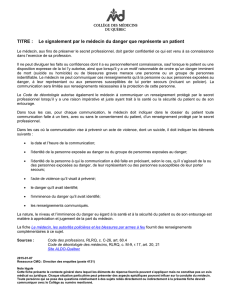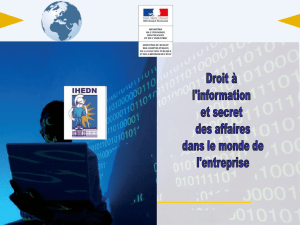L`INFORMATION MEDICALE

1
DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
L'INFORMATION MEDICALE
Liliane DUSSERRE
Henry DUCROT
François-André ALLAERT
[1] DUCROT H.
confidentialité andhiscopie,
numéro spécial
novembre 1987, 25-26
[2] VILLEY R.
histoire du secret médical
Editions Seghers
Médecine et histoire
Paris, 1986
L'ORDINATEUR ET LA LOI
D
Du
u
s
se
ec
cr
re
et
t
m
mé
éd
di
ic
ca
al
l
a
au
u
s
se
ec
cr
re
et
t
i
in
nf
fo
or
rm
ma
at
ti
iq
qu
ue
e
u cours des années soixante, avant même que l'informatique en médecine
quitte la phase expérimentale, avant même qu'une loi, une réglementation
ou une jurisprudence spécifique aient pu prendre en compte les aspects juridiques des
applications de l'informatique à la médecine, se posait déjà le problème du respect du
secret médical. Au cours d'enregistrements sur support magnétique des informations
propres à un malade, la confidentialité des données est-elle menacée, se demandait-on.
Toute collecte organisée d'informations implique à un moment ou à un autre
l'accès à ces informations et leur transmission. Ne s'agit-il pas là d'un risque
particulièrement grave pour le secret médical ? .
Les réponses à ces questions sont ambiguës et même contradictoires car il est
vrai que l'informatique facilite l'accès aux informations [1] en les rangeant de faon
systématique et homogène, en les conservant sur des supports compacts, en permettant
des tris plus ou moins complexes qui peuvent aboutir à la sélection de sous populations
et en favorisant l'interconnexion de fichiers. Mais à l'inverse, il est plus difficile
d'accéder à des informations contenues dans un fichier informatique bien protégé qu'à
celles rassemblés par exemple dans un dossier papier traditionnel souvent à la
disposition de qui veut le consulter, même illégalement. Quant à la transmission
télématique d'informations médicales nominatives, il est possible d'en assurer la
sécurité.
De toute manière, si utiles que puissent être pour l'individu et pour la société
certaines applications médicales informatiques, il ne serait pas acceptable qu'elles
menacent les droits des patients et en particulier le droit au secret des données médicales
personnelles.
Après avoir rappelé succinctement ce que représente le "secret médicale" pour
le patient et pour le médecin, nous verrons que si les dispositions légales sont claires,
dans la pratique leur respect peut-être l'objet d'interprétations délicates. En informatique
ou en télématique, chaque fois qu'une application est mise en œuvre, il est indispensable
de mener une reflexion préalable pour s'assurer que le secret médical est bien respecté.
Préserver la confidentialité des données médicales personnelles est pour le
médecin une obligation, qui procède d'une déontologie professionnelle multiséculaire
[2] et d'un fondement légal qui l'a précédée et codifiée plus récemment.
La déontologie médicale, qui évolue au cours des époques en raison des
modifications des conditions d'exercice et de l'environnement culturel, a toujours
réservé une place privilégiée au secret médical à tel point que leurs histoires se
confondent.
Le secret médical qui occupe une large place dans leur serment d'Hippocrate
prêté par les médecins depuis bien longtemps au début de leur engagement
professionnel, est devenu une obligation légale dès l'instauration en FRANCE du Code
pénal. Il a toujours été explicitement défini dans le Code de déontologie 1
A

2
DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
[3] LE SECRET PROFESSIONNEL DES
MEDECINS
Monographie
Ordre national des médecins,
1995
1. LE SECRET MEDICALE DANS LES TEXTES LEGISLATIFS
ET REGLEMENTAIRES
La règle du secret repose sur un fondement légal constitué par diverses
catégories de textes qui en précisent le principe.
____________________________________
a) CODE PENAL
Le texte législatif fondamental date du code pénal de 1810 [3], c'est l'article
378 de ce code modifié par la loi en 1933, 1939 et 1944.
La loi du 22 juillet 1992 portant réforme du Code pénal², appliquée au 1er mars
199, a substitué à l'ancien article 378 les articles 226.13 et 226.14 de la section 4 qui
traite de l' "atteinte au secret".
Ces deux nouveaux articles sont :
Le nouveau texte ne fait plus référence explicitement aux médecins, il traite de
secret professionnel et non plus de secret médical. Il ne retient plus la notion de secret
confié, mais de secret dont on est dépositaire. Il annonce, sans les préciser, des
dérogations qui permettent des divulgations imposées et des divulgations autorisées.
Dans le code de déontologie médicale, la règle du secret médical est formulée
de façon plus explicite, et seul le terrain de l'exercice de la médecine est pris en compte.
Après plusieurs projets préparés en 1936 puis en 1940, le code de déontologie médicale,
revu et corrigé par le conseil d'Etat est publié sous forme de décret depuis 1945.
Le décret du 28 novembre 19553, nouvelle version du code de déontologie des
médecins, disposait dans son article 7 : le secret professionnel s'impose à tout médecin,
sauf dérogation établie par la loi et tous les commentaires s'accordaient pour préciser
que le législateur ne voulait pas seulement protéger l'individu contre l'indiscrétion mais
considérait le secret du médecin comme d'intérêt public. La violation apparaît dès qu'il y
a révélation de faits, secrets par nature, connus à l'occasion de l'activité professionnelle
sans même qu'il y ait intention de nuire. Quant aux dérogations légales, elles sont
justifiées lorsqu'il parait au législateur que l'intérêt public doit l'emporter sur l'intérêt
privé au secret médical. On verra plus loin (deuxième partie, chapitre 2) un exemple à
propos du PMSI, à travers l'article 40 de la loi du 27 janvier 19934
Article 378 du code pénal
Les médecins chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens,
les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession
ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui,
hors le cas ou la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets seront punis d'un emprisonnements d'un mois à six mois et
d'une amende de 24 000 à 120 000 francs.
L'article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une
mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs
d'amende.
L'article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans le cas ou la loi impose ou autorise la
révélation du secret.

3
DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
[
[4
4]
]
c
co
om
mm
me
en
nt
ta
ai
ir
re
es
s
d
du
u
c
co
od
de
e
d
de
e
d
dé
éo
on
nt
to
ol
lo
og
gi
ie
e
d
de
es
s
m
mé
éd
de
ec
ci
in
ns
s.
.
Ordre national des médecins,
1995
[
[5
5]
]
r
ra
ap
pp
po
or
rt
t
d
de
e
l
la
a
c
co
om
mm
mi
is
ss
si
io
on
n
d
de
e
r
ré
éf
fl
le
ex
xi
io
on
n
s
su
ur
r
l
le
e
s
se
ec
cr
re
et
t
p
pr
ro
of
fe
es
ss
si
io
on
nn
ne
el
l
a
ap
pp
pl
li
iq
qu
ué
é
a
au
ux
x
a
ac
ct
te
eu
ur
rs
s
d
du
u
s
sy
ys
st
tè
èm
me
e
d
de
e
s
so
oi
in
ns
s,
,
p
pr
ré
és
si
id
dé
ée
e
p
pa
ar
r
L
L.
.R
RE
EN
NE
E
F.Gazier
Mars 1994
[
[6
6]
]
c
cf
f.
.
r
re
ef
f
[
[5
5]
]
Le code de déontologie médicale de 19795 dans ses articles 11, 12, et 13, puis
la dernière version de 19956 dans son article 4, reprennent l'obligation du secret médical
qui est explicitée dans les commentaires du code, publiés par le conseil de l'ordre des
médecins[4]. La nouvelle numérotation de ces articles n'est pas anodine : si l'article 11
est devenu l'article 4 dans la dernière version du code, c'est pour mieux montrer la place
essentielle de cette obligation dans la déontologie médicale, le texte en est le suivant :
Le code de déontologie n'ayant qu'une valeur réglementaire, la portée juridique
de ses dispositions est moins absolue que celle des articles du code pénal [5]
____________________________________
b) AUTRES SOURCES JURIDIQUES
D'autres textes législatifs réglementaires ou de jurisprudence affirment le
principe du secret professionnel des médecins, c'est à dire du secret médical.
La loi du 3 juillet 19717 a introduit dans le code de la sécurité sociale un article
L162-2 qui rappelle les grands principes de la médecine libérale et qui donne également
un fondement législatif au principe du secret médicale :
Quant à la jurisprudence, tant judiciaire qu'administrative, elle renforce ces
dispositions et proclame le caractère général et absolu du secret médical. Par exemple
en 1885 dans l'arrêt WATELET, en 1947 dans l'arrêt DEGRAENE, la cour de cassation
affirme que
l
ll'
''o
o
ob
b
bl
lli
iig
g
ga
a
at
tti
iio
o
on
n
n
d
d
du
u
u
s
s
se
e
ec
c
cr
r
re
e
et
tt
p
p
pr
r
ro
o
of
f
fe
e
es
s
ss
s
si
iio
o
on
n
nn
n
ne
e
el
ll
s
s
s'
''i
iim
m
mp
p
po
o
os
s
se
e
e
a
a
au
u
ux
x
x
m
m
mé
é
éd
d
de
e
ec
c
ci
iin
n
ns
s
s
c
c
co
o
om
m
mm
m
me
e
e
u
u
un
n
n
d
d
de
e
ev
v
vo
o
oi
iir
r
r
d
d
de
e
e
l
lle
e
eu
u
ur
r
r
é
é
ét
tta
a
at
tt
q
q
qu
u
u'
''i
iil
ll
s
s
s'
''a
a
ag
g
gi
iit
tt
d
d
d'
''u
u
un
n
ne
e
e
o
o
ob
b
bl
lli
iig
g
ga
a
at
tti
iio
o
on
n
n
g
g
gé
é
én
n
né
é
ér
r
ra
a
al
lle
e
e
e
e
et
tt
a
a
ab
b
bs
s
so
o
ol
llu
u
ue
e
e
e
e
et
tt
q
q
qu
u
u'
''i
iil
ll
n
n
n'
''a
a
ap
p
pp
p
pa
a
ar
r
rt
tti
iie
e
en
n
nt
tt
à
à
à
p
p
pe
e
er
r
rs
s
so
o
on
n
nn
n
ne
e
e
d
d
de
e
e
l
lle
e
es
s
s
e
e
en
n
n
a
a
af
f
ff
f
fr
r
ra
a
an
n
nc
c
ch
h
hi
iir
r
r.
..
Des jurisprudences de la cour de cassation et du conseil d'Etat, il résulte selon F.Gazier
les conséquences suivantes [6] :
On ne peut déroger au secret médical que par la loi d'ou l'annulation par le
conseil d'Etat de plusieurs décrets ou circulatoires organisant des
procédures qui portaient atteinte au secret médical.
Ces dérogations législatives peuvent ne pas être toujours formelles et
explicites, une atteinte au secret médical peut être jugée légale si elle est
la conséquence nécessaire d'une disposition législative.
Le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret.
Cette obligation ne cesse pas après la mort du malade.
Le secret s'impose même devant le juge.
Le secret s'impose même à l'égard d'autres médecins dès alors qu'ils ne
concourent pas à l'acte des soins.
Le secret s'impose même à l'égard de personnes elles-mêmes tenues au
secret professionnel telles que les agents des services fiscaux.
Le secret couvre non seulement l'état de santé du patient mais également
son nom, et le médecin ne doit pas faire connaître à des tiers le nom des
personnes qui ont eu recours à ses services.
Article 4
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans
les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa
profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, amis aussi ce qu'il a vu,
entendu ou compris.
Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté
d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré
conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix, la
liberté de prescription, le secret professionnel, le paiement direct et la liberté
d'installation.....

4
DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
2. LA COMMUNICATION NECESSAIRE DES INFORMATIONS
MEDICALES
La définition même de l'information comme cela a été dit plus haut, implique
sa transmission à des niveaux de communication variés.
C'est ainsi que le médecin a le devoir d'informer son patient, voire ses proches,
dans des cas bien définis prévus par le code de déontologie si l'article 35 du nouveau
code de déontologie, article 42 de l'ancien code, restreint l'information du patient, ce
n'est pas pour renforcer le secret médicale mais pour répondre à un souci humanitaire
lors de la révélation de la vérité due au malade [4].
La circulation de l'information entre les médecins concourant aux soins d'un
même patient est nécessaire dans l'intérêt du malade, et la jurisprudence a donc reconnu
la notion de secret partagé pour le personnel soignant et les médecins traitants ; sa
nécessité est d'évidence à l'hôpital public ou privé non seulement pour assurer
l'information du patient, de son entourage, de ses ayants droit en cas de décès, mais
aussi pour disposer des données médicales nécessaires à une évaluation des activités et
des coûts en vue de la maîtrise des dépenses de santé.
Tout en ensemble de lois hospitalière, avec leur décrets d'application et des
circulaires aménagent avec précision le nécessaire compromis entre confidentialité et
communication des informations.
La loi du 31 juillet 1991 8, codifié un livre VII du code de la santé publique, a
proclamé le droit à l'information du patient hospitalisé par l'article L710-2. On verra
dans la deuxième partie, au chapitre 1, l'importance du décret d'application pris le 30
mars 19929 en matière de dossier médical pour la communication des informations à la
demande du patient par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui.
L'article l710-5 du code de la santé publique qui impose l'évaluation de
l'activité des établissements a du être complété par la loi DMOS du 27 janvier 199310
qui autorise la collecte, à des fins médico-administratives, d'informations médicales
nominatives sur chaque patient et leur transmission à un médecin hospitalier désigné
pour les traiter dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes
d'information (PMSI). Cette disposition déroge à l'impératif du secret médical en
autorisant la transmission de données médicales nominatives à un médecin qui ne
participe pas aux soins des patients. On verra dans le chapitre consacré au PMSI que
décrets et arrêtés ont complété ces textes à propos du respect du secret.
Le fonctionnement de la Sécurité Sociale, tant au niveau du remboursement des
dépenses médicales aux assurés que de la recherche d'une politique de maîtrise des
dépenses de santé, nécessité la transmission de données médicales nominatives qui
mettent en cause le respect du secret médical. Le mécanisme des feuilles de maladie
nominatives qui indiquent les actes effectués par des lettres clés affectés de coefficients,
les déclarations d'accidents et de maladies professionnelles par des certificats nominatifs
descriptifs sont admises soit parce qu'elles sont autorisées par la loi, soit parce qu'elles
sont la conséquence de dispositions législatives. Quant au contrôle des médecins
conseils dans les établissements de santé, il est fondé sur l'application un peu forcée de
la notion de secret partagé, et a été autorisé par décret 11.
Le système de codage des actes et des pathologies annoncé par la loi du 4
janvier 1993 12 soulève des discussions relatives au respect du secret médical au fur et à
mesure de la publication des décrets d'application. C'est ainsi que le décret du 6 mais
1995 13 prévoit la transmission de la nature des actes effectués, des prestations servies et
des pathologies diagnostiquées des organismes d'assurance maladie, sous forme codée,
mais faisant apparaître en clair l'identité du patient.

5
DU SECRET MEDICAL AU SECRET INFORMATIQUE
Dans le domaine de la santé publique, il existe tout un système de déclarations
et de registres qui assurent la collecte d'informations médicales forcément nominatives
si on veut être en mesure de les contrôler et de les exploiter. Il a donc fallu des
dérogations législatives successives pour permettre, par exemple, la déclaration de
certaines maladies contagieuses et, plus particulièrement, des maladies sexuellement
transmissibles ; de même, les registres épidémiologiques, dont l'intérêt scientifique est
indiscutable, restaient récemment en FRANCE dans l'illégalité ; la solution législative
globale souhaitée par la CNIL, puis dans l'avant projet de loi BRAIBANT sur les
sciences de la vie et les droits de l'homme, a finalement vu le jour dans la troisième des
trois lois sur la bio-éthique promulguées en 1994. C'est la loi du 1er juillet 1994 14 qui a
introduit un chapitre V bis dans la loi " informatique et libertés" du 06 janvier 1978,
comme nous le verrons plus loin.
On concilie ainsi la rigueur du secret médical et les besoins de la santé
publique qui ont tous le même objectif : L'intérêt du patient. Il ne s'agit pas, en effet, de
faire de l'impératif du secret médical un alibi pour freiner certaines évolutions
techniques, scientifiques ou sociales qui sont souhaitables ou inéluctables.
Les dérogations autorisées par la loi au fur et à mesure des époques successives
ne peuvent répondre à toutes les questions que médecins et patients se posent à propos
de l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'informatique et de la télématique,
faites pour faciliter la communication mais menaçante pour le secret des informations.
Très tôt, l'informatique, en raison de ses possibilités de stockage et de
manipulation des données a été ressentie comme une menace pour la vie privée des
individus. On se rappelle l'opposition, en France, au développement de certains fichiers,
comme le fichier GAMIN (Gestion Automatisée en Médecine Infantile) et le fichier
SAFARI. Le fichier GAMIN ne contenait pas seulement des informations ponctuelles
mais certaines données résultaient d'interprétations et pouvaient "catégoriser" des
enfants dits à risque. De même, le fichier SAFARI, qui avait pour objectif de regrouper
des fichiers administratifs grâce à un identifiant unique, a été arrêté en son temps. Il est
vrai que l'interconnexion de fichiers accroît la valeur des informations concernées et les
risques d'atteinte à la liberté des individus.
La technique informatique, qui oblige à ranger l'information selon un schéma
et un ordre précis pour en faciliter l'extraction et qui concentre en un espace réduit un
volume considérable de données sur lesquelles il est possible de faire des tris successifs,
peut permettre d'identifier un individu même si on en ignore le nom. De plus, la micro-
informatique et le développement des réseaux ont compliqué la surveillance des
fichiers.
La loi du 06 janvier 1978 15, complétée par celle du 1er juillet 1994, assure la
protection des données. En médecine, nous verrons que cette protection n'implique pas
seulement une restriction à l'accès des données, qui doit être limitée aux personnes
participant à l'acte de soins, au patient et à ses ayants droits dans des conditions bien
précises ; la loi prévoit également l'intégrité de ces données. C'est effectivement la
condition d'une bonne pratique médicale. Autrement dit, l'information doit être
disponible dans des conditions d'intégrité et de rapidité optimales pour ceux qui y ont
droit, mais le secret exige qu'elle ne soit jamais accessible aux autres.
 6
6
1
/
6
100%