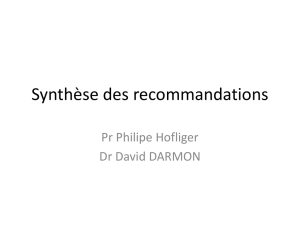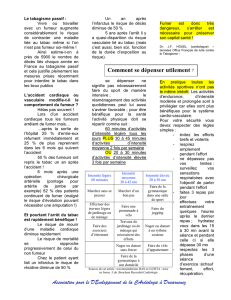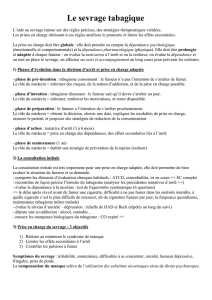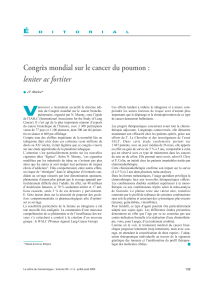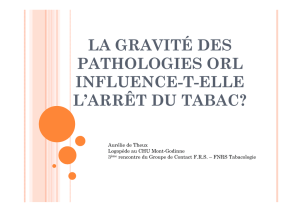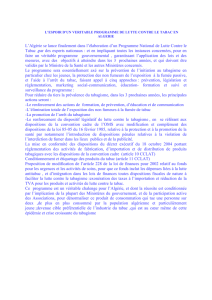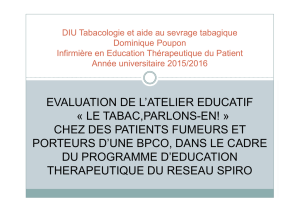[10] Baromètre santé médecins - pharmaciens

1
Université Louis Pasteur
Faculté de Médecine de STRASBOURG
Mémoire présenté en vue de l’obtention du
Diplôme Inter Universitaire de
Tabacologie et d’aide au sevrage tabagique
Pr Elisabeth QUOIX
Influence de la consommation tabagique
des médecins généralistes
sur l’aide au sevrage tabagique de leurs patients
Revue de la littérature
Lionel MICHEL
Résident de Médecine Générale
Année Mémoire 2007-2008

2
Université Louis Pasteur
Faculté de Médecine de STRASBOURG
Mémoire présenté en vue de l’obtention du
Diplôme Inter Universitaire de
Tabacologie et d’aide au sevrage tabagique
Pr Elisabeth QUOIX
Influence de la consommation tabagique
des médecins généralistes
sur l’aide au sevrage tabagique de leurs patients
Revue de la littérature
Lionel MICHEL
Résident de Médecine Générale
Année Mémoire 2007-2008

3
SOMMAIRE
Introduction : ___________________________________________ 4
Méthode ________________________________________________ 5
Résultats _______________________________________________ 5
1. Le conseil minimum _________________________________ 5
2. Le tabagisme dans la population générale _______________ 8
3. Le tabagisme des médecins généralistes _________________ 9
4. Influence du tabagisme médical sur le sevrage de leurs
patients ? ____________________________________________ 10
Discussion _____________________________________________ 13
Conclusion ____________________________________________ 15
Annexe _______________________________________________ 16
Références _____________________________________________ 17

4
Introduction :
L’idée de départ de ce mémoire vient de mon piètre tropisme pour le tabac. Malgré les
tentatives inhérentes à l’adolescence, je n’ai jamais réussi à maîtriser la technique nécessaire
pour pouvoir apprécier la cigarette. J’ai abandonné sur ce constat d’échec.
Bien plus tard, alors que mon métier de médecin généraliste me confronte régulièrement au
tabac et à ses méfaits sur les patients que je suis amené à soigner ; les cours du DIU de
tabacologie et d’aide au sevrage tabagique m’ont ramené à cette rencontre ratée avec le tabac
à l’adolescence. En effet comment aider au quotidien les patients au mieux dans leur difficile
entreprise à se défaire de cette addiction, sans pouvoir imaginer une seconde le « plaisir » et
donc le « désir » que revêt pour le patient en cours de sevrage, la cigarette.
Cette recherche, peut-être exagérée, d’empathie pour les patients que je serai amené à
accompagner dans leur démarche est-elle justifiée ? Un médecin ne peut pas expérimenter ni
toutes les maladies ni tous les traitements qu’il serait amené à rencontrer dans sa carrière pour
mieux conseiller ses patients.
La crainte d’essuyer au cours d’un entretien un « De toute façon, Docteur, vous ne pouvez pas
comprendre, vous n’avez jamais fumé ! » est bien présente, même si celle-ci paraît
inéluctable. Est-ce un atout ou un handicap d’être un soignant fumeur ou ancien fumeur pour
mieux aider les candidats au sevrage ? Les soignants non-fumeurs sont-ils plus convaincants
ou plus acharnés dans la lutte contre le tabagisme ?
Cette question est d’autant plus cruciale que le médecin généraliste occupe une position idéale
en amont du système de soins pour développer des actions de prévention quant au tabagisme,
en particulier le conseil minimum, dont les effets ne sont plus à démontrer.

5
Méthode
Pour tâcher de répondre à la question posée, la méthode employée dans ce mémoire est la
revue de la littérature scientifique récente dans le domaine de la tabacologie.
Résultats
1. Le conseil minimum
1
C’est une intervention brève et systématique pour tout patient, durant moins de 3 minutes et
qui a fait ses preuves. Le conseil minimum s’adresse à tous les fumeurs, qu’ils soient prêts ou
non à arrêter de fumer. Sa formulation a été validée :
Première question : « Fumez-vous ? »
En cas de réponse négative : mot de félicitation
En cas de réponse positive :
Deuxième question : « Envisagez-vous d’arrêter ? »
En cas de réponse négative, le médecin donne un conseil clair, ferme, sans jugement.
Exemple « Je dois vous informez qu’arrêter de fumer est la meilleur chose que vous
puissiez faire pour votre santé. »
En cas de réponse positive, le médecin propose une aide plus approfondie lors d’une
consultation dédiée à ce problème ou lors d’une consultation spécialisée.
Conseiller l’arrêt du tabac et proposer une aide au sevrage augmente de 2% le taux de sevrage
tabagique spontané à long terme. Si chaque médecin généraliste pratiquait ce conseil minimal,
1
Les stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de l’aide à l’arrêt du tabac.
Recommandations de bonnes pratiques. AFSSAPS, mai 2003
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%