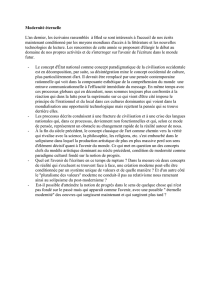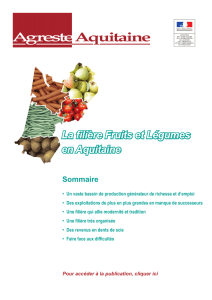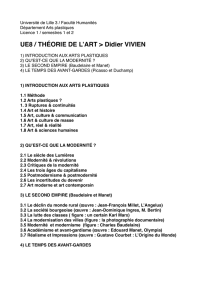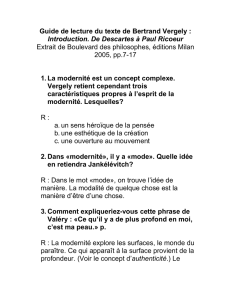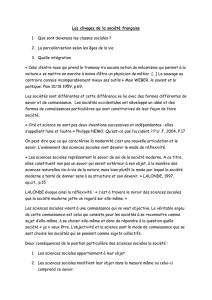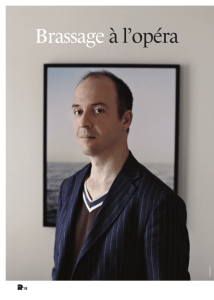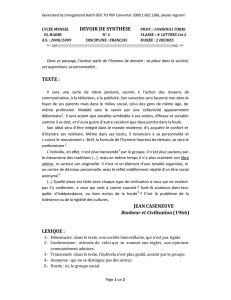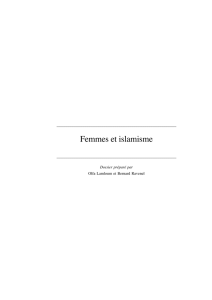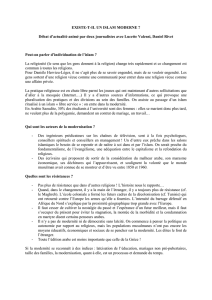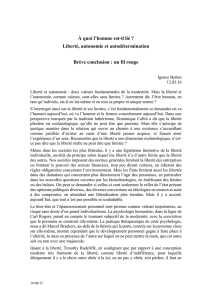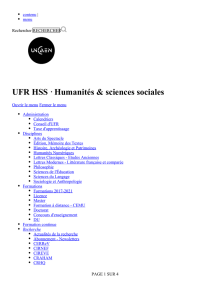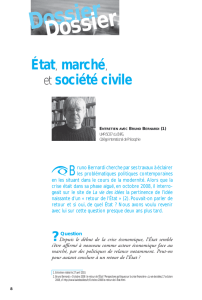Intervention de Jean-Pierre PINEL – Structures organisationnelles et

1
Notes de Geneviève CHALOPIN et de Sandrine FORTINA
Intervention de Jean-Pierre PINEL – Structures organisationnelles et valeurs
institutionnelles à l’épreuve de l’hyper modernité
Jean-Pierre PINEL – Psychologue à Paris 13 – Champs de la clinique psychanalytique
des institutions et des organisations – Intervenant dans des institutions du champ
sanitaire et médicosocial.
Objectif de l’intervention : proposer une analyse des changements culturels
contemporains qui mettent à mal les équipes dans nos institutions spécialisées.
Première hypothèse : il y a une mutation de l’arrière-plan institutionnel et
organisationnel. Les institutions spécialisées sont les dernières à subir ces
changements, elles ont résisté le plus longtemps. Les conséquences de cette
mutation sont :
- Une crise voire un effondrement de certaines valeurs fondatrices des
Institutions spécialisées et des structures
- Un travail de refondation nécessaire
- L’effacement du collectif dans les théorisations des processus.
Référentiel théorique :
Il faut distinguer :
Institution ≠ institution ≠ organisation
Abstraction services et établissements Moyens et méthodes
pour atteindre la finalité
institutionnelle
Notre secteur met davantage l’accent sur les valeurs que sur les moyens. Cela a
pour conséquence notre méconnaissance des effets des organisations.

2
Notes de Geneviève CHALOPIN et de Sandrine FORTINA
Pôle Individuel Pôle Social
Entre ces deux pôles, il y a tout l’espace des groupes d’appartenance, de
l’organisation. C’est un maillon pour passer d’un pôle à l’autre.cet espace est évincé
de nos formations initiales. Il y a eu un saut épistémologique.
Quelques références :
WEBER : typologie des organisations (bureaucratiques et charismatiques).
ENRIQUEZ (E)
ROUCHY (JC) : les organisations en réseau.
KAES (R)
Dans les typologies des organisations, on trouve : les organisations coopératives,
technocratiques, en réseau…
Ces organisations appartiennent à notre psyché (KAES). Elles sont même dans la
partie la plus primitive de notre psyché. C’est ainsi que les angoisses les plus
archaïques se libèrent dans la vie des institutions.
Ce qui se joue dans les institutions : Identité – Narcissisme – Jouissance. On y
joue sa peau.
Les liens de coordination et de coopération ne font pas partie par définition des
fonctionnements humains. Il faut sans cesse les mettre en chantier.
L’organisation est faite pour canaliser les investissements vers les idéaux de
l’institution. Les deux scènes (consciente et inconsciente) peuvent être en synergie,
notamment au moment de la fondation (dynamique fondatrice). Parfois, il y a un
clivage entre ces scènes. Là apparaissent les risques d’épuisement, de
fonctionnement en faux, en simulacre.
Les mouvements mortifères coexistent avec ceux de la création et de l’innovation :
Eros et Thanatos.

3
Notes de Geneviève CHALOPIN et de Sandrine FORTINA
On a un lien d’identité et d’identification aux institutions :
Identité verticale : dans les idéaux
Identité horizontale : dans le partage des idéaux.
→ Voir FREUD (S) : Psychologie collective et analyse du moi.
La résistance au changement est une défense naturelle contre une attaque de
l’identification. C’est un mouvement similaire à celui qui se produit dans un trauma.
C’est une protection contre la souffrance.
Les institutions sont traversées par des valeurs transversales. Les conflits portent
sur des valeurs, après la période de fondation. Par exemple, il y a un conflit actuel
et récurent entre aide et contrôle.
Les valeurs centrales et les filiations théoriques des institutions spécialisées des
années 50 à 70 se sont actualisées dans des structures d’organisation qui sont
homomorphes
1
des valeurs fondatrices.
1 Les idéaux de la modernité viennent des militants et des résistants :
Elucidation des sources d’aliénation → Position critique
Promotion et émancipation des personnes et des groupes sociaux
Liberté du sujet et primat de la responsabilité.
2 Théories :
Sociologie critique (BOURDIEU)
Psychanalyse
Cette bipolarité théorique a permis une dynamique créative dans les institutions.
Cette conflictualité est reconnue, acceptée. C’est le contraire de la pensée unique.
Ces affrontements théoriques ont agi comme prévention de la violence et comme
moteur de la création.
3 Structures organisationnelles qui en résultent :
Structure charismatique / structure coopérative
1
Vient de l’algèbre : renvoie à une notion d’équivalence.

4
Notes de Geneviève CHALOPIN et de Sandrine FORTINA
Nombre d’institutions sont mixtes. Les institutions charismatiques sont sur un axe
vertical tandis que les institutions coopératives sont sur un axe horizontal. Les
institutions qui sont positionnées au croisement sont les plus fécondes.
Modèle charismatique :
Le modèle charismatique s’est effondré à l’hôpital.
Voir : Serge BLONDEAU – N°82 de la revue Connexions : « Groupes de parole et
crise institutionnelle ».
Ce qui prime c’est la personnalité et les compétences du chef. Chacun a avec lui un
lien individualisé. C’est un lien narcissique, le désir d’être le fils préféré, ce qui
crée une rivalité entre les frères. C’est un mode homosexué et phallique. Il y a une
soumission narcissique au chef. L’ambivalence vient du désir de destruction. La
violence se développe alors à l’endroit du féminin (pas au sens de genre). Le
féminin, c’est la capacité à la RECEPTIVITE, condition nécessaire et préalable à
l’élaboration.
Modèle coopératif :
La cohérence et le partage du sens sont privilégiés. Cohérence n’est pas cohésion
(la cohésion renvoie à un fonctionnement uniforme, celui des organisations
bureaucratiques). Cela implique un ensemble de dispositifs, donc un mode qui prend
du temps. Ce modèle est chronophage, en contradiction avec les exigences
contemporaines. Il fonctionne par la négociation, traite les conflits. Il repose sur
une part d’utopie.
Ces deux modèles ont connu leur fécondité et leurs impasses. Il y a un vécu
nostalgique par rapport à eux.
Le concept d’hyper modernité :
Vient de Marcel GAUCHET : anthropologue contemporain.
On parle d’hyper modernité plutôt que de post modernité. La post modernité
supposerait que l’on ait changé de processus. Or, l’hyper modernité est la pointe
extrême du processus qui donne la mutation. La logique profonde en œuvre est celle
de la montée de l’individualisme et de la démocratie. Lorsque l’individu augmente, le
collectif diminue. Voir DUBET : la désinstitutionalisation. Cette

5
Notes de Geneviève CHALOPIN et de Sandrine FORTINA
désinstitutionalisation contemporaine place les individus et les jeunes professionnels
dans la certitude d’être SANS DETTE. C’est l’oubli de l’hétéronomie.
Le méta cadre se transforme, les institutions sont fragilisées. L’hyper modernité va
développer des troubles du narcissisme et de l’identité (tandis que la modernité
développait des névroses).
Voir Olivier DOUVILLE : la mélancolisation du lien social. La découverte des camps
et d’Hiroshima a provoqué un désenchantement par rapport aux idéaux messianiques
et une poussée démocratique. Cela a aboli la différenciation générationnelle de
l’asymétrie.
Voir la montée des communautés de jouissance et des groupes de parole (modalité
de réponse à la crise).
L’hyper modernité a crée une inversion de la flèche temporelle. Dans les sociétés
traditionnelles, le passé est la référence. Dans les sociétés modernes, le passé
existe et on recherche une amélioration dans le futur. Dans l’hyper modernité,
c’est le futur pur. Cette idéologie du futur attaque la TRANSMISSION.
Attention à ne pas dénier le passé et l’histoire du sujet dans le PROJET de
l’usager.
Le modèle charismatique et l’utopie coopératrice ont perdu leurs fondements
symboliques. On bascule dans des logiques de transparence qui empêchent la
construction narcissique.
Les effets sur les Institutions Spécialisées (IS) :
Les IS sont des ensembles intersubjectifs fragiles. Ils doivent être suffisamment
fragiles pour rendre possible la réceptivité du féminin. C’est cela qui permet
l’accueil de l’Autre et de sa souffrance. C’est une place intermédiaire entre le tissu
social et la mésinscription. Les IS sont des lieux d’accueil de la violence, de la
désespérance où l’on doit se déprendre de la fascination. Elles sont un lieu de
contention. Il faut être fort (pour contenir) et fragile (pour accueillir) en même
temps.
La structure organisationnelle donne un arrière plan de fiabilité et de sécurité.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%