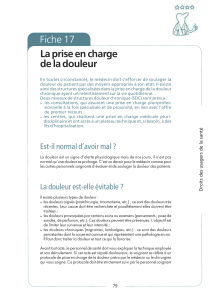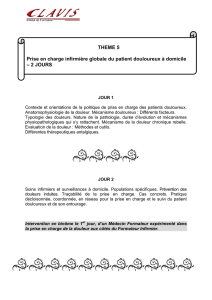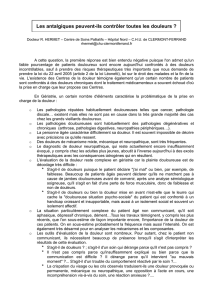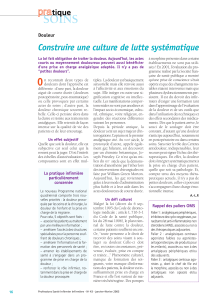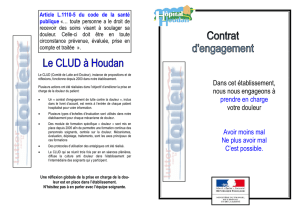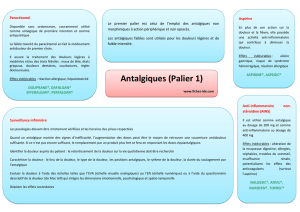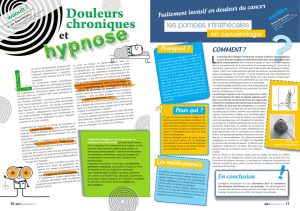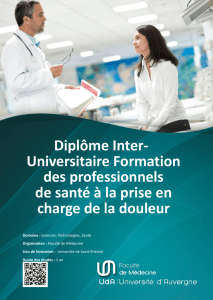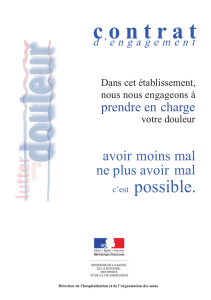Spécificités des traitements de la douleur chez le sujet

Spécificités des traitements de la douleur chez le sujet âgé
Jean-Marie GOMAS,Annie PETROGNANI,Tristan CUDENNEC,Charles JOUSSELLIN,
Frédéric LEROUX,Jacques DELPORTE, Fanny KNORECK, Bruno LE DASTUMER
Hôpital Gériatrique Ste Perine, Paris
La douleur, en gériatrie, est source d’anorexie persistante, de perte d’autonomie et de dépression. La dépression
accentue l’intensité des douleurs organiques. Non contrôlée, la douleur peut aboutir à l’observation d’états
régressifs, avec repli sur soi, détachement et désinvestissement de l’entourage. La douleur peut à tout moment
générer un syndrome confusionnel chez une personne âgée (13).
Abord infirmier et Positionnement du malade
Pour l’évaluation :
Une évaluation par équipe semble souhaitable afin de comprendre le ressenti douloureux du patient âgé.
Chaque équipe ciblera un moment privilégié pour l’évaluation et s’efforcera de le conserver afin de diminuer les
variables surtout par l’hétéro-évaluation.
(ex : la toilette et/ou le pansement le matin, un change ou un transfert l’après-midi, une mobilisation la nuit).
Quel que soit le type d’évaluation choisie (auto ou hétéro) l’essentiel est de conserver le même outil pour le
même patient dans un souci de clarté des transmissions.
Pour le traitement :
Une réflexion au sein de l’équipe médico-soignante est nécessaire quant aux horaires de distribution des
antalgiques de palier II. Ces traitements comme les autres sont proposés le plus souvent aux heures des repas
(8h-12h-18h), et leur efficacité s’en ressent. La pharmacocinétique de ces produits requiert une distribution
rythmée sur 6 ou 8 heures : c’est une vraie réflexion à mener car elle bouleverse les habitudes des prescripteurs
et des infirmières.
Concernant les antalgiques administrés oralement ou par sonde d’alimentation, les formes à libération
prolongées ne peuvent être ni écrasées, ni diluées. Le Skénan* peut s’ouvrir et les micro granules administrées
per os dans une cuillère de confiture ou autre. Par sonde d’alimentation, le Skénan* peut être administrer avec du
lait, ce qui évite aux micro-granules de coller à la seringue et à la paroi de la sonde ce qui diminue la quantité de
produit effectivement reçu par le malade.
Pour les soins :
- Etre deux soignants pour les soins d’un patient douloureux diminue les risques de gestes brusques inévitables,
quand les personnes âgées sont très invalidées.
- Préparer un chariot le plus complet possible faisant face à toutes les éventualités car la longueur d’un soin est
un facteur d’apparition ou d’aggravation de la douleur.
- Administrer les prémédications 1h30 avant le soin douloureux afin d’être certain que l’efficacité antalgique est
à son maximum.
- Travailler en étroite collaboration avec l’ergothérapeute et le kinésithérapeute qui apportent de précieuses
ressources quant à l’installation au fauteuil et au lit.
Kinésithérapie et Physiothérapie
Chez le sujet âgé douloureux, la kinésithérapie sera pragmatique, basée sur l’écoute et la réévaluation
multidisciplinaire ; le seuil douloureux dans les exercices sera pris en compte, et permettra de préciser les
indications de prémédications antalgiques. Toutes les techniques sont applicables mais à adapter de manière
réalistes, en particulier si existent des perturbations du schéma corporel.
La physiothérapie (utilisation des agents physiques : air, eau, froid, chaud, lumière...) est fort utile dans bien des
cas de douleurs par excès de nociception et de douleurs neurogènes : sa mise en œuvre doit être simple dans un
contexte exempt d’anxiété.
L’efficacité de la physiothérapie est plus particulièrement perceptible pour des douleurs très localisées, surtout
dans le domaine rhumatologique ; elle reste bien sur compatible avec les traitements médicamenteux.
Deux types de physiothérapies répondent à ces exigences avec une quasi-absence d’effets non désirables.

-L ‘application du chaud et du froid sous forme de compresses adaptées avec des modalités d’applications
ajustables,
-L’utilisation d’un stimulateur neuro musculaire programmable suivant les topographies et les lésions
Le résultat doit se faire sentir dès les premières séances, sinon il est inutile de persévérer.
Psychomotricité
La psychomotricité du sujet âgé, au sens de l’inscription dans son corps de ses processus psychiques, va être
bouleversée par le vécu corporel douloureux. Ce bouleversement risque d’être d’autant plus marqué que les
difficultés psychomotrices sont fréquentes chez la personne âgée (schéma corporel désorganisé, image du corps
perturbée, désorientation temporo-spatiale, capacités psycho-intellectuelles altérées).
Le rôle du psychomotricien va être dans un premier temps de tenter de repérer comment le sujet âgé douloureux
utilise son corps d’un point de vue instrumental, comment il l’investit dans la relation à lui-même et aux autres et
comment il perçoit son corps (en référence à l’image du corps) (21).
Dans un second temps, au regard de cette lecture psychomotrice (22), le psychomotricien pourra proposer une
médiation corporelle adaptée pour un mieux-vivre psychique. Selon ce qui fait rencontre dans cette relation
singulière, différents axes d’intervention psychomotrice peuvent être envisagés : faire l’expérience du lâcher
prise, de la détente à travers la relaxation, le toucher, le bain relaxant ; permettre une meilleure connaissance de
son corps et de ses capacités et en particulier un meilleur contrôle de sa respiration ; donner les moyens
d’exprimer par des supports artistiques (peinture, dessin, modelage collage) son vécu pas toujours verbalisable
Hypnose
Cela fait plus de deux siècles que l’hypnose est utilisée notamment dans la prise en charge de la douleur.
L’hypnose est une technique de communication mais c’est aussi une relation à l’autre. Rainville(19) et son
équipe a montré que pratiquer l’hypnose dans la prise en charge de la douleur permet d’agir sur toutes ses
composantes.
C’est le patient lui-même qui doit définir un objectif, certes optimiste, mais réaliste. Chaque séance doit être
personnalisée, rien n’est possible sans la participation active du patient. Toute séance est interactive et le
praticien doit orienter le patient en utilisant les informations reçues de ce dernier. Faire des séances d’hypnose
sous sa forme moderne revient à apprendre au patient à faire de l’auto hypnose ; c’est un apprentissage où le
patient acquiert des compétences.
C’est dire à quel point en gériatrie, le déficit cognitif peut rendre difficile cette démarche ; les rares équipes
gériatriques qui ont cette pratique (18, 20) évaluent pour chaque situation douloureuse si le psychisme et la
performance cognitive du malade lui permettent d’utiliser cette technique.
De nombreuses techniques sont à adapter : utilisation des ressources évidentes du patient, d’une autre partie du
corps, de l’imaginaire, ré interprétation de la douleur, utilisation des expériences antérieures, fractionnement de
la douleur, substitution de la douleur par une autre sensation moins désagréable, déplacements et changements
dans l’espace, distorsion du temps, métaphores soufflées par le patient, allusions, etc...
Tableaux douloureux particuliers
Sans oublier quelques principes généraux qui conditionnent l’usage des antalgiques chez les personnes âgées :
accorder le bénéfice du doute (toujours croire un patient qui se plaint et pratiquer un test thérapeutique si cela est
nécessaire), se renseigner sur les traitements antérieurs et sur leur efficacité, enfin, réévaluer régulièrement leur
efficacité (14).
Les douleurs d’arthrose. Lorsqu’elles sont permanentes, elles nécessitent des antalgiques en permanence, à
intervalles réguliers adaptés à la cinétique des produits. A prédominance nociceptive (justifiant le recours aux
antalgiques et aux anti-inflammatoires), elles peuvent présenter une composante neuropathique et dépressive
(justifiant le recours aux tricycliques). Ces douleurs sont le plus souvent positionnelles : intenses à la marche,
absentes en position assise ou allongée. Outre le traitement antalgique, des soins de kinésithérapie et un soutien
psychologique peuvent s ‘avérer nécessaire (15).
Les douleurs d’escarre ou d’ulcères des membres. Lorsqu’elles sont permanentes, un traitement antalgique
permanent est nécessaire. Celui-ci peut nécessiter l’utilisation d’antalgiques de palier 3. Si la douleur survient de

façon aiguë, essentiellement lors des soins, l’emploi d’un antalgique, souvent de palier 3 et de courte durée
d’action, est nécessaire (la voie sous-cutanée est la plus souvent utilisée). On peut associer une antalgie locale
grâce à des gels ou des pommades.
Les douleurs séquellaires des A.V.C. sont souvent difficiles à évaluer et à traiter. Elles résultent de l’intrication
de douleurs nociceptives (ankylose, grabatisation, douleurs musculo-articulaires...) et neuropathiques (centrale,
lésions neurologiques distales par troubles trophiques...). Insistons sur la nécessité des réévaluations et sur
l’association des traitements.
La douleur du patient dément est au mieux dépistée par une évaluation systématique et le recueil régulier des
observations de l’entourage et des soignants intervenant quotidiennement. En cas de doute, un test thérapeutique
antalgique peut être licite : en quelques heures (suivant la galénique utilisée, souvent un morphinique d’action
immédiate) seront évalués les changements de comportement du patient par toute l’équipe.
Les douleurs après amputation, justifient d’abord un minutieux bilan pour séparer ce qui revient à l’infection,
au névrome, à l’artérite, à un éperon osseux, à l’algodystrophie, ou la réelle neuropathie. Celles-ci (avec
nevrome, ou pas) sont fréquentes et peuvent persister des années après l’acte chirurgical. Leur prise en charge est
difficile et nécessite un traitement médical (antalgiques mineurs ou majeurs, A.I.N.S., antidépresseurs, anti-
épileptiques et myorelaxants, kétamine, blocs infiltrants, stimulation électrique), parfois un traitement
chirurgical, et toujours une prise en charge psychologique (16).
Les douleurs provoquées par les ponctions et injections, sont fréquentes et participent à la mémorisation
douloureuse. La crème EMLA* , simple efficace, permet d’améliorer le confort des sujets âgés pour ces soins
répétitifs.
BIBLIOGRAPHIE
1. H.Merskey, N.Bogduk. Classification of chronic pain, 2nd Ed. IASP Press, Seattle, 1994, 11.
2. S.Donnadieu. Traitement de la douleur en cancérologie. In J.M.Andrieu. Cancers, Paris, Estem éd., 1997, 220-
236.
3. Ba.Ferrell, Br. Ferrell, L.Rivera. Pain in cognitively impaired nursing home patients. J. Pain Symptom
Manage, 1995, 10, 591-598.
4. A.N.A.E.S. Evaluation et suivi de la douleur chronique chez l’adulte en médecine ambulatoire. Texte de
recommandations. Douleurs, 2000, 1, 1, 7-15.
5. F. Hirszowski, F.Boureau. Nécessité d’évaluer la douleur en pratique quotidienne. Douleurs, 2000, 1, 1, 16-
18.
6. B.Wary et le collectif DOLOPLUS. Plaidoyer pour l’évaluation de la douleur chez les sujets âgés.
Gérontologie et Société, 1997, 78, 89-98.
7. A.Jean, R.Morello, M.Alix. Evaluation de la douleur du sujet âgé hospitalisé en long séjour. Rev Gériatr.,
1998, 23, 253-256.
8. J.L.Le Quintrec, M.Maga, A.Baulon. L’échelle simplifiée comportementale simplifiée (E.C.S.)- un nouvel
outil d’évaluation de la douleur en long séjour gériatrique. La revue de gériatrie, 1995, 20, 6, 363-368.
9. R.Gonthier. La morphine en gériatrie. La revue de gériatrie, 1997, 22, 8, 105-111.
10. S.Donnadieu, M.C.Djian. Traitement de la douleur. La presse médicale, 1998, 27, 39, 2062-2069.
11. P.Onghena, B.Van Houdenhove. Antidepressant-induced analgesia in chronic nonmalignant pain : a meta-
analysis of 39 placebo-controlled studies. Pain, 1992, 49, 205-219.
12. Y. Lazorthes, J.Sieffried, J.C.Verdie, J.Cassaux. La stimulation médullaire chronique dans le traitement des
douleurs neurogènes. Neurochirurgie, 1995, 41, 73-88.
13. Le Collège National des Enseignants de Gériatrie. Prise en charge de la douleur et des malades en fin de vie.
Corpus de Gériatrie, 2M2 éd., 2000, 1, 131-144.
14. S.Lefebvre-Chapiro, C.Trivalle, S.Legrain, D.Feteanu, R.Sebag-Lanoé. Particularités de la douleur et de sa
prise en charge chez les personnes âgées. La Presse Médicale, 2000, 29, 6, 333-339.
15. J.Glowinski. Douleur arthrosique du sujet âgé. La revue du généraliste et de la gérontologie, 2000, 7, 64,
170-178.
16. A.Madjlessi. Douleurs après amputation : littérature fantôme en gériatrie. La revue du généraliste et de la
gérontologie, 2000, 7, 64, 170-178.

17. J-M Gomas. Etude des traitements morphiniques chez 200 patients en unité de soins palliatifs gériatriques.
Congrès mondial Pain clinic, 1998
18. Becchio J, Joussellin Ch. De la nouvelle hypnose à l’Hypnose Psychodynamique. Edition DDB, 2002
19. RainvilleP. Carrier B. Hofbauer RK, Bushnell MC, Duncan GH, Dissociation of sensory and affective
dimensions of pain using hypnotic modulation. ¨Pain ,82(1999) 159-17
20. Joussellin . Hypnose et douleur ( à paraître )
21. F. Le Roux . Psychomotricité et fin de vie . in Vieillissement et psychomotricité. Sous la dir.de J-M Albaret
et E. Aubert. Editions Solal, Marseille - 2001 pp 245-251.
22. Goumas, F. Le Roux, L. Pham Quang. Apports des thérapeutiques pychomotrices dans la prise en charge du
sujet âgé douloureux. Infokara n° 61, 1/2001, pp 15-26
1
/
4
100%