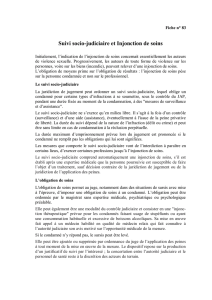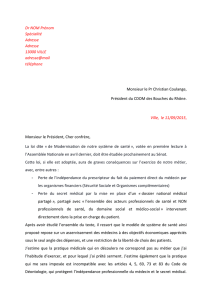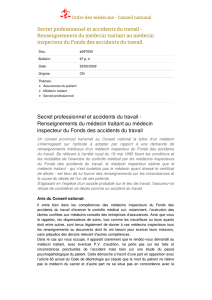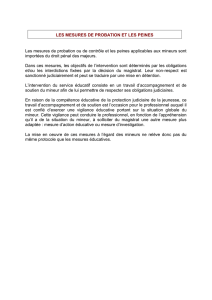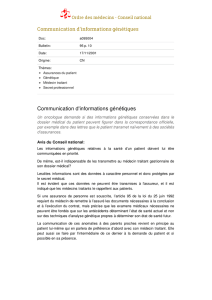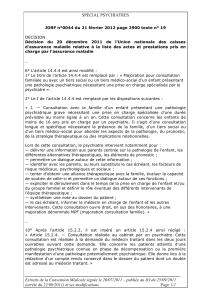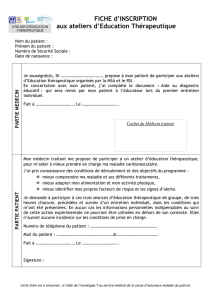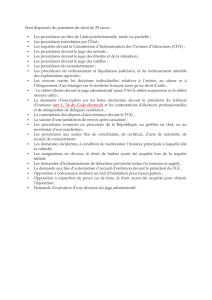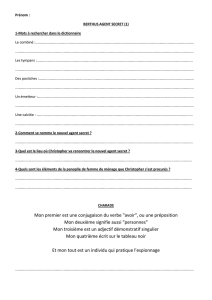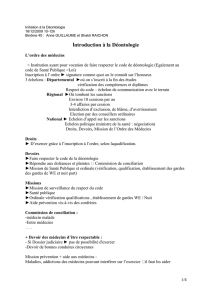QUEL EST LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE DES

LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE
DU TRAITEMENT DES AUTEURS D’AGRESSION SEXUELLE
EN DEHORS ET DURANT LA JUDICIARISATION
Problème du secret professionnel et de la responsabilité du psychiatre
Par le Docteur Marcel DANAN,
Président du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins de l’Hérault
Expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER
Médecin Coordonnateur.
C’est une gageure que de traiter un tel sujet pour une conférence de consensus !
Recommander à un médecin d’appliquer la déontologie est superflu voire injurieux :
n’a-t-il pas prêté serment de le faire. Il en est de même pour le droit, nul n’étant
sensé ignorer la Loi. Par contre, lorsqu’il s’agit d’éthique les avis peuvent et, pourquoi
pas, doivent diverger. On ne peut imposer une éthique, on doit susciter une réflexion
sur la signification de nos actes en tenant compte de leurs tenants et aboutissants.
« Nous avons tout à gagner à remplacer la pure déclaration de bonnes intentions par
une réflexion éthique complexe » écrit Monique CANTO-SOERBER(1), spécialiste de
la philosophie antique et morale, pour laquelle il n’y a pas de différence
fondamentale entre l’éthique et la morale dès lors qu’il s’agit de réfléchir. Paul
RICOEUR(2), par contre, tient à la nécessité de disposer de deux termes. Pour lui le
terme « éthique » doit s’employer par rapport à un point fixe, « le noyau »
représentant le concept de morale qui est le terme fixe de référence auquel il assigne
une double fonction « …celle de désigner, d’une part, la région des normes,
autrement dit des principes du permis et du défendu, d’autre part, le sentiment
d’obligation en tant que face subjective du rapport d’un sujet à des normes ». Ce
concept d’éthique est clivé par P. RICOEUR entre « l’éthique antérieure (ou
fondamentale) pointant vers l’enracinement des normes dans la vie, et dans le désir
[et] l’éthique postérieure [ou appliquée] visant à insérer les normes dans les
situations concrètes ». Appliquée à la médecine cette perspective fait apparaître
l’acte médical comme ayant un triple encadrement normatif : Code de Déontologie
Médicale, savoir médical et règles administratives. En amont (éthique antérieure) se
trouve « la sollicitude, qui demande que secours soit porté à toute personne en
danger ». C’est là, pour notre thème, celui des agresseurs sexuels, que le débat et la
réflexion commencent. Vers qui va se porter la sollicitude : vers l’agresseur (présumé
innocent tant qu’il n’a pas été condamné) ou l’agressé parfois inconnu du psychiatre,
ou les deux ? Le psychiatre va avoir à sa disposition un certain nombre de textes,
que nous jugeons indispensable de rappeler, et sa conscience.
Je remercie le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui m'a fourni la jurisprudence et le
Professeur Christine LAZERGES, vice-présidente de l'Assemblée Nationale qui a mis à ma disposition
les textes de loi et ceux des débats parlementaires préalables.

2
Traiter un agresseur sexuel avant la judiciarisation est un exercice redoutable voire
impossible sinon périlleux pour le psychiatre. A ce stade il s’agit plutôt du
traitement… de l’information recueillie auprès du consultant ou reçue de son
entourage. Nous étudierons tous les cas de figure possibles en soulignant la
complexité des situations.
Traiter un agresseur sexuel durant la judiciarisation est plus facile sur le plan de la
responsabilité professionnelle, mais va confronter le thérapeute à de multiples cas de
conscience même s’il a l’appui des lois.
CADRE DEONTOLOGIQUE
Le Code de Déontologie médicale actuel (décret n° 95-1000 du 06 septembre 1995 –
J.O. du 08 septembre 1995) modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (J.O. du
22 mai 1997) insistait sur l’affirmation des droits du malade, la nécessité de les
informer et de les protéger. Il a intégré les apports de la jurisprudence et les
références aux législations intervenues depuis 1979 (année du précédent Code de
Déontologie).
Les articles suivants sont plus particulièrement à respecter lorsqu’il s’agit des
agresseurs sexuels et de leurs victimes :
Article 4 : «Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout
médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Article 43 : «Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt
de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».
Article 44 : «Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est
appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les
plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il
s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf
circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires,
médicales ou administrations ».
Article 28 : «La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance
est interdite». Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté.
Article 51 : "Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les
affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients".
Article 5 : «Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous
quelque forme que ce soit ».

3
Article 6 : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir
librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice d ce droit ».
Article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les
investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir
informé le malade de ses conséquences… ».
Chacun de ces articles soulève un débat éthique car dans la pratique les choses ne
sont pas toujours simples aussi bien pour ce qui concerne le secret professionnel, le
signalement des faits venus à la connaissance du médecin, la protection de l’enfant,
des incapables majeurs, le libre choix du patient et le consentement du malade
auquel on propose un soin.
Par ailleurs le Code de Déontologie fait référence aux lois existantes lors de sa
promulgation d’où une difficulté supplémentaire : qu’en est-il de l’aspect déontologie
des lois votées après la parution du C.D.M. en attendant la parution, en préparation,
du prochain Code.
LE CADRE JURIDIQUE
1° - Le Code actuel de Déontologie a intégré les articles du Code du 1er mars 1994 :
Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une
personne qui en est dépositaire, soit par état soit par profession, en raison d’une fonction
ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F
d’amendes ».
Article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable : premièrement à celui qui
informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de sévices ou privations
dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique, deuxièmement au médecin qui avec l’accord de la victime
porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a
constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».
Il existe donc des dérogations légales au secret professionnel.
Article 223-6 : est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amendes
« quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril
l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours".
Article 434-1 : sur la non dénonciation de crime : « Le fait pour quiconque ayant
connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets,
ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient

4
être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F d’amendes. …Sont exemptées des
dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l’article 226-13".
Article 434-3 : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements,
privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de protéger en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité, d’une déficience
physique ou psychique, ou d’une état de grossesse, de ne pas informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et 300.000 F
d’amendes. Sauf lorsque la loi en dispose en autrement, sont exceptées des dispositions
qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article
226-13 ».
Une circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie législative
du Code Pénal mentionne : « En excluant expressément des dispositions de l’article
434-3 les personnes tenues au secret professionnel, ce qui implique que la décision de
signalement est laissée à la seule conscience de ces personnes, le législateur a
notamment pensé à la situation des médecins. Il a ainsi estimé que ces derniers ne
devaient pas être obligés, sous peine de sanction pénale, de signaler des mauvais
traitements, afin d’éviter que les auteurs de sévices n’hésitent à faire prodiguer à l’enfant
les soins nécessaires par crainte d’être dénoncés ». L’ambiguïté peut donc
persister et ce d’autant que cette circulaire poursuit : « Il convient néanmoins de
rappeler que les dispositions de l’article 223-6 du nouveau Code réprimant la non
assistance à personne en péril sont applicables aux personnes soumises au secret
professionnel et qu’en cas de mauvais traitement mettant en danger la vie ou l’intégrité
physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable, un médecin ne saurait rester passif
sans encourir les peines prévues par cet article. La non application de l’article 434-3 ne
justifie donc pas l’absence de tout intervention de la part du médecin. Cette intervention
peut revêtir diverses formes et avoir par exemple pour objet l’hospitalisation de la victime.
Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives ou
judiciaires puisque l’article 226-14 lève le secret professionnel dans cette hypothèse ».
2° - Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des
infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
Cette loi qui n’a pas encore été prise en compte par le Code de Déontologie
médicale soulève divers problèmes de conscience faisant jouer un rôle considérable
aux médecins et en particulier aux psychiatres aussi bien traitants qu’experts. Nous
rappelons ci-dessous les principales dispositions de cette loi.
Il est inséré après l’article 131-36 du Code Pénal une sous-section 6 ainsi rédigée :
Article 131-36-1 : « Dans les cas prévus par la loi la juridiction de jugement peut
ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire comporte pour le
condamné, l’obligation de se soumettre sous le contrôle du Juge de l’Application
des Peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des
mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée
du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit
ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ».
Article 131-36-4 : « Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de
soins. Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est

5
établi après une expertise médicale ordonnée dans les conditions prévues par le
Code de Procédure Pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire
l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de
poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un
viol, de tortures ou d’acte de barbarie. Le Président avertit alors le condamné
qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il
refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application
du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Lorsque la
juridiction de jugement propose une injonction de soins et que la personne a été
également condamnée à une peine privative de liberté non assortie de sursis, le
Président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement
pendant l’exécution de la peine ».
Article 131-36-5 : « L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des
obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de
confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions
commises pendant l’exécution de la mesure ».
Article 131-36-7 : « En matière correctionnelle le suivi socio-judiciaire peut être
ordonné comme peine principale".
La loi complète l’article 721-1 du Code de Procédure Pénale : «Sauf décision du Juge
de l’Application des Peines, prise après avis de la Commission de l’Application des Peines,
les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins,
et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées
comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La loi introduit dans le Code de Procédure Pénale l’article 763-3 : « Le Juge de
l’Application des Peines peut également s’il est établi après une expertise médicale
ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un
suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l’objet d’un traitement, prononcer une injonction
de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour
meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte
de barbarie. Le Juge de l’Application des Peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne
pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse les soins qui lui seront
proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1
du Code Pénal pourra être mis à exécution ». Il s’agit donc de soins sous conditions.
Article 763-4 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la
suite d’une peine privative de liberté, le Juge de l’Application des Peines peut ordonner
l’expertise médicale de l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la
condamnation a été prononcée plus de deux mois auparavant. Le Juge de l’Application des
Peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des
dispositions de l’article 763-6, ordonner, d’office ou sur réquisition du Procureur de la
République, les expertises nécessaires pour l’informer sur l’état médical ou psychologique
de la personne condamnée. Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par
un seul expert, sauf décision motivée du Juge de l’Application des Peines ».
Article 763-5 : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-2 et
131-36-3 du Code Pénal (suivi socio-judiciaire) ou de l’injonction de soins, le Juge de
l’Application des Peines peut, d’office ou sur réquisitions du Procureur de la République,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%