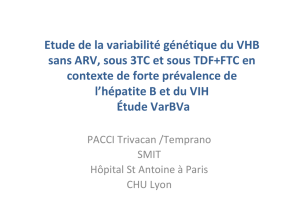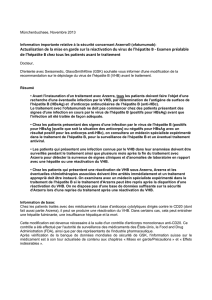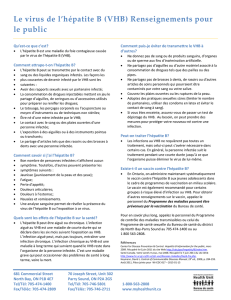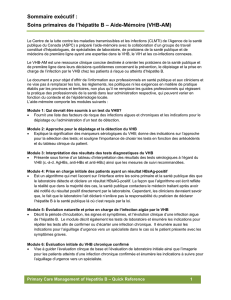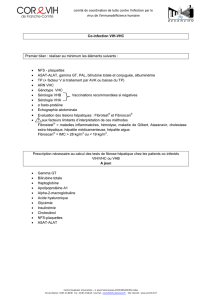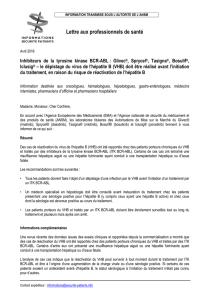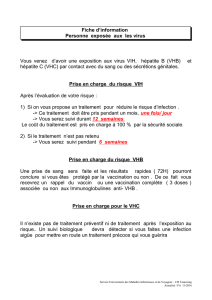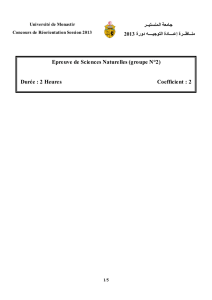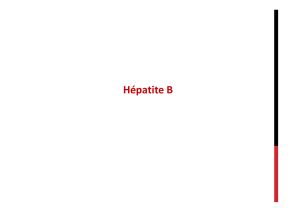Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

N. Goossens
F. Negro introduction
Le virus de l’hépatite B (VHB) est une cause majeure de morbi-
dité et mortalité dans le monde. Environ un tiers de la popula-
tion mondiale a une évidence sérologique d’infection pré sente
ou passée par le VHB et 5% de la population, soit 350-400 mil-
lions de personnes, sont porteurs chroniques de l’antigène de
surface du VHB (HBsAg).1 En Europe, la prévalence d’infection
chronique par le VHB s’étend de 0,1% en Irlande à 7% dans
certaines régions de Turquie.2 En Suisse, la prévalence de l’in-
fection chronique par le VHB est estimée à 0,7%.3
L’histoire naturelle du VHB dépend d’une interaction complexe
entre le virus et le système immunitaire de l’hôte. Ainsi, moins
de 5% d’adultes immunocompétents infectés par le VHB déve-
lopperont une hépatite B chronique, tandis que jusqu’à 90% des sujets infectés
dans la période périnatale évolueront vers une infection chronique.4
En raison de cette interaction entre l’hôte et le virus, toute situation diminuant
l’immunité de l’hôte, par exemple l’introduction de médicaments immunosup-
presseurs, est à risque de mener à une réactivation du VHB. Les répercussions
cliniques de cette réactivation virale sont parfois nulles, mais peuvent également
mener à une hépatite virale aiguë sévère, compliquée d’insuffisance hépatocel-
lulaire, voire de décès.
Vu la prévalence élevée du VHB et le risque de réactivation virale lors d’intro-
duction d’immunosuppresseurs, tout médecin de premier recours doit être familier
avec les notions de base sur la prise en charge de ces patients.
quelques définitions
La
réactivation
du VHB est un syndrome bien défini caractérisé par l’augmentation
de la virémie VHB (habituellement de plus de 1 log10 IU/ml) chez un patient
connu pour une infection VHB chronique ou même «guérie» (anticorps anti-HBs
positif).5 Une des causes fréquentes de réactivation du VHB est une diminution
de l’immunité de l’hôte, par exemple par des médicaments immunosuppres-
seurs ou liée au VIH.
Cette réactivation virale peut, ou non, être suivie d’une
poussée
d’hépatite, qui
se manifestera cliniquement par une élévation des transaminases (habituellement
définie à plus de trois fois la valeur de base) et histologiquement par une inflam-
mation et nécrose du parenchyme hépatique.5
Reactivation of hepatitis B associated
with immunosuppression
The hepatitis B virus is an important cause of
viral reactivation and flares in immunosup-
pressed patients. Factors associated with viral
reactivation include positive HBs antigen, ri-
tuximab treatment, onco-haematological pa-
thology and bone marrow transplantation. In
situations at high risk of viral reactivation pro-
phylactic antiviral therapy is indicated and
reduces morbidity and mortality related to
viral hepatitis flares.
Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1566-71
Le virus de l’hépatite B est une cause importante de réactivation
virale et de poussée d’hépatite chez les patients immunosup-
primés. Les facteurs fortement associés avec une réactivation
virale B sont l’antigène HBs positif, un traitement par rituximab,
une pathologie onco-hématologique ou encore une transplan-
tation de moelle. Dans les cas à haut risque de réactivation
virale B, l’introduction d’un traitement prophylactique antiviral
est indiquée et diminue la morbidité et la mortalité liées à une
poussée d’hépatite.
Réactivation de l’hépatite B
au cours de l’immunosuppression
le point sur...
1566 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 septembre 2013
Dr Nicolas Goossens
Pr Francesco Negro
Service de gastroentérologie
et hépatologie
Département des spécialités de
médecine (NG et FN)
Service de pathologie clinique
Département de médecine génétique
et de laboratoire (FN)
HUG, 1211 Genève 14
06_11_37348.indd 1 29.08.13 08:34

Esoméprazole-Mepha®
Les médicaments à l’arc-en-ciel
Pour un estomac en bonne santé
* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».
1 OFSP, LS, 1.12. 2012
Esoméprazole-Mepha® C: 1 Lactab® gastrorésistant contient 20 mg ou 40 mg d’ésoméprazole. I: Traitement curatif et prophylactique au long cours du reflux gastro-œsophagien.
Reflux gastro-œsophagien non érosif/ulcéreux. Éradication de Helicobacter pylori en association avec le traitement par antibiotiques approprié. Traitement de l’ulcère duodénal
associé à Helicobacter pylori. Prévention des récidives de l’ulcère associé à Helicobacter pylori. Traitement de l’ulcère gastrique induit par les ARNS, traitement prophylactique de
l’ulcère gastrique et de l’ulcère duodénal induits par les ARNS. Hypersécrétion pathologique y compris syndrome de Zollinger-Ellison et hypersécrétion idiopathique. P: Reflux
gastro-œsophagien: 1 fois par jour 40 mg pendant 4 semaines. En cas de besoin, poursuivre le traitement pendant 4 semaines supplémentaires. Prévention au long cours des réci-
dives de l’œsophagite: 1 fois par jour 20 mg. Reflux gastro-œsophagien symptomatique: 1 fois par jour 20 mg pendant 4 semaines au maximum. Traitement de l’ulcère duodénal
associé à Helicobacter pylori et prévention des récidives de l’ulcère associé à Helicobacter pylori: 7 jours de traitement avec prise respective 2 fois par jour 20 mg d’Esoméprazole-
Mepha®, d’1 g d’amoxicilline et de 500 mg de clarithromycine. Traitement de l’ulcère gastrique lié aux ARNS: 1 fois par jour 40 mg pendant 4 à 8 semaines. Traitement prophylactique
de l’ulcère gastrique et de l’ulcère duodénal lié aux ARNS chez les patients à risque: 1 fois par jour 20 mg. Hypersécrétion pathologique dont syndrome de Zollinger-Ellison et hyper-
sécrétion idiopathique: dose initiale de 40 mg 2 fois par jour. Adaptation individuelle de la posologie. Pour les indications posologiques particulières, cf. Compendium Suisse des
Médicaments. CI: Hypersensibilité connue à l’ésoméprazole, aux benzimidazoles substitués ou à d’autres composants du Lactab®. Allaitement. PC: Suspicion d’ulcère gastrique,
traitement par ARNS, «trithérapie» contre Helicobacter pylori, infections gastro-intestinales. EI: Céphalées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, nausées, vomissements.
IA: Kétoconazole, itraconazole, inhibiteurs du CYP2C19 (p.ex. diazépam, citalopram, imipramine, clomipramine, phénytoïne), warfarine, cilostazole, cisapride, antirétroviraux
(p.ex. atazanavir, nelfinavir, saquinavir). Liste: B. [0712]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter www.swissmedicinfo.ch. Vous trouverez d’autres
informations sur Esoméprazole-Mepha® à l’adresse de notre Service Littérature: [email protected]
Mepha Pharma SA, 4010 Bâle, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch
0513
Lactab® 20 mg Lactab® 40 mg
admis par les caisses maladie
nouveau
Vous trouverez les données
de bioéquivalence
et le profil de la préparation
sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,
Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*
58%
plus avantageux que l’original1
jusqu’à
plus avantageux que
le générique de l’original1
jusqu’à
26%
Esomeprazol_210x297+3_df_0513.indd 2 08.05.13 14:35
1006649
1006649_rms_ct.indd 1 10.05.13 08:05

physiopathologie
Le VHB est un virus à ADN avec un génome circulaire,
partiellement en double brin. Le gène S code pour l’anti-
gène de surface (HBsAg). Le gène C code pour l’antigène
core (HBcAg), tandis que la protéine precore, deviendra
l’antigène e (HBeAg). D’autres régions codent pour la poly-
mérase virale et la protéine X.
Lors d’une infection par le VHB, si l’hôte ne guérit pas
spontanément, il développera une hépatite B chronique.
L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique peut être di-
visée en plusieurs phases, pas nécessairement séquen-
tielles. La
phase immunotolérante
est caractérisée par une
virémie élevée et des transaminases basses reflétant l’ab-
sence d’inflammation hépatique. Cette phase est suivie de
la
phase immunoréactive HBeAg positive
avec une diminution
de la virémie et des transaminases élevées ou fluctuantes
associée à une inflammation hépatique et une progression
de la fibrose. La
phase de porteur inactif
présente une virémie
VHB basse ou indétectable avec des transaminases nor-
males et un anticorps anti-HBe positif, à différencier de
l’
hépatite B chronique HBeAg négative
caractérisée par des
fluctuations de la virémie VHB et des transaminases si-
gnant une maladie évolutive et des mutations dans le
génome viral rendant impossible la sécrétion de l’HBeAg.
Rarement, le patient perdra spontanément l’HBsAg pour
aboutir à l’apparition des anticorps anti-HBs. Dans cette
dernière phase, bien que la virémie VHB plasmatique soit
négative, les techniques modernes d’analyse moléculaire
ont permis de mettre en évidence de l’ADN viral intrahé-
patocytaire persistant parfois à long terme dans le noyau
hépatocytaire et pouvant mener à une infection par le VHB
«occulte». Cette dernière explique les (rares) cas de réac-
tivation VHB chez les patients HBsAg négatifs.6
Chez les patients immunosupprimés, l’histoire naturelle
de l’infection chronique par le VHB pourra être différente
du patient immunocompétent. Les mécanismes menant
aux réactivations virales dans le cadre d’une immunosup-
pression sont incomplètement compris mais comprennent
la diminution de la réponse immune contenant la réplica-
tion virale et un segment sensible aux corticoïdes dans
l’ADN viral stimulant la réplication et la transcription vi-
rales.7
situations associées à la réactivation
du vhb
De nombreuses situations cliniques sont associées à une
réactivation du VHB, y compris la co-infection par le VIH,
l’histoire naturelle de l’infection chronique par le VHB, l’in-
fection par d’autres virus hépatotropes et finalement l’im-
munosuppression. Nous nous concentrerons ici sur l’immu-
nosuppression, surtout dans le contexte de médicaments
immunosuppresseurs pour le contrôle d’affections auto-
immunes ou de chimiothérapies oncologiques.
Chimiothérapie
Dans une des premières séries prospectives, publiée en
1991, de 100 patients chinois recevant une chimiothérapie
d’induction pour un lymphome, 48% des patients préala-
blement positifs pour l’HBsAg et 3% des patients HBsAg-
négatifs ont développé une réactivation VHB. Parmi les 27
patients HBsAg-positifs, la réactivation du VHB était asso-
ciée à un ictère, à une insuffisance hépatocellulaire et à une
mortalité chez 22, 4 et 4% respectivement des patients.8 Le
sexe masculin était le seul facteur associé à un risque de
réactivation. Une revue systématique récente, incluant qua-
torze études et 475 patients HBsAg-positifs ayant une chi-
mio thérapie sans prophylaxie VHB, a démontré un taux de
réactivation moyen de 33% (24-88%) et une mortalité liée à
la réactivation VHB de 7%.9
Le rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20 utilisé
en onco-hématologie, rhumatologie ou encore en immuno-
logie, confère un risque élevé de réactivation virale B. Une
étude rétrospective de 115 patients, traités pour un lym-
phome avec des régimes à base de rituximab, a démontré
un taux de poussées du VHB de 80% chez les dix patients
HBsAg positifs, dont un décès.10 De plus, 4,2% des patients
HBsAg négatifs ont également développé des poussées
de VHB, dont deux menant à des décès (2,1% des patients
HBsAg-négatifs).
Un autre facteur de risque majeur pour la réactivation
VHB est la transplantation allogénique de moelle. Chez les
patients HBsAg-positifs, la réactivation virale VHB est qua-
siment universelle.11 Il y a également des cas décrits de
«séroconversion inverse», soit la perte des anticorps HBc et
HBs et l’apparition de la virémie VHB et de l’HBsAg. A noter
que chez les patients transplantés de moelle, la réactiva-
tion virale ainsi que la séroconversion inverse apparaissait
plus tard, jusqu’à 1-3 ans après la greffe de moelle.5
Immunosuppression pour pathologie
non oncologique
La réactivation VHB est rare dans le contexte d’un trai-
tement par azathioprine ou corticoïdes à faibles doses.
Toutefois, quelques cas de poussées sévères, voire fatales,
ont été décrits dans un contexte de traitement par métho-
trexate, surtout lors de l’interruption du traitement.5,12
La réplication virale du VHB augmente sous traitement
de corticoïdes. Sous traitement, la réplication virale aug-
mente, puis diminue à l’arrêt du traitement. Cette diminu-
tion est accompagnée d’une élévation des transaminases
avec un pic à 4-6 semaines après l’interruption du traitement
corticoïde.13
Les traitements biologiques sont utilisés en rhumato-
logie, dermatologie et gastroentérologie et comprennent
les anti-TNFa et d’autres anticorps monoclonaux bloquant
l’action de produits biologiques impliqués dans la patho-
genèse inflammatoire de nombreuses maladies. Dans une
série prospective de patients avec une maladie de Crohn,
traités par infliximab, deux patients sur trois HBsAg-positifs
ont développé une poussée sévère du VHB et un patient
est décédé.14 A noter que les poussées sont apparues à
l’interruption du traitement d’infliximab. Des rapports de
cas concernant l’adalimumab et l’étanercept démontrent
également un potentiel de réactivation du VHB sans fatalité
documentée pour l’instant.15
L’immunosuppression associée à la greffe d’organe est
fortement liée à la réactivation du VHB. Ce sujet spécialisé
ne sera pas plus discuté ici, car ces patients nécessitent
d’emblée un suivi dans un centre spécialisé.
1568 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 septembre 2013
06_11_37348.indd 2 29.08.13 08:34

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 septembre 2013 1569
Facteurs de risque de réactivation du VHB
L’antigène HBe positif ainsi qu’un niveau élevé de virémie
VHB sont associés à un risque plus élevé de réactivation
virale. Par ailleurs, le sexe masculin, un traitement par
rituximab, les pathologies hématologiques et une trans-
plantation de moelle sont tous associés à un risque plus
élevé de réactivation du VHB.
prise en charge pratique
Les sociétés hépatologiques européenne et américaine
ont édicté des recommandations de prise en charge des
patients VHB recevant un traitement immunosuppres-
seur.16,17 La stratégie thérapeutique développée ci-des-
sous (figure 1, tableau 1) est conforme à ces recommanda-
tions, bien qu’elle soit adaptée au contexte local.
Qui dépister ?
En accord avec la Société européenne d’hépatologie
(European Association for the Study of the Liver, EASL) nous
recommandons un dépistage du VHB à tous les patients
candidats à une chimiothérapie ou une immunosuppression,
y compris par des agents biologiques.16 Le dépistage devrait
comporter au moins l’antigène HBs et les anticorps anti-HBs
et anti-HBc. Si un de ces marqueurs est positif, un dépistage
sérologique du VHB complet devrait être effectué (ADN
VHB, HBeAg, Ac anti-HBe et, selon la situation clinique, un
dépistage de l’hépatite D).
Si le dépistage du VHB est négatif, une vaccination contre
ce virus est fortement recommandée, en accord avec le plan
de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique.18
Malgré les recommandations, le dépistage du VHB,
avant introduction d’immunosuppresseurs, est loin d’être
univer sel. Ainsi, une étude australienne a démontré que
seuls 19% des oncologues recherchaient le VHB chez tous
les patients avant une chimiothérapie,19 tandis que 69%
des rhumatologues nord-américains déclaraient un dépis-
tage systématique du VHB avant introduction d’un traite-
ment immunomodulateur.20
Pourquoi traiter ?
De multiples études ont mis en évidence le bénéfice à
introduire un traitement préventif chez les patients à risque
d’une réactivation du VHB dans le contexte d’une immuno-
suppression. Une revue systématique a démontré le béné-
fice de la lamivudine, un analogue nucléosidique, dans ce
contexte. Cette revue a inclu quatorze études (deux études
randomisées contrôlées, huit cohortes prospectives et quatre
rétrospectives) avec 275 patients dans le bras lamivudine
et 475 patients contrôles.9 Aucun patient dans le groupe
lamivudine n’a développé une insuffisance hépatique liée
au VHB, contre 13% des patients du groupe contrôle. Par
ailleurs, la mortalité attribuée au VHB était de 2% dans le
groupe lamivudine mais de 7% dans le groupe contrôle.
Aucun effet secondaire important de la lamivudine n’a été
rapporté dans cette revue.9
Ainsi, le traitement prophylactique du VHB par lamivu-
dine dans un contexte d’immunosuppression est efficace,
sûr et simple à administrer (un comprimé quotidien).
Qui traiter ?
Le risque de réactivation du VHB dépend du type et de
la durée de l’immunosuppression, de facteurs liés à l’hôte
et de l’histoire naturelle du VHB (tableau 1).
Bien que tous les immunosuppresseurs augmentent
potentiellement le risque d’une réactivation du VHB, nous
avons noté précédemment le risque plus élevé lié à certaines
Figure 1. Indication à un traitement prophylactique
du VHB dans le cadre d’une immunosuppression
Situations cliniques HBsAg ou ADN viral + HBsAg -, anti-HBc + Anti-HBs+, HBsAg-
Chimiothérapie oncologique Risque élevé Risque modéré Risque faible
Transplantation de moelle Risque élevé Risque modéré Risque faible
Transplantation d’organes Risque élevé Risque modéré Risque faible
Immunosuppression à base de rituximab Risque élevé Risque modéré Risque faible
Immunosuppression pour maladies auto-immunes Risque élevé Risque faible Risque faible
(par exemple : agents biologiques, MTX, azathioprine)
Traitements de corticoïdes de courte durée (l 2 semaines) Risque faible Risque faible Risque faible
Tableau 1. Risque de poussée du VHB dans un contexte d’immunosuppression
HBsAg : antigène HBs ; anti-HBc : anticorps anti-HBc ; MTX : méthotrexate ; + : positif ; - : négatif.
06_11_37348.indd 3 29.08.13 08:34

thérapies. Ainsi, un traitement de rituximab, une chimio-
thérapie d’induction pour une transplantation de moelle
ou le traitement d’une hémopathie maligne sont tous des
facteurs de risque importants pour une réactivation du VHB.
De plus, l’utilisation de corticoïdes, surtout en association
avec une chimiothérapie aplasiante, augmente également
le risque de réactivation.5 A noter que le sexe masculin est
également un facteur indépendant augmentant le risque
de réactivation du VHB.
Le risque de réactivation virale dépend également du
profil virologique de l’hôte. Les patients HBsAg positifs avec
une virémie positive (risque élevé de réactivation, tableau 1)
sont à plus fort risque de réactivation et devraient en gé-
néral bénéficier d’une prophylaxie antivirale. Les sujets
HBsAg négatifs, anticorps anti-HBc positifs et ADN négatifs
peuvent bénéficier d’un suivi rapproché avec des transa-
minases et une virémie VHB tous les un à trois mois. Un
traitement antiviral devrait être débuté en cas de réactiva-
tion virale ou de poussée d’hépatite. Certains experts pré-
conisent un traitement antiviral prophylactique par un ana-
logue nucléos(t)idique chez ces patients, en cas d’utilisa-
tion de rituximab ou en présence d’hémopathie maligne
au vu du risque important de réactivation.16 Les patients
présentant un anticorps anti-HBs positif sans HBsAg ou vi-
rémie VHB peuvent être suivis cliniquement, bien que des
cas décrits de séroconversion inverse ont été rapportés
(voir précédemment).
En pratique, les facteurs de risque majeurs cités précé-
demment sont des situations à risque élevé de réactivation
indiquant un traitement prophylactique (tableau 1). Les
situations à risque modéré de réactivation sont des situa-
tions moins claires où l’indication à une prophylaxie anti-
virale doit être individualisée pour chaque patient et les
situations à faible risque de réactivation n’indiquent en gé-
néral pas de traitement prophylactique (figure 1). Dans les
situations de risque modéré, si un traitement prophylactique
n’est pas prescrit, un suivi clinique et biologique rapproché
est indiqué. Par ailleurs, il y a une indication formelle à
traiter rapidement un patient qui développe une réactiva-
tion virale, voire une poussée d’hépatite, lors d’un traite-
ment immunosuppresseur. En cas de poussées sévères
avec insuffisance hépatocellulaire, le patient devrait être
hospitalisé et un transfert dans un centre spécialisé doit
être discuté.
Comment traiter ?
Si l’indication à débuter un traitement préventif d’une
réactivation du VHB est retenue, le traitement devrait être
débuté rapidement, si possible dès le début de l’immu-
nosuppression. En effet, une étude randomisée ayant éva-
lué un traitement antiviral préventif versus un traitement
symptomatique (soit un traitement débuté lors d’une réac-
tivation virale ou d’une poussée d’hépatite) a démontré un
taux d’hépatite sévère liée au VHB de 0 versus 36% en fa-
veur du traitement préventif.21
Le médicament antiviral le plus étudié pour le traitement
prophylactique du VHB est la lamivudine, notamment dans
la revue systématique citée précédemment.9 Toutefois, le
risque de développement de virions mutants résistant à la
lamivudine limite son utilisation à des situations avec une
virémie faible (l 2000 IU/ml) et une durée d’immunosup-
pression courte.16 Par contre, les patients avec une virémie
VHB élevée et/ou une durée prolongée d’immunosuppres-
sion devraient bénéficier d’antiviraux engendrant peu de
résistances virales (par exemple, l’entécavir ou le ténofovir).
Il est important de noter que l’interféron est en général
contre-indiqué dans ces situations.
La durée de la prophylaxie antivirale demeure sujette à
débat. Dans une étude prospective, chez 46 patients HB-
sAg positifs traités par lamivudine pendant la durée de
l’immunosuppression suivie d’une médiane de 3,1 mois
après interruption de l’immunosuppression, les facteurs
prédictifs de réactivation virale à l’arrêt du traitement de
lamivudine étaient une virémie VHB élevée (L 2000 IU/ml,
risque relatif de 16 !) avant le début de la lamivudine et
l’HBeAg positif.22 En pratique, le traitement antiviral doit
se poursuivre pendant une durée de douze mois après arrêt
des immunosuppresseurs, particulièrement dans les situa-
tions à risque élevé de réactivation virale.16 Par ailleurs, la
durée du traitement antiviral doit évidemment prendre en
compte les indications indépendantes de l’immunosup-
pression.
conclusion
La réactivation virale et les poussées du VHB survenant
dans un contexte d’immunosuppression ont une morbidité
et mortalité significatives. Cette morbidité est évitable par
des mesures simples et peu d’effets secondaires. Toute
introduction de médicaments immunosuppresseurs doit
faire rechercher, de façon réflexe, une potentielle infection
par le VHB et discuter de l’introduction d’un traitement
prophylactique du VHB en cas de dépistage positif. En cas
de doute ou de situation complexe, un avis spécialisé est
justifié.
1570 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
4 septembre 2013
Implications pratiques
Tout patient à risque de recevoir un traitement immunosup-
presseur doit bénéficier d’un dépistage du VHB (au minimum
HBsAg, anticorps anti-HBs et anti-HBc)
Si le dépistage est négatif (anticorps anti-HBs, HBsAg et an-
ticorps anti-HBc négatifs) un vaccin pour l’hépatite B doit
être proposé
Si l’HBsAg est positif et qu’une immunosuppression significa-
tive va être introduite, un traitement prophylactique pour
prévenir la réactivation du VHB doit être proposé
La plupart des patients sous prophylaxie VHB devraient re-
cevoir un analogue nucléos(t)idique connu pour engendrer
peu de résistances virales (par exemple, entécavir ou téno-
fovir). L’interféron est le plus souvent contre-indiqué dans ce
contexte
La durée du traitement antiviral est de douze mois après la
fin de l’immunosuppression
>
>
>
>
>
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec
cet article.
06_11_37348.indd 4 29.08.13 08:34
 6
6
1
/
6
100%