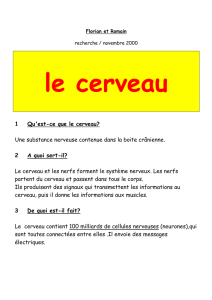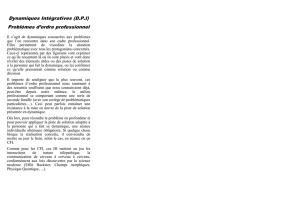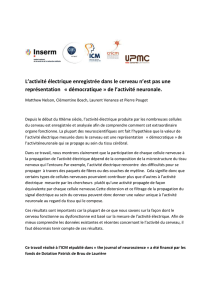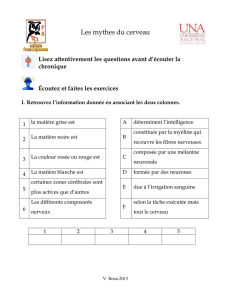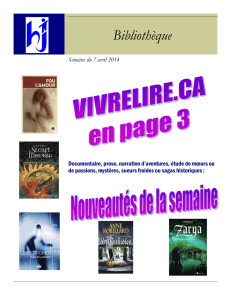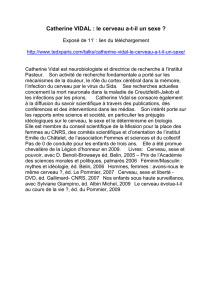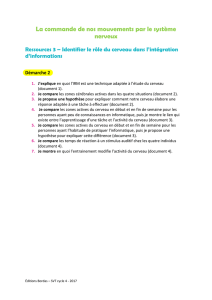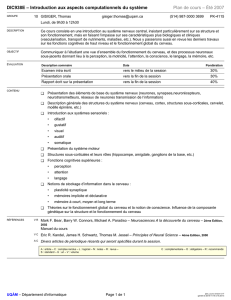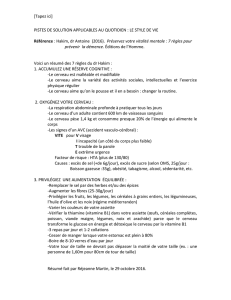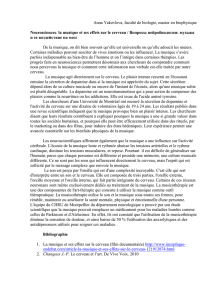celui, ceux, celle, celles qui /que, c`est-à

c’est, ce fut, c’était…
ce + pr. relatif, .. qui , que/qu’ , dont…
celui, ceux, celle, celles qui /que,
c’est-à-dire (que)…
….ceci, cela…
…
in Chapitre 8. Physiologie du cerveau p.p. 113-134,
Les sciences du cerveau par Paul Chauchard (Dunod, Paris, 1966)
Cf. ce.pdf

c’est, ce qui/que, celle qui/que, c’est-à-dire (que)…
in Chapitre 8. Physiologie du cerveau 113-134, Les sciences du cerveau par Paul Chauchard (Dunod, Paris, 1966)
06/05/2016
2
c’est + art.ou démonstratif + nom 117, 118, 119, 120 x 5 , 123, 124, 125, 126, 129, 131,
134)
c’est + pr. pers compl. (130)
c’est + nom propre + qui… (124) c’est + subst. + qui… (124)
c’est donc cela + subst. (122)
c’est ici que (114)
c’est d’abord + art + subst.. (117)
c’est là + art + subst.. (115)
c’est + prép. + subst.. (123)
c’est de + infinitif (113
c’est ce qui… (131)
c’est que (124, 127)
c’était + inf. + que .. (126)
ce fut (113, 125, 130)
ce que c’est (120)
ce n’est que.. (113)
locution : c’est le fait des… (120)
c’est donc cela + subst.. (122)
et pour cela (118)
ceci + verbe (115)
tout ceci + verbe (116)
et ceci déjà (134)
celui que … / celui qui… celles qui, que../ ceux qui, que… ø celui, celle, ceux , celles :
ceux qui (134) ceux (113)
celle qui… + verbe (114 x 2)
celui-ci (128, 130)
celui de… (130)
celui du (133)
celle-ci (117, 128)
celle de (121, 128, 134) celles à (128)
celles du (118)
celles des (119)
à celle (+ p.p.) (122)
c’est-à-dire…. (113x2, 117, 118, 120 , 125, 127) c’est-à-dire que … (116, 117)
ce que sont (114) ce qui, ce que/qu’ :
ce que c’est (120)
ce qu’ + pr. pers. + verbe 118)
ce que + art + subst.. + verbe (118)
ce qui + verbe (116x2, 117, 120, 126x2, 128, 131, 132)
ce qui + verbe +….c’est (que)… (113, 124)
c’est ce qui + pr. pers. + verbe (131)
pour tout ce qui + verbe (132)
de ce qui (132)
ce dont (132) ce dont , ce + prép. + quoi :
ce à quoi (132) / ce en quoi (128)
adjectifs
démonstratifs :
ce, cet, cette,
ces + substantif
ce (113, 118, 119,
120, 122, 123 x 2, 124,
126, 129, 132)
cet (113, 123, 128,
134)
cette (114, 117, 118
x 3, 119 x 2, 120 x 5,
124, 125, 126, 128 x 2,
130, 131 x 2)
ces (113, 118 x 4,
120 x 2, 121, 122,
123 x 2, 124 x 2, 134)

c’est, ce qui/que, celle qui/que, c’est-à-dire (que)…
in Chapitre 8. Physiologie du cerveau 113-134, Les sciences du cerveau par Paul Chauchard (Dunod, Paris, 1966)
06/05/2016
3
113. Comme un moyen pour mieux comprendre les fonctions du cerveau, c’est-à-dire la physiologie
de cet organe.
113. Ce n’est qu’au XIXe siècle qu’on a commencé à expérimenter, c’est-à-dire à voir les effets
d’ablations…, puis ceux d’excitations
113. Ce fut, inauguré par Broca, la découverte des localisations motrices…
113. Ce qui est de son domaine c’est de préciser la localisation dans le cerveau des commandes
motrices et des réceptions sensorielles…
113. …ce rêve n’a jamais abouti, et le physiologiste n’a jamais pu mettre en évidence que des
fonctions organiques.
113. La neurophysiologie classique…ne s’intéresse donc pas à ces phénomènes psychologiques.
114. Cette science ne nous dira certes jamais ce que sont en elles-mêmes la conscience et la pensée,
mais elle peut nous en préciser les mécanismes cérébraux.
114. Il y a maintenant deux neurophysiologies ; celle qui ne s’intéresse qu’à des fonctions
physiologiques simples, et celle qui travaille à nous préciser les mécanismes cérébraux des
comportements, de la conscience et de la pensée.
114. c’est ici que siège la formation réticulaire.
115. Mais l’animal mésencéphalique qui tient bien sur ses pattes n’a pas de psychisme, de
comportement, car c’est là la fonction des centres supérieurs ; écorce centrale, et noyaux gris
centraux.
115. Ceci explique que des lésions de surface qui séparent deux zones peuvent être sans effet car
elles sont restées réunies en profondeur.
116. A la régulation physiologique va se surajouter une régulation psychologique, un automatisme
de comportement, un instinct alimentaire ou sexuel. C‘est-à-dire que le besoin organique
inconscient va activer l’animal et lui interdire de demeurer en place. Circulant dans le milieu
extérieur, il va rencontrer ce qui peut satisfaire le besoin, alimentaire ou partenaire sexuel ; ce qui
déclenchera automatiquement le comportement voulu :

c’est, ce qui/que, celle qui/que, c’est-à-dire (que)…
in Chapitre 8. Physiologie du cerveau 113-134, Les sciences du cerveau par Paul Chauchard (Dunod, Paris, 1966)
06/05/2016
4
116. Tout autre apparaît le fonctionnement de l’écorce cérébrale…….Tout ceci est rendu possible
par la complexité du réseau neuronique cérébral où l’activité peut rester longtemps interne,
purement intracérébrale.
116/117. (le lobe frontal dans sa partie postérieure au voisinage de la scissure de Rolando)…On n’y
localise pas la volonté mais simplement des neurones moteurs qui peuvent être au service de celle-
ci, mais peuvent aussi fonctionner de façon involontaire.
117. Quand en neurochirurgie, sur le sujet éveillé, on excite cette zone, on déclenche un mouvement
dont le patient est conscient, mais qu’il n’estime pas avoir voulu. On localise donc ce qui
correspond à l’anatomie, c’est-à-dire le siège des neurones moteurs cérébraux actionnant les
muscles par l’intermédiaire des neurones moteurs de la moelle épinière.
117. Il existe deux types de motricité cérébrale. C’est d’abord une motricité de précision assurée par
les neurones pyramidaux qui vont directement se terminer dans la moelle.
117. la répartition des neurones psychomoteurs correspondant à tout le corps. C’est une répartition
somatotopique, c’est-à-dire que chaque région a sa place dans le cerveau.
118. L’excitation de cette zone cause des mouvements, sa lésion ne crée pas de paralysie…mais une
impossibilité des mouvements précis qu’assurent ces neurones.
En avant de cette aire motrice est l’aire prémotrice.
….
118. (corps striés) La répartition des ces neurones n’est pas aussi précise.
118. Nous avons de façon innée un pouvoir de motricité cérébrale ; ce pouvoir, il nous faut
apprendre à l’utiliser en formant les circuits neuroniques coordinateurs : ces circuits existent
virtuellement mais il faut les utiliser et pour cela les activer.
118. Une lésion de l’aire prémotrice praxique va donc faire disparaître, non la motricité, mais
l’aptitude au geste appris créant ainsi une apraxie…(par exemple : agraphie , anarthrie ou aphasie
motrice) C’est l’oubli de ce qu’il faut faire, de ce que l’enfant a appris pour écrire ou parler sa
langue. Les méthodes modernes ont permis d’apporter plus de précision dans la connaissance de ces
mécanismes…
118. Les praxies ordinaires sont bilatérales ; par contre celles du langage sont du seul côté
dominant : c’est-à-dire dans le cerveau gauche correspondant à la main droite pour les droitiers et à
droite pour les gauchers. On ignore la raison de cette dominance.
119. Ce problème de la dominance et de la répartition des praxies (et des gnosies sensorielles) entre
les deux hémisphères ainsi que leur coordination est encore mal connu.

c’est, ce qui/que, celle qui/que, c’est-à-dire (que)…
in Chapitre 8. Physiologie du cerveau 113-134, Les sciences du cerveau par Paul Chauchard (Dunod, Paris, 1966)
06/05/2016
5
119. Ajoutons que si la motricité volontaire ne concerne que la vie de relation, les expériences
d’excitation du cerveau comme celles des réflexes conditionnés ont montré que le cerveau renferme
aussi à leur place somatotopique des neurones concernant la motricité viscérale inconsciente:
119. En arrière, de l’autre côté de la scissure de Rolando c’est le lobe pariétal, que l’anatomie
spécialise dans la sensibilité générale (le « tact » au sens large).
119. (lobe pariétal) La lésion de cette zone crée une insensibilité localisée, son excitation crée chez
l’homme une hallucination tactile que l’homme décrit ;
119./120. Si les messages bien localisés de la sensibilité à la piqûre sont reçus dans cette zone, par
contre les autres douleurs (pincement, brûlure), mal localisées, résultent surtout d’un ébranlement
hypothalamique qui se communique à tout le cerveau d’où impossibilité de les faire disparaître…
120. De même que nous apprenons à coordonner nos mouvements, nous devons apprendre à donner
une signification aux messages de la sensibilité générale. C’est le fait des circuits neuroniques situés
dans ce même lobe pariétal en arrière et en bas. C’est la zone perceptive ou zone de gnosie. Une
lésion y supprime non la sensibilité mais la signification. Par exemple on reconnaît facilement les
yeux fermés un objet à la palpation, ce qui est impossible en cas de lésion de la zone gnosique
pariétale (agnosie) : le malade décrira tous les caractères de l’objet, mais n’en déduira pas
directement ce que c’est, sauf après long raisonnement intelligent (astéréognosie ou perte du sens
du relief). Les gnosies de cette zone ont une grand importance dont nous ne sommes pas pleinement
conscients….
120. C’est la coordination de tous ces messages de sensibilité générale qui nous permet de former
dans notre cerveau l’image de notre corps et de nous distinguer du monde extérieur. C’est un vrai
« moi cérébral » dont nous verrons l’importance dans la prise de conscience.
120./121. En psychiatrie on note des troubles graves de cette image du corps prise pour un double…
Cette zone est aussi très importante pour l’harmonie de l’articulation, elle est le siège du schéma
corporel vocal (Soulairac), c’est-à-dire de cette image sensible des positions des muscles pour les
divers phénomènes qui contribue à régulariser la voix parlée. C’est un second centre, cette fois
sensoriel, du langage. Son excitation chez l’homme éveillé, comme celle de tous les centres du
langage, perturbe les circuits nerveux et rend transitoirement incapable de parler le sujet qui parle,
tandis qu’elle est inapte à le faire parler s’il est / silencieux. Nous sommes ordinairement peu
conscients de ces régulations par les sensibilités liées à la phonation ; tout chanteur, au contraire, a
appris à les utiliser.
122. « C’est donc cela la lumière ! »
122. Les zones cérébrales du reste de l’aire occipitale sont gnosiques. ……permettant ainsi la
reconnaissance des formes, des couleurs, des objets et en particulier celle des lettres.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%