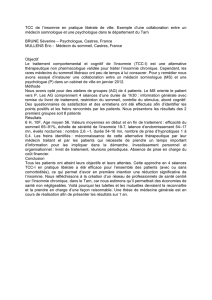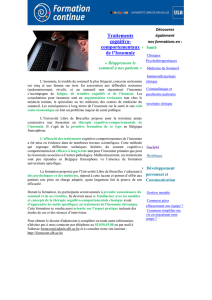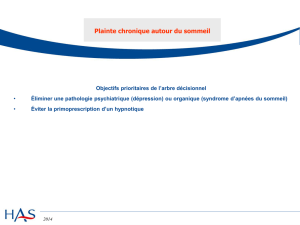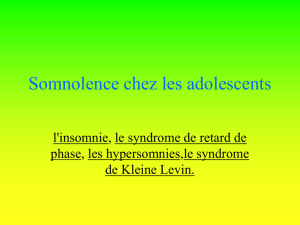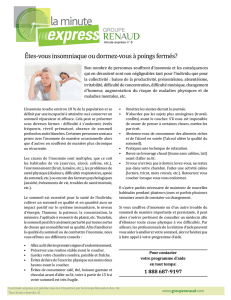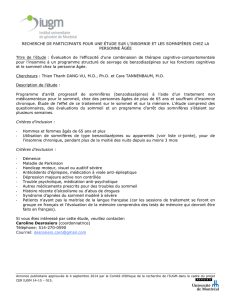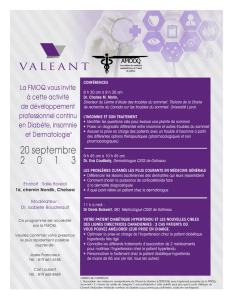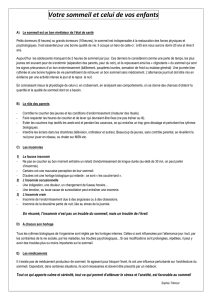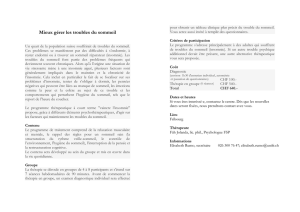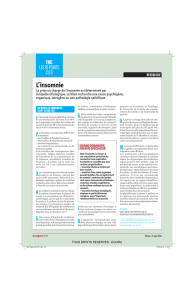Prise en charge comportementale de l`insomnie chronique

Prise
en
charge
comportementale
de
l'insomnie
Prise
en
charge
comportementale
de
Ilinsomnie
chronique
S.
Beaulieu-Bonneau,
É.
Fortier-Brochu,
C.
M.
Morin
Il)
(1)
Université Laval, Québec,
Québec, Canada
Correspondance :
Charles
M.
Morin,
Ph.
D.,
tcole
de psychologie,
Université Laval, Québec,
Québec, Canada G1K
7P4.
Téléphone: (418) 656-3275
Télécopieur: (418) 656-5152
Courriel :[email protected]
4
Résumé
L'insomnie est une plainte fréquente
en
pratique clinique. Qu'il
s'agisse
d'un trouble
primaire ou
associé
àune autre affection
médicale ou psychologique, l'insomnie
entraîne souvent
des
conséquences néfastes
pour
la
qualité
de
vie de l'individu.
Bien
que
le
traitement de première ligne repose
principalement sur
la
pharmacothérapie,
l'approche comportementale représente une
alternative efficace et souvent préférable pour
le
patient.
Cet
article fait
le
point
sur
la
thérapie cognitivo-comportementale
(TCC)
de
l'insomnie. Après avoir
passé
en
revue
quelques éléments-clés àinvestiguer dans
l'évaluation
de
la
plainte d'insomnie, on y
fait une brève description
des
principes
de
la
TCC
et de
ses
principales composantes
thérapeutiques, suivie d'une liste
des
preuves
empiriques appuyant cette forme d'inter-
vention.
Les
données principales indiquent
que
la
TCC
entraîne une réponse théra-
peutique chez environ
70%
à80%
des
patients,
avec
une réduction
des
symptômes
d'insomnie de
50%
à
60%.
Bien
que
la
TCC
demande plus
de
temps et d'efforts que
la
pharmacothérapie,
les
effets thérapeutiques
persistent plus longtemps après
la
fin
de
la
thérapie.
La
TCC
est
indiquée
dans
l'insomnie
chronique, dans
sa
forme primaire ou
associée
à
un
autre trouble médical ou psychologique.
Quelques recommandations pratiques afin de
faciliter l'observance
au
traitement
et
d'optimiser
la
réponse thérapeutique sont
formulées.
Mots-clés
Insomnie, prise
en
charge, thérapie
comportementale, thérapie cognitive.
Summary
Insomnia
is
aprevalent complaint
in
c1inical
practice.
Whether
its
presentation
is
as
aprimary
disorder or
as
acondition comorbid with
another medical
or
psychological
disorder,
insomnia
is
often
associated
with negative
consequences
impairing quality of
life.
Although
the
first line treatment
is
usually pharma-
cological
in
nature,
cognitive-behavior
therapy
((BT)
represents
an
efficacious and weil
accepted
non
pharmacological treatment
alternative.
This
paper
summarizes
the
current
status of cognitive-behavior therapy for
persistent
insomnia.
After
reviewing
key
issues
to
address
in
the
evaluation of insomnia
complaints,
abrief
description
of(BT
is
provided,
with
its
rationale
and
indications,
followed
by
a
summary of
the
evidence
supporting
this
therapeutic
approach.
Clinical
data
indicate
that
(BT
produces
atreatment
response
in
70%
to
80%
of
patients,
with
an
average
50%
to
60%
reduction
of
insomnia
symptoms.
Although (BT
is
more
time consuming and
requires
more
efforts
relative
to
pharmacotherapy,
therapeutic
benefits often persist
much
longer after
treatment completion.. (BT
is
indicated for
chronic insomnia, both
in
its
primary and
comorbid
subtypes.
Practical
recommendations
are
made
to
facilita
te
compliance with
treatment and
to
optimize therapeutic
outcomes.
Keywords
Insomnia,
management, behavioral
therapy,
cognitive
therapy.
MEDECINE
DU
SOMMEIL
-
Année
4-
Janvier
-
Février
Mars
2007

S.
Beaulieu-Bonneau,
É.
Fortier-Brochu,
C.
M.
Morin
L'insomnie est un problème de santé fort commun.
Plus
de
30
%
des
adultes présentent
des
problèmes de sommeil occasionnels
et près de
10
%souffrent d'insomnie chronique
(1,
2).
Or,
l'insomnie chronique est souvent associée àune détresse
psychologique accrue, à
des
problèmes de santé plus fréquents,
àune moindre qualité de vie, à
un
taux d'absentéisme plus élevé
ainsi qu'à une utilisation plus importante
des
services de santé
(3-5).
La
persistance
des
troubles de sommeil est également
associée àune augmentation du risque de développer
un
épisode de dépression majeure
(6).
Malgré une prévalence
élevée et
des
conséquences significatives
au
quotidien, peu de
patients consultent spécifiquement pour leurs difficultés de
sommeil
(1).
Lorsqu'une consultation est initiée auprès du
médecin de famille,
le
traitement de première intention est
habituellement de nature pharmacologique. Malgré l'efficacité
des médicaments hypnotiques
pour
traiter
les
problèmes
d'insomnie aiguë,
la
pharmacothérapie est plus controversée
pour l'insomnie chronique
en
raison
des
risques accrus de
tolérance, de dépendance et d'effets indésirables.
La
thérapie
cognitivo-comportementale
(TeC)
représente une alternative
non pharmacologique à
la
fois efficace et
sûre
qui peut s'avérer
très utile pour
le
médecin praticien confronté àune plainte
d'insomnie chronique (7,8).
Dans
ce
contexte, cet article
se
veut
une introduction aux différents aspects de
la
prise
en
charge
de l'insomnie chronique selon l'approche cognitivo-
comportementale. Après un survol
des
éléments centraux de
l'évaluation de
la
plainte d'insomnie,
les
principes fondamentaux
et
les
différentes composantes de
la
TeC
seront détaillés, et une
méthode visant àfaciliter
le
sevrage
des
hypnotiques
sera
brièvement présentée.
En
guise de conclusion, quelques
considérations cliniques et pratiques
dont
le
clinicien
doit
tenir
compte afin de favoriser
le
succès thérapeutique seront
discutées.
ÉVALUATION
DE
L'INSOMNIE
Selon
le
Manuel
diagnostique
et
statistique
des
troubles
mentaux
(DSM-IV-TR)
(9),
le
diagnostic d'insomnie repose sur une plainte
de difficultés d'endormissement, de maintien du sommeil ou de
sommeil non réparateur, difficultés qui persistent pendant
au
moins un mois.
Les
perturbations du sommeil ou
les
conséquences diurnes qui ysont associées doivent être à
l'origine
d'une
détresse marquée ou
d'une
altération du
fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines
importants.
Compte tenu du taux peu élevé de consultations spontanées
pour
les
problèmes de sommeil,
il
est souhaitable qu'une brève
évaluation du sommeil soit incluse d'emblée dans l'examen de
routine effectué par
le
médecin
(10).
Lorsqu'une difficulté de
sommeil est ainsi mise
en
évidence, certaines questions-clés
doivent
permettre d'en
obtenir
un tableau plus détaillé.
L'entretien clinique
doit
notamment
être posées afin de
caractériser
la
nature de
la
plainte d'insomnie (par
ex.,
problème
d'initiation et/ou de maintien du sommeil), l'horaire veille-
sommeil du patient (par
ex.,
heure d'endormissement, heure du
MEDECINE
DU
SOMMEIL
-
Année
4-
Janvier
-
Février
-
Mars
2007
Prise
en
charge comportementale de l'insomnie chronique
dernier réveil,
siestes),
les
conséquences de l'insomnie (par
ex.,
difficultés de concentration, fatigue, irritabilité), de même que
l'évolution temporelle de l'insomnie (par
ex.,
élément
déclencheur, durée, caractère persistant ou épisodique).
Insomnie
primaire
ou
co
morbide
Une fois
la
présence d'insomnie établie,
le
praticien devra
évaluer
s'il
s'agit d'une insomnie primaire ou associée àune
autre condition.
Le
diagnostic d'insomnie primaire peut être
posé lorsque
la
perturbation du sommeil
ne
survient
pas
exclusivement dans
le
contexte d'une autre pathologie du
sommeil, d'un autre trouble mental ou d'une affection médicale,
et
n'est
pas
liée aux effets physiologiques directs d'une
substance.
Dans
une perspective de diagnostic différentiel,
le
clinicien devra également rechercher
la
présence de symptômes
d'autres pathologies du sommeil (par
ex.,
apnée du sommeil,
mouvements périodiques
des
jambes), ainsi que
les
antécédents
médicaux et psychiatriques.
La
prise de médicaments pour
favoriser
le
sommeil, l'utilisation de substances (par
ex.,
alcool),
ainsi que
les
habitudes de vie (par
ex.,
exercice physique) doivent
également être évaluées
(11).
Agenda
du
sommeil
En
plus de l'entretien clinique du patient,
le
recours àl'agenda
du sommeil s'avère indispensable afin de caractériser l'horaire
veille-sommeil
du
patient, ainsi que
les
variations de
son
sommeil d'une nuit àl'autre. Àl'aide de cet agenda,
le
patient
doit
noter
quotidiennement
les
informations suivantes,
idéalement pendant une période d'une àdeux semaines avant
d'initier
le
traitement et pendant toute
la
durée du traitement:
heures et durées
des
siestes,
usage de médicaments ou d'alcool,
heure du coucher, estimation du temps nécessaire
pour
s'endormir, nombre et durée
des
éveils nocturnes, heure du
réveil et du lever, estimation de
la
qualité subjective du sommeil.
Ces
données pourront par
la
suite être utilisées pour établir un
niveau de
base
et évaluer
les
progrès du patient
au
cours du
traitement. Cet outil permettra également d'effectuer
l'ajustement hebdomadaire
des
procédures de restriction du
temps
au
lit
décrites plus loin. L'évaluation polysomno-
graphique peut être utile pour objectiver
la
plainte du
patient;
toutefois, cette évaluation est habituellement indiquée
uniquement lorsque l'entretien clinique
laisse
soupçonner
la
présence d'un autre trouble du sommeil
(12).
THERAPIE
COGNITIVO-COMPORTEMENTALE
Principes,
indications
et
objectifs
thérapeutiques
Le
déclenchement et l'évolution de l'insomnie dans
le
temps
reposent sur l'interaction de facteurs prédisposants, précipitants
et de maintien
(13).
Initialement, l'insomnie apparaît souvent
en
réaction àun événement de vie stressant (par
ex.,
deuil,
problèmes familiaux, difficultés
au
travail, etc). Pour
la
plupart
des
sujets,
le
sommeil retourne à
la
normale
avec
la
disparition
de l'événement précipitant ou
avec
l'adaptation à
la
situation
perturbatrice.
Or,
chez certaines personnes, particulièrement
5

celles
qui
sont
plus
vulnérables
à
présenter
une
insomnie,
différents
facteurs
de
maintien contribuent àentretenir
les
difficultés
de
sommeil
et
ce,
indépendamment
de
l'événement
précipitant.
Parmi
ces
facteurs
d'entretien,
notons
la
tendance
à
avoir
des
horaires
de
sommeil
irréguliers,
à
passer
un
temps
excessif
au
lit
dans
le
but
de
prévenir
ou
de
compenser
les
nuits
d'insomnie, à
faire
la
sieste
le
jour,
etc.
La
TCC
vise
précisément
à
désamorcer
ces
facteurs
de
maintien
afin
de
favoriser
le
retour à
un
sommeil
de
meilleure qualité.
Plus
spécifiquement,
la
TCC
vise
àcorriger
certaines
mauvaises
habitudes
de
sommeil,
à
réduire
l'activation physiologique
et
cognitive
au
coucher,
àrectifier
certaines
croyances
erronées
en
rapport
avec
le
sommeil
et
l'insomnie,
ainsi
qu'à
promouvoir
une
meilleure
hygiène
de
sommeil.
Description
des
procédures
thérapeutiques
Les
principales
composantes
de
la
TCC
de
l'insomnie
seront
décrites
brièvement
dans
cette
section.
Pour
une
description
plus
exhaustive,
le
lecteur
est
invité àconsulter d'autres
ouvrages
àl'intention
des
cliniciens
(14)
ou
des
patients
(15,
16).
Restriction
du
temps
au
lit -
Une
stratégie
à
laquelle
recourent
spontanément
certains
sujets
pour contrer
les
effets
de
leur
insomnie
consiste
àaugmenter
le
temps
passé
au
lit.
Bien
qu'utile àcourt
terme,
cette
stratégie
entraîne
éventuellement
un
sommeil
plus
fragmenté,
perpétuant
le
problème d'insomnie.
La
restriction
du
temps
au
lit
est
une
méthode relativement
simple
et
efficace
pour rétablir
la
continuité
et
la
qualité
du
sommeil.
Cette
procédure
consiste
àlimiter
le
temps
passé
au
lit
le
plus
près
possible
du
temps
réel
de
sommeil
(17)
(voir
tableau
1).11
s'agit
d'abord
de
déterminer
une
fenêtre
de
sommeil;
le
patient
ne
pourra
dormir
qu'à
l'intérieur
de
cette fenêtre
et
à
aucun
autre
moment,
et
ce
tous
les
jours,
y
compris
les
journées
de
congé.
La
durée
initiale
de
cette
fenêtre
de
sommeil
est
déterminée
en
calculant
la
moyenne
de
temps
dormi
par
nuit.
De
préférence,
cette
estimation
est
obtenue àpartir
de
l'agenda
du
sommeil
que
le
patient
aura
complété pendant
au
moins
une
semaine.
Donc,
si
la
durée
moyenne
de
sommeil
est
estimée
à6
heures
par
nuit,
sur
8
heures
passées
au
lit,
le
patient
devra
limiter
sa
fenêtre
de
sommeil
à6
heures
par
nuit pour
la
première
semaine
d'intervention.
Par
la
suite,
sa
durée
est
ajustée
de
façon
hebdomadaire,
étant
augmentée
d'environ
20
minutes
si
l'efficacité
du
sommeil
(pourcentage
du
temps
dormi
sur
le
temps
passé
au
lit) atteint
85%
ou
diminuée d'environ
20
minutes
si
l'efficacité
du
sommeil
est
inférieure à
80%.
"est
habituellement préférable
de
garder l'heure
de
lever
relativement
fixe
d'une
semaine
àl'autre
et
de
modifier l'heure
de
coucher; toutefois,
ce
paramètre
peut
être
modifié
selon
les
besoins
de
chacun
et
aussi
selon
le
type d'insomnie (initiale
vs.
matinale).
Afin
d'optimiser
les
effets thérapeutiques,
il
est
Tableau
1:
Procédures
comportementales
dans
le
traitement
de
l'insomnie.
Table
1:
Behavioral
procedures
for
treating
insomnia.
Restreindre
le
temps
passé
au
lit
au
temps
dormi
-
Permet
de
consolider
la
continuité
et
la
qualité
du
sommeil
1>Déterminer
une
fenêtre
de
sommeil:
-
Sur
la
base
d'un
agenda
du
sommeil
complété
par
le
patient pendant
au
moins
une
semaine,
calculer
la
moyenne
du
temps
dormi
par
nuit
(ex.,
6hOO),
la
moyenne
de
temps
passé
au
lit
(ex.,
8hOO)
et
l'efficacité
du
sommeil
(ex.,
75%).
-Délimiter
une
fenêtre
de
sommeil
correspondant à
la
moyenne
du
temps
dormi
(ex.,
6hOO)
et
déterminer apriori
l'heure
de
coucher
(ex.,
00h30)
et
l'heure
de
lever
(ex.,
6h30)
selon
le
type d'insomnie
et
les
préférences
du
patient.
2>
Ajuster
la
fenêtre
de
sommeil
chaque
semaine
selon
l'efficacité
du
sommeil
du
patient:
-Augmenter
la
fenêtre
de
sommeil
de
20
minutes
si
l'efficacité
du
sommeil
pour
la
semaine
précédente
est
supérieure
à
85%,
diminuer
de
20
minutes
si
elle
est
inférieure à
80%
et
maintenir
la
fenêtre
de
sommeil
stable
pour
une
autre
semaine
si
elle
est
entre
80%
et
85%.
-Modifier
la
fenêtre
de
sommeil
jusqu'à
ce
qu'une
durée
optimale
de
sommeil
soit
atteinte.
Réserver
au
moins
une
heure
de
détente
avant
le
coucher
-
Permet
d'éviter
de
provoquer
un
état d'activation.
-
Favorise
l'association
entre
les
indices
temporels
de
détente
et
le
coucher.
Aller
au
lit uniquement
lorsque
somnolent
-
Favorise
un
endormissement
rapide.
-
Nécessite
de
distinguer entre fatigue
et
somnolence.
Si
le
sommeil
ne
survient
pas
dans
les
15 à
20
minutes,
se
lever
et
faire
une
activité tranquille
dans
une
autre
pièce.
Retourner
au
lit uniquement
lorsque
somnolent.
-
Brise
l'association
entre
les
stimuli environnementaux (lit,
chambre)
et
l'insomnie.
-
Exige
de
privilégier
une
activité
calme
et
d'éviter toute activité stimulante.
Se
lever
à
la
même
heure
chaque
matin, et
ce
peu
importe
la
quantité
de
sommeil
obtenue
-
Permet
de
régulariser
le
cycle
veille-sommeil.
Réserver
le
lit et
la
chambre
à
coucher
uniquement
pour
le
sommeil
et
les
activités
sexuelles
-
Brise
l'association
entre
les
stimuli environnementaux (lit,
chambre)
et
l'éveil
(lecture,
télévision,
résolution
de
problèmes).
Éviter
de
faire
des
siestes
durant
la
journée
-
Renforce
l'homéostasie
du
sommeil
et
minimise
les
difficultés
de
sommeilla nuit
suivante.
6
MEDECINE
DU
SOMMEIL
-
Année
4-
Janvier
-
Février
-
Mars
2007

S.
Beaulieu-Bonneau,
É.
Fortier-Brochu,
C.
M.
Morin
essentiel de respecter
la
fenêtre de sommeil de façon rigoureuse
et quotidienne et de
ne
dormir
en
aucun autre moment.
Une
plus grande constance d'une nuit àl'autre
en
ce
qui atrait
au
temps
passé
au
lit et àl'heure du lever est
associée
àde meilleurs
progrès lors de l'application de cette intervention
comportementale
(18).
Initialement,
il
est possible que
la
durée
du sommeil soit légèrement diminuée, entraînant de
la
somnolence diurne.
Bien
qu'il
s'agisse
d'un effet transitoire,
la
durée de
la
fenêtre de sommeil
ne
doit jamais être inférieure à
cinq heures.
La
procédure
doit
également être appliquée
avec
précaution chez
des
gens pour qui
la
somnolence peut être
dangereuse (par
ex.,
opérateurs de machinerie lourde).
La
restriction du temps
au
lit entraîne rapidement
des
résultats
positifs
sur
la
continuité et
la
qualité du sommeil. Pour cette
raison,
il
est recommandé de débuter
le
traitement par cette
intervention et d'intégrer par
la
suite
les
instructions de contrôle
par
le
stimulus.
Thérapie
par contrôle
du
stimulus
-Pour certaines personnes
qui souffrent d'insomnie,
la
période qui précède l'heure du
coucher est souvent signe d'appréhension et l'environnement
de
la
chambre àcoucher est
associé
àl'activation mentale plutôt
qu'au sommeil.
Ce
conditionnement s'installe graduellement,
souvent àl'insu de
la
personne, et contribue à
la
chronicité du
problème.
La
méthode de
contrôle
par
le
stimulus
(19),
par un
processus de conditionnement,
vise
àrecréer l'association entre
les
stimuli temporaux et environnementaux et un
endormissement rapide.
Un
objectif parallèle est de régulariser
les
horaires de veille-sommeil.
Les
procédures de
base
du
contrôle par
le
stimulus, de même que leur rationnel, sont
présentées
au
tableau
1.
Une observance systématique et
rigoureuse de l'ensemble de
ces
procédures pendant plusieurs
semaines est indispensable àleur efficacité
(20).
Méthodes de relaxation
Un
niveau d'activation
particulièrement élevé peut constituer
un
obstacle de taille à
la
survenue du sommeil. Une telle hyperactivation
peut
se
présenter
le
jour
comme
la
nuit et prendre plusieurs
formes:
cognitive (par
ex.,
pensées intrusives, images répétitives),
émotionnelle (par
ex.,
anxiété) ou physiologique (par
ex.,
tension
musculaire).
Chez
certains individus dont
le
niveau d'activation
ou de tension contribue de façon significative àl'insomnie,
l'utilisation de
la
relaxation peut être indiquée et s'avérer
efficace, surtout lorsqu'elle est utilisée
en
association
avec
les
autres procédures comportementales.
Le
choix de
la
technique
de relaxation dépend notamment de
son
accessibilité (par
ex.,
équipement
nécessaire,
durée de l'entraînement) et du type
d'activation
en
jeu.
Par
exemple,
les
méthodes de biofeedback,
de relaxation musculaire progressive et d'entraînement
autogène ciblent l'activation physiologique, alors que des
techniques telles que
la
méditation et l'entraînement à
l'imagerie mentale visent davantage àréduire l'activation
cognitive. Initialement,
il
est préférable de pratiquer
la
technique
durant
la
journée afin d'éviter l'anxiété de performance et
des
attentes trop élevées par rapport
au
sommeil. Àl'étape de
l'entraînement, l'aide d'un spécialiste ou
le
recours àdes
enregistrements audio
ou
vidéo peut être bénéfique dans
le
but
de bien maîtriser
la
technique.
Par
la
suite,
la
relaxation peut être
MEDECINE
DU
SOMMEIL
-
Année
4-
Janvier
-
Février
-
Mars
2007
Prise
en
charge comportementale de l'insomnie chronique
implantée
au
moment du coucher ou
des
éveils nocturnes.
Les
résultats de
la
relaxation sont tributaires d'une application
rigoureuse et constante, et
ils
sont rarement immédiats.
En
outre,
l'ampleur
des
progrès est
assez
similaire indépendamment de
la
méthode privilégiée (21,22).
Hygiène
du
sommeil-
Le
sommeil est affecté par une multitude
de facteurs
associés
au
style de
vie,
tels que l'alimentation,
l'exercice,
la
consommation d'alcool, ainsi que d'autres facteurs
environnementaux
(ex.,
bruit, lumière, température).
Ces
facteurs
sont rarement suffisamment importants pour constituer
la
cause
principale de l'insomnie,
mais
ils
sont susceptibles d'exacerber
les
difficultés de sommeil engendrées par d'autres
causes.
Quelques recommandations de
base
d'hygiène
du
sommeil
peuvent réduire l'impact des facteurs interférant avec
le
sommeil (voir tableau Il).
De
façon générale,
les
recommandations d'hygiène du sommeil devraient être utilisées
de façon complémentaire àd'autres composantes
thérapeutiques.
En
effet, peu de données empiriques sont
disponibles concernant l'effet bénéfique de
la
seule adoption
d'une meilleure hygiène du sommeil chez
des
gens souffrant
d'insomnie
(23).
Tableau
Il
:
Hygiène
du
sommeil
Table
Il
:
51eep
hygiene recommendations.
-Éviter
la
caféine quatre à
six
heures avant l'heure du coucher
en
raison de
son
effet stimulant.
-Éviter de fumer àl'heure du coucher et lors
des
éveils
nocturnes.
-Ëviter de consommer de l'alcool
près
de l'heure du coucher
puisqu'il peut occasionner un sommeil plus fragmenté et
des
réveils matinaux prématurés.
-
Favoriser
l'activité physique durant
la
journée
ou
en
début
de
soirée,
mais
pas
en
fin de soirée puisque
cela
peut avoir
un effet stimulant.
-Privilégier
un
environnement confortable, sombre et calme
dans
la
chambre àcoucher.
Thérapie
cognitive -
En
plus des interventions de nature
comportementale décrites précédemment,
la
thérapie
cognitive
est fréquemment incluse dans
les
approches multimodales.
Cette approche psychothérapeutique repose
sur
le
postulat
selon lequel
la
façon dont une personne réagit à
ses
difficultés
de sommeil peut contribuer àleur chronicisation.
Par
exemple,le
fait d'interpréter l'insomnie comme une perte de contrôle ou de
porter une attention accrue à
tout
ce
qui atrait
aux
difficultés de
sommeil et àleurs conséquences peut provoquer une activation
émotionnelle, laquelle est habituellement nuisible
au
sommeil.
La
thérapie cognitive de l'insomnie
(24)
vise
àidentifier
les
croyances erronées et idées
reçues
par rapport
au
sommeil et à
l'insomnie, à
les
confronter et àguider
le
patient à
les
remplacer
par
des
cognitions plus adaptées.
Pour
ce
faire,
des
techniques
de restructuration cognitive
basées
sur
le
modèle classique
de
Beck
(25,
26)
sont utilisées. Citons quelques cibles
thérapeutiques de
la
thérapie cognitive:
-
les
attentes irréalistes par rapport
au
sommeil (par
ex.,
«dormir
huit
heures
toutes
les
nuits
est
essentiel
»,
«
je
devrais
toujours
me
lever
frais
et
dispos
à
chaque
matin
»)
;
7

-
les
conceptions
erronées
des
causes
de
l'insomnie
(par
ex.,
«
mon
insomnie
est
due
à
un
déséquilibre
biochimique
ou
hormonal »);
-l'amplification
des
conséquences
de
l'insomnie
(par
ex.,
«
si
je
ne
dors
pas
cette
nuit,je
serai
incapable
de
fonctionner
demain
»).
L'utilisation d'un questionnaire
(par
ex.,
échelle
Croyances
et
attitudes
,concernant
le
sommeil)
(27)
peut
s'avérer
très
utile
afin
d'identifier
les
pensées
et
croyances
d'un patient
en
particulier
et
ainsi
orienter
le
traitement.
Par
rapport
aux
interventions
comportementales,
la
thérapie cognitive
nécessite
davantage
d'échanges
verbaux
entre
le
patient
et
le
thérapeute,
de
même
qu'un
niveau
plus
élevé
de
formation clinique
et
d'habiletés
thérapeutiques
de
la
part
de
ce
dernier.
La
durée
et
l'intensité
de
l'intervention doivent également
être
adaptées
en
fonction
de
la
capacité
du
patient àappliquer
les
principales
recomman-
dations
reliées
à
la
thérapie cognitive
(voir
tableau
III)
(28).
Tableau
III :
Principes
de
thérapie
cognitive
pour
l'insomnie.
Tab/e
11/:
Princip/es
of
cognitive
therapy
for
insomnia.
-Maintenir
des
attentes
réalistes
par
rapport
au
sommeil.
-
Réviser
l'évaluation
des
causes
de
l'insomnie.
-
Ne
pas
essayer
d'induire
le
sommeil
sur
commande.
-
Ne
pas
considérer
l'insomnie
comme
responsable
de
toutes
les
difficultés
de
la
journée.
-
Ne
pas
paniquer
après
une
mauvaise
nuit
de
sommeil.
-
Développer
une
certaine
tolérance
aux
effets
du
manque
de
sommeil.
Données
probantes
et
efficacité
de
la
Tee
L'efficacité
des
interventions psychologiques et compor-
tementales
pour l'insomnie a
reçu
une
attention scientifique
considérable
au
cours
des
dernières
années,
plus
de
100
études
ayant
été
publiées
sur
le
sujet.
Leurs
résultats
ont
été
résumés
dans
quatre
méta-analyses
(21,
29-31)
et deux
revues
systématiques
complémentaires
de
l'American
Academy
of
51eep
Medicine
(22,
32).
Selon
l'état
actuel
des
connaissances,
ces
interventions représentent
une
option thérapeutique
de
premier plan pour l'insomnie chronique. Habituellement
instaurée
sur
une
période
variant
entre
4à6
semaines,
la
TCC
entraîne
une
réponse
thérapeutique
chez
environ
70%
à
80%
des
patients,
avec
une
réduction
des
symptômes
d'insomnie
variant
entre
50%
et
60%.
On
observe
également
une
réduction
marquée
de
la
détresse
psychologique
qui
accompagne
souvent
l'insomnie chronique.
Par
ailleurs,
des
données
récentes
indiquent
que
la
TCC
s'avère
également
efficace
pour traiter
l'insomnie
chez
les
utilisateurs
chroniques
de
médicaments
hypnotiques,
chez
les
personnes
âgées
et
chez
les
sujets
présentant
une
affection
médicale
ou
psychiatrique
associée,
telle qu'un
cancer,
des
douleurs
chroniques
ou
un
abus
d'alcool
(32).
Les
méthodes
décrites
précédemment peuvent
être
utilisées
individuellement
ou
en
combinaison.
Les
méthodes
fondées
sur
le
contrôle
par
le
stimulus,
la
restriction
du
temps
au
lit
et
la
relaxation
sont
les
modalités
de
traitement
ayant
le
plus
de
8
données
empiriques àl'appui.
L'hygiène
du
sommeil
présente
des
résultats
moins
convaincants
lorsqu'elle
est
utilisée
seule,
alors
que
la
thérapie cognitive
n'a
pas
été
évaluée
de
façon
individuelle.
Par
rapport à
une
intervention comportementale'
unique,
la
TCC
présente
l'avantage
de
cibler différents
facteurs
contribuant àl'insomnie, et
les
gains
thérapeutiques sont
maintenus
à
long
terme,jusqu'à
deux
ans
après
le
traitement.
Une
conférence
du
National
Institutes
of
Health
(8)
faisant
état
des
connaissances
sur
l'insomnie a
conclu
que
la
TCC
était
un
traitement
aussi
efficace
àcourt
terme
que
la
pharmacothérapie
et
plus
efficace
dans
la
durée.
Pour
plusieurs
patients,
lorsque
les
deux options thérapeutiques sont
présentées,
l'approche
comportementale
est
souvent
préférable
et
plus
acceptable
que
l'approche pharmacologique
(33).
Toutefois,
ces
deux
approches
ne
sont
pas
nécessairement
incompatibles
et
elles
peuvent
être
avantageusement combinées pour optimiser
les
gains
thérapeutiques. Al'heure
actuelle,
toutefois,
il
ya
encore
peu
d'information
sur
la
meilleure méthode d'intégration
de
ces
deux
approches
et
sur
le
type
de
patients
pour
qui
une
approche
combinée
est
indiquée.
SEVRAGE
DES
HYPNOTIQUES
La
prescription d'hypnotiques
demeure
l'intervention
la
plus
fréquemment proposée pour
le
traitement
de
l'insomnie
chronique.
Or,
bien
que
l'utilisation d'hypnotiques
puisse
s'avérer
utile àcourt
terme
pour
soulager
les
difficultés
de
.
sommeil situationnelles, leur efficacité pour
des
périodes
d'utilisation prolongée
demeure
controversée
en
raison
des
risques
accrus
de
tolérance,
de
dépendance
et
des
effets
indésirables
potentiels.
Après
une
utilisation
prolongée,
il
peut
être
difficile pour
certains
patients
de
cesser
la
médication.
Un
plan
de
sevrage
graduel
tenant compte
du
type
de
médication,
de
la
dose
utilisée
et
de
la
fréquence d'utilisation peut
grandement faciliter
le
succès
de
cette
démarche.
Les
étapes
à
suivre
dans
l'élaboration d'un
plan
de
sevrage
sont
détaillées
au
tableau
IV.
CONSIDERATIONS
PRATIQUES
ET
CONCLUSIONS
Le
succès
de
la
TCC
pour traiter
une
insomnie
repose
largement
sur
l'observance
du
patient
aux
différentes procédures
comportementales et cognitives.
Même
si
la
TCC
est
généralement
bien
acceptée
par
les
patients,
cette
approche
exige
un
niveau
élevé
de
motivation
et
plus
d'efforts
et
de
temps
que
la
simple
prise
d'un
somnifère.
Il
est
particulièrement
important
de
prévoir
plusieurs
consultations
de
suivi
après
l'évaluation initiale.
Lors
de
ces
rencontres,
le
clinicien explique
les
consignes
thérapeutiques
et
leurs
objectifs,
encourage
une
observance
soutenue
aux
différentes
procédures
et
assiste
le
patient
dans
la
résolution
de
problèmes
qui
surviennent
en
cours
de
traitement.
Le
patient doit tout
de
même
jouer
un
rôle
très
actif
dans
sa
propre
prise
en
charge.
Plusieurs
consultations,
MEDECINE
DU
SOMMEIL
-
Année
4-
Janvier
-
Février
-
Mars
2007
 6
6
 7
7
1
/
7
100%