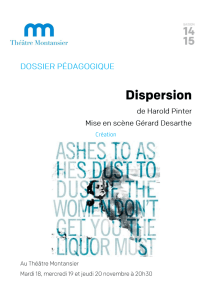AVANT-PROPOS - Presses Universitaires de Rennes

11
Delphine Lemonnier-Texier
AVANT-PROPOS
De Fin de partie à Endgame, le texte remet en cause ce que l’on tient pour
acquis du langage, de la fi ction littéraire, et du jeu théâtral à la fois. Ce n’est
pas parce que l’on sait parler que l’on peut dire quelque chose, semblent
indiquer les dialogues entre Clov et Hamm ; le fait de déchiffrer les mots sur
la page ou de les entendre ne semble pas davantage suffi re pour « lire » la
pièce ; acteurs et metteurs en scène, enfi n, témoignent de cette même résis-
tance du texte.
Mettre en scène Beckett, c’est avant tout faire un travail d’explication de
texte 1 , lire Beckett, c’est se plonger dans l’univers du plateau, de ses rouages,
de ses effets. C’est la force de ce constat qui a guidé les choix éditoriaux dont
découle le présent ouvrage.
Repères
Retraçant le cheminement de Beckett et les trois types de théâtre qu’il a
conçus, au fur et à mesure de son expérience de l’épuisement de la langue,
Catherine Naugrette montre comment Fin de partie « s’insère donc à la fois
dans le mouvement général de l’œuvre beckettienne et dans le processus spéci-
fi que qui régit et différencie le théâtre – les théâtres de Beckett – au sein de
cette œuvre ». Toute l’écriture beckettienne tend vers le même aboutissement :
« [d]ans Fin de partie, à l’intérieur du théâtre I, Beckett travaille encore avec les
matériaux dramatiques traditionnels. Pourtant, les malmenant, les retournant,
les détournant, il les soumet déjà à ce geste fondamental, qui est à chaque fois
le même : réduction, contraction, dépouillement, épuisement… »
1. C’est le terme précis employé (en français dans le texte) par Herbert BLAU : “How did we do
the play ? First of all, it was really a matter of explication de texte”, in Lois OPPENHEIM, Directing
Beckett, Ann Arbor, the University of Michigan Press, 1994, p. 52.
[« Lectures de Endgame / Fin de partie de Samuel Beckett », D. Lemonnier-Texier, B. Prost et G. Chevallier (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009, www.pur-editions.fr]

Delphine Lemonnier-Texier
12
Les notes prises par Beckett pour la version allemande de Fin de partie
en 1967 défi nissent la structure de la pièce, dont par ailleurs tout est fait
pour qu’elle soit gommée, tant du point de vue du spectateur que de celui
du lecteur. La rigueur et la symétrie structurelles voulues par Beckett sont de
précieuses indications pour entamer toute analyse en profondeur du texte,
comme le souligne Geneviève Chevallier.
C’est la cruauté qui est l’élément initial de l’analyse faite de la pièce par
Marie-Claude Hubert. Un monde frappé d’inertie, dont ne subsistent que les
quatre personnages (et trois générations) d’une famille où la torture est le
principal mode relationnel. Pourtant « l’aliénation qui assujettit Hamm et Clov
l’un à l’autre est le seul mode d’être compatible avec la vie. Elle semble consti-
tutive de la vie même ». Le parallèle avec Artaud est présent mais n’atteint
pas le stade de la cruauté de sang : « Dans Fin de partie, des meurtres sont
commis, certes, mais ils sont accomplis presque silencieusement et ils ne sont
accompagnés d’aucune manifestation extérieure de violence. »
Lieu, didascalies
Gildas Bourdet raconte la genèse du décor rouge qui l’opposa à Beckett
et qu’il fi nit par être contraint de bâcher de gris pendant l’intégralité des
représentations de Fin de partie, soulignant ce paradoxe : « The point of the
scenic artifi ce was to materialize the feeling the play induced in me, the feeling
that what is dead sometimes seems more alive than what is still alive and that
what is alive also seems sometimes about to be frozen in death. Nothing to
me was more Beckettian than the effect thus produced. »
L’étude détaillée des didascalies d’Endgame permet de mettre en lumière
la multiplicité des conventions théâtrales qui y sont soulignées et subverties,
la richesse du répertoire scénographique employé, ainsi que le parallèle établi
entre plateau et tableau. Le regard (de Clov, et donc du spectateur) y remplit
une fonction déictique, et parfois presque une fonction narrative. La symétrie
s’affi che dans les didascalies de manière obsessionnelle, et les objets sont
comme autant d’extensions des personnages, si bien qu’entre illusion miméti-
que éphémère et affi chage de la théâtralité, l’univers que dessinent les didas-
calies est bien celui d’un espace claustrophobe qui se confond avec l’acte de
parole (le dialogue) ininterrompu qui s’y déroule.
La préoccupation de Bernard Levy à propos du respect du texte de Beckett
le conduit à « dans la mise en scène donner à voir ce respect du texte qu’im-
pose l’écriture beckettienne. C’est pourquoi la pièce s’ouvre par la projection
de la page de garde des Éditions de Minuit, suivie de la première page de
didascalies, tandis que le plateau apparaît derrière le tulle : l’espace scénique
[« Lectures de Endgame / Fin de partie de Samuel Beckett », D. Lemonnier-Texier, B. Prost et G. Chevallier (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009, www.pur-editions.fr]

Avant-propos
13
se superpose à l’écriture avant de prendre sa place. En confrontant ainsi le
texte et sa réalisation sur scène, je montre d’emblée que même le respect le
plus absolu de la lettre ouvre sur un véritable espace de liberté et de réinter-
prétation : on semble être très proche des didascalies et en même temps on
a l’impression d’en être très loin ». Il insiste également sur la parenté avec la
musique : « Diriger des acteurs dans Fin de Partie me semble proche d’une
direction musicale, toujours au plus près de la partition. »
Venu à Beckett après sa lecture de Molloy à dix-sept ans, Joël Jouanneau
raconte sa fascination pour son théâtre, et la diffi culté présentée par les didas-
calies qui pour lui ont longtemps constitué un obstacle à la mise en scène
de ses pièces : « J’ai un rapport complexe à ses didascalies : j’ai toujours été
bouleversé par les mots de Beckett, et nous lui devons de nous avoir révélé un
théâtre quantique, proche de Lucrèce et De la nature des choses. Sa poésie,
la structure de ses pièces, ses personnages sont au théâtre, oui, un équivalent
pour moi de la révolution quantique en physique. » À travers son rapport très
personnel au texte de Fin de partie, il retrace et explique ses choix de mise en
scène, ses écarts par rapport aux didascalies.
Voix, corps, mouvement, regard
Robert Scanlan situe le théâtre de Beckett dans le contexte global de son
œuvre, pour défi nir deux types de texte, et deux statuts de la voix : « Beckett
himself has said to me (and to others) that certain texts come from “things
heard” and others come from “things seen”. Some texts are generated by a
visible fi gure, and others are heard only by an invisible auditor. These distinc-
tions, in fact, defi ne the difference between the dramatic and the nondramatic
texts. » Mettre en scène Beckett, c’est avant tout localiser l’origine de la voix :
« Since all the Beckett works are fundamentally structured around the voice,
any handling of the text that fails to locate the voice accurately will disrupt the
formal coherence of the work. » C’est dans la comparaison avec Shakespeare
que l’on mesure le statut spécifi que du théâtre de Beckett et la nécessité
d’en préserver le contexte, le cadre voulu par Beckett, afi n de ne pas risquer
d’amoindrir la portée de ses pièces.
Gerry McCarthy analyse la diffi culté posée par le théâtre de Beckett aux
comédiens. Pour la surmonter, il utilise l’analogie avec la chorégraphie, où
le mouvement prime sur l’interprétation, où l’interprétation est même hors
de propos : « For the actor to play the entire performance never using his
sight, but visualizing through his narratives and through his interrogation of
Clov, brings a sighted actor as near to a representation of blindness as we
can expect. The question of sight or blindness is never examined in dramatic
[« Lectures de Endgame / Fin de partie de Samuel Beckett », D. Lemonnier-Texier, B. Prost et G. Chevallier (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009, www.pur-editions.fr]

Delphine Lemonnier-Texier
14
terms. It is, therefore, not a valid question. Beckett gives the actors problems
of performance, not of interpretation. »
L’étude du corps dans Endgame montre que « le corps du personnage becket-
tien répond […] à une triple logique : il est aussi anonyme que possible, avec un
visage grimé et un regard fi gé ou absent, il expose sa difformité et ses dysfonc-
tionnements – souvent répugnants – et il souligne le caractère artifi ciel, théâtra-
lisé, de son existence sur la scène, par l’absence de toute apparence possible
de naturel ». Alors qu’il constitue un élément central du plateau, c’est parado-
xalement par le récit que le corps se donne à voir « dans une dialectique de la
présence et de l’absence : en bonne partie caché, sur scène, par les vêtements
ou les poubelles, le corps du personnage est complété par le récit ». Du corps
montré au corps raconté, c’est en tant qu’instrument à mesurer le temps, au fi l
de sa déchéance, que s’inscrit le corps dans l’univers des personnages.
Le mouvement dans Endgame est à tel point codifi é qu’il ne laisse aucune
place à la spontanéité du comédien, comme le montre Charlotta Palmstierna
Einarsson, ce qui pose un certain nombre de problèmes de mise en scène :
« Among the diffi culties that the interpreter of the written script of Endgame
must face is the fact that the play is meant to be experienced, not read, and
within the structure of the performance, signifi cances and meanings come
to bear on each other through elliptic patterns. » C’est ainsi que tout ce qui
est relatif aux déplacements acquiert, dans la pièce, une fonction spécifi que :
« Immobility and mobility are foregrounded to be perceived as anomalies
which the spectator cannot but notice and speculate about. » Cette façon
de défamiliariser le mouvement est au cœur même de la stratégie de Beckett
consistant à inciter le spectateur à utiliser d’autres ressources dans son proces-
sus de réception, dans sa quête de sens.
Herbert Blau revient sur son expérience de première main dans la mise en
scène d’Endgame pour souligner le contraste structurel avec Godot : « Only
Beckett is Beckett, but not all Beckett is the same, within the dramaturgical
spectrum of universal grayness. There are improvisational appearances in all
his texts, but not all improvisation is alike either, being a function of the
psychic mechanisms at work. » C’est par le biais de Shakespeare qu’il éclaire le
fonctionnement de Clov : « [he] functions like a kind of extension or exacerba-
tion of the “ratiocinative meditativeness” that Coleridge attributed to Hamlet,
an impacted fi gure (as a tooth is impacted) of the Hamletic condition. As when
Hamlet fi nally kills the king, he does so out of maximum indecisiveness, as a
refl ex against the near-crippling inability to act. No wonder Clov lurches when
he walks, as if he were impelled only by stasis itself. » C’est le performatif qui
fait sens, en tant que tel : « Things make sense, if you want to make sense,
but they also have to have a performative sense. »
[« Lectures de Endgame / Fin de partie de Samuel Beckett », D. Lemonnier-Texier, B. Prost et G. Chevallier (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009, www.pur-editions.fr]

Avant-propos
15
Dans la série des dysfonctionnements corporels qui défi nit la pièce,
Stéphanie Ravez choisit de se pencher sur les troubles de la vision : « Une
des façons d’aborder ce qu’il convient d’appeler l’hermétisme de la pièce, sa
résistance à l’interprétation, est de s’intéresser précisément à ce qu’elle nous
dit et nous montre de la vision. » Le passage par l’histoire de la perspective
permet de prendre conscience que « ce que révèle le dispositif perspectif de
l’aveuglement du sujet “regardant” la peinture, correspond à notre expérience
du texte mis en scène ».
Marek Kedzierski revient sur ses mises en scène d’Endgame pour insister
sur la rigueur exigée du comédien : « This is something actors who played with
me have come up with: the sense of discipline that a Beckett play requires,
which makes them feel that all that they have played so far was easy! Beckett
is so dense and you cannot simply hide something that you don´t know how
to play. It stands out. » Ce sont également les répétitions qui sont au cœur du
jeu dramatique : « Ideally, every important repetition should be noticed by the
audience the way a musical leitmotiv is immediately recognised. So I always
try to be insistent on the echoes in the play: it is important that the actors
should play it the same way when the words are the same, or are a variation
on the same pattern. »
Texte(s), intertexte(s), langue(s), langage(s)
Bruno Clément se penche sur les trois récits de Fin de partie : « […] roman
et poésie, sur un mode qui fi nalement ne permet guère de les distinguer,
viennent l’un et l’autre “rejoindre”, c’est-à-dire servir, l’intrigue générale de
la pièce. L’histoire que raconte Hamm est, en effet, sans doute vraisemblable,
une mise en intrigue des événements qui l’ont conduit à adopter, du moins à
recueillir l’enfant dont une catastrophe naturelle et générale menace la vie ;
cet enfant pourrait bien être Clov, qui serait donc en ce cas le fi ls adoptif
de Hamm. » Les trois types de mode narratif présents dans Fin de partie
permettent « en cherchant à caractériser chacun de ces récits, [d’]ébaucher
quelque chose qui ressemble sinon peut-être à un projet esthétique, du moins
à un diagnostic, voire à l’énoncé d’une thèse historiquement orientée qui ne
concernerait pas seulement Fin de partie, ou le genre dramatique en tant
que tel, mais la conception même de l’activité artistique ». L’analyse souligne
des rapprochements « avec un texte qui appartient à une tradition littéraire
à laquelle on ne rattache pas souvent Beckett : le roman de quête, et plus
précisément de la quête du Graal ».
C’est un autre intertexte également qui est éclairé, celui que Beckett souli-
gne particulièrement dans Endgame, où il ajoute à la citation tronquée de
[« Lectures de Endgame / Fin de partie de Samuel Beckett », D. Lemonnier-Texier, B. Prost et G. Chevallier (dir.)]
[Presses universitaires de Rennes, 2009, www.pur-editions.fr]
 6
6
 7
7
1
/
7
100%
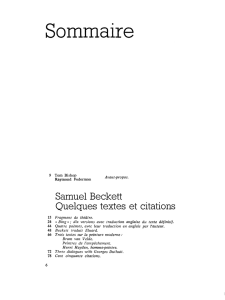
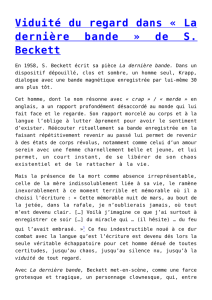
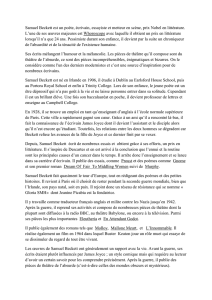
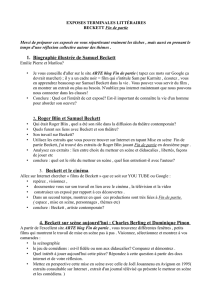
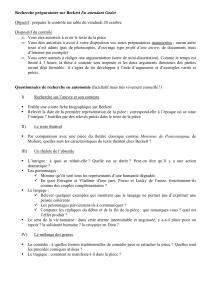
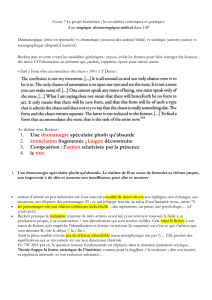
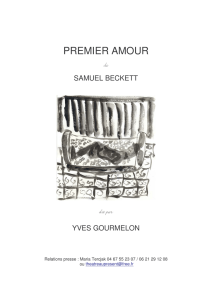

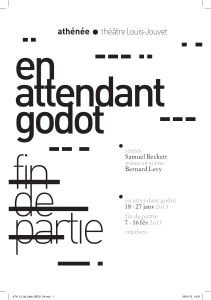
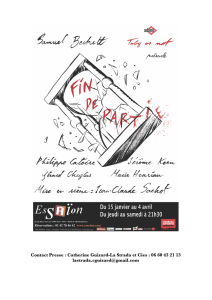
![[de théâtre] sont-ils [nécessairement] des corsaires](http://s1.studylibfr.com/store/data/004068383_1-6811f6f320fa32dbc5abe94406f33351-300x300.png)