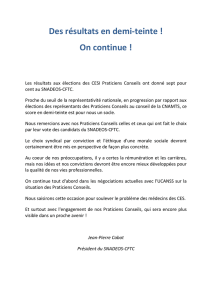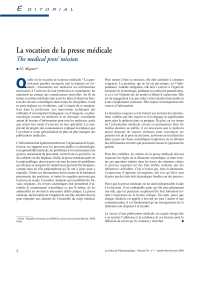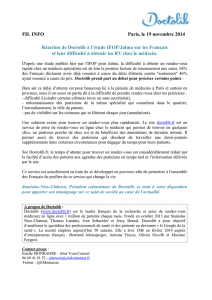Entrevue avec Marie-Chantal Doucet, Ph.D. Sociologie, Professeure

71INTERVENTION 2016, numéro 144:71-75
Entrevue avec Marie-Chantal Doucet, Ph.D. Sociologie, Professeure,
École de travail social, Université du Québec à Montréal
Réalisée par
Sarah Boucher-Guèvremont, T.S., Rédactrice en chef, Revue
Intervention
Stéphane Richard, T.S., Ph.D., Professeur, École de service social, Université Laurentienne
1. Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de vous lire, qu’est-ce que signifie un métier relationnel?
D’une manière générale, on peut définir les métiers relationnels comme une catégorie d’activités
transdisciplinaires d’aide ou d’accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit au
travers de transactions visant l’adaptation, l’émancipation des personnes ou encore d’une quête de sens, et que
ce soit aussi par l’entremise d’une méthode individuelle, familiale, groupale ou communautaire. Parmi ce vaste
ensemble hétérogène de pratiques, un langage commun aux praticiens ressort, et ce, indifféremment de leurs
modes d’action, des orientations théoriques qui les sous-tendent, des formes d’interventions qu’elles suscitent
et des contextes où elles s’inscrivent.
L’analyse de ce langage transversal permet de constater que ce qui se trouve au centre de l’éthos de ces
métiers concerne l’action de travailler «la qualité de la relation» avec les sujets et entre les sujets rencontrés
dans le cadre du travail des praticiens.
J’ai voulu élargir le sens de la catégorie «métier» pour la considérer avant tout comme un genre d’activités
que différentes professions viennent alimenter et qui, à son tour, enrichit ces professions, bien qu’elles n’en
soient pas les seules dépositaires. Cela signifie que le métier contient les professions plutôt que de s’y résumer.
Par exemple, il y a des intervenants communautaires qui partagent ce langage, mais n’appartiennent pas à
des ordres professionnels. On peut aussi rencontrer des praticiens cliniques comme l’art-thérapeute qui font
partie d’une association professionnelle, mais ne sont pas porteurs d’un titre réservé. Le métier est ici lié à la
notion d’activité, car j’y réfléchis dans le cadre d’une théorie de l’activité et du langage en milieu de travail1.
Je me concentre sur une focale sociologique de l’activité qui peut être rendue possible entre autres par ce
courant, un peu moins connu au Québec, que la psychodynamique du travail ou la sociologie clinique de
l’organisation, bien qu’il s’agisse de perspectives que je rejoins à plusieurs niveaux. Le métier met en branle
des savoirs spécifiques au milieu sociosanitaire qui se déploient dans différentes structures (ex.: un centre de
crise); il mobilise des processus d’identité et d’appartenance de même que le développement et l’application
d’une grammaire commune comme on peut le retrouver, par exemple, dans le métier d’intervenant de crise ou
celui de praticienne de première ligne en santé mentale. C’est le langage commun à l’ensemble de ces praticiens
qui se rapporte à la terminologie de «métiers relationnels».
2. Pourquoi, selon vous, les métiers du relationnel sont-ils eux-mêmes concernés
par la souffrance psychique au travail?
D’abord, ce qui est fréquemment nommé «souffrance ou mal-être au travail» peut être composé de divers
sentiments selon les auteurs. Par exemple, Thomas Périlleux parle de «désarroi» au sens d’une déroute (en
ancien français: être en mauvais arroi) qu’il attribue surtout aux nombreuses réformes organisationnelles au
milieu desquelles se retrouvent les praticiens. Il est ironique de constater que les spécialistes par excellence du
relationnel se trouvent en aussi mauvais arroi (arrimage, lien, relation) dans la foulée des réformes constantes
ou lorsqu’une pratique qui était hier considérée comme adéquate devient caduque le lendemain. Marc Loriol
travaille sur la «fatigue», cette espèce de lourdeur dont les travailleurs ne se départissent pas. Christophe
Dejours développe la question de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance. Vincent de Gaulejac, pour
sa part, présente un sujet enserré dans les paradoxes de l’organisation. Yves Clot problématise ce qu’il nomme
«l’activité empêchée». Je n’aurai pas l’espace pour discuter de tous les auteurs qui se sont penchés sur ce phénomène,
car la question de la souffrance au travail est très documentée, notamment dans la littérature francophone.
1. Voir les travaux des auteurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive: Clot, 2008; Faïta, 2001; Filliettaz et Bronkart, 2005; Boutet, 2001).

72 INTERVENTION 2016, numéro 144
C’est dans l’optique d’une subjectivation et d’une singularisation croissante du travail que j’aborde
moi-même la question. Mes propres recherches font ressortir le « ressentiment » que l’on peut définir comme
une expérience émotive complexe, empreinte à la fois d’une colère longtemps contenue et aussi d’une
profonde amertume. Le Guillant a examiné ce ressentiment qui se rapporterait selon lui en grande partie à
un sentiment d’injustice en lien avec la hiérarchie. C’est ici la colère rentrée de l’ouvrier dont les conditions de
travail sont injustes qui illustre le mieux ce que cet auteur décrit comme le ressentiment (Le Guillant, 2006).
Or, selon moi, ce qui semble atteint au premier chef chez les travailleurs contemporains qui possèdent un
savoir spécialisé sur leur activité, c’est le rapport devenu de plus en plus subjectif au travail où le ressentiment
peut être interprété à partir du thème de l’engagement personnel. Une analyse de la grammaire du travail
des praticiens permet effectivement d’identifier l’engagement personnel «dans» le travail et «envers» son
travail comme une règle centrale (Doucet et Dubois, 2016). C’est ce que nous exposons, Dominic Dubois et
moi-même, dans un chapitre consacré au thème de la subjectivité au travail. Cet investissement subjectif ne
doit pas être exclusivement examiné sous l’angle de la psychologie, comme il a été très souvent l’objet. Il faut
considérer cet engagement personnel aujourd’hui décuplé (notamment dans les métiers relationnels) comme
l’un des vecteurs centraux du travail contemporain, d’où émerge un nouveau sens du travail. Le travail devient
ainsi l’un des supports les plus importants des individus contemporains. La morale du devoir a fait place à une
tout autre exigence, celle de se réaliser dans son travail.
Je pense que ce qui demeure spécifique aux métiers relationnels et vient en rendre l’étude intéressante
du point de vue des études sur le travail concerne les dimensions particulières de cette activité, qui implique
aussi un travail sur soi. Les praticiens relationnels sont à la fois les spécialistes et les objets de leur savoir; ils
ne sont pas simplement réflexifs «dans» leurs actions mais bien aussi «sur» ces actions, et cette réflexivité de
deuxième niveau implique un retour constant sur les raisons et les motivations de leurs actions. La profession
et la personnalité restent ainsi étroitement liées. Une phrase revient comme un refrain dans les entretiens
que j’ai réalisés avec mon équipe: notre outil, c’est nous. Dans ce cas précis, le travail ne peut pas s’envisager
uniquement à l’intérieur d’une logique productive et économique que l’on a tendance à associer à l’objectivité.
Ici, le travail met en branle des processus subjectifs de haut niveau. J’ai donc pu rencontrer un certain discours
du mal-être dans l’organisation, mais il est important de dire que j’ai aussi entendu des récits de passion du
métier. Par son engagement personnel «dans» et «envers» son métier, le praticien contribue à faire le métier
autant que le métier semble contribuer à le faire exister comme individu singulier. C’est donc d’autant plus
souffrant d’être «empêché» quand on y a mis autant de soi-même. Encore une fois, je n’en fais pas une affaire
psychologique, mais bien profondément sociale. Le nouvel idéal type du travailleur requiert un engagement
personnel d’une nature sociohistorique; raison de plus pour que se manifeste une série d’états affectifs,
particulièrement chez les travailleurs du relationnel qui s’investissent eux-mêmes comme outil de travail.
3. À votre avis, à qui appartient la souffrance psychique au travail?
Aux individus? Aux organisations? À la société?
Dans les milieux sociosanitaires, j’inclus ici les contextes institutionnels et communautaires. On retrouve
régulièrement une posture de rejet du modèle gestionnaire ou managérial ainsi que des normes qui viennent
des hiérarchies dans les discours des praticiens. Ce modèle, selon leurs propos, heurte parfois de plein fouet
ce qui fait l’éthos de ces métiers. Cela renforce naturellement la thèse que l’on peut qualifier de classique, celle
d’une cause organisationnelle aux divers malaises exprimés. Je suis en bonne partie d’accord avec cette thèse.
Les praticiens se trouvent devant des enjeux réels de dissonances cognitives. On peut définir cette dissonance
par l’adhésion de ces travailleurs à des dispositifs symboliques n’ayant pas le même degré de légitimité pour
eux dans l’élaboration quotidienne de leurs pratiques. Chaque métier développe une représentation de ce
qu’est le travail bien fait. Dans le cas des praticiens, ce qui constitue la pulsation vitale de leur talent est de
travailler le relationnel. Un cas typique de dissonance chez les praticiens institutionnels concerne la durée des
interventions sur les plans de l’évaluation, des entretiens et surtout du suivi. L’expérience du temps vécu dans la
relation clinique s’y trouve donc segmentée en fonction d’une logique managériale qui confronte leur volonté
de construire une relation de confiance qui s’étend plutôt sur la durée. Les intervenants disent constamment
devoir se justifier du temps qu’ils consacrent à leurs interventions. Ce n’est donc pas uniquement l’affectivité
des praticiens qui est assez souvent mise à mal, mais leur intelligence même du métier. Le ressentiment
se rencontre donc particulièrement dans les rapports à la hiérarchie et s’inscrit dans les contraintes et les
empêchements.

73INTERVENTION 2016, numéro 144
Cependant, il faut aussi reconnaitre que le ressentiment peut être aussi lourd dans les milieux où des
rapports plus collégiaux sont encouragés. Parfois même, il est plus facile de «faire à sa tête» dans des milieux
institutionnels plus larges. On y retrouve d’ailleurs fréquemment l’expression «moi, ce qui se passe dans mon
bureau…» pour souligner une singularisation et une subjectivation importante du métier et ainsi une distance
assumée face aux prescriptions des tâches. Dans certains milieux communautaires, une incartade par rapport
à l’esprit du lieu peut être interprétée comme une faute professionnelle, et on peut y rencontrer des conflits
épiques. L’équipe de travail qui, dans les milieux institutionnels et communautaires, peut jouer un certain
rôle de contre-pouvoir et de refuge où il est possible d’obtenir la reconnaissance et le soutien attendus peut
également, à l’occasion, constituer un véritable ring. L’égalitarisme n’est aucunement un gage de pacification
des rapports, ni de reconnaissance. La thèse des causes hiérarchiques et particulièrement managériales de la
souffrance reste incomplète.
Or, pour répondre plus directement à votre question, je pense que la souffrance liée au travail, bien
qu’elle affecte à divers degrés les individus, selon leur histoire personnelle et leurs dispositions psychiques,
a des origines profondément sociales et qu’il faut regarder du côté d’enjeux plus grands que les cadres
organisationnels. Parmi ces enjeux, ce qui reste décisif concerne la visée générale d’une réalisation de soi
dans le travail. L’éthos de ces métiers pour lequel il faut toujours «se battre» requiert autonomie d’action et
indépendance d’esprit chez des travailleurs de plus en plus instruits et spécialisés. S’il se trouve des potentialités
de réalisation de soi dans le travail, il existe aussi des contraintes qui empêchent cette réalisation. L’«activité
empêchée» encore plus que la lourdeur de la tâche serait la cause de souffrances sociopsychiques la plus
souvent repérée (Clot, 2008).
4. En fonction de votre intérêt pour la psychosociologie des métiers relationnels, et en lien avec le
présent numéro de la revue Intervention, quels sont, selon vous, les enjeux les plus préoccupants
pour les professionnels du secteur sociosanitaire de nos jours?
Bien qu’elles aient une incidence indéniable sur les manières d’envisager le métier, les questions
organisationnelles n’ont pas le monopole des explications sur le devenir des métiers relationnels. On ne doit
pas laisser de côté des aspects sociaux plus larges qui ont une influence importante sur les pratiques de ces
métiers. Il faut aussi regarder du côté d’enjeux liés à la fois à leur propre autonomie et à celle des sujets qu’ils
rencontrent. Ces enjeux relèvent d’une redéfinition collective de ce qu’est la relation d’aide. Cela soulève une
question intéressante: quelle serait alors la définition de l’autonomie professionnelle, mais aussi de l’autonomie
du sujet rencontré dans un contexte «relationnel»? L’autonomie des personnes, qui est visée dans les pratiques
de ces métiers, induit aussi la volonté d’une symétrie relationnelle de la part des personnes rencontrées, ce
qui nécessite un « toucher clinique » différent remettant en cause certaines théories d’intervention. Par
exemple, dans plusieurs milieux communautaires comme institutionnels, une sorte de «contrat» est signé
afin de favoriser le pouvoir d’agir du client face à son rétablissement, remettant ainsi en question le principe
d’une autorité symbolique du thérapeute. Face à cette revendication de symétrie relationnelle en tant que
phénomène social nouveau, les praticiens doivent sans cesse revoir leurs pratiques.
Un autre défi occasionné par la nouvelle horizontalité relationnelle concerne la possibilité – et la
nécessité – de réfléchir sur les mots pour se définir. Par exemple, l’une des caractéristiques de ces métiers
est de faire coexister des postures d’expertise et d’accompagnement qui sont en même temps considérées
comme antagonistes. L’évaluation, par exemple, suppose que le professionnel possède une certaine expertise
et cependant, on entend souvent que c’est mal d’être un expert et bien d’être un accompagnateur. Mais
qu’entend-on par accompagnement? En quoi l’accompagnement serait-il moins orienté que l’expertise?
L’accompagnement n’est-il pas une forme d’expertise? Dans cette veine, il est aussi intéressant d’entendre les
distinctions extraordinairement floues entre thérapie et non-thérapie au-delà des enjeux liés à la loi21. Ainsi,
on accompagne des participants vers la sortie d’une crise relationnelle en travaillant l’estime de soi par la
parole et des stratégies de mobilisation, mais «on ne fait pas de thérapie». Dans le même esprit, le mouvement
de la pair-aidance (on n’hésite pas d’ailleurs à parler du client-expert) s’introduit également dans le débat
expertise et accompagnement, thérapie/non-thérapie, comme ce fut le cas avec les bénévoles. Si, par exemple,
le professionnel se dit non expert, quels sont les critères pour le différencier du pair-aidant? Je ne défends pas
du tout ici la position de l’expert, mais je crois que les défis des professionnels se trouvent non seulement dans
la confrontation avec les cadres organisationnels, mais avec leur propre langage et ce que ce langage contient
d’implicite social.

74 INTERVENTION 2016, numéro 144
Par ailleurs, si l’on en vient aux questions organisationnelles, l’autorégulation continue du métier, entre
autres par l’entremise de formations postuniversitaires et de sessions de développement professionnel tout au
long de la vie, de même que par des supervisions de toutes sortes, constitue selon moi un autre enjeu majeur qui
mènera peut-être – simple intuition – au développement des métiers relationnels vers plus d’indépendance et
une ouverture que l’on presse déjà vers le secteur privé. On en devine d’ailleurs les premiers pas en ce moment.
Il reste à savoir comment chacune des professions mènera sa barque, car ici la concurrence peut être vive.
Je n’ai pas de réponse directe d’un point de vue professionnel. Parmi les jeunes praticiens rencontrés, nous
avons entendu souvent le désir de «sortir du réseau». Il y a quelques années, la voie alternative se trouvait
pour nombre d’entre eux presque exclusivement dans le domaine communautaire; à l’heure actuelle, toutefois,
de jeunes praticiens et praticiennes, toutes appartenances professionnelles confondues, aspirent à travailler
avec une «petite équipe» dans une clinique privée. Ce n’est pas forcément le modèle des GMF (groupes de
médecine familiale) qui est prisé, mais plutôt des équipes de professionnels «sans les psychiatres, juste entre
nous». On peut d’ores et déjà penser que ce nouveau lien économique entre aidant et aidé serait déterminant
dans la recomposition du métier et de ses pratiques. Pourtant, cette possibilité du privé génère des tensions
importantes chez d’autres, souvent parmi les plus expérimentés. En effet, pour plusieurs d’entre eux, l’aide
ou la relation d’aide devrait relever du secteur public ou communautaire. L’idée que l’on puisse un jour se
retrouver à travailler dans des services médicosociaux privés chambarde leurs valeurs et leurs croyances,
en plus de bouleverser les équipes et les liens de confiance construits jour après jour avec la clientèle. On
retrouve une inquiétude sociale généralisée face à «ce qui s’en vient» dans un contexte de démantèlement
de l’État-providence. Cette tension est très palpable chez les praticiens, d’autant plus que les appareils sont
extrêmement lourds et difficiles à mobiliser. Les changements se font donc lentement, si bien que c’est
souvent l’interminable attente de «ce qui s’en vient» qui angoisse. Or, «ce qui s’en vient» concerne souvent
les changements organisationnels, mais aussi les nouvelles approches, dont les fameuses TCC (thérapies
cognitivo-comportementales) qui, pour plusieurs, mettent de côté le sens des problèmes que présentent les
personnes en situation de vulnérabilité. Cette locution «ce qui s’en vient» peut donc être interprétée comme
un sentiment généralisé d’une menace d’imposition de manières de penser et de faire, ce qui entrerait en
conflit direct avec la volonté d’indépendance et d’autonomie des métiers relationnels.
Toutefois, et ce sera mon dernier point, les organisations ont elles-mêmes des défis à relever. Elles
devront composer avec des travailleurs de plus en plus instruits, ce qu’elles requièrent paradoxalement. Une
forte majorité des praticiens détient des diplômes universitaires qui vont du premier au troisième cycle,
sans compter les nombreuses formations postuniversitaires spécialisées comme la thérapie familiale, la
psychanalyse, l’intervention interculturelle, etc. On a parfois affaire à une érudition de professionnels qui entre
en conflit avec les connaissances, par ailleurs très peu théorisées, qui sont véhiculées dans les directives des
organisations. On a ainsi droit à des explications fortement singularisées sur certaines notions. Par exemple,
la notion de rétablissement semble recevoir des définitions relativement flexibles, chacun y déposant ce qui lui
parait cohérent avec sa théorie de référence. Il y a des préoccupations largement documentées sur une certaine
dynamique descendante et son impact sur le développement du métier. Mais je pense aussi qu’il faut redonner
toute sa place à la dynamique ascendante, c’est-à-dire à la puissance de l’activité. Je renvoie ici au livre que je
viens de publier sur cette question: « L’activité n’est pas soumise à des déterminismes purs et durs allant des
directives aux actions ni à une complète liberté, mais se développe et se réalise dans un entre-deux où il faut
composer entre les contraintes et les potentialités» (Doucet et Viviers, 2016).
5. Comment pourrait-on penser ou faire les choses différemment en lien avec cet objet
complexe qu’est la souffrance au travail? Quel peut être, en ce sens, l’apport des cliniques du
travail pour s’adresser à la souffrance de celles et ceux qui font des métiers du relationnel?
Il existe de très nombreuses pratiques d’accompagnement de toutes sortes à l’heure actuelle. Je viens
de codiriger un autre ouvrage sur la question2. On connait les pratiques de coaching dans l’entreprise qui
vont dans le sens de l’adaptation par des moyens tels que la gestion du stress ou encore la présence attentive,
par exemple. Il y a aussi depuis quelques années une vision critique de l’organisation qui serait responsable
2. Bourassa, B. et M.-C. Doucet (2016). Éducation et vie au travail. Perspectives contemporaines sur les pratiques d’accompagnement
pour l’orientation et l’intégration socioprofessionnelle, PUL.

75INTERVENTION 2016, numéro 144
des problèmes actuels de souffrance au travail. Récemment est apparue la notion de risque psychosocial,
qui établit des liens entre individu, organisation et société. En France, il existe plus de 4000spécialisations
du domaine (Clot, 2008b). Au Québec, ces pratiques s’inscrivent surtout dans le registre du développement
personnel et professionnel.
Le rôle d’une clinique sociale du travail serait, selon moi, de rendre visibles les liens sociologiques
entre tous les acteurs que sont les individus, les équipes, l’organisation, l’institution et finalement le monde
social en tant que tel. Pour l’observer, il faut donc interroger ces langages d’un point de vue social, et non
exclusivement psychologique comme on a tendance à le faire dans les organisations. Cela ne veut pas dire que
les accompagnements personnalisés n’ont pas leur place. Je suis tout autant pour une intervention collective
des problèmes. Cependant, ce qui manque, c’est une compréhension sociale de ce que vivent les individus
au travail. D’ailleurs, je trouve qu’il s’agirait d’une voie de recherche et d’intervention à développer en travail
social. En fait, il faut demeurer à l’écoute des nouvelles sensibilités sociales en établissant des liens entre ce que
vivent les individus et les grands enjeux sociétaux: comprendre par exemple le ressentiment comme étant à la
fois social et individuel. Comprendre surtout que le ressentiment des praticiens relationnels contemporains,
ce n’est pas le même que celui de l’ouvrier des années1930 qui était rattaché à une conscience de classe. J’ai
parlé plus haut de subjectivation et de singularisation du travail. Je pense bien qu’il s’agit là d’un point central.
Dans un contexte syndical fragilisé, les mécanismes collectifs se sont effrités. On peut le déplorer, mais il
faut saisir que l’expérience – ou, si l’on veut, le vécu subjectif du travail – a changé. Il se vit dans une solitude
équivoque: à la fois revendiquée en tant qu’espace à soi pour penser et source de souffrance dans l’épreuve.
RÉFÉRENCES
Bourassa, B. et M.-C. Doucet (2016). Éducation et vie au travail. Perspectives contemporaines sur les pratiques
d’accompagnement pour l’orientation et l’intégration socioprofessionnelle, PUL.
Clot, Y. (2008). Travail et pouvoir d’agir, Paris: PUF.
Clot, Y. (2008b). Le travail sans l’homme? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie, Paris: La Découverte
Dejours, C. (2003). L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, critique des fondements de l’évaluation, Versailles: INRA.
Doucet, M.-C. et S. Viviers (2016). Métier de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail, Québec: PUL.
Doucet, M.-C. (2014). «Grammaire du métier de praticien en santé mentale jeunesse: catégories cognitives et configuration
d’une individualité authentique», dans M.-C. Doucet et N. Moreau (sous la dir.), Penser les liens entre santé
mentale et société aujourd’hui. Les voies de la recherche en sciences sociales, PUQ.
Doucet, M.-C. et D. Dubois (2016). «Repères pour la thématique subjectivité et travail. Le thème de l’engagement personnel
dans les métiers de la relation en milieu institutionnel et communautaire au Québec», dans M.-C. Doucet et
S. Viviers (sous la dir.), Métiers de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail, PUL.
Doucet, M.-C. (2016). «L’activité et le langage des métiers relationnels. Une sociologie de l’implicite», dans M.-C. Doucet
et S. Viviers (sous la dir.), Métiers de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du travail, PUL.
Faïta, D. (2001). «L’analyse du travail et le statut de l’activité chez Bakhtine»,Travailler, no6, 13-30.
Filliettaz, L. et J.-P. Bronkart (2005). L’analyse des actions et discours en situation de travail, Louvain-la-Neuve: Peeters.
de Gaulejac, V. (2010). «La NGP, nouvelle gestion paradoxante», dans C. Jetté et M.Goyette (sous la dir.), Pratiques
sociales et pratiques managériales, des convergences possibles?, vol.22,no2, printemps2010,83-98.
Le Guillant, L. (2006). Le drame humain du travail. Essai de psychopathologie du travail, Toulouse: Érès.
Loriol, M. (2012). La construction du social. Souffrance, travail et catégorisation des usagers dans l’espace public, Rennes: PUR.
Périlleux, T. (2016). « Le cœur battant du travail relationnel. Métiers mis en danger, répliques cliniques », dans
M.-C. Doucet et S. Viviers (sous la dir.), Métier de la relation. Nouvelles logiques et nouvelles épreuves du
travail, Québec: PUL.
1
/
5
100%