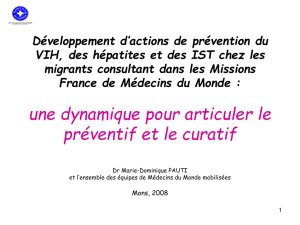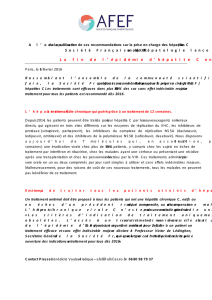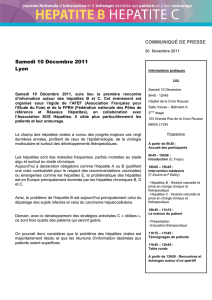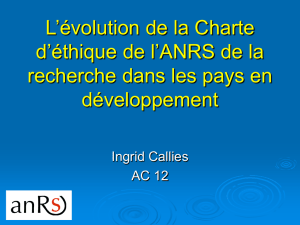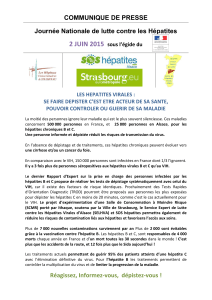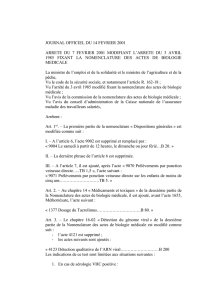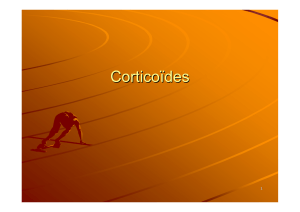Réflexions sur la prise en charge optimale des hépatites virales, en

DOSSIER
14 Santé-MAG N°08 - Juillet 2012
Professeur Saadi Berkane,
hépato-gastro-entérologue, Hôpital Bologhine-Alger
Réflexions sur la prise en charge optimale
des hépatites virales, en Algérie
A l’occasion de la Journée Mondiale
contre l’Hépatite Virale qui a lieu,
chaque année, le 28 juillet, en recon-
naissance de l’anniversaire du pro-
fesseur Baruch Blumberg, qui a reçu
le Prix Nobel, pour avoir découvert le
virus de l’hépatite B. Cette initiative
mondiale, doit avoir lieu dans les 194
États membres de l’OMS, qui s’est
engagée à l’organiser, lorsqu’elle a
adopté la Résolution 18 de la 63ème
Assemblée mondiale de la Santé. Il
nous a semblé utile d’évaluer les pro-
grès réalisés contre ce fléau, dans
notre pays. Force est de constater que,
malgré les efforts consentis par les
autorités sanitaires du pays, en accor-
dant, depuis 2007, près 3 Milliards de
DA, par an, pour la prise en charge de
la maladie, par la vaccination systéma-
tique des nouveau-nés, depuis 2003;
l’installation du Comité national de
lutte contre les hépatites, depuis mars
2007; les tentatives de mise à niveau
de la désinfection du matériel à risque;
la proposition, par le Comité National,
en Avril 2012, d’un guide de la prise en
charge diagnostique et thérapeutique
des hépatites B et C, des insuffisances
persistent.
La première constatation est : à défaut
de données statistiques fiables, nous
colligeons, en pratique hospitalière
quotidienne, le même nombre de pa-
tients porteurs d’une hépatite C, pro-
venant des régions de l’Est du pays,
principalement de Barika, 17ans après
les premiers cas rapportés à l’hôpital
de Bologhine. Pour l’infection virale B,
la prévalence nationale de 1998, avec
un portage de l’AgHbs de 2,15%, reste
d’actualité. La seule explication serait
le non respect des règles d’hygiène
universelle. Ainsi, il est rapporté des
pratiques telles que : le partage de
matériel personnel (ciseaux, rasoirs,
lames à raser, coupe ongles, brosses à
dent), la médecine traditionnelle (sca-
rification et hidjama), pratiquée avec
des instruments non jetables ou mal
désinfectés, l’usage, persistant, par le
coiffeur, du même porte lame désin-
fecté à l’eau de javel diluée, l’usage de
l’alun (echeb) pour coaguler le saigne-
ment cutané, malgré les efforts d’in-
formation et de vulgarisation de la ma-
ladie par l’association SOS hépatites
Algérie. Nous relevons, également :
-L’absence de médecins spécialistes,
formés en hépatologie et la prise en
charge de cette pathologie, L’absence
de biologie moléculaire en dehors
d’Alger, indispensable à l’indication et
à l’évaluation de la réponse au traite-
ment, se pose le problème d’achemi-
nement des prélèvements, de prise en
charge financière des examens, obli-
geant le patient au déplacement
-Nous sommes toujours l’un des rares
pays ou le dépistage de l’AgHbs, chez
la femme enceinte n’est pas effectif,
avec le risque de transmission mère-
enfant et le passage à la chronicité de
l’infection VHB, chez le nouveau né, de
l’ordre de 90%. Pourtant des solutions
existent, simples et proposées depuis
des années.
Pour la prévention :
-Actions d’incitation au dépistage,
pour augmenter la proportion de gens
connaissant leur statut. La majorité
des patients ignore son statut à l’égard
du VHB et C;
-Améliorer l’information des malades
sur l’infection virale et ses caractéris-
tiques, par des campagnes de sensibi-
lisation et de prévention des pratiques
à risques des populations, par les
médias (spots publicitaires télévision,
radio, journaux) et l’action des associa-
tions de malades;
-Renforcer la réduction des risques
de transmission des virus, par une
politique de lutte contre les infections
nosocomiales, dans les établissements
de santé; mener des actions envers la
profession libérale et publique, impri-
mer et diffuser des guides de bonne
pratique, pour la prévention et la dé-
sinfection, pour les dentistes, l’endos-
copie, hémodialyse…;
-Faciliter l’accès au matériel perfor-
mant de désinfection et de stérilisa-
tion (autoclaves, produits chimiques)
avec une formation médicale continue,
par le biais d’ateliers, pour vulgariser

DOSSIER
15
Santé-MAG
N°08 - Juillet 2012
la désinfection, avec présence obliga-
toire des professionnels;
-Rendre obligatoire le dépistage de
la femme enceinte, par une circulaire
pour les gynécologues, sages femmes,
pédiatres;
-Disponibilité des Immunoglobulines
anti-Hbs, indispensables pour proté-
ger le nouveau né, de mère porteuse de
l’AgHbs, en plus de la vaccination;
-Vérifier la réponse vaccinale de tout
nouveau né, de mère Ag Hbs+, par le
pédiatre;
-Rattrapage vaccinal des grands en-
fants et adolescents, nés avant 2003
(école, Cem, lycée);
-Vacciner les sujets à risque : entourage
familial du sujet AgHbs +, sujet contacts
et les sujets à risque (employés des
structures médicales et paramédicales,
hôpitaux, étudiants en médecine, mi-
lieu carcéral, prostituées...);
-Créer un Observatoire national de sur-
veillance épidémiologique des hépa-
tites (déclaration obligatoire des infec-
tions nosocomiales, réseau de recueil
de données en continu, surveiller les
nouveaux cas et déclencher une en-
quête, si nombre anormalement élevé
de cas déclarés);
-Uniformiser les techniques de dépis-
tage à travers le pays, en référence
à l’IPA utilisant les tests ELISA et non
les tests rapides non validés, qui com-
portent le risque de faux négatifs;
-Pour le don de sang, dépister en plus
de l’Ag Hbs, les Ac anti Hbc et dosage
des ALAT (détecter les hépatites B
occultes);
-Uniformiser et réglementer les formu-
laires de dépistage prénuptial. Il doit
être demandé en cas de facteurs de
risque, séparé, en respectant le code de
la confidentialité
Pour l’amélioration de la prise en
charge thérapeutique :
- Faciliter l’accès aux soins, et dispo-
nibilité permanente des médicaments,
dont la rupture peut être fatale, surtout
chez le patient cirrhotique;
-Mettre en place des PCR de biologie
moléculaire, dans les principales ré-
gions sanitaires du pays;
-Désigner les centres de traitement,
en leur octroyant les moyens néces-
saires;
-Formation et recyclage des médecins
prenant en charge les hépatites, par le
biais de centre de référence;
-Créer des réseaux, pour favoriser
l’accès aux soins, la coordination, la
continuité pour l’interdisciplinarité des
prises en charge sanitaires, adaptée
aux besoins de la personne, tant sur
les plans de l’éducation à la santé, de
la prévention, du diagnostic que des
soins.
L’objectif final est d’améliorer le
nombre de cas dépistés et le nombre
de cas traités. Ces actions ne peuvent
aboutir que dans le cadre d’un plan
national de lutte contre les hépatites,
avec un programme visant à réduire
le risque de transmission virale, dé-
velopper et renforcer les mesures de
lutte contre les hépatites.
La première solution est l’ouverture
de services d’hépatologie, dotés de
moyens adéquats, à travers le terri-
toire national, pour préparer l’hépato-
logie de demain et aboutir, in fini, à la
transplantation hépatique.
Sur les 48 wilayate du pays, il y a 8
services universitaires de gastroen-
térologie, dont 3 sont à Alger et 2 à
Oran. Le nombre de cirrhoses décom-
pensées et le risque de cancer du foie,
de prise en charge lourde et coûteuse,
pour l’économie du pays, va aller en
progression les prochaines décen-
nies et la majorité des hépato-gastro-
entérologues, formés actuellement,
optent pour le privé, pour exercer une
gastro-entérologie de routine, faute
de services.
Telle est la situation actuelle des hé-
patites virales, en Algérie.
Espérons que le prochain anniversaire
de la journée mondiale de l’hépatite
verra des améliorations
Hépatites :
la moitié des malades
s’ignore
Ce samedi 28 juillet marquera la deu-
xième édition de la journée mondiale
contre les hépatites. C’est l’occasion,
de faire le point sur les hépatites
B et C.
«Les hépatites représentent une prio-
rité de santé publique mondiale, au
même titre que le VIH, la tuberculose
et le paludisme». Les hépatites vi-
rales sont souvent asymptomatiques.
En s’aggravant, elles peuvent abou-
tir «à des complications mortelles,
telles que les cirrhoses et les cancers
du foie».
Lutter contre ce fléau. Objectif: «ré-
duire la transmission des virus, ren-
forcer le dépistage, pour orienter les
patients vers une prise en charge
médicale précoce (…) et développer la
surveillance épidémiologique».
«la prévention de ces maladies re-
pose, principalement, sur la vaccina-
tion pour l’hépatite B et la politique de
réduction des risques pour l’hépatite
C». Les populations à risque «doivent
se faire dépister, le plus tôt possible»
1
/
2
100%