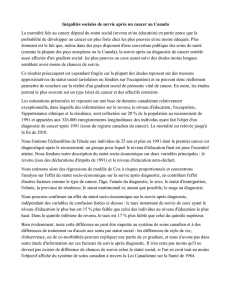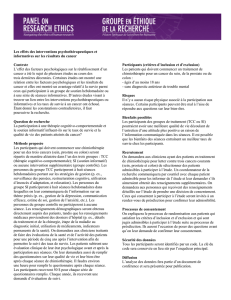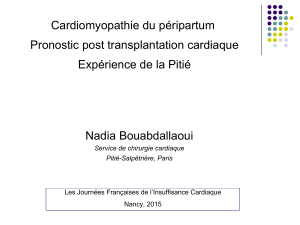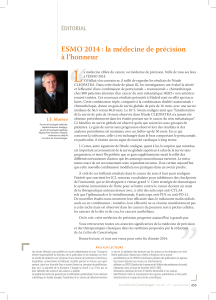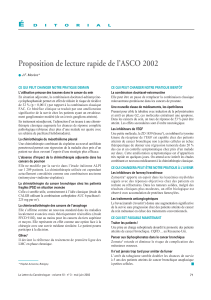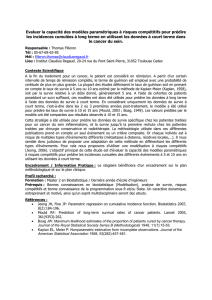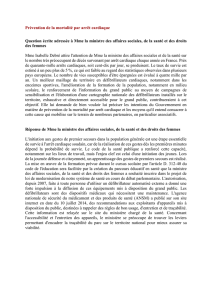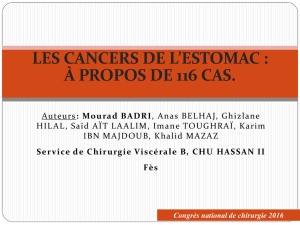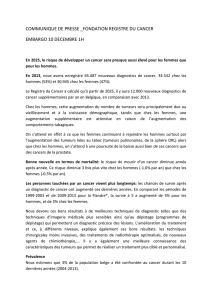Diminution du nombre de décès par cancer aux États

LE JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE
L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
LE JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE
L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N° 7TRIMESTRIEL – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
Éditeur responsable: Harry Bleiberg, 1 rue Héger-Bordet, 1000 Bruxelles – N° d’agréation: P501016 – Autorisation de fermeture B-714 – Ne paraît pas en juillet-août
DOSSIER SURVIE:
Le point de vue du philosophe,
de l’économiste, du psychologue…
pp. 8-18
Diminution du nombre
de décès par cancer
aux États-Unis!!!
Où en est l’Europe ? p. 4
Au-delà de la médecine –
Rubrique «Art Contemporain» p. 36
Les leucémies lymphoblastiques
aiguës de l’enfant p. 24
DOSSIER SURVIE:
Le point de vue du philosophe,
de l’économiste, du psychologue…
pp. 8-18
Diminution du nombre
de décès par cancer
aux États-Unis!!!
Où en est l’Europe ? p. 4
Au-delà de la médecine –
Rubrique «Art Contemporain» p. 36
Les leucémies lymphoblastiques
aiguës de l’enfant p. 24

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
1
ÉDITORIAUX
2
Des gains de survie à une réduction de la mortalité par cancer:
il n’y a qu’un pas!
Harry Bleiberg
4
La mortalité par cancer diminue aux USA. Et aussi en Europe
(et depuis plus longtemps…)
Philippe Autier
5
Traitement antifongique: quelle place pour les échinocandines?
Michel Aoun
DOSSIER SURVIE
8
Au carrefour des morales – Savoir lutter et accepter
Gilbert Hottois
9
La distribution de survie après le diagnostic d’un cancer:
un outil d’évaluation des traitements
Marianne Paesmans
11
La survie dans les cancers: le point de vue des autorités de santé
Jean-Paul Degaute
12
Development of new technologies in oncology: do the advantages
justify the cost? A perspective from within the industry
Pierre Dodion
13
Survie: trop cher? Le point de vue de l’économiste de santé
Alain Dewever
14
Quantité de vie ou qualité de vie?
Dominique Bron
16
Qu’est ce que la survie quand on parle des tumeurs solides:
l’exemple du cancer du côlon
Harry Bleiberg
17
La guérison du cancer: l’expérience vécue du côté des «survivants»
Nicole Delvaux
DÉPISTAGE
20
Le dépistage du cancer du sein: Pourquoi, pour qui et comment?
Jean-Marie Nogaret
IMAGERIE
22
Nouvelles technologies en oncologie médicale: le PET-CT
Patrick Flamen
INFORMATION SCIENTIFIQUE
24
Les leucémies lymphoblastiques aiguës de l’enfant
Alina Ferster
27
Anesthésie-réanimation et oncologie:
nécessité d’une bonne connaissance de la pathologie cancéreuse
Patricia Ewalenko
29
Novel treatment strategies for malignant melanoma
Bernd Kasper
30
Traitement adjuvant des tumeurs cervico-faciales localement avancées:
enfin un «nouveau» standard?
Yassine Lalami
GUIDELINES
32
Données récentes sur l’utilisation des facteurs stimulant la granulopoièse
pour réduire l’incidence de la neutropénie fébrile induite
par la chimiothérapie des tumeurs solides et des lymphomes
Jean Klastersky
ÉTUDES CLINIQUES
33
Lapatinib: le deuxième espoir pour le cancer du sein HER-2 positif?
Evandro de Azambuja et Martine Piccart-Gebhart
AU-DELÀ DE LA MÉDECINE
36
Prologue à une chronique d’art vivant
Pierre Sterckx
RÉDACTEURS EN CHEF
Harry BLEIBERG
Ahmad AWADA
Recherche Clinique
Ahmad AWADA
Recherche Translationnelle
Fatima CARDOSO
Recherche Fondamentale
Christos SOTIRIOU
Gilbert VASSART
Hémato-oncologie
Willy FERREMANS
Philippe MARTIAT
Psycho-oncologie
Nicole DELVAUX
Darius RAZAVI
Spécialistes en oncologie
Vincent NINANE
Jean-Luc VAN LAETHEM
Bordet-IRIS
Jean-Pierre KAINS
Martine PICCART
Wallonie
Vincent RICHARD
Erasme
Thierry VELU
COMITÉ DE RÉDACTION
Ahmad AWADA
Harry BLEIBERG
Arsène BURNY
Vincent NINANE
Jean-Claude PECTOR
Martine PICCART
Jean-Luc VAN LAETHEM
CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
Marc ABRAMOWICZ
Guy ANDRY
Michel AOUN
Jean-Jacques BODY
Dominique BRON
Dominique DE VALERIOLA
Olivier DEWITT
André EFIRA
Patricia EWALENKO
Patrick FLAMEN
Thierry GIL
Michel GOLDMAN
André GRIVEGNEE
Alain HENDLISZ
Jean KLASTERSKY
Denis LARSIMONT
Marc LEMORT
Dominique LOSSIGNOL
Thi Hiyen N’GUYEN
Thierry ROUMEGUERE
Eric SARIBAN
Jean-Paul SCULIER
Philippe SIMON
ASSISTANTE À LA RÉDACTION
Martine HAZARD – Tél. 02/541 32 01
jcancer[email protected]
COMITÉ DE LECTURE
Marianne PAESMANS
Jean-Claude PECTOR
Marielle SAUTOIS
Le contenu des articles publiés dans ce journal
n’engage que la responsabilité de leur(s) auteur(s)
www.jcancerulb.be
Si vous souhaitez recevoir la version électronique
(PDF) du Journall du Réseau Cancer
de l’Université Libre de Bruxelles,
vous pouvez en faire la demande
à Martine Hazard à l’e-mail suivant:
jcancer[email protected]

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
2
3
ÉDITORIAUX
Des gains de survie à une
réduction de la mortalité par cancer:
il n’y a qu’un pas!
La survie est au cœur du problème quand on parle du cancer. Pour le malade, évidemment, mais
aussi pour tous les professionnels de la santé qui, de loin ou de près, vont être en charge de cette
maladie qui occupe tous les imaginaires. Nous voulions voir comment chacun abordait le concept.
Le philosophe s’est intéressé à la condition humaine, aux choix de fin de vie, l’acharnement théra-
peutique, l’euthanasie, les soins palliatifs. Pour lui, la philosophie morale et la bioéthique contem-
poraines doivent offrir des cadres et des principes théoriques qui, sans donner des solutions,
constituent des repères pour la réflexion et la prise de décision (Gilbert Hottois page 8). Le méde-
cin d’industrie perçoit la survie comme un gain de temps qui ne peut être produit que s’il est
associé à un gain financier. Pour lui l’équation va de soi. L’industrie pharmaceutique est floris-
sante dans la mesure où elle met sur le marché un produit qui répond au besoin des malades. À la limite, plus le
gain de survie est important plus le médicament rapportera de l’argent (Pierre Dodion page 12). Pour les autorités
de santé, la survie ne s’exprime pas seulement en termes de durée mais également en termes de coût que la
société, dans un système social comme celui de la Belgique, doit assumer. On sent son malaise devant des
coûts qui s’envolent et les difficultés de remboursements qui lui paraissent inévitables. Il esquisse une réflexion
sur des solutions possibles (Jean-Paul Degaute page 11). L’Économie de la Santé a pour rôle de mettre à la dispo-
sition des nombreux décideurs en matière de soins de santé, des outils permettant d’établir des priorités et de
faire des choix basés à la fois sur l’efficacité et le coût d’un traitement. Il faudra faire des choix, l’économiste don-
nera ses indications, ce n’est pas lui qui décidera (Alain Dewever page 13). Les chercheurs cliniciens veulent pro-
longer le temps de vie. Lutter contre la maladie c’est l’empêcher d’évoluer, de progresser. Le temps gagné est un
bon étalon de la mesure de l’effet des traitements. Un gain de temps, même minime finira par produire une prolon-
gation de la durée de vie de plusieurs années (Harry Bleiberg, Dominique Bron pages 16 et 14). La psychologie
se rapproche plus des préoccupations humaines, elle rappelle que l’expérience du cancer représente sur le plan
humain une véritable crise et implique une série d’adaptations continues. Survivre c’est vivre avec cet événe-
ment qu’est le cancer toute sa vie durant. Le rôle du psychologue est d’aider le patient dans ce chemin de
redéfinition de soi (Nicole Delvaux page 17).
Tandis que la préparation de ce numéro 7 du Journal touchait à sa fin, le hasard a voulu que le NCI Cancer Bulletin for
January 23, 2007 annonce que, pour la deuxième année consécutive, on observait une réduction de la mortalité par
cancer aux États-Unis1. La nouvelle a fait peu de bruit dans la presse européenne et pourtant elle répond aux rêves
de toutes ces personnes qui nous demandent toujours «Alors le traitement du cancer, cela progresse?» Mais oui
le traitement progresse! L’American Cancer Society rapporte une diminution de 3014 décès par cancer aux États-
Unis de 2003 à 2004. La première réduction était observée de 2002 à 2003 et était de 369 décès. Cette réduc-
tion du nombre des décès par cancer est perceptible pour les quatre principaux sites du cancer chez l’homme
et chez la femme (poumon, sein, prostate et côlon/rectum), excepté pour le cancer du poumon chez la femme.
(Figures 1 et 2). Le cancer colorectal est celui qui démontre la plus forte diminution dans le nombre de décès.
Alors que le taux de décès est en baisse depuis 1991, ce n’est qu’en 2003 que la chute de la mortalité était
suffisamment importante pour compenser l’augmentation de l’incidence des cancers liée au vieillissement et à
l’accroissement de la population. L’ampleur du phénomène fait dire aux experts qu’il est probablement irréver-
sible2. En 1971, le Président Richard Nixon déclarait une guerre nationale contre le cancer et signait le National
Cancer Act, établissant un programme national afin de rechercher le traitement du cancer. L’effet sur la mortalité
rapporté 35 ans plus tard résulte des stratégies menées contre le cancer aux États-Unis en faveur de la prévention,
du diagnostic précoce et l’élaboration de nouveaux traitements.
L’Europe semble suivre la même tendance. On note depuis les années 90 une diminution du taux des cancers.
Il est probable que la réduction du nombre des décès par cancer sera également perceptible lorsqu’il compen-
sera l’augmentation de l’incidence des cancers liée au vieillissement de la population.
Augmenter la survie, réduire la mortalité par cancer était un objectif que nous avons longtemps cru inatteigna-
ble. La mise en place de stratégies diagnostiques et thérapeutiques structurées et validées est le fondement de
ce succès. Le cancer reste la première cause de mort chez les personnes de moins de 85 ans. Nous devons
poursuivre le chemin. Harry Bleiberg
Rédacteur en Chef
2. Jemal A et al. CA Cancer J Clin 2007; 57:43-66.
Figure 1: Taux annuel de la mortalité, ajusté sur l’âge, pour une sélection de cancers
chez les hommes (1930-2003).
Figure 2: Taux annuel de la mortalité, ajusté sur l’âge, pour une sélection de cancers
chez les femmes (1930-2003).
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
Harry Bleiberg

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
5
ÉDITORIAUX
La mortalité par cancer diminue aux USA.
Et aussi en Europe (et depuis plus longtemps…)
Le rapport pour 2007 de l’American Cancer Association1sur l’incidence et la mortalité par
cancer aux USA montre une diminution de 13,9% du nombre de décès pour 100.000 person-
nes par an (c’est-à-dire le «taux de décès») par cancer entre 1991 et 2002, et ce après ajuste-
ment sur l’âge. Cette dernière précision, «après ajustement sur l’âge» indique que le change-
ment observé n’est pas dû à une différence de structure d’âge de la population américaine
entre 1991 et 2002. La baisse de mortalité par cancer aux USA est donc bien réelle et subs-
tantielle. Qu’en est-il en Europe, et plus précisément en Belgique? En l’absence de données
de mortalité décemment récentes pour la Belgique, nous avons préféré examiner les données
françaises2, 3, qui sont nationales pour la mortalité et basées sur quatre registres départemen-
taux pour l’incidence (figure 1). Comme pour les données américaines, l’ajustement des taux
sur l’âge efface les changements temporels dus à des changements de structure d’âge.
Depuis 1978, le nombre de patients atteints d’un cancer par 100.000 personnes par an (c’est-à-dire le taux
d’incidence) ajustés sur l’âge a augmenté de 23% chez les hommes et de 20% chez les femmes. Ces augmen-
tations d’incidence sont donc réelles et non expliquées par le vieillissement. Les causes essentielles de ces
augmentations sont l’accroissement du taux d’incidence du cancer du sein chez la femme et du cancer de la
prostate chez l’homme. Ces augmentations sont largement induites par le dépistage de ces cancers. La prise
de traitement hormonal de la ménopause pendant plusieurs années, les changements des facteurs reproductifs
(par exemple, diminution de l’âge à la ménarche, première naissance après 30 ans, fertilité nulle ou faible,
absence d’allaitement au sein) et l’accroissement de l’obésité sont d’autres causes d’augmentation de l’inci-
dence du cancer du sein.
En contraste avec l’incidence, les taux de mortalité ajustés sur l’âge diminuent considérablement: un pic est
observé en 1985 pour la mortalité chez les hommes, alors qu’on observe une diminution constante chez les
femmes (figure 1). Au total, de 1985 à 2002, la mortalité par cancer (ajustée sur l’âge) a diminué de 13% chez
l’homme et de 1968 à 2002, elle a diminué de 29% chez les femmes. Cette diminution est donc largement
comparable, sinon supérieure à celle observée aux USA.
Maintenant, les changements de taux annuel ne peuvent masquer le fait patent que les nombres absolus de
décès par cancer sont actuellement supérieurs à ce qu’ils étaient auparavant. Toujours en France, il y avait
105.683 décès par cancer en 1968 et 146.420 en 2002, soit un accroissement de 39%. Un peu de calcul de
proportionnalités montre qu’entre 1968 et 2002, le simple accroissement de la population française aurait dû
conduire à un accroissement de 22% du nombre de cancers, et le vieillissement aurait dû conduire à un
accroissement proportionnel de 28% de ce même nombre. L’addition des effets population totale et vieillissement
donne 42%. Or, l’accroissement réel du nombre de décès par cancer du sein a été de 38%. La différence de
4% représente la diminution de mortalité par cancer en France entre 1968 et 2002. Cette différence serait bien
plus considérable si l’année 1985 avait servi de référence.
Les données américaines informent aussi que le nombre absolu de personnes décédant d’un cancer tend à
diminuer aux USA, avec un déficit de 3000 décès en 2004 par rapport à 2003. Il y a d’abord un petit effet
annonce, car ces 3000 décès représentent seulement 0.5% du total des décès par cancer aux USA, et un
changement mineur dans les modalités de déclarations de décès peut expliquer cette diminution. Il reste aussi
à démontrer la signifiance statistique de cette diminution. Quoiqu’il en soit, une diminution du nombre de décès
par cancer ne surviendra sans doute pas en Europe. Il existe une forte différence de structure d’âge entre les
populations américaines et européennes: le vieillissement de l’Europe est le principal responsable de l’accrois-
sement soutenu du nombre de patients cancéreux, et il faudrait des gains de survie considérables, irréalistes à
court terme, pour observer une diminution du nombre de patients cancéreux. Le vieillissement étant moins pro-
noncé aux USA, une diminution de la mortalité par cancer (c’est-à-dire une meilleure survie) peut très bien se
refléter par un moindre nombre de décès par cancer.
Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que l’espérance de vie, l’indicateur qui finalement synthétise toutes les pres-
sions possibles sur la vitalité des individus, reste plus élevée en Europe occidentale qu’aux USA.
■
Philippe Autier,
Coordinator, Biostatistics & Epidemiology Cluster, Group Head,
Data Analysis and Interpretation Group EUROCAN+PLUS
Project Coordination (www.eurocanplus.org)
International Agency for Research on Cancer (www.IARC.fr)
Traitement antifongique:
quelle place pour les échinocandines?
Éditorial concernant l’article: Echinocandins for Candidemia in Adults without
Neutropenia. J.E. Bennett, New Eng J Med 2006; 333 n°11:1154-1159
Les infections fongiques, notamment candidoses et aspergilloses invasives, sont fréquentes chez
les patients immunocompromis.
Six à 9% des hémocultures positives sont dues au Candida tandis que l’aspergillose invasive sur-
vient dans 10 à 25% des allogreffes de moelle ou des leucémies aiguës. La mortalité des infections
fongiques reste élevée, de 30 à 40% pour les candidoses invasives, et supérieure à 50% pour l’as-
pergillose invasive.
Le diagnostic microbiologique reste difficile puisque seulement 50% des hémocultures sont positi-
ves sans des candidoses prouvées à l’autopsie, et le rendement du lavage broncho-alvéolaire
ne dépasse pas les 30 à 40% dans les aspergilloses invasives.
La nature eucaryote des champignons a constitué pendant longtemps un obstacle au développement de nouveaux
produits à la fois actifs et peu toxiques. Cet obstacle a été surmonté par la découverte des échinocandines. Contrai-
rement aux polyènes et dérivés azolés qui ont pour cible l’ergostérol et la membrane plasmidique, les échinocandi-
nes inhibent la synthèse de 1.3 ß-D glucan, un composant essentiel de la paroi de certains champignons et qui
n’est pas présent dans la cellule humaine.
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
4
Références
1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer
Statistics, 2007. CA Cancer J Clin 2007; 57:43-66.
2. Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Storm H. Cancer Incidence in
five Continents, Vol. I to VIII, IARC CancerBase No.7, Lyon,
2005.
3. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale,
Centre d’Épidémiologie sur les Causes Médicales de Décès
(INSERM, CepiDc), Paris, 2006.
Incidence registres du Bas-Rhin,
du Calvados, du Doubs et de l’Isère Mortalité
France métropolitaine
>>>
Philippe Autier
Michel Aoun
Figure 1

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°7 – JANVIER-FÉVRIER-MARS 2007
6 7
ÉDITORIAUX
La classe des échinocandines comprend trois molécules développées en clinique: caspofungine (MSD), mica-
fungine (Astellas) et anidulafungine (Pfizer). Leur spectre d’activité antifongique est étroit avec une action fongicide
sur le Candida fungistatique, sur l’Aspergillus et pas d’activité sur le Cryptocoque, les Zygomycetes et le Fusarium.
Les échinocandines sont actives in-vitro sur tous les types de Candida y compris C. Glabrata et C. Krusei. Seul
C. Parapsilosis apparaît moins sensible in vitro avec des concentrations minimales inhibitrices (CMI) de l’ordre de
2 µg/ml. La résistance est croisée entre les trois molécules. Les échinocandines ne sont pas résorbées par le tube
digestif et sont disponibles uniquement par voie intraveineuse. Elles se caractérisent par une longue demi-vie et
sont données en une dose journalière. Le taux de liaison aux protéines est très élevé pour micafungine (96%) et
caspofungine (90%) et plus faible pour anidulafungine (84%). Les trois molécules ont un volume de distribution
faible augurant d’une pénétration tissulaire limitée de certains sites notamment au niveau du système nerveux.
Aucune des 3 molécules n’est un substrat ou un inhibiteur du cytochrome P450. Elles sont métabolisées dans le
foie et ne sont pas éliminées dans les urines (< 1%).
L’administration concomitante de caspofungine et de cyclosporine résulte en une augmentation de l’aire sous la
courbe de la caspofungine et a donné lieu à une augmentation des transaminases hépatiques chez des volontaires
sains. La micafungine augmente l’aire sous la courbe de la nifedipine et du sirolimus tandis qu’il n’y a pas d’in-
teraction médicamenteuse décrite pour l’anidulafungine.
Qu’en est-il de l’expérience clinique de ces trois échinocandines?
Dans une revue récente du rôle des échinocandines dans le traitement des candidémies, John E. Bennet souligne
tout d’abord la 4eplace qu’occupe le Candida parmi les germes responsables d’infections hématogènes nosoco-
miales, l’émergence de C. glabrata sous prophylaxis par fluconazole, l’excès de mortalité attribuée aux candidémies
de 14.5%. Il analyse ensuite le rôle des échinocandines dans le traitements des candidémies et des candidoses
invasives, à travers 3 études randomisées, en double aveugle, comparant chacune des échinocandines avec
un antifongique contrôle, différent dans chaque étude: amphotéricine B conventionnelle pour la caspofungine,
amphotéricine B liposomale pour micafungine et fluconazole pour anidulafungine.
Il s’agit en majorité de patients non neutropéniques, avec un score Apache peu sévère en moyenne. Les taux
de réponse étaient comparables, seule l’anidulafungine s’est montrée supérieure au fluconazole en taux de
succès mais la mortalité est identique. De tout ceci, on peut conclure, même s’il n’y a pas eu de comparaison
directe entre les trois échinocandines, qu’elles sont équivalentes, qu’elles donnent un taux de succès supérieur
à 70% dans les candidémies, qu’elles sont toutes bien tolérées et peu toxiques. Dès lors, faut-il les substituer
aux autres antifongiques comme l’amphotéricine B conventionnelle ou le fluconazole dans le traitement de la
candidémie? Compte-tenu du prix plus élevé des échinocandines par rapport aux deux autres antifongiques, il
est plus judicieux de les réserver à certaines indications particulières.
Pour un patient non neutropénique, hémodynamiquement stable, qui n’a pas reçu récemment un dérivé azolé
et qui n’est pas connu pour être colonisé par C. krusei ou glabrata, le fluconazole constitue le traitement de pre-
mière ligne. Par contre, toujours pour un patient non neutropénique mais hypotendu, le choix d’une échinocan-
dine est plus adéquat, basé sur la fongicidie et l’absence de néphrotoxicité.
Pour les patients neutropéniques, il y a peu d’expérience avec les échinocandines à l’exception de la micafungine
(34 patients avec 75% de succès); par contre, il existe une large expérience avec l’amphotéricine B conventionnelle.
En cas d’insuffisance rénale, on a le choix entre une formulation lipidique d’amphotéricine B ou micafungine.
Existe-t’il des sites sanctuaires où l’efficacité des échinocandines pourrait être compromise?
L’endophtalmite, l’endocardite à C. parapsilosis, la méningite et la candidurie, pourraient être problématiques.
Il est indéniable que les échinocandines constituent un progrès majeur dans le traitement des candidémies et
candidoses invasives, avec beaucoup d’atouts et quelques limitations qu’on doit apprendre à connaître.
■
Michel Aoun,
Département des Maladies Infectieuses, Institut Jules Bordet
ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG
Résultats 2003-2005 de l’enquête de surveillance
dans les hôpitaux belges
Les piqûres par aiguilles, les blessures par instruments et les
éclaboussures de sang, sont fréquentes dans les hôpitaux et
les maisons de soins. Elles impliquent des risques aux consé-
quences psychiques, physiques, juridiques et financières non
négligeables. Devant le manque de données spécifiques à
notre pays, l’ISP (Institut Scientifique de Santé Publique) a
entrepris en juin 2003 un programme de surveillance des
accidents d’exposition au sang (AES) – les accidents de piqûre,
coupure, éclaboussure – au sein du personnel hospitalier dans
le cadre du réseau national de la surveillance des infections
dans les hôpitaux (NSIH); 47 hôpitaux aigus (sites) y ont par-
ticipé de manière volontaire durant un an et ont enregistré les
accidents selon la version belge du logiciel EPINet (Exposure
Prevention Information Network)2.
En extrapolant le chiffre de 1624 accidents de piqûres et cou-
pures et 102 éclaboussures rapportés, soit une moyenne à
10,1 AES par 100 lits par an, les auteurs estiment qu’il y a, dans
notre pays 5700 AES par an, un chiffre qui sous-estime proba-
blement le problème. Beaucoup d’AES ne sont en effet pas
rapportés si l’on en croit une étude des CDC avec 57% d’AES
non déclarés. «On atteindrait alors un chiffre de 13000 AES par
an, rapporte Eva Leens, très semblable aux chiffres rappor-
tés par d’autres réseaux de surveillance EPINet en Europe.»
Qui? Où? Comment?
L’incidence moyenne varie significativement selon le statut de
l’hôpital: 11,3 AES par 100 lits par an dans les hôpitaux univer-
sitaires pour 9,5 AES dans les hôpitaux non-universitaires, le
nombre d’AES variant également selon le nombre de lits. Les
hôpitaux avec plus de 500 lits ont significativement plus d’AES
par rapport aux hôpitaux plus petits. La majorité des AES sont
déclarés par les infirmiers(ères), plus d’un tiers de ces AES
ayant lieu lors de l’utilisation de matériel permettant d’admi-
nistrer un liquide, un geste de routine. Les médecins n’enregis-
trent de leur côté que 8% des AES… Enfin, il est étonnant de
constater que 9% des AES surviennent parmi le personnel des
services logistiques, le plus souvent suite à un contact avec des
aiguilles perdues. La chambre du patient est l’endroit princi-
pal où ont lieu les AES (38%). La salle d’opération (17%) et le
service d’urgence sont également des services à risque.
Trois accidents de piqûres sur quatre (78%) sont causés par
des aiguilles creuses (aiguilles IV, IM, SC et ID pour 27%,
cathéters intra-vasculaires: 11%, aiguilles de prise de sang:
11%). Parmi les instruments tranchants/piquants, les aiguil-
les de suture (non creuses) (7%), les bistouris (6%) et les lan-
cettes (6%) sont également à risque. Enfin, un peu plus d’un
tiers des accidents de piqûres se produit pendant le retrait
du matériel, 27% pendant l’utilisation et 27% pendant le ran-
gement, ces pratiques de rangement méritant d’ailleurs plus
d’attention, en particulier par l’utilisation d’un collecteur d’ai-
guilles. «Signalons également, poursuit-elle, que, malgré des
messages répétés déconseillant le recapuchonnage et atti-
rant l’attention sur le danger de cette pratique, 6,7% des
accidents de piqûres rapportés sont encore causés par ce
recapuchonnage».
Le personnel soignant se protège trop peu
L’application des mesures de prévention universelles s’est avé-
rée être efficace surtout pour les accidents d’éclaboussures.
«Cependant, dans plus de la moitié (53%) des éclaboussures,
le personnel ne portait aucun moyen de protection (gants, mas-
que, lunettes ou tablier), 17% ne portant même pas de gants
pendant une prise de sang, une activité à haut risque. Ces
mesures sont pourtant importantes, non seulement en protec-
tion contre les AES, mais également pour la protection des
patients contre les infections nosocomiales, la sécurité du
personnel allant ici de pair avec celle du patient.»
Par ailleurs, si le patient source était connu dans 77% des AES,
le statut de contamination n’était pas connu pour la moitié
d’entre eux, alors que dans un peu plus que 1 cas sur 10 AES
rapportés (11,4%) il s’agissait d’une aiguille qui avait été en
contact avec un patient contaminé. «Ce patient source était
contaminé par le VIH (n=28), HBV (n=30), HCV (n=80), ou un
autre micro-organisme (n=35), la prévalence des 3 virus étant
par ailleurs plus élevée dans la surveillance que dans la popu-
lation, ce qui pourrait indiquer que ce sont principalement les
contacts à haut risque qui sont rapportés.» Enfin, ce pro-
gramme de surveillance a permis d’estimer le risque de séro-
conversion au sein du personnel hospitalier à 0,6 à 6 cas par
an pour l’hépatite C et à un cas en 5 ans pour le VIH.
De quoi multiplier les moyens de prévention…
1. http://www.iph.fgov.be/nsih/download/PRIK_cumul_rapport2003_
2005FR6.pdf /
http://www.iph.fgov.be/nsih/download/PRIK_cumulrapport_prik_2003_
2005_nl4.pdf
2. http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/EPINet/
70% des accidents d’exposition au sang (AES) rapportés
dans les hôpitaux belges sont évitables1. Et, si la prévention
passe d’abord par une adaptation des procédures et l’utili-
sation du matériel de sécurité, elle nécessite également une
formation, des campagnes de prise de conscience du pro-
blème, un personnel adapté et un intérêt pour la sécurité du
personnel de la part des cadres.
ACCIDENTS D’EXPOSITION AU SANG
Résultats 2003-2005 de l’enquête de surveillance
dans les hôpitaux belges
Dr Dominique-Jean Bouilliez – Directeur médical CMPMedica
UNE COMMUNICATION AMGEN
>>>
Éditeur responsable: A. Hubert/Amgen/03.2007/1723
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%