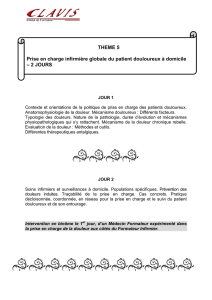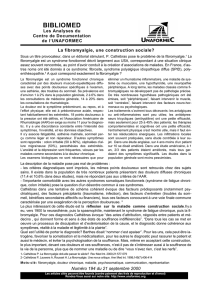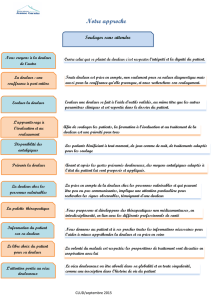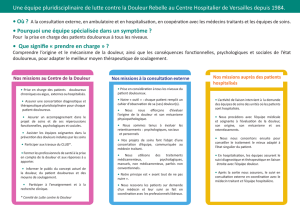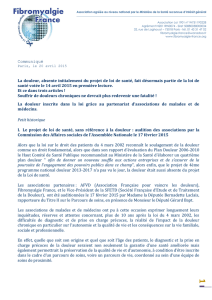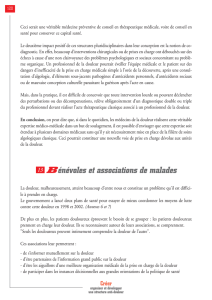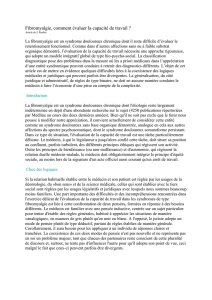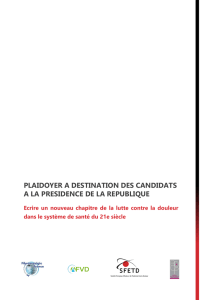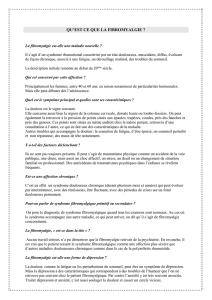La douleur chronique comme construction sociale

144
Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003
Éthique
É
thique
La douleur chronique comme construction sociale
Pascal Cathébras*
A
u cours des débats entre cliniciens non spécialistes
de la douleur et “algologues”, il est parfois question
d’éventuels “effets pervers” des centres d’évaluation
et de traitement de la douleur : diagnostics potentielle-
ment occultés par le label “douleur” ; attentes irréalistes
suscitées chez les malades souffrant de douleurs chro-
niques non malignes ; accaparement durable des moyens
des centres par un certain type de patients dont la qualité
de vie demeure médiocre (mais d’espérance de vie nor-
male), alors que d’autres malades ne bénéficient que trop
peu des progrès de l’algologie. Il m’est apparu que le
terme de “construction sociale de la douleur chronique”
pouvait fournir un point de départ à la fois provocateur et
éclairant sur ces questions. Je sais que ce concept de
“construction sociale” est à la mode chez les spécialistes
des sciences humaines, et qu’il tend à irriter les cliniciens
et les malades, qui y voient un déni de la souffrance. C’est
pourquoi j’essaierai d’en faire une réalité tangible, y com-
pris pour le praticien confronté chaque jour à une com-
plexité qui lui interdit “la quête futile de la certitude” (1).
Sous le titre général de “construction sociale de la douleur
chronique”, on peut tenter de répondre à deux questions,
en théorie distinctes, mais indissociables en pratique :
– Comment la catégorie “douleur chronique” s’est-elle so-
cialement et culturellement construite au cours des cinquante
dernières années, et comment est-elle devenue opératoire
pour les médecins, en particulier dans les centres de la dou-
leur (qui, à leur tour, contribuent à la diffusion du concept) ?
– Comment, dans chaque cas individuel, les situations de
douleur chronique se construisent-elles au fil du temps, par
interaction entre pathologie lésionnelle, prédisposition
et/ou retentissement psychologiques et système de soin,
avec, dans tous les cas, une dimension sociale essentielle,
mais largement occultée, y compris dans les consultations
d’évaluation et de traitement de la douleur ?
La construction sociale d’un diagnostic
médical : qu’est-ce que cela veut dire ?
Les maladies sont-elles des “choses en soi” ? Existent-elles
dans la nature indépendamment des concepts qui servent à
les décrire ? Porter un diagnostic, est-ce “découvrir” une réa-
lité ? Ou est-ce aussi “construire” une explication (2) ? La
perspective constructiviste en sociologie des sciences remet
en question le point de vue selon lequel les sciences ne fe-
raient que décrire objectivement les phénomènes de la na-
ture, mais n’implique pas que ces phénomènes seraient
moins réels. Elle indique simplement que “derrière chaque
connaissance, il y a un empilement de croyances et de
conventions sociales” (3). En médecine, cela veut dire que
nommer une maladie revient à extraire du chaos de la réa-
lité des éléments jugés signifiants, en fonction de théories
et de croyances préexistantes, pour donner sens aux obser-
vations et les orienter en retour. “Construire” un diagnos-
tic (qu’il s’agisse de porter un diagnostic dans une situation
de soin ou d’inventer une nouvelle maladie), c’est extraire
de l’ensemble confus des symptômes, de leur vécu subjec-
tif et de leurs représentations (illness) les éléments d’une en-
tité “ontologique” : la maladie (disease) (2). Dans cet es-
prit, Roger Bastide écrivait que “la maladie n’est pas une
entité en soi, elle résulte d’une confrontation entre deux in-
dividus, l’un qui apporte le mystère de ses troubles, l’autre
qui lui en propose une explication, qui fait entrer le subjec-
tif dans l’objectivité d’un système théorique”. La maladie
est donc “une construction au bout d’un dialogue, mais une
construction qui dépasse le dialogue, puisque, derrière le
malade, il y a toutes les représentations collectives des
troubles et, derrière le médecin, des systèmes appris dans
les livres et dans les écoles” (4). C’est aussi l’avis de
Norbert Bensaïd, pour qui il faut que le médecin “s’im-
prègne d’une vérité à laquelle rien dans ses études ne le pré-
pare (...) Il lui faut d’abord se convaincre que le fait médi-
cal, c’est-à-dire tout ce qui se passe à partir du moment où
la personne se dit malade et fait appel à la médecine (...),
n’est pas une réalité donnée au départ, mais une construc-
tion… Cette construction (...) s’élabore à partir de deux
réalités de base, qu’elle ne nie pas, mais qu’elle dépasse :
la demande du malade et les connaissances médicales. En-
core faut-il rappeler que ces deux réalités sont relatives.
Elles sont des abstractions commodes mais falsifiantes,
pour peu qu’on s’obstine à en faire des réalités “en soi”...
La plainte du malade ne devient une “maladie” qu’à partir
du moment où le médecin et la médecine interviennent.
Mais ce n’est que par violence et artifice qu’elle est sépa-
rée du vécu dans laquelle elle s’enferme, qu’elle devient une
chose parfaitement définie et circonscrite” (5).
En raison de l’aspect fondamentalement relationnel de la pra-
tique médicale, la construction des faits scientifiques n’a
pas la même conséquence en médecine qu’en astronomie.
Si les astres ne seront jamais changés par les théories des as-
tronomes, les comportements, en revanche, peuvent être in-
fluencés par les théories qui visent à les expliquer (6). Dire
que la maladie est socialement construite ne revient pas à nier
la réalité des symptômes, et encore moins de la souffrance,
mais c’est rappeler qu’en nommant les choses, en expli-
* Service de médecine interne, hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne.

145
Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003
Éthique
É
thique
quant et en proposant un pronostic, le médecin va interve-
nir sur le cours de la maladie elle-même. Les théories mé-
dicales diffusant dans le public “profane” modifient les
symptômes et le cours de la maladie, et sont en retour in-
fluencées par les idéologies en vigueur dans un moment his-
torique et socioculturel donné (2). De nombreux chercheurs
(sociologues, historiens, anthropologues et même méde-
cins) ont ainsi montré comment certaines catégories dia-
gnostiques étaient “socialement construites”. Cela est, bien
sûr, plus visible dans le domaine de la pathologie mentale.
De l’hystérie de Charcot au syndrome de fatigue chronique,
les symptômes “psychosomatiques” sont modelés par les
théories médicales qui visent à en rendre compte (7). Et
lorsque apparaît un “nouveau” syndrome, on peut parfois de-
viner, sous cette construction, certaines des préoccupations
de la société tout entière : la souffrance occultée des vété-
rans du Vietnam dans le syndrome de stress post-traumatique
(8), la dénonciation des violences sexuelles faites aux enfants
pour la personnalité multiple (9), la conjonction de la reli-
gion du travail et de la crainte des virus pour le syndrome de
fatigue chronique (10). Les catégories diagnostiques des pa-
thologies les plus organiques n’échappent pas à cette
construction sociale, comme l’a montré Aronowitz (11),à
propos de la maladie coronarienne et de la maladie de Lyme,
par exemple. Les facteurs socioculturels interviennent par-
ticulièrement (et cela n’est pas anodin pour notre sujet) lors-
qu’il s’agit de donner à un symptôme (ou à un syndrome)
un statut de maladie (12). Aronowitz prend l’exemple de
l’asthme, et on pourrait aussi citer le travail d’Alain Ehren-
berg sur la dépression (13). À propos de la dépression et de
la pathologie mentale en général, on doit maintenant ajou-
ter aux facteurs historiques et culturels d’insolents facteurs
économiques : ainsi, le marketing de l’industrie pharma-
ceutique contribue régulièrement à redéfinir (en les élargis-
sant) les contours de la pathologie dépressive et anxieuse, et
les enjeux se chiffrent en millions de dollars (14-16). Dans
le même esprit, j’ai essayé de montrer, non sans susciter de
vigoureuses critiques, comment le diagnostic de fibro-
myalgie était socialement construit (2, 17). Or, on peut, me
semble-t-il, considérer la fibromyalgie comme le paradigme
de la douleur chronique sans substratum anatomique.
L’exemple de la fibromyalgie
La fibromyalgie est un syndrome de douleur diffuse sans ex-
plication lésionnelle, exacerbée au niveau de certains points
d’insertion tendineuse. Il s’agit d’un syndrome fréquent,
d’évolution chronique, dont la physiopathologie reste mys-
térieuse, mais vraisemblablement centrée autour d’un phé-
nomène d’hyperalgésie d’origine multifactorielle, avec la
participation de troubles “périphériques”, comme des mi-
crotraumatismes musculotendineux répétés, et “centraux”
(perturbations du sommeil et troubles de l’humeur, entre
autres) (18). Souvent décrite comme une “nouvelle” mala-
die, la fibromyalgie se révèle être, en fait, un syndrome très
ancien, que l’on retrouve dans la littérature médicale sous des
noms variés, dont celui de neurasthénie (17). La question de
la nature somatique ou psychogène de la fibromyalgie, ou
même de son existence réelle, divise le monde médical (19).
En quoi la fibromyalgie est-elle socialement construite ?
Tout d’abord, par l’artifice qui consiste à extraire d’un
cortège de troubles les douleurs “musculosquelettiques”,
faisant passer une souffrance indifférenciée au statut de
maladie rhumatologique. En effet, de nombreux symp-
tômes sont rapportés par les patients fibromyalgiques :
outre la fatigue et les troubles du sommeil, des douleurs
abdominales, des céphalées, des paresthésies des extré-
mités, etc. Ces symptômes, communs à d’autres syn-
dromes fonctionnels (syndrome de fatigue chronique, syn-
drome de l’intestin irritable, etc.), font penser qu’une
conceptualisation plus globale des symptômes fonction-
nels (ou somatisation) serait plus appropriée (20). Mais les
points douloureux sur les insertions tendineuses sont ju-
gés plus significatifs. La publication de critères diagnos-
tiques (21) donne ainsi l’illusion d’une cohérence des
symptômes et d’une “réalité” de la “maladie”. L’officia-
lisation tient lieu d’authentification. Les associations de
malades ne s’y trompent pas, qui rappellent inlassablement
les critères de l’ACR et la “reconnaissance officielle” du
syndrome par l’Organisation mondiale de la santé.
En second lieu, la fibromyalgie est une catégorie sociale-
ment construite parce qu’elle reproduit une idéologie so-
ciale : la stigmatisation des troubles psychologiques. Si
ceux-ci sont fréquents chez les fibromyalgiques, et alors que
les rares médicaments ayant montré une petite efficacité
dans ce syndrome sont des psychotropes, les facteurs psy-
chologiques sont remarquablement absents de la liste des
“causes” de la fibromyalgie, au moins dans les brochures
et les thèmes de congrès des associations de malades, alors
que les anomalies biologiques les plus contestables sont
mises en avant. Ce qui est en jeu ici est l’assimilation du psy-
chogène à l’imaginaire ou, presque, comme le propose Kir-
mayer (22), de l’innocence à la culpabilité.
Enfin et surtout, le pronostic de la fibromyalgie est sociale-
ment construit. Les études confirment, certes, l’extrême chro-
nicité du syndrome, mais elles concernent des sujets sélec-
tionnés par leur recours aux soins les plus sophistiqués, et les
études menées plus près de la population générale sont loin
d’être aussi pessimistes (18). Or, la “reconnaissance offi-
cielle” réclamée par les militants de la fibromyalgie est
d’abord la reconnaissance d’une pathologie invalidante, al-
térant de façon définitive la qualité de vie. Si cette revendi-
cation est d’abord une demande de reconnaissance sociale et
montre surtout le douloureux besoin de légitimité des ma-
lades, elle risque aussi d’enfermer durablement des personnes
dont la souffrance relève au moins partiellement de causes
psychologiques ou économiques dans un statut de malades
chroniques dont elles auraient pu avantageusement se passer.
Mais revenons maintenant à la douleur chronique “pro-
prement dite”.

146
Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003
Éthique
É
thique
La douleur chronique :
perspective historique
La catégorie “douleur chronique” est constitutive de l’al-
gologie telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée et enseignée.
Je m’appuierai, pour le montrer, sur le remarquable livre
d’Isabelle Baszanger (23) : “La médecine de la douleur
s’est historiquement constituée autour de l’autonomisation
(la reconnaissance et la légitimation) d’une catégorie mé-
dicale nouvelle, la douleur chronique” (p. 33). Même si des
précurseurs, comme Leriche, avaient déjà évoqué la notion
de “douleur-maladie”, Baszanger situe la naissance du
concept de douleur chronique dans l’immédiat après-guerre
(1945), avec le travail inlassable de John Bonica pour faire
reconnaître la nécessité d’une approche nouvelle des si-
tuations d’échec médical face à la douleur. Dans la pre-
mière édition de son livre (1953), Bonica montre que la
douleur chronique (à cette époque, seule la durée entre en
compte) est dévastatrice et résulte de l’intrication (plutôt que
de la juxtaposition) d’effets physiques et mentaux. La dou-
leur qui dure “crée un pattern de douleur centrale” ; elle est
toujours un “problème psychosomatique”. Mais, déjà, le sta-
tut du psychologique, dans cette première formulation, pose
problème : la singularisation de la douleur chronique passe
par la reconnaissance de sa dimension émotionnelle, mais
celle-ci est davantage conçue comme une conséquence
(d’où l’idée de prévention de la douleur chronique), et
Bonica demande de se garder d’étiqueter toutes les douleurs
qui durent comme douleurs “psychiques”. Ce double sta-
tut des facteurs psychologiques dans la douleur chronique,
à la fois élément accompagnateur de toute douleur et fac-
teur causal exclusif de certaines douleurs “psychogènes”,
sera la cause de nombre d’ambiguïtés à venir dans la prise
en charge de la douleur, comme on le verra plus loin. La
théorie de la porte (1965), qui pose les bases d’une nouvelle
approche thérapeutique fondée sur la notion de “contrôle
sensoriel” de la douleur, va permettre d’ancrer la médecine
de la douleur de Bonica dans la physiopathologie, réconci-
liant ainsi cliniciens et fondamentalistes, et va permettre
d’intégrer à une théorie scientifique la reconnaissance du
rôle des activités cognitives dans la douleur. Le premier
symposium international sur la douleur (1973), acte fon-
dateur de l’IASP, mettra en place la rhétorique fondatrice
du “monde de la douleur” : distinction fondamentale entre
douleur aiguë, signal d’alarme et symptôme, et douleur
chronique, maladie à composantes somatique, psycholo-
gique et sociale, invalidante et coûteuse pour la collectivité.
La multidisciplinarité de la pain clinic de Bonica devient
alors un modèle pour la pratique de la médecine de la dou-
leur. C’est à cette époque que les approches psychologiques
de la douleur, portées par le courant alors dominant aux
États-Unis du béhaviorisme, se radicalisent : quelle que
soit son origine (organique ou non), la douleur peut être
conçue comme un comportement appris, une “conduite de
maladie anormale” (Pilowsky), et il devient capital de sé-
parer conceptuellement la “douleur” du “comportement de
douleur”. Le rôle de l’interaction entre médecin et malade
(les “jeux de douleur” de l’approche transactionnelle) est
aussi reconnu. Les travaux des psychologues cliniciens im-
pliqués dans les pain clinics vont puissamment contribuer
à faire reconnaître l’existence d’un syndrome douloureux
chronique, et à le construire en opposition à la douleur ai-
guë non par sa durée, mais par un ensemble cognitif et com-
portemental spécifique. Ainsi apparaît une nouvelle ligne
de partage au sein de la douleur qui dure, centrée autour de
l’idée d’adaptation. La douleur chronique “non maligne” est
fréquente, comme le montrent de plus en plus d’études épi-
démiologiques (24), mais la plupart des sujets s’y adap-
tent. Seuls certains d’entre eux présentent des perturbations
comportementales retentissant sur leur vie familiale, so-
ciale et professionnelle : le syndrome douloureux chro-
nique. En conséquence, le problème cible des consultations
de la douleur doit-il être la douleur elle-même ou le syn-
drome douloureux chronique ? Cette question, qui divise les
algologues, représente aussi un problème central entre mé-
decins et malades. À travers elle, c’est la question fonda-
mentale de la responsabilité qui est posée. Même si l’on s’en
défend, on a toujours tendance à considérer une douleur
comme plus “réelle”, plus “légitime” si elle a une explica-
tion organique satisfaisante, et à en situer l’origine hors du
malade (au besoin, le clinicien s’en remet à l’idée scientiste
qu’avec les progrès de la connaissance, toute souffrance
subjective trouvera une explication biologique). Ainsi, le
conflit de responsabilité et de légitimité attaché à toute si-
tuation de douleur chronique n’est que très superficiellement
dépassé dans les consultations de la douleur. Il réapparaît
dans l’organisation interne des centres, comme le montre
Baszanger dans son étude ethnographique (23), et il est tou-
jours péniblement vécu par les patients (25, 26).
Le syndrome douloureux chronique :
une maladie en soi,
mais aussi un stéréotype médical
Comme le remarque Baszanger (23), les manifestations du
syndrome douloureux chronique, qui sont, “dans un modèle
dit médical [le modèle initial de Bonica] posées comme
accompagnant toute douleur qui dure, sont, dans le modèle
dit comportemental ou d’apprentissage, posées non plus
comme accompagnement mais comme la marque même de
la seule douleur chronique relevant d’une approche nou-
velle” (p. 153). Selon le modèle comportemental, qui ap-
paraît dominant, la “maladie en soi”, c’est le syndrome
douloureux chronique, qui doit être appréhendé de manière
identique quelle que soit l’étiologie initiale de la douleur.
Dans les présentations destinées aux non-spécialistes de la
douleur, le syndrome douloureux chronique est présenté
comme “l’ensemble mal différencié des facteurs émotion-

147
Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003
Éthique
É
thique
nels, cognitifs et comportementaux susceptibles de parti-
ciper à l’entretien et à l’exacerbation d’une douleur chro-
nique” (27). Il comprend quatre volets : la plainte doulou-
reuse, le comportement anormal vis-à-vis de la maladie, la
symptomatologie dépressive, et des facteurs de renforce-
ment (tableau). Bien sûr, toutes ces caractéristiques ne
concernent pas chacun des patients douloureux chroniques,
mais on a du mal à ne pas voir le type de patient ainsi des-
siné comme un repoussoir pour la médecine, et un malade
au moins partiellement responsable de son malheur. Le sté-
réotype du patient présentant un syndrome douloureux
chronique porte donc en lui le risque de la stigmatisation.
Cette situation apparaît quelque peu paradoxale, puisque les
centres de la douleur visent justement à prendre en charge
les laissés-pour-compte de la médecine, en les considérant
avant tout, au contraire de ce qui avait pu être suggéré ou
dit jusque-là, comme de “vrais” malades. Concept incon-
testablement utile lorsqu’il s’agit, par exemple, d’éviter les
interventions iatrogènes, le syndrome douloureux chro-
nique peut aussi contribuer à reproduire certains des sté-
réotypes médicaux les plus rétrogrades. En diffusant dans
le milieu médical et, petit à petit, dans la société tout entière,
le concept de syndrome douloureux chronique contribue à
la construction sociale du pronostic de la douleur chro-
nique.
Le syndrome douloureux chronique nous parle de l’en-
kystement de la douleur dans le sujet souffrant. La dou-
leur devient une part inaliénable de l’individu, une iden-
tité qu’il s’agit de maintenir à tout prix : “Quiconque a
souffert et souffre sait que la douleur lui appartient,
comme ses yeux et ses mains ; que son mal procède de
son existence même et que, s’il le perd, il risque de tout
perdre” (28). Mais le syndrome douloureux chronique
nous parle aussi d’une relation conflictuelle à la médecine.
N’est-ce pas plutôt en fait une relation conflictuelle avec
les médecins ? Trop de déception et trop peu de confiance
envers les médecins, résultant paradoxalement de trop
de confiance en la médecine, et de trop d’attentes irréa-
listes (29) encouragées par la médicalisation du monde.
Un monde anesthésié :
le contexte idéologique et culturel
de la douleur chronique
Le contexte social moderne de la douleur chronique est en
effet avant tout celui de la médicalisation de la douleur
(30). Cette médicalisation va de pair avec la diffusion dans
la société de deux idées fortes, bien que contestables :
– toute douleur doit avoir une explication médicale ;
– il est techniquement possible et moralement juste de lut-
ter contre la douleur.
Ce nouveau credo face à la douleur a des conséquences im-
portantes. En premier lieu, la douleur devient une affaire de
spécialiste, avec le risque de dépendance qui en découle.
De plus, si la douleur devient un problème médical, elle
perd tout ou partie du sens (moral, religieux, etc.) qu’elle pou-
vait avoir auparavant dans telle ou telle culture. Ce manque
de sens est considéré par certains auteurs comme central
dans la douleur chronique (31). Enfin, les conflits de légiti-
mité, déjà mentionnés, sont exacerbés : la douleur n’est lé-
gitime que lorsqu’elle a une explication médicale satisfai-
sante. Lorsqu’elle est mal expliquée médicalement, cas le
plus fréquent des douleurs chroniques non malignes, elle est
suspecte d’être imaginaire, et le patient devient un coupable
potentiel (22). La légitimité de la plainte passe par l’institu-
tion médicale, qui décide ou non de la valider. Le dualisme
cartésien à la base de cette dichotomie et les valeurs morales
qui y sont attachées ne sont pas seulement ceux des soi-
gnants : ils colorent aussi toute la démarche des malades (ma
douleur doit bien venir “de quelque chose” – sous-entendu :
de quelque chose qui soit hors de ma responsabilité). Or, on
l’a vu, ce conflit fondamental de légitimité n’est que super-
ficiellement dépassé dans les centres de la douleur.
Dans le monde occidental moderne, la douleur (ou tout au
moins ses manifestations les plus bruyantes) est devenue in-
tolérable. Il faut à ce sujet lire, ou relire, malgré leurs excès,
les pages que consacre Ivan Illich à “l’aliénation de la dou-
leur” dans Némésis médicale (32). Dans un monde anesthé-
sié, “le développement de l’art de la souffrance” est perdu.
Réifiée par la médicalisation, la douleur devient une “chose
en soi” et n’a aucun sens. “Le patient devient capable de vé-
géter avec sa douleur sans pouvoir en souffrir : il la regarde
comme on regarde un poisson à travers le cristal de l’aqua-
rium”. Illich note que “la douleur arrive à être vue d’abord
comme la condition des hommes que la corporation médi-
cale n’a pas fait profiter de sa boîte à outils. L’idée que l’art
de souffrir est une réponse alternative et complémentaire à
la consommation analgésique acquiert un ton littéralement
obscène”. Et il va jusqu’à soutenir qu’une société “dominée
Tableau. Le syndrome douloureux chronique, d’après (27).
1. Plainte douloureuse
– douleur depuis plus de 6 mois
– origine physiopathologique incertaine
– nombreux antécédents de traitements inefficaces
– handicap fonctionnel exagéré
– conduite toxicomaniaque
2. Comportement anormal vis-à-vis de la maladie
– conviction somatique de la maladie
– désir de chirurgie
– déni des conflits interpersonnels
– déni des perturbations émotionnelles
3. Symptomatologie dépressive
4. Facteurs de renforcement
– évitement d’activités “néfastes”
– attention et sollicitude de l’entourage
– bénéfices secondaires financiers

148
Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003
Éthique
É
thique
par l’analgésie” fait “perdre toute capacité à faire face à
la douleur, indice de capacité à vivre”, et qu’il faut “des
stimulants de plus en plus puissants aux gens qui vivent
dans une société anesthésiée pour avoir l’impression
qu’ils sont vivants... Dans son paroxysme, une société
analgésique accroît la demande de stimulations doulou-
reuses”. En plus de leur grand intérêt philosophique, ces
lignes nous renvoient à la place des centres de la douleur
dans le monde contemporain, où la douleur est incon-
testablement devenue intolérable, et affaire de spécia-
listes (réalisant “l’expropriation professionnelle de la
souffrance” prophétisée par Illich). De “La douleur n’est
pas une fatalité” du premier plan Kouchner (1999) au
“Défense d’avoir mal” d’une publicité plus récente, le
message émis par la société glisse progressivement vers
l’interdiction de souffrir.
Ma conviction est que cette injonction à ne pas souffrir
est un facteur iatrogène, dès lors que la douleur n’a pas
d’explication médicale satisfaisante. Elle enferme le dou-
loureux chronique dans un paradoxe : d’un côté, “il ne
faut plus souffrir”, “il est possible de ne plus souffrir si
l’on s’adresse aux bons spécialistes” ; de l’autre, le sté-
réotype médical du syndrome douloureux chronique, qui
ne laisse aucun espoir à la guérison et la remplace par
l’idée d’adaptation ou, pire, renvoie la douleur à sa place
inaliénable (et donc à respecter) dans l’économie psy-
chique du malade. Malades et soignants en sont réduits,
face à ce paradoxe, à reproduire des rôles convenus :
“vivre avec” la douleur, mais aussi “vivre avec” les re-
présentations médicales et sociales désespérantes de la
douleur chronique, situation d’échec par définition.
La dimension sociale occultée
dans les situations de douleur chronique
Comment s’exerce le pouvoir du “social” dans chaque
cas individuel de douleur chronique ? Je propose de dis-
tinguer trois grandes dimensions sociales de la douleur
chronique (à l’exclusion des facteurs culturels, abon-
damment traités par ailleurs [33-35]) :
– la dimension socio-économique : précarité, perte de
statut social et absence de reconnaissance ;
– la dimension sociomédicale : elle résulte de l’inter-
action problématique du douloureux chronique avec les
organismes de Sécurité sociale. Les démarches com-
plexes nécessaires, le fonctionnement opaque des insti-
tutions, les termes abscons ou franchement trompeurs de
la législation, comme celui de “consolidation” d’un ac-
cident du travail, contribuent incontestablement à la souf-
france. Ces problèmes, qui sont souvent considérés
comme périphériques par les médecins (car hors de leurs
compétences pour la plupart), deviennent parfois cen-
traux. Lorsque la douleur n’a pas d’explication médi-
cale satisfaisante, l’interaction avec les médecins-conseil
de la Sécurité sociale, ou médecins-experts, est un évi-
dent facteur de renforcement du comportement doulou-
reux : comment aller mieux si l’on doit prouver que l’on
est malade (36) ?
– la dimension sociomorale : elle découle des représen-
tations culturelles de la douleur, qui font de la douleur
non explicable par une lésion organique une douleur “ima-
ginaire” et de la personne en souffrant un “coupable” po-
tentiel. Nous avons déjà largement abordé ce thème.
Or, il me semble que ces dimensions sociales sont lar-
gement occultées dans la prise en charge des doulou-
reux chroniques, y compris dans les centres de la dou-
leur. Fait significatif, elles sont parfois “maquillées” en
dimensions psychologiques individuelles, conduisant à
une psychiatrisation des problèmes sociaux. C’est ainsi
que le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux
(qui décrit – ni plus ni moins – le comportement dou-
loureux chronique en l’absence de pathologie organique
identifiable) est devenu une cause importante d’invalidité
en Suisse, alors que les situations de détresse sociale
sous-jacentes sont ignorées (37). La nosologie psychia-
trique (qui ne redoute pas les recouvrements entre caté-
gories) fournit en effet toute une gamme de diagnostics
séduisants pour classer les troubles des consultants des
centres de la douleur : troubles de personnalité, troubles
somatoformes, troubles de l’adaptation, troubles de l’hu-
meur. Les catégories décrivant la détresse sociale (soli-
tude, chômage de longue durée, emploi précaire, harcè-
lement, exclusion, etc.) mériteraient sans doute autant de
place dans les dossiers médicaux des douloureux chro-
niques, mais ces thèmes s’écartent trop du médical pour
être jugés opératoires par les soignants.
Conclusion
J’ai tenté, dans ce travail, de montrer que nous ne
sommes pas véritablement capables de dépasser les
conflits de légitimité et de responsabilité qui enferment
malades et soignants lorsque la plainte chronique de dou-
leur n’a pas d’explication médicale satisfaisante, ce qui
est la situation finalement la plus fréquente dans les
centres d’évaluation et de traitement de la douleur. Ces
conflits sont superficiellement réglés par la psychologi-
sation du problème, que le patient réticent finit par ac-
cepter de mauvaise grâce. La douleur chronique contraint
malades et soignants à se conformer à la prophétie déses-
pérante d’échec que contient en germe sa définition
même. Le facteur social déterminant de cette relation
insatisfaisante est celui de la médicalisation de la dou-
leur, qui crée des attentes irréalistes, attise les conflits sur
la légitimité de la souffrance, et tend à priver le patient
du sens moral, religieux ou de protestation sociale que
pourrait avoir sa douleur dans un autre contexte histo-
rique et culturel.
 6
6
1
/
6
100%