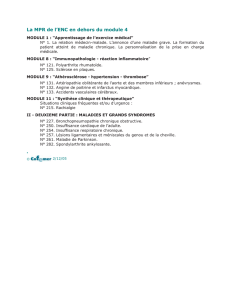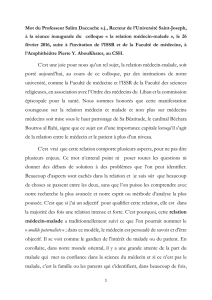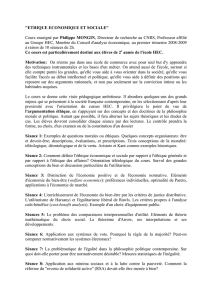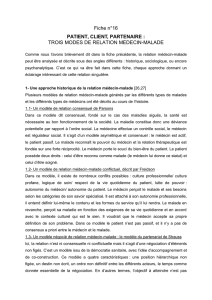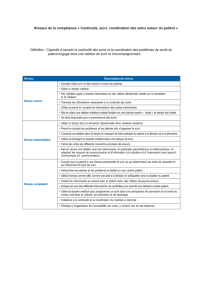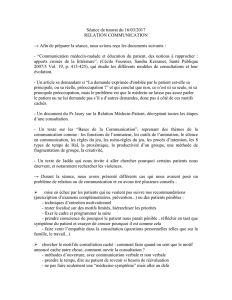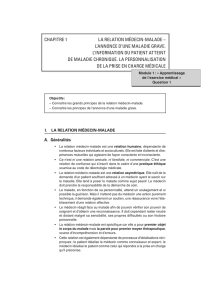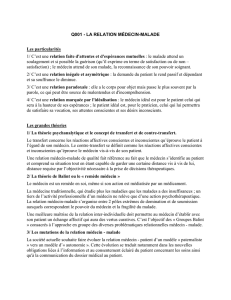Allocution du Pr MONGIN

Assemblée Générale du 26 octobre 2006
Discours du Professeur Mongin 1/4
Assemblée générale du 26 octobre 2006
Discours du Professeur Maurice MONGIN,
Parrain de la promotion 2006 des PCEM2
Chers futurs Confrères,
Je vous félicite, en mon nom propre et aussi au nom de nos Professeurs, d’avoir franchi l’obstacle
de la première année : j’en connais la grande difficulté et l’effort de travail que cela représente. Ce
résultat témoigne de votre volonté de devenir médecins. C’est une épreuve initiatique que vous su
surmonter. Bravo !
Je me suis demandé en quoi je pouvais vous être utile alors que plus de 60 ans me séparent de mon
entrée en 1ère année de Médecine.
En aucune façon, je ne souhaite évoquer un passé révolu pour lequel je n’éprouve aucune nostalgie.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la science biologique et médicale n’a cessé de
s’enrichir et d’accroître son efficacité. Le monde s’est transformé et bien évidemment aussi les
modalités de l’exercice médical.
En dépit de ces changements, je suis persuadé qu’on peut jeter un pont entre nos générations en
évoquant ce qu’il y a de permanent dans l’acte médical : je veux parler de la « Clinique ».
La clinique est à la fois la démarche initiale dans l’élaboration du diagnostic et la prise en charge du
malade dans la globalité de son individualité.
Analysons schématiquement le début de la « relation Médecin-Malade » dans le cadre d’une
consultation type.
D’un côté, le Médecin muni de son savoir. En face, le Patient qui se confie à lui. Ce couple
éphémère est très inégal. La supériorité du Médecin est évidente : dans l’esprit du Malade, il est

Assemblée Générale du 26 octobre 2006
Discours du Professeur Mongin 2/4
supposé appartenir au monde des « biens portants ». Surtout il est détenteur d’un savoir qu’il
s’apprête à mettre en pratique. Le Patient, lui, comme son nom l’indique, est passif : tout ce qu’il
peut offrir, c’est sa confiance. Celle-ci n’a rien d’automatique. Elle peut découler de la bonne
réputation du Médecin mais ceci n’est ni nécessaire, ni suffisant. Elle doit se sceller au fil de la
consultation. C’est au Médecin de l’inspirer par son comportement :
- d’abord, dans l’entretien qu’il conduit avec le malade : il est attentif, courtois, patient,,
interrogeant avec précision mais sans brutalité. Il doit rester directif pour éviter toute dérive vers
le bavardage. C’est le stade de « l’écoute » : celle-ci exclut tout recours à l’informatique. Ne
faites pas intervenir votre ordinateur dans la conversation.
- Il faut ensuite examiner le malade ; cet examen est presque exclusivement sensoriel et manuel :
o Regarder et même scruter le patient, ses gestes, ses mouvements, sa démarche, en
position debout, couché, assis ;
o Ausculter le coeur et les poumons,
o Percuter,
o Palper.
Cet examen, bien souvent, ne décèlera rien d’anormal, mais de ce fait il permet d’exclure beaucoup
d’éventualités et de mieux centrer les recherches ultérieures en sélectionnant les examens
complémentaires utiles.
Il s’agit, aux sens propre et figuré, d’une véritable prise en main du malade. Si cet examen est bâclé,
accompli machinalement ou escamoté, le patient se sentira frustré.
L’adhésion indispensable du malade à la décision du médecin découle de la confiance que le
médecin lui inspire au terme de la consultation.
Cette confiance suppose évidemment la compétence du Médecin. Celui-ci n’a pas le droit de la
tromper.
Ainsi la compétence est une nécessité et une obligation morale : le malade nous confie ce qu’il a de
plus cher : son corps vivant et sa santé. Nous engageons à son égard notre responsabilité. Ainsi,
méconnaître un diagnostic, négliger les examens complémentaires adaptés, rassurer ou inquiéter à
mauvais escient, perdre l’occasion de guérir par trop d’atermoiements, ce sont là des fautes
professionnelles qui peuvent être graves de conséquence.
Nous sommes des « Praticiens » : si la médecine est de moins en moins empirique, elle n’a rien de
spéculatif. C’est une action.
La compétence est à la fois un savoir et un savoir faire. Compétence ne veut pas dire une
omniscience devenue tout à fait impossible actuellement. Etre compétent, c’est connaître ses limites
et au-delà se faire aider par d’autres, plus compétents que soi.
La compétence n’est pas un acquis définitif. Elle est remise en cause par les progrès incessants des
connaissances et des techniques. Si riche que soit votre bagage au terme de vos études, il se
dépréciera au fil des années, si, pris par la routine et gagnés par la paresse, vous ne le renouvelez
pas en permanence.
Dans l’acte médical, la compétence est donc essentielle mais elle ne suffit pas : il faut qu’elle
s’inscrive dans une conception humaniste de notre action.
Le malade ne se réduit pas à un « corps-objet » doté d’un cerveau plus ou moins fonctionnel. Nous
avons affaire à un sujet libre et virtuellement autonome : c’est une personne : elle a bien sûr une
identité sociale mais elle a constitué depuis l’enfance, au cours de sa vie une identité intérieure, un

Assemblée Générale du 26 octobre 2006
Discours du Professeur Mongin 3/4
« ego », qui lui permet de s’affirmer à la fois semblable et différent des autres, capable d’agir en
disant « je » et « moi ».
Le médecin doit prendre en considération cette notion de personne : il traite une maladie, un
processus pathologique et en même temps il soigne un malade qu’il doit respecter même si ce
dernier est au comble de la déchéance.
Mais le médecin n’est pas consulté seulement par des malades : beaucoup de sujets sains, ou se
considérant comme tels, se présentent à lui à l’occasion d’incidents bénins, de légers malaises ou en
vue d’un bilan de santé systématique.
C’est pour le Médecin l’occasion de jouer un rôle de prévention : ne pas se contenter de rassurer le
patient mais en profiter pour corriger son mode de vie, ses habitudes alimentaires nocives, prôner
l’exercice physique, la marche, l’aider à se défaire d’habitudes désastreuses (tabac, alcool, drogues,
dopants). Il s’agit là d’une médecine clinique et humaniste, une médecine de la « santé » qui vise à
la sauvegarde de l’individu par une meilleure adaptation sociale.
La relation médecin-malade que nous avons décrite n’est pas un idéal abstrait mais bien une réalité
quotidienne. Cependant, elle n’est pas tout à fait un tête-à-tête intime et libre. Un tiers y est présent
en filigrane, c’est l’Assurance-maladie de la Sécurité Sociale qui assure le financement de cette
rencontre.
La Sécurité Sociale se montre discrète et peu gênante dans la mesure où elle laisse au médecin la
liberté de ses actes et qu’elle octroie au malade la quasi gratuité des soins.
Mais cette libéralité, pour ne pas dire ce laxisme, s’est fondée à l’origine sur un système de santé
peu coûteux. Depuis lors, les dépenses de santé n’ont cessé de croître en raison des possibilités de
soins de plus en plus efficaces et sophistiquées parallèlement à une longévité très accrue.
Quelles que soient les réformes de « l’assurance-maladie », son déficit peut s’infléchir mais ne
disparaîtra sans doute pas.
Si la santé n’a pas de prix pour l’assuré, elle en a un très élevé pour la collectivité. D’où la nécessité
d’une bonne gestion en évitant tout gaspillage et tout abus. Dans ce domaine, le rôle du médecin est
capital : il est l’ordonnateur des dépenses de la Sécurité Sociale.
Les erreurs de diagnostic, les retards de diagnostic, les traitements inappropriés, ou superflus, la
redondance des examens radiologiques ou biologiques, tout ceci est le fruit de l’incompétence, de la
négligence, et traduit un désintérêt à l’égard du bien public.
Il y a aussi le manque de disponibilité pour assurer un service de garde ou d’astreinte. Fuir les
obligations de l’urgence pour ne pas être dérangé et compter sur les services publics : pompiers,
SAMU, accueil à l’hôpital, pour qu’ils prennent en charge des malades qui relèveraient souvent de
la seule compétence du médecin.
Il y a aussi le désir de complaire à son patient en lui prescrivant des arrêts de travail injustifiés, des
séances de rééducation interminables, des massages de confort, en écrivant sous sa dictée des
ordonnances.
Le médecin doit s’obliger à la sobriété et à la rigueur dans toutes ses prescriptions. Notre système
de soins ne pourra pas survivre en l’absence de sens civique chez le médecin. Or, celui-ci n’est pas
très soucieux du bien public : :très indépendant par tradition, en raison de son exercice singulier, il
est naturellement enclin à l’individualisme. Les contraintes extérieures lui pèsent. Mais cette pente
est injustifiable dans un système de santé complexe et coûteux qui impose le travail par équipes, un
réseau d’informations et d’échanges, une perpétuelle collaboration entre médecins de disciplines
diverses.

Assemblée Générale du 26 octobre 2006
Discours du Professeur Mongin 4/4
Dans les années qui vont suivre, vous ne quitterez plus le domaine de la clinique, dans lequel vous
intégrerez toutes les données scientifiques déjà acquises auxquelles s’en ajouteront bien d’autres.
L’initiation à la clinique passe par la séméiologie qui donne une signification aux troubles
fonctionnels ou organiques observés chez le malade. Puis viendront la connaissance de la
pathologie et de la thérapeutique. Enfin, dans l’examen terminal, la clinique joue un rôle central.
Ultérieurement, quelle que soit votre orientation, peu ou beaucoup spécialisée, vous resterez
définitivement imprégnés de sens clinique.
Pour me résumer, je vous demanderai de vous souvenir de trois principes :
o le devoir impératif de compétence,
o une conception humaniste de la relation médecin-malade,
o le civisme.
Moyennant quoi, vous exercerez un merveilleux métier aussi peu routinier que possible où l’on ne
cesse d’enrichir sa connaissance des Hommes et son intérêt pour eux.
Je vous remercie de m’avoir écouté : vous avez ainsi permis à un vieux médecin de vous dire
combien il avait aimé son métier.
1
/
4
100%