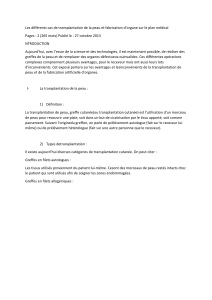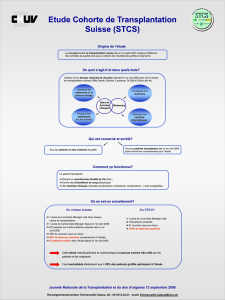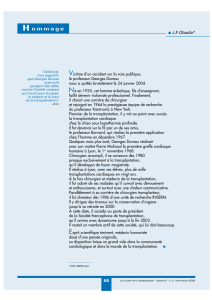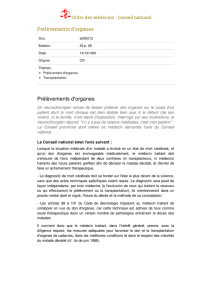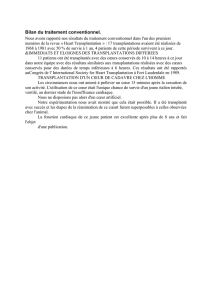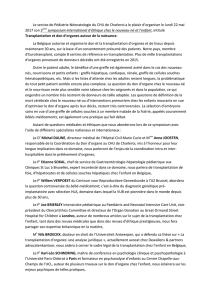Hémochromatose génétique et transplantation hépatique

* CHRU Lille.
Les critères de transplantation hépatique pour l’hémochro-
matose ne sont pas spécifiques. La consommation excessive
d’alcool augmente la probabilité de développer une cirrhose
et également de sa décompensation. Chez les patients candidats
à une transplantation hépatique, une évaluation cardiologique
s’avère indispensable en raison du risque de cardiomyopathie
associée. Une atteinte cardiaque est moins fréquemment obser-
vée chez les transplantés ayant bénéficié d’une déplétion mar-
tiale par phlébotomies. En conséquence une déplétion martiale
doit être systématiquement instaurée chez les patients candi-
dats à la transplantation hépatique.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
Hémochromatose génétique
et transplantation hépatique
Liver transplantation for hemochromatosis
●V. Canva*
L’
espérance de vie globale des patients atteints d’hémo-
chromatose génétique (HG) est proche de celle de la
population générale dès lors que la surcharge en fer
est maîtrisée par le traitement déplétif. En revanche, l’étude de
l’espérance de vie de ces patients a permis de démontrer que l’HG
est responsable d’une diminution significative de la survie chez ceux
présentant une cirrhose ou un diabète au moment du diagnostic
(1,2). Trente pour cent des patients avec cirrhose sont susceptibles
de développer un carcinome hépatocellulaire (risque multiplié
par 200). Lorsque la cirrhose est présente, le risque de cancer du
foie persiste, même après suppression de la surcharge en fer (1, 3).
À l’inverse, les malades diagnostiqués au stade précirrhotique et
traités par saignées ont une espérance de vie identique à celle de la
population générale (1). Les causes de décès sont représentées par
le carcinome hépatocellulaire, ou plus rarement par une décom-
pensation de la cirrhose (1, 3, 4).
La transplantation hépatique est le traitement de choix des hépato-
pathies chroniques au stade de cirrhose décompensée et/ou com-
pliquée d’insuffisance hépatocellulaire ou de carcinome hépato-
cellulaire. La survie est, respectivement à un an et 5 ans, de 88 % et
74 % (5). Si, au moment de la transplantation, environ 20 % des
patients présentent une surcharge en fer intrahépatique, rares sont
ceux chez qui elle est liée aux mutations du gène HFE(6). En effet,
l’hémochromatose génétique reste une indication peu fréquente
de la transplantation hépatique (environ 1 %), et le devenir de ces
patients est mal connu. De plus, les patients hémochromatosiques
relevant de cette thérapeutique ont volontiers d’autres facteurs de
risque d’hépatopathie chronique associés, notamment une consom-
mation excessive d’alcool (> 60 g/j). Cette extrême rareté contraste
avec la grande fréquence de l’homozygotie C282Y dans la popula-
tion (1 à 5 pour mille en Europe) (6).
La durée de la survie après transplantation reste controversée.
Réduite dans certaines études, elle est évaluée, respectivement 1,
3 et 5 ans après transplantation, à 72 %, 62 % et 55 % (6-9). Cette
moindre survie est liée en grande partie à des décès sur récidive
d’un carcinome hépatocellulaire mais s’avère meilleure si les cri-
tères de Mazzaferro (10)sont respectés, passant ainsi à 74 %, 68 %
et 60 % (la grande majorité de ces patients décédés de carcinome
hépatocellulaire ayant une lésion entre 5 et 10 cm de diamètre).
La seconde cause de décès est représentée par les complications
cardiaques (6-8). Cela tient, possiblement, au rôle du diagnostic
tardif de la maladie dans les séries anciennes, et donc à la plus fré-
quente infiltration endomyocardique (7). Pour les patients candi-
dats à une transplantation hépatique, une évaluation cardiologique
s’avère plus qu’indispensable en raison du risque de cardiomyo-
pathie associée, laquelle peut, en soi, constituer une contre-indication
à la greffe hépatique. Néanmoins, il faut, dans ce cas, prendre en
considération l’impact positif du traitement déplétif réalisé avant
transplantation sur la réduction des complications cardiaques (par
réduction de l’infiltration endomyocardique et l’amélioration de la
fonction cardiaque, cela étant corroboré par les séries récentes qui
objectivent une survie très favorable (100 %) (11). En effet, si les
phlébotomies ne permettent pas de faire régresser la cirrhose, elles
apportent un bénéfice réel quant à l’évolution de l’atteinte cardiaque,
DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 2 - vol. VIII - mars-avril 2005 75
Introduction (P. Mathurin) - Actualités sur la physiopathologie des surcharges en fer (O. Loréal, M.B.Troadec, L. Detivaud, P. Brissot) - Hémochromatose liée
au gène HFE :de la génétique à l’expression clinique (O. Rosmorduc) - Hémochromatoses non liées à HFE-1 (P. Brissot, C. Le Lan, R. Lorho, O. Loréal) -
Quantification de la surcharge en fer et indication de la biopsie hépatique (D. Guyader) - Hépatosidérose dysmétabolique (Y. Deugnier,A. Guillygomarc’h,
F. Lainé) - Hémochromatose génétique et transplantation hépatique (V. Canva) - Conclusion (P. Mathurin)

laquelle constitue une indication formelle à leur instauration. Par
ailleurs, en cas d’atteinte cardiaque majeure, une transplantation
combinée hépatique et cardiaque pourrait être proposée. Les pre-
miers résultats de ces transplantations combinées cœur/foie semblent
encourageants, puisque la survie à un et à 4 ans est respectivement
de 81 % et 72 % (12). La conduite de l’immunosuppression dif-
fère quelque peu en transplantation hépatique et en transplantation
cardiaque, notamment en termes de corticothérapie, laquelle est
assez rapidement diminuée pour la transplantation hépatique et peut,
de fait, majorer le risque de rejet sur le plan cardiaque. Néanmoins,
il a été démontré que la transplantation combinée du foie et d’un
autre organe solide s’associait à un risque de rejet moindre que
celui attendu sur l’autre organe, le foie ayant un effet immuno-
protecteur (13).
Bien que cela soit controversé, il a également été rapporté un rôle
délétère de la surcharge en fer en termes d’aggravation de la morbi-
dité et de la mortalité infectieuse après transplantation. Là encore,
il a été souligné l’intérêt de la déplétion martiale avant la transplan-
tation en termes de bénéfice de survie après transplantation (14).
Les complications infectieuses semblent être une cause fréquente
de décès après transplantation, notamment les infections fongiques.
La surcharge en fer est responsable d’une modification du statut
immunitaire, avec altération de la prolifération et de la fonction
de bon nombre de cellules intervenant dans les défenses immuni-
taires, notamment dans le cas des infections à Yersinia,bactérie
dont la virulence est accrue en cas de surcharge en fer. Des infec-
tions fatales à Listeria (méningites, endocardites et péricardites)
ont été rapportées, de même que des infections mycotiques. Néan-
moins, cette sensibilité accrue aux infections a également été
décrite en cas de surcharge en fer secondaire (14).
L’une des anomalies princeps dans l’hémochromatose repose sur
l’hyperabsorption duodénale du fer. Cette anomalie n’est pas cor-
rigée par la transplantation hépatique et pose donc la question de
la récidive de la surcharge en fer après la greffe. Les données sur
ce point sont relativement rares, la récidive de la surcharge en fer
après transplantation ayant été peu étudiée. Il n’a pas été démontré
de différence sur les biopsies précoces à 1 mois entre les patients
avec et sans HG en termes de dépôts de fer (8). Cela est, en revanche,
lié à l’existence ou non d’une surcharge en fer histologique sur le
foie du donneur et n’est nullement le fait d’une redistribution du
fer en excès à partir des autres organes. Néanmoins, il existe une
tendance à l’apparition d’une surcharge en fer sur les biopsies tar-
dives dont la disposition dans les cellules de Kuppfer s’apparente
plus à une surcharge en fer secondaire et plaide donc en faveur du
rôle de la mobilisation des stocks de fer en excès à partir des autres
tissus. Aucune étude n’a démontré de récidive de la surcharge intra-
hépatique en fer de type hémochromatosique, c’est-à-dire sous la
forme d’un gradient portocentrolobulaire, vraisemblablement en
raison d’un suivi trop court (environ 4 à 5,5 ans). L’absence de réci-
dive de la surcharge en fer à moyen terme est retrouvée par d’autres
auteurs, avec une absence d’argument en faveur d’une récidive rapide
de la surcharge en fer et sans morbidité d’ordre cardiologique
environ 5 ans après la transplantation hépatique (15). Eu égard à
la relative lenteur d’apparition de la surcharge intrahépatique en
fer, laquelle n’apparaît généralement pas avant la deuxième ou la
troisième décennie, cela n’est peut-être pas très surprenant.
Les données sur le devenir des patients atteints d’HG après transplan-
tation hépatique sont peu nombreuses en raison du peu de patients accé-
dant à cette thérapeutique. Cela s’explique peut-être en partie par :
–une sous-estimation, et donc un défaut de diagnostic d’HG avant
la découverte du gène HFE ;
–un dépistage plus fréquent et donc plus précoce de l’HG depuis
la découverte du gène HFEpermettant une prise en charge thérapeu-
tique par phlébotomies également plus précoce et plus efficace car se
situant avant l’existence d’une cirrhose. Malgré les résultats moins
satisfaisants de certaines études, la survie spontanée à un an de ces
patients (avec carcinome hépatocellulaire notamment) sans transplan-
tation hépatique, comparée à une survie après transplantation même
minorée à 74 % en cas d’hémochromatose génétique (contre 88 %
pour les autres pathologies), semble pouvoir légitimer entièrement
le recours à cette thérapeutique. Enfin, les premiers résultats des
transplantations combinées foie/cœur laissent entrevoir une perspec-
tive thérapeutique pour des patients jusqu’à présent récusés. ■
Mots-clés : HFE-1 - Transplantation hépatique - Déplétion mar-
tiale - Consommation excessive d’alcool.
Keywords:HFE1 - Liver transplantation - Iron depletion - Exces-
sive drinker.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Niederau C, Fischer R, Prschel A et al. Long-term survival in patients with
hereditary hemochromatosis. Gastroenterology 1996;110:1107-19.
2. Adams PC, Speechley M, Kertesz AE. Long-term survival analysis in heredi-
tary hemochromatosis. Gastroenterology 1991;101:368-72.
3. Deugnier YM, Guyader D, Crantock L et al. Primary liver cancer in genetic
hemochromatosis: a clinical, pathological, and pathogenetic study of 54 cases.
Gastroenterology 1993;104:228-34.
4. Fargion S, Mandelli C, Piperno A et al. Survival and prognostic factors in 212
Italian patients with genetic hemochromatosis. Hepatology 1992;15:655-9.
5. 2000 Annual Report of the US Scientific Registry of Transplant Recipients
and the Organ Procurement and Transplantation Network. Transplant Data
1989-1998 Available at: http://opnt.org/AR2003/survival_rates.htm.
6. Crawford DHG, Flechter LM, Hubscher SG, Stuart KA. Patients and graft
survival after liver transplantation for hereditary hemochromatosis: implica-
tions for pathogenesis. Hepatology 2004;39:1655-62.
7. Farrel FJ, Nguyen M, Woodley S et al. Outcome of liver transplantation in
patients with hemochromatosis. Hepatology 1994;20:404-10.
8. Parolin Mb, Batts KP, Wiesner RH et al. Liver allograft iron accumulation
in patients with and without pretransplantation hepatic hemosiderosis. Liver
Transplant 2002;8:331-9.
9. Kilpe VE, Krakauer H, Wren RE. An analysis of liver transplant experience
from 37 transplants centers as reported to medicare. Transplantation 1993;56(3):
554-61.
10. Mazzaferro V, Regalia E, Doci R et al. Liver transplantation for the treat-
ment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. N Engl J
Med 1996;334:693-9.
11. Nyckowski P, Dudek K, Zieniewicz K et al. Results of liver transplantation
in a patient with hemochromatosis. Transplant Proc 2003;35:2265-7.
12. Haynes H, Farroni J. Successful combined heart-liver transplantation in a
patient with hemochromatosis. Progress in Liver Transplantation 2004;14(1):39-40.
13. Tazbir JS, Cronir DC. Indications, evaluations and postoperative care of the
combined liver-heart transplant recipient. AACN Clin Issues 1999;10:240-52.
14. Brandhagen DJ,Alvarez W, Therneau TM et al. Iron overload in cirrhosis-HFE
genotypes and outcome after liver transplantation. Hepatology 2000;31:456-60.
15. Pillay P, Tzoracolefttherakis E, Tzakis AG et al. Orthotopic liver transplan-
tation for hemochromatosis. Transplant Proc 1991;23(2):1888-9.
DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 2 - vol. VIII - mars-avril 2005
76

Le dépistage systématique
de l’hémochromatose
héréditaire : état des lieux
Pr H. Michel (président de l’Association
Hémochromatose France, Nîmes)
Le dépistage systématique de l’hémo-
chromatose héréditaire (HH) HFE-1 (géno-
type C282Y homozygote) est primordial,
mais, à ce jour encore, non réalisé, car
“repoussé” par les autorités de santé. Or,
plusieurs arguments plaident en faveur
de ce dépistage, demandé, entre autres,
depuis 1989, par l’Association Hémochro-
matose France (AHF) :
–la haute prévalence de l’HH, reconnue
comme la maladie héréditaire la plus fré-
quente dans la population caucasienne
(1/300 d’après le Secrétariat national des
maladies métaboliques et héréditaires) ;
–la gravité de l’HH en raison à la fois du
handicap qu’elle génère (asthénie, at-
teinte articulaire, endocrinienne, etc.)
et de son pronostic vital (cirrhose avec
cancer, cardiopathie, diabète insulino-
requérant, etc.) ;
–la facilité du diagnostic, aussi bien du
point de vue clinique que biologique,
par la saturation de la transferrine et
surtout par le test génétique HFE-1 ;
–l’efficacité du traitement par phlébo-
tomies, qui en fait une maladie bénigne
lorsqu’elle est diagnostiquée précoce-
ment, mais invalidante et mortelle lors-
qu’elle n’est que tardivement reconnue ;
–la méconnaissance de cette maladie
par les médecins et le public du fait de
son polymorphisme clinique, de l’ab-
sence de publicité des laboratoires phar-
maceutiques et des difficultés de commu-
nication des résultats génétiques.
Deux types de dépistage sont à envisager :
–dans la population générale ;
–dans la famille.
◗Le dépistage systématique
dans la population générale
Dans la première stratégie (la plus com-
mune), le dépistage associe d’abord le
test de saturation de la transferrine, puis
le test génétique. Dans la deuxième stra-
tégie, il associe le test de saturation de
la transferrine à la ferritine puis au test
génétique. Le test de saturation de la
transferrine, toujours fait en premier et
à jeun, est pathologique (au-dessus de
45 % chez l’homme et de 50 % chez la
femme), informatif (première expression
phénotypique de l’HH avant toute lésion
viscérale ou métabolique), peu coûteux
(B50 : 13,50 €). Il peut être négatif en
cas de syndrome inflammatoire ou chez
la femme (deux contrôles à 5 ans et à
10 ans sont alors à faire). Il peut être faus-
sement positif (10 % des cas) en cas de
surcharge non HFE-1 C282Y homozygote,
ou d’hépatopathie alcoolique ou non,
mais, dans ce dernier cas, il sera corrigé
par le test génétique HFE-1.
En fait, le dépistage dans la population
doit se faire à tout âge (idéalement à
20 ans
chez l’homme et à 30 ans chez la
femme). La
découverte des signes clini-
ques, les antécédents familiaux (diabète,
cirrhose, décès précoces) orientent le dia-
gnostic d’HH. De même, un dépistage
ciblé est utile en cas de diabète ou de cir-
rhose – souvent considérée à tort comme
alcoolique –, et chez tout sujet rhumati-
sant, cardiaque ou dépressif. Les résul-
tats des études contrôlées dans la litté-
rature démontrent deux faits : le dépis-
tage réduit la morbidité et la mortalité
et le dépistage génétique est supérieur
au dépistage phénotypique.
◗Le dépistage familial
Il a une efficacité supérieure à celle du
dépistage dans la population, car, du fait
de la transmission autosomique, il con-
cerne un milieu à plus haut risque d’être
porteur de la mutation C282Y homozy-
gote. Ainsi, à partir du probant (sujet por-
teur de la mutation averti par son méde-
cin et lui-même seul autorisé à informer
les membres de sa famille), il faut recher-
cher la mutation :
–d’abord chez les frères et sœurs
(coefficient de saturation de la transfer-
rine et gène HFE-1). Ils sont les apparen-
tés les plus à risque : 100 % si les deux
parents sont homozygotes, 50 % si un
parent est homozygote et le deuxième
hétérozygote pur ou composite, 25 % si
les deux parents sont hétérozygotes
purs ou composites ;
–puis chez les parents du probant,
d’abord par le coefficient de saturation
de la transferrine et, s’il est normal, par
le test génétique ;
–enfin, chez le conjoint du probant, par
le test génétique uniquement. En effet,
le résultat du test permet de prévoir le
risque chez leurs enfants. Ce risque est
de 100 % si le conjoint est homozygote,
de 50 % si le conjoint est hétérozygote et
de 0 % si le conjoint n’a pas de mutation.
Le dépistage à partir de nouveau-nés tes-
tés au hasard et identifiés comme étant
homozygotes C282Y augmente de 17 fois
la probabilité de diagnostiquer de nou-
veaux cas.
Donc, le dépistage génétique familial est
économiquement supérieur à un dépis-
tage phénotypique et au dépistage de la
population en général, du fait du plus
faible nombre de personnes pour iden-
tifier un homozygote C282Y.
◗État des lieux à ce jour
Les conclusions sur le dépistage de
l’HH HFE-1 faites en 2004 par l’ANAES
sont décevantes : “Le dépistage systéma-
tique de l’HH HFE1 reste posé ; la faisa-
bilité d’un tel dépistage n’est pas démon-
trée. Le dépistage familial doit être ren-
forcé. Le test génétique doit être utilisé
en première intention.” En fait, ce test
génétique (B200 : 52 €) n’est pas encore
remboursé. Pendant ces dix ans d’attente
et de réunions (ANDEM 1995, ANAES*
1999 et 2004), des malades ont souffert,
ont vu leur pathologie s’aggraver et sont
morts, alors que nous disposons aujour-
d’hui d’informations et de moyens dia-
gnostiques pour reconnaître une maladie
héréditaire bénigne, mais rendue grave,
et même mortelle, en l’absence de déci-
sion sur le dépistage. En attendant, pour
l’AHF, l’information à faire passer auprès
des médecins est d’ajouter systémati-
quement le test de saturation de la trans-
ferrine et la ferritine (et, s’ils sont posi-
tifs, le test génétique) au cours de tout
bilan sanguin au moins une fois dans la
vie d’un individu sain ou malade pour
pouvoir détecter l’HH.
* ANAES : Évaluation clinique et économique du
dépistage de l’hémochromatose HFE1,mai 2004.
DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 2 - vol. VIII - mars-avril 2005 77
1
/
3
100%