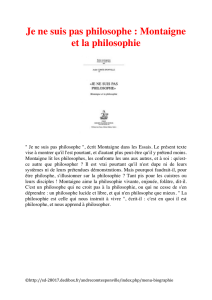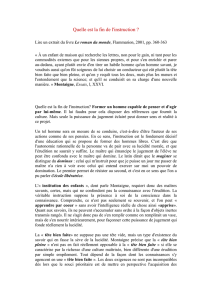format pdf - Université Bordeaux Montaigne

ESSAIS - Revue interdisciplinaire d’Humanités Hors série - 2016
Usages critiques de Montaigne
Études réunies par Philippe Desan et Véronique Ferrer
Hors série - 2016
ÉCOLE DOCTORALE MONTAIGNEHUMANITÉS
Revue interdisciplinaire d’Humanités
◗ Dossier – Usages critiques de Montaigne
• Avant-propos ......................................................... 7
Philippe Desan & Véronique Ferrer
• Philologie, histoire du livre, ecdotique :
le texte des Essais et son édition critique ......................................................... 15
Jean Balsamo
• Approches rhétoriques des Essais ......................................................... 29
Déborah Knop
• Montaigne : un cas intertextuel ?
......................................................... 43
John O’Brien
• « D’un dessein farouche et extravagant » :
Montaigne et la philorature ......................................................... 57
Olivier Guerrier
• Ce que les Essais nous apprennent sur les
impensés de la philosophie ......................................................... 67
omas Mollier
• Ce que les Essais nous apprennent sur la valeur
cognitive et morale de la littérature ......................................................... 83
Emiliano Ferrari
• « Et route par ailleurs… » : d’un usage
philosophique de Montaigne ......................................................... 97
Telma de Souza Birchal
• « Artialisation » : ce qu’Alain Roger doit
à un hapax de Montaigne ......................................................... 107
Bernard Sève
• Pour une approche sociologique de Montaigne ......................................................... 121
Philippe Desan
• Montaigne : nouveaux regards des historiens ......................................................... 141
Anne-Marie Cocula
• Montaigne et ses représentations :
un « gibier » pour l’historien ? ......................................................... 155
Marie-Clarté Lagrée
ISBN : 978-2-954426????
9 782954 426???
ED
H

Usages critiques de Montaigne
Études réunies par Philippe Desan et Véronique Ferrer
Hors série - 2016
ÉCOLE DOCTORALE MONTAIGNEHUMANITÉS
Revue interdisciplinaire d’Humanités

Comité de rédaction
Jean-Luc Bergey, Laetitia Biscarrat, Charlotte Blanc, Fanny Blin, Brice Chamouleau,
Antonin Congy, Marco Conti, Laurent Coste, Hélène Crombet, Jean-PaulEngélibert,
Rime Fetnan, Magali Fourgnaud, Jean-Paul Gabilliet, Stanislas Gauthier,
AubinGonzalez, Bertrand Guest, Sandro Landi, Sandra Lemeilleur, Mathilde Lerenard,
Maria Caterina Manes Gallo, Nina Mansion, Mélanie Mauvoisin, MyriamMetayer,
Isabelle Poulin, Anne-Laure Rebreyend, Je rey Swartwood, François Trahais
Comité scienti que
Anne-Emmanuelle Berger (Université Paris 8), Jean Boutier (EHESS),
Catherine Coquio (Université Paris 7), Philippe Desan (University of Chicago),
Javier Fernandez Sebastian (UPV), Carlo Ginzburg (UCLA et Scuola Normale
Superiore, Pise), German Labrador Mendez (Princeton University), Hélène Merlin-
Kajman (Université Paris 3), Franco Pierno (Victoria University in Toronto),
Dominique Rabaté (Université Paris 7), Charles Walton (University of Warwick)
Directeur de publication
Sandro Landi
Secrétaire de rédaction
ChantalDuthu
Les articles publiés par Essais sont des textes originaux. Tous les articles font l’objet d’une double
révision anonyme.
Tout article ou proposition de numéro thématique doit être adressé au format word à l’adresse
suivante: [email protected]
La revue Essais est disponible en ligne sur le site :
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/la-revue-essais.html
Éditeur/Di useur
École Doctorale Montaigne-Humanités
Université Bordeaux Montaigne
Domaine universitaire 33607 Pessac cedex (France)
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/la-revue-essais.html
École Doctorale Montaigne-Humanités
Revue de l’École Doctorale
ISSN : 2417-4211
ISBN : 978-2-954426?????? • EAN : 9782954426????
© Conception/mise en page : DSI Pôle Production Imprimée

En peignant le monde nous nous peignons nous-mêmes, et ce faisant
ne peignons «pas l’être», mais «le passage»1. Dialogues, enquêtes, les
textes amicalement et expérimentalement réunis ici pratiquent active-
ment la citation et la bibliothèque. Ils revendiquent sinon leur caractère
fragmentaire, leur existence de processus, et leur perpétuelle évolution.
Créée sur l’impulsion de l’École Doctorale «Montaigne-Humanités»
devenue depuis 2014 Université BordeauxMontaigne, la revue Essais
a pour objectif de promouvoir une nouvelle génération de jeunes
chercheurs résolument tournés vers l’interdisciplinarité. Essais propose
la mise à l’épreuve critique de paroles et d’objets issus du champ des
arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
Communauté pluridisciplinaire et plurilingue (des traductions
inédites sont proposées), la revue Essais est animée par l’héritage de
Montaigne, qui devra être compris comme une certaine qualité de
regard et d’écriture.
Parce que de Montaigne nous revendiquons cette capacité à s’exiler
par rapport à sa culture et à sa formation, cette volonté d’estrange-
ment qui produit un trouble dans la perception de la réalité et permet
de décrire une autre scène où l’objet d’étude peut être sans cesse refor-
mulé. Ce trouble méthodologique ne peut être disjoint d’une forme
particulière d’écriture, celle, en e et, que Montaigne quali e de façon
étonnamment belle et juste d’«essai».
Avec la revue Essais nous voudrions ainsi renouer avec une manière
d’interroger et de raconter le monde qui privilégie l’inachevé sur le
méthodique et l’exhaustif. Comme le rappelle eodorAdorno («L’essai
comme forme», 1958), l’espace de l’essai est celui d’un anachronisme
permanent, pris entre une «science organisée» qui prétend tout expli-
quer et un besoin massif de connaissance et de sens qui favorise, plus
encore aujourd’hui, les formes d’écriture et de communication rapides,
lisses et consensuelles.
Écriture à contrecourant, l’essai vise à restaurer dans notre
communauté et dans nos sociétés le droit à l’incertitude et à l’erreur,
le pouvoir qu’ont les Humanités de formuler des vérités complexes,
dérangeantes et paradoxales. Cette écriture continue et spéculaire, en
questionnement permanent, semble seule à même de constituer un
regard humaniste sur un monde aussi bigarré que relatif, où «chacun
appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage».
C’est ainsi qu’alternent dans cette « marqueterie mal jointe »,
numéros monographiques et varias, développements et notes de lecture,
tous également essais et en dialogue, petit chaos tenant son ordre de
lui-même.
Le Comité de Rédaction
1 Toutes les citations sont empruntées aux Essais (1572-1592) de Michel de Montaigne.

 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
1
/
174
100%
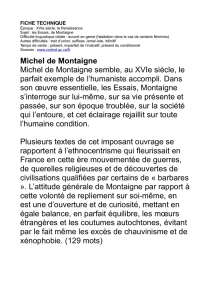


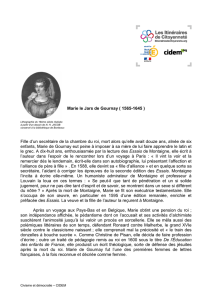

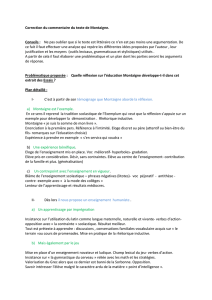
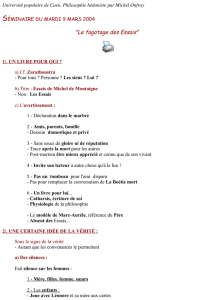
!["Les auteurs" [ / 33.06 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002766794_1-066a78493fb2577980249b334dcf04ce-300x300.png)