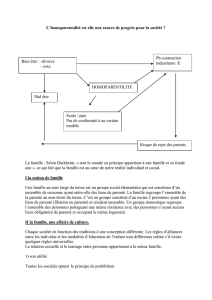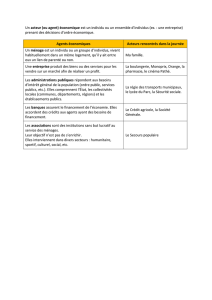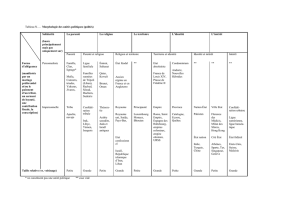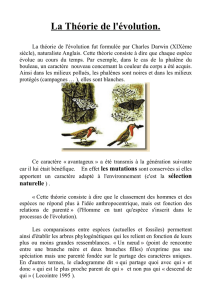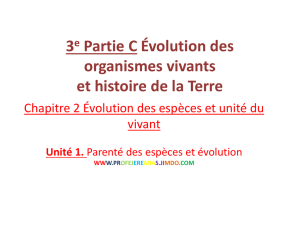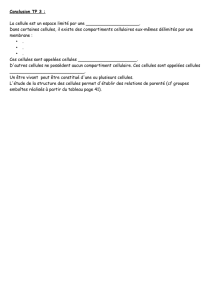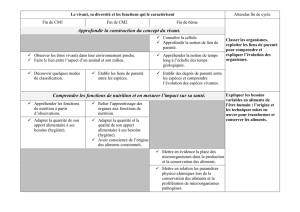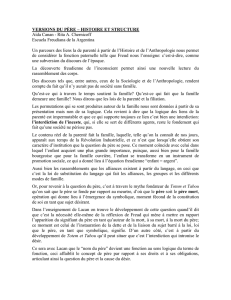La parenté sans la reproduction

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm
Mini-revue
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2013 ; 15 (1) : 121-32
La parenté sans la reproduction ?
Kinship without reproduction?
Florence Weber
École normale supérieure,
48, boulevard Jourdan,
75014 Paris,
France
Résumé. L’anthropologie de la parenté a mis au point des outils de traduction universelle
des différents systèmes de parenté, qui permettent d’étudier les transformations de la parenté
contemporaine. La dissociation entre les trois dimensions de la paternité (le sang, le nom et
le quotidien) est étudiée à travers le cas de Bérénice, engagée dans un procès en contestation
de paternité légitime. La maternité est également dissociée aujourd’hui en maternité géné-
tique (par les gamètes) et corporelle (par le ventre), sans que la maternité quotidienne ne soit
reconnue, ni pratiquée la transmission du nom maternel. Plutôt que de valence différentielle
des sexes, ne faudrait-il pas analyser les contraintes et les ressources des stratégies de parenté,
différentes selon les hommes et les femmes, mais aussi les cultures et les classes sociales ?
Mots clés : anthropologie, parenté, droit, idéologie du sang, parenté quotidienne, ventre
Abstract. Anthropology of kinship has used universal tools translating the different existing kin-
ship systems, available for a study of the transformations of nowadays kinship. The dissociation
between three dimensions of fatherhood (blood, name and everyday life) is studied through
the case of Bérénice, involved in a suit contesting her legitimate birth. Motherhood has been
also dissociated in recent times between genetics (through gametes) and body (womb) but nei-
ther everyday life is yet recognized or transmission of the mother’s name is used. More than
differential valence of gender, should we analyze constraints and resources within strategies
of kinship, different among men and women, but also cultures and social classes?
Key words: anthropology, kinship, law, ideology of blood relationship, everyday life relation-
ship, womb
L’ anthropologie contemporaine
repose sur deux constats empi-
riques connus depuis la fin du XIXe
siècle : l’unité de l’espèce humaine,
qui a permis le développement de
l’anthropologie physique ; la diver-
sité des différentes cultures, qui est
l’objet de l’anthropologie sociale et
culturelle. La reproduction est un
phénomène biologique universel à
l’échelle de l’espèce humaine, la
parenté est un système social de
représentations, de sentiments et
de pratiques, fortement normatif,
propre à chaque culture et suscep-
tible de transformations, qui fut l’un
des premiers objets de l’anthropologie
sociale au XIXesiècle. Les liens entre la
reproduction humaine et les différents
systèmes de parenté font toujours
débat. Peut-on parler d’invariants
anthropologiques en matière de
parenté, comme l’ont fait Claude
Lévi-Strauss pour l’interdit de l’inceste
[1] puis, Franc¸oise Héritier pour la
valence différentielle des sexes [2] ?
Les ethno-savoirs de la reproduction
biologique fondent-ils systématique-
ment les représentations de la parenté,
comme le croyait Malinowski [3] ? Ou
bien faut-il analyser le jeu stratégique
des individus et des groupes sociaux
avec les contraintes biologiques et
sociales, ces contraintes variant selon
les contextes historiques et le sens
du jeu étant inégalement réparti dans
la société, comme l’a proposé Pierre
Bourdieu [4] ?
L’anthropologie culturelle améri-
caine postmoderne, peu connue en
France, a montré avec David Schnei-
der dès 1968 l’importance de la
«nature »dans les représentations
américaines de la parenté [5] puis,
l’importance de ces représentations
dans les modèles scientifiques de la
parenté en anthropologie [6] et de
la reproduction en biologie, avec les
travaux de l’anthropologie féministe,
notamment ceux d’Emily Martin [7].
Les évolutions contemporaines
des sociétés occidentales représentent
un magnifique laboratoire pour
reprendre le débat, pour peu qu’on les
étudie avec la rigueur ethnographique
habituelle en anthropologie sociale.
doi:10.1684/mte.2013.0452
médecine thérapeutique
Médecine
de la Reproduction
Gynécologie
Endocrinologie
Tirés à part : F. Weber
121
Pour citer cet article : Weber F. La parenté sans la reproduction ? mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2013 ; 15 (1) : 121-32
doi:10.1684/mte.2013.0452
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm
Mini-revue
L’évolution des mœurs, du droit et des technologies de
la reproduction a-t-elle conduit à dissocier davantage la
reproduction biologique, qui apparaît comme de plus en
plus maîtrisée, et le système de parenté qui se serait auto-
nomisé des contraintes et des ressources biologiques ou
au contraire à un renforcement du lien entre les deux ?
Nous commencerons par rappeler les bases de
l’anthropologie classique de la parenté, dont les modèles
reposent sur la différence de genre et sur la distinction
entre filiation et alliance comme le rappelle Franc¸ois
Héran [8], c’est-à-dire sur les représentations occidentales
de la parenté [5] pour qui le genre est une donnée bio-
logique et la nature (parenté consanguine) s’oppose au
droit (parenté affine). Nous montrerons que les schémas
classiques de parenté sont suffisamment souples pour se
détacher de ces modèles et décrire avec une précision
ethnographique les transformations des mœurs, divorce,
liaison non officielle, alliance homosexuelle, naissance
hors mariage reconnue ou non. Une étude du droit de
la filiation en France, avant et après 1972, montre que
l’État est présent dans l’établissement de la filiation et ne
s’incline pas forcément devant la nature, contrairement
à ce qu’avanc¸ait Schneider dans le cas américain. Une
troisième dimension de la parenté a été découverte en
Malaisie dans les années 1980 par l’anthropologue britan-
nique Janet Carsten : la parenté nourricière ou quotidienne
[9].
Ces trois dimensions de la parenté (nature, droit, quo-
tidien) permettent d’analyser les transformations de la
filiation dans les sociétés occidentales contemporaines.
On partira du cas de Bérénice pour montrer la dissocia-
tion entre trois dimensions de la filiation paternelle dans
le contexte franc¸ais des années 1990 : la transmission du
nom, l’idéologie du sang et le partage du quotidien [10].
On s’interrogera ensuite sur les différentes dimensions de
la filiation maternelle : la grossesse et l’accouchement, étu-
diées dans leur relation avec le pouvoir médical [11, 12],
relèvent-elles de la nature ou du quotidien ? N’assiste-t-
on pas à une dissociation de la reproduction féminine,
entre ses représentations génétiques (gamète) et corpo-
relles (ventre) ? Cette focalisation sur la nature féminine
désormais dédoublée ne s’accompagne-t-elle pas d’une
incapacité redoublée des femmes à transmettre leur nom
malgré les évolutions législatives ? Quels sont les liens
entre le rôle des femmes dans la reproduction biologique,
désormais prise en mains par le corps médical, et leur
place, centrale et invisible, dans la reproduction sociale ?
Les schémas de parenté :
filiation et alliance
La parenté est un domaine particulièrement actif et
cumulatif de l’anthropologie sociale, présent dès l’origine
de la discipline avec les travaux de Lewis Morgan en
1871 [13], et qui a résisté aux changements de paradigme
scientifique, notamment à l’abandon de l’hypothèse évo-
lutionniste. Du point de vue de la méthode, les ethno-
graphes étudient les terminologies de parenté (la fac¸on
dont les indigènes appellent leurs parents et se réfèrent
à eux), les règles de l’alliance (règles positives qui dési-
gnent les partenaires préférentiels, règles négatives qui
désignent les partenaires à éviter, dont la plus connue
est l’interdit de l’inceste) et les normes de comportement
(qui vont de l’évitement et du respect à la plaisante-
rie [14]). La synthèse des données ethnographiques fut
facilitée par l’universalité des diagrammes de parenté
(figure 1).
Les faiblesses du diagramme classique, mises en évi-
dence par Franc¸ois Héran qui propose une notation
plus efficace pour représenter les structures, constituent
sa force pour un usage ethnographique. Celui-ci, d’une
grande puissance descriptive et qui a peu varié, repose sur
quatre notations conventionnelles :
–la différence de genre (le triangle désigne un
homme, le cercle une femme) ;
–l’alliance (représentée par un crochet horizontal
ouvert vers le haut) ;
–la filiation (représentée par un trait vertical qui relie
les enfants au crochet d’alliance) ;
–la germanité (représentée par un crochet horizontal
ouvert vers le bas).
Chacune de ces notations est d’une grande sou-
plesse. Lorsque le genre n’est pas connu ou qu’il n’a pas
d’importance, l’individu est représenté par un carré. Une
alliance homosexuelle ne pose pas de problème de nota-
tion. Chaque individu peut être relié à plusieurs conjoints,
successifs ou simultanés, à l’aide de plusieurs crochets
vers le haut, numérotés si nécessaire, et chacune de ces
alliances peut donner lieu à filiation. Un divorce est repré-
senté par un trait oblique qui rature le crochet d’alliance.
Une filiation naturelle est représentée par un trait verti-
cal entre la mère seule ou le père seul, et l’enfant. Une
alliance non officielle est représentée par un crochet en
pointillés, une filiation non officielle par un trait vertical
en pointillés.
La constitution de tels schémas repose sur une opéra-
tion de traduction entre les représentations de la parenté
des personnes enquêtées et cette représentation uni-
verselle. Ils sont susceptibles d’un usage structuraliste
(lorsque prime le jeu des formes et de leur répétition)
ou d’un usage ethnographique (lorsque chaque schéma
représente un cas, centré sur un individu noté «Ego »).
Si les nouveaux diagrammes proposés par Héran sont
plus puissants pour l’usage structuraliste, les diagrammes
classiques légèrement modifiés permettent l’usage ethno-
graphique, à condition de noter les décès (par une croix)
et éventuellement les dates (de mariage, de naissance et
de décès).
122 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm
11
2
2
33
4
4
55
6
6
1
2
3
4
5
6
77
8
8
99
10
10
810
11 1111
7911
12 12
12
13 13
14
14
15 15
16
16
18
18
17 17
13
14
15
16 18
17
1
Diagramme classique Diagramme de structure
(figuratif)
Diagramme de structure
(élémentaire)
Diagramme classique
23456
78910 11 12
13 14 15 16 1817
Figure 1. Diagrammes de parenté. Diagramme classique et diagramme de structure (d’après Hamberger [15]).
Dans le diagramme de structure, les hommes sont représentés par des traits verticaux, les femmes par des traits obliques, les relations par
des nœuds, l’ouverture vers le bas représentant la germanité et vers le haut l’alliance (comme dans le diagramme classique). Le diagramme
élémentaire ressemble donc beaucoup au diagramme classique, le diagramme figuratif permet de représenter les cas ethnographiques.
Source : Klaus Hamberger, Espaces de la parenté, L’Homme 195-6 (2010), 451-468, à propos de Franc¸ois Héran, Figures de la Parenté. Une histoire critique
de la raison structurale (PUF, 2009).
Le schéma tout entier représente le réseau des per-
sonnes avec lesquelles «Ego »reconnaît avoir un lien
de parenté, nommé parentèle lorsqu’il s’agit de parents
vivants. Les usages politiques et sociaux d’un tel réseau
ont été étudiés par Claude Karnoouh [16]. On peut ajouter
sur le schéma des lignes courbes fermées pour représenter
les deux groupes de parenté auxquelles appartient Ego :
la lignée, groupe pérenne fondé sur la filiation, qui exclut
certains parents et inclut des vivants et des morts et dont le
poids symbolique a été étudié par Jean-Hugues Déchaux
[17] ; la maisonnée, groupe provisoire qui englobe non
seulement l’ensemble des cohabitants mais éventuelle-
ment des proches réunis par le partage du quotidien, dont
l’importance économique a été montrée par Weber et
al. [18] dans le cas de la prise en charge des personnes
dépendantes (figure 2).
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013 123
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm
Mini-revue
• Ego, une femme de 90 ans qui vit seule à son domicile avec l’aide de
deux maisonnées successives. Elle est coloriée en rouge.
• On a entouré en rouge les membres de la première maisonnée et tracé ses
contours en rouge.
• On a tracé les contours de la seconde maisonnée en bleu, le fils qui
décide est entouré de bleu, le fils qui aide est entouré de violet.
• On n’a pas inclus Ego dans le périmètre de la seconde maisonnée, pour
marquer son incapacité à décider.
Figure 2. Un diagramme de parenté avec deux maisonnées en concurrence.
(D’après Weber F. Etre pris en charge sans dépossession de soi ?Alter, European Journal of Disability Research 2012;6:326-39).
La place de la nature et du droit
dans la parenté européenne
L’anthropologie de la parenté a connu, dans les années
1970 à 1980, un tournant décisif avec la mise au jour
de ses postulats occidentaux. L’anthropologue américain
David Schneider, après avoir étudié les représentations
de la parenté dans les familles américaines [5], a montré
que celles-ci avaient servi de fondement à l’étude anthro-
pologique de la parenté [6]. Les diagrammes classiques
reposent en effet sur l’opposition entre filiation et ger-
manité, d’une part, autrement dit la parenté consanguine
(kinship by nature), alliance d’autre part, autrement dit la
parenté affine (kinship by law), qui renvoie à l’opposition
occidentale entre «vraie »parenté et parenté «politique »
(l’espagnol oppose lui aussi deux parentés, carnal et poli-
tica).
En réalité, l’examen du code civil napoléonien oblige
à nuancer cette analyse. C’est en effet le droit qui
fonde la filiation, comme l’a montré la juriste Marcela
Iacub [19]. Le code oppose la maternité, démontrée par
l’accouchement (by nature), et la paternité, qui ne peut
être que présumée et pour laquelle on ne vérifie que
la vraisemblance (en termes de délais entre l’alliance et
124 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm
l’accouchement). De plus, avant la loi franc¸aise du 3 jan-
vier 1972 sur la filiation, le code opposait la filiation
légitime (établie par le mariage et qui relie donc l’enfant
indissolublement au père et à la mère mariés) et la filia-
tion naturelle (établie séparément vis-à-vis de la mère,
par l’accouchement, et du père, par un acte juridique de
reconnaissance). Si la filiation maternelle naturelle relevait
de la seule «nature »(ici, l’accouchement), les filia-
tions légitime et paternelle naturelle faisaient intervenir un
acte volontaire (le mariage et la reconnaissance). La situa-
tion est devenue plus complexe après 1972, du fait de la
volonté du législateur de réduire les inégalités statutaires
et successorales entre enfants légitimes, naturels et adulté-
rins. Deux éléments interdisent de lire cette réforme, et les
réformes suivantes, comme un abandon du droit devant la
nature (comme le disent certains anthropologues et même
si les juges en quête de stabilité ont parfois la tentation de
recourir aux tests sanguins) : l’adoption et la possession
d’état.
Les règles juridiques de la filiation ont pour objec-
tif premier d’établir l’identité de l’enfant et pour objectif
second de définir les règles de transmission successo-
rale. L’État, garant de l’identité des personnes, semble
alors plus important que la nature dans l’établissement
de la filiation, surtout lorsque l’on considère la possibilité
d’une adoption plénière qui vient remplacer une éven-
tuelle filiation précédente. De plus, le concept juridique
de possession d’état – qui désigne la réalité sociale telle
qu’elle est – représente une traduction efficace des liens de
parenté créés au quotidien : les actions en contestation de
paternité ne peuvent déboucher sur un test sanguin qu’en
l’absence de possession d’état, autrement dit seulement si
la relation de filiation entre l’enfant et son père n’est pas
reconnue par leur entourage.
La découverte
de la parenté quotidienne
Ce concept de possession d’état entre en résonance
avec une troisième dimension de la parenté qui a été mise
au grand jour dans les années 1980 : la parenté quoti-
dienne, issue d’un processus d’élevage, de soin et de prise
en charge (en anglais, care). C’est à partir de l’exemple de
la Malaisie que l’anthropologue britannique Janet Cars-
ten a montré l’importance d’une parenté qui n’est fondée
ni sur la loi ni sur la nature mais sur le partage de la
nourriture et de la vie quotidienne. En Malaisie en effet,
l’adoption est une modalité fréquente de la parenté et
elle repose sur la fabrication du corps par la nourriture
ingérée et la cohabitation, liée à une surveillance per-
manente du comportement de l’adopté. De nombreux
travaux sur l’adoption, notamment autour d’Agnès Fine
[20], ont montré qu’il ne s’agit ni d’une parenté fictive, ni
d’une parenté de substitution (comme l’adoption plénière
en droit franc¸ais), mais d’une filiation qui s’ajoute à la filia-
tion de naissance (quel que soit le mode d’établissement
de celle-ci) en élargissant le cercle des parents et en trans-
formant durablement, sinon définitivement, la personne
adoptée.
Le concept de parenté quotidienne permet d’étudier le
sentiment d’obligation entre parents (au sens large) et les
pratiques économiques au-delà des obligations inscrites
dans le code civil, notamment lorsque la cohabitation
n’est pas officialisée par un mariage ou un Pacs, mais
qu’elle relève du concubinage, c’est-à-dire d’un état de fait
reconnu par les administrations sociales mais non fiscales.
La parenté quotidienne permet également d’analyser les
flux financiers au-delà du ménage, entre des adolescents
dépendants financièrement et ceux de leurs proches qui
les aident ou encore entre des personnes âgées dépen-
dantes médicalement et ceux de leurs proches qui les
aident. La parenté quotidienne, ou parenté effective, per-
met de comprendre le décalage entre les obligations
légales et les pratiques, que ce décalage intervienne
comme un manque (des parents légaux qui n’aident pas)
ou comme un surplus (des aidants qui ne sont pas obli-
gés d’aider). Il permet donc de sortir des représentations
juridiques de la parenté, comme y invitait Pierre Bour-
dieu [4], pour étudier les pratiques, les sentiments et les
représentations.
La paternité dissociée : le cas Bérénice
L’analyse d’un procès en contestation de paternité
légitime met en évidence l’existence de trois dimen-
sions de la paternité : la transmission du sang (parenté
charnelle ou by nature), la transmission du nom (qui
reste en pratique un patronyme malgré l’évolution légis-
lative) et le partage du quotidien (traduit dans le droit
par le concept de possession d’état). Le procès est
intenté en 1997 par le père juridique (que nous appel-
lerons Simon Sirius) à sa fille Bérénice âgée d’un peu
moins de 30 ans. Simon n’a pas revu sa fille depuis
une réunion de famille où sa paternité biologique a
été publiquement dénoncée, alors qu’il l’avait élevée
comme sa fille depuis sa naissance, un an auparavant
(figure 3).
Pour décrire cette réunion et ses conséquences notam-
ment sur les sentiments de parenté des protagonistes,
laissons d’abord la parole au père de Simon Sirius, qui
rédige une attestation dans le cadre du procès. Son récit,
rédigé près de 30 ans après l’événement, laisse transpa-
raître une forte émotion, liée à la dissociation brutale et
définitive entre une parenté quotidienne bien établie (sa
petite-fille avait alors un an) et l’absence de fondement
biologique de cette parenté, soudain révélée.
mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013 125
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%