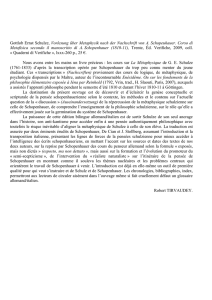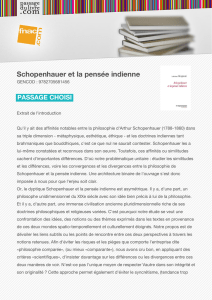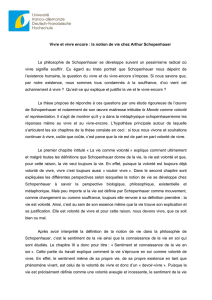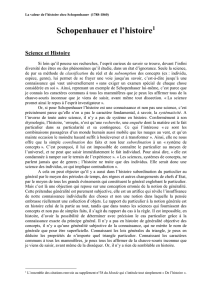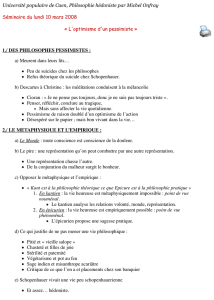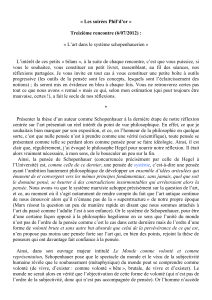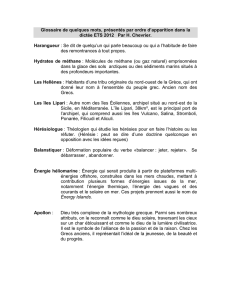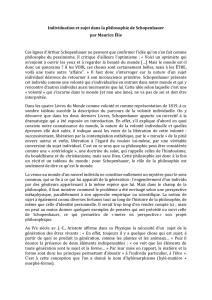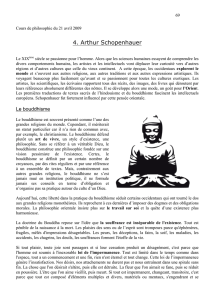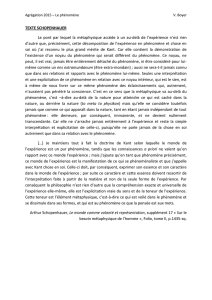Influences et réceptions de la philosophie d`Arthur

Université Charles-de-Gaulle – Lille III
UFR de Lettres Modernes
Dimitri JULIEN
Influences et réceptions de la
philosophie d’Arthur Schopenhauer
dans la littérature française de la fin
du XIXème siècle.
À rebours, La Joie de vivre, Sixtine, Paludes.
Mémoire de master 1ère année soutenu le 18 juin 2012 en présence de :
- M. Andrea Del Lungo, professeur de littérature française du
XIXème siècle, directeur de recherche.
- Mme Dominique Dupart, maître de conférences en littérature
française du XIXème siècle.

1
Remerciements
J'adresse mes remerciements aux personnes qui m'ont aidé dans la
réalisation de ce mémoire.
En premier lieu, je remercie M. Del Lungo, professeur à l'université
Charles-de-Gaulle Lille III. En tant que directeur de mémoire, ses nombreux
conseils et avis critiques ont été précieux pour la réalisation de ce mémoire.
Je remercie également Hélène, ma compagne, pour sa patience et ses
nombreuses relectures qui ont permis d’améliorer ce travail de recherche.

2
Sommaire
Introduction 3
I] À rebours, bréviaire du pessimisme schopenhauerien 7
A] La thématique du refuge 7
B] La réaction misogyne 15
C] Schopenhauer, une introduction au christianisme 23
II] La Joie de vivre, Schopenhauer contre le pessimisme
schopenhauerien 30
A] Lazare, condamnation du pessimisme d’une génération 30
B] La Misère du Monde 37
C] Éloge de Schopenhauer : Pauline et la pitié 45
III] Sixtine, roman du monde comme représentation 54
A] La théâtralité du monde 54
B] La cérébralité ou le monde : un perspectivisme narratif 60
C] L’art est la vie : pour un dandysme schopenhauerien 67
IV] Paludes, l’outrance du schopenhauerisme 73
A] L’ennui et l’éternel retour 73
B] Fiction et ambigüités du schopenhauerisme 80
Conclusion 86
Bibliographie 89

3
Introduction
Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand né en 1788 et mort en 1860. Son
œuvre principale, Le Monde comme volonté et comme représentation, ne lui a permis de
trouver le succès et la reconnaissance qu’à la fin de sa vie, bien qu’elle ait été publiée une
première fois en 1818. Sa découverte en France fut plus tardive encore, où il fallut attendre la
fin du siècle afin de découvrir l’ampleur de la pensée allemande. En effet, comme le rappelle
Paul Lévy, « inexistant en 1830, [l’enseignement des langues vivantes dans les Facultés] est
encore mal assis en 1870 »1, ce qui explique partiellement le retard dans la diffusion des
ouvrages allemands en France. Pourtant, à bien des égards, Schopenhauer bénéficia d’un
traitement particulier dans sa réception, notamment du fait de son style que beaucoup
qualifiait alors de « français ». Comme le rappelle René-Pierre Colin dans son ouvrage sur
Schopenhauer en France, « le sort de Schopenhauer est en effet un cas unique : aucun critique
n’eut jamais l’idée de faire de Kant, de Fichte ou de Hegel des Français d’adoption. C’est
pourtant ce qui advint presque dès sa découverte au pessimiste »2. En effet, la clarté du
philosophe le distingue de ses contemporains que lui-même n’hésite pas à qualifier de
sophistes ne sachant proférer que des galimatias incompréhensibles3. Clément Rosset
témoigne de cette langue presque littéraire de Schopenhauer, qui fut sans doute l’un des legs
qu’aura su recueillir Nietzsche de celui qu’il nommera son « éducateur » :
Une autre singularité de Schopenhauer est la clarté et la lisibilité de
son écriture (qualité peu fréquente, on le sait, chez les philosophes,
notamment les philosophes allemands). J’allais dire que Schopenhauer
est le seul philosophe allemand à bien écrire le français. Ce lapsus
n’en serait d’ailleurs pas tout à fait un, puisque Nietzsche déclarait
préférer lire Schopenhauer dans sa traduction française plutôt que dans
sa version originale.4
L’intérêt porté à Schopenhauer à la fin du XIXème siècle en France fut également dû au
contexte de cette époque. Suite à l’échec de la guerre franco-prussienne, un climat pessimiste
s’instaure dans la nouvelle génération, qui vient renforcer le découragement qui avait déjà
saisi de nombreux écrivains suite à l’échec de la révolution de 1848. Les idées de
1 Paul Lévy, La langue allemande en France. Pénétration et diffusion des origines à nos jours, t. II : De 1830 à
nos jours, cité dans René-Pierre Colin, Schopenhauer en France. Un mythe naturaliste, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 1979, p. 6.
2 René-Pierre Colin, Schopenhauer en France. Un mythe naturaliste, op. cit., p. 7.
3 À ce sujet, voir Arthur Schopenhauer, Au-delà de la philosophie universitaire, Paris, Mille et une nuits, 2006,
126 p.
4 Clément Rosset, préface à Arthur Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, éd. R
Roos, trad. A. Burdeau, Paris, Presses Universitaires de France (Quadrige), 2006, p. VI (désormais : Le Monde).

4
Schopenhauer sont alors accueillies favorablement, celui-ci apparaissant comme le maître du
pessimisme, sa philosophie démontrant les mécanismes qui font de l’existence un éternel
retour de la souffrance et de l’ennui. Pour Schopenhauer, le monde n’est que notre propre
représentation : nous ne pouvons connaître qu’à partir du regard que nous portons sur les
choses. Dès lors, toute connaissance absolue est vaine. Beaucoup s’inspireront de cette
épistémologie pour théoriser une manière d’être-au-monde solipsiste et individualiste,
refusant de faire société ou réfutant la modernité. Ce sont notamment les antimodernes, dont
Antoine Compagnon rappelle que Schopenhauer fut leur « idole »5 à la fin du XIXème siècle.
Un autre versant de la philosophie schopenhauerienne réside dans sa conception du monde
comme volonté. Si nous ne pouvons connaître les choses en soi mais qu’à travers la
représentation que nous nous en faisons, Schopenhauer tend néanmoins à nous révéler la
véritable nature de l’essence du monde : il s’agit du Vouloir ou Volonté (Wille), qui fait écho
à notre volonté individuelle : « La volonté qui est en nous, comme le rappelle René-Pierre
Colin, notre volonté individuelle, est en effet identique en son principe à ce qui régit
l’ensemble de la nature, à la volonté en soi »6. Celle-ci constitue une force omniprésente et
agissant sans raison apparente, que la psychanalyse identifiera notamment par la suite à
l’inconscient. Dès lors, l’homme n’est pas libre ; il est contraint par cette force tout en
s’illusionnant sur l’existence en ne considérant que la représentation qu’il a des choses. Se
croyant libre, il ne fait en réalité qu’obéir à un Vouloir qui se morcelle et se particularise en
plusieurs individualités, et par conséquent ne cesse d’entrer en conflit avec lui-même. Ce
pessimisme tragique est à la source de la réception de Schopenhauer en France et a bien
souvent mis de côté l’aspect rédempteur de la philosophie schopenhauerienne. Le penseur
allemand offre en effet une voie qui permet le salut : l’esthétique considérée comme une
contemplation pure des Idées (c’est-à-dire de l’objectivation directe de la Volonté), et la pitié
comme sentiment d’identité au Vouloir, d’appartenance au tout et donc comme fin du
morcellement de la chose en soi et des conflits qui lui sont inhérents.
La littérature fut particulièrement apte à recevoir cette philosophie et à la modeler à
son goût à la fin du siècle. De nombreux auteurs s’approprient les idées du philosophe
allemand, tandis que d’autres s’emparent de celles-ci pour s’y opposer ou pour en chercher les
contradictions. Cette influence du schopenhauerisme dans la littérature de la fin du XIXème
siècle ne fut pas seulement française mais également européenne, et a pu s’étendre bien au-
5 Antoine Compagnon, Les antimodernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes, Paris, Gallimard, 2005, p. 49.
6 René-Pierre Colin, Schopenhauer en France. Un mythe naturaliste, op. cit., p. 21.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
1
/
92
100%