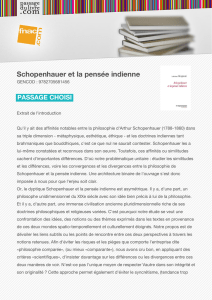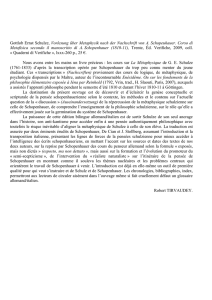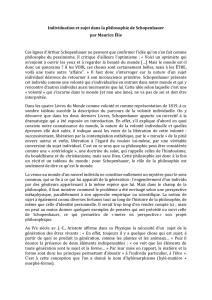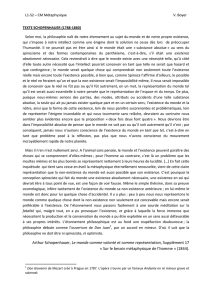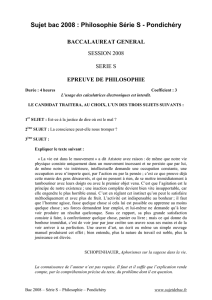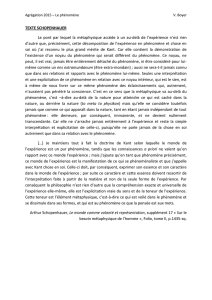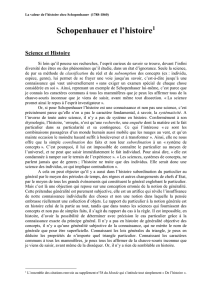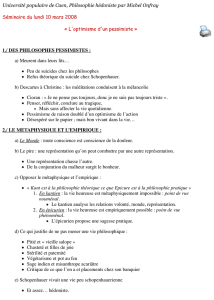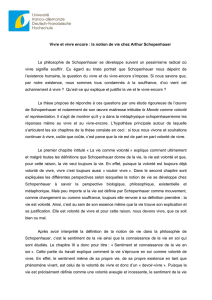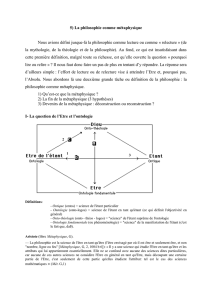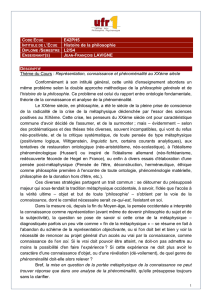Arthur Schopenhauer Le Monde comme volonté et comme

Arthur Schopenhauer
Le Monde comme volonté et comme
représentation.
Le monde comme volonté et comme représentation (1819) : le titre est à la fois clair et
sibyllin. Clair pour quiconque sait lire et comprend immédiatement que le monde n’est
pour l’auteur que de la "volonté" et de la "représentation". Sibyllin pourtant à
l’entendement commun qui ne peut que reculer devant la radicalité de cette thèse. Et il y
a de quoi, en effet, hésiter à suivre Arthur Schopenhauer (1788-1860) à mesure que l’on
découvre les implications de sa philosophie qui reconnaît, comme seule matière de
l’existence, le désir et les illusions de la pensée. Toute transcendance morale, religieuse
ou métaphysique se trouve ruinée, dissipée à titre de mirage consolateur entretenu par
une vie qui n’a d’autre vocation que la souffrance. La seule issue du vouloir-vivre est
dans le renoncement à lui-même, dans le détachement et l’acceptation du vide. Très
influencé par les grands thèmes de la sagesse bouddhiste, Schopenhauer est aussi et
surtout un héritier de Kant et c’est dans les catégories de la pensée occidentale qu’il
tente de lever le voile de Maya pour nous confronter à la dure condition d’exister. Les
analyses consacrées dans cet ouvrage à l’amour, à la beauté et à l’art ont très vite rendu
célèbre leur auteur en Allemagne et au-delà : le jeune Nietzsche marche dans ses pas et
Freud reconnaîtra dans le philosophe de Francfort un précurseur de ses thèses sur le
refoulement et sur le rôle déterminant de la sexualité dans l’expérience humaine. Un
penseur crucial donc, et pourtant mal connu, dont l’œuvre est au carrefour d’une
modernité qui se cherche encore et lui devra finalement beaucoup.
Sur la vie et l’œuvre de Schopenhauer : Rüdiger Safranski, Schopenhauer. Pour une
présentation de la philosophie schopenhauérienne : Clément Rosset, Schopenhauer,
philosophe de l’absurde; Alexis Philonenko, Schopenhauer. Une philosophie de la tragédie. --Emilio
Balturi --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.
Présentation de l'éditeur
Cette édition Quadrige est la reprise de l'édition reliée parue en 1966 aux Puf et dont la
14e édition est parue en 1996.
L'année du centenaire de sa mort 1960, des articles parus, la plupart considérait les
publications du "vieux solitaire, irascible et grincheux" philosophe comme n'ayant plus
qu'un intérêt historique d'autant que peu de textes étaient disponibles en français.
L'avenir les détrompa. D'où l'intérêt de cette traduction qui permet de redécouvrir
l'oeuvre et la pensée de Schopenhauer, initiateur entre autres de Nietzsche, Thomas
Mann, André Gide, sans compter les "admirateurs" actuels.
Lors de la première publication de l'ouvrage son auteur n'avait pas trente ans, les

éditions suivantes ont été augmentées de commentaires qui parfois trahissent davantage
la maturité et même la vieillesse d'où les critiques de "philosophe grincheux et
solitaire"... Sa philosophie n'est pas celle d'un système mais davantage une vision
intuitive augmentée au fil des années, qu'on accepte ou qu'on rejette, dont
l'enseignement se rapproche de celui d'Epicure.
Cet ouvrage est l'un des plus grands classiques de la philosophie à l'égal de la "Critique
de la raison pure" de Kant. --Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non
disponible de ce titre.
De la mort et de ses rapports
La mort, au sens biologique du terme, n'est pas propre aux hommes,
elle est le fait de tout être vivant, du simple unicellulaire au plus complexe des
organismes.
Mais la conscience de la mort et le savoir de l'existence semble bien être
l'apanage des hommes, au point que le qualificatif de "mortel" vient, dans les
anciens récits, désigner sans équivoque les humains. Mais pourquoi seuls les
êtres humains s'interrogent ainsi sur leur existence?
Schopenhauer répond à cette question en considérant l homme comme un
être profondément métaphysique, s'étonnant devant le monde et aspirant à
l'absolu. Les autres êtres de la nature, selon lui, ne se posent pas la question
de l'existence car ils ne sont pas étouffés par la conscience de leur mort en
tant que disparition individuelle. Par contre l'homme vit meurtri par la
conscience de sa mort et la difficulté de sa vie qui le pousse à la réflexion. La
raison est propre à l'homme et fait de lui un "animal métaphysique". Porté par
la mort et la douleur, l'homme s'étonne de son existence et cherche une
explication au monde dans lequel il vit.
De la ligne 1 à 11, Schopenhauer distingue clairement l'homme du reste des
êtres et explique la relation de la nature avec son existence. Seul l'homme est
perplexe devant l'idée d'exister, le reste des hommes de la nature ne
s'interroge même pas sur le pourquoi et le devenir de leur vie. Pour tous sauf
pour l'homme, l'existence est une chose naturelle, évidente et inévitable qui ne
mérite pas que l'on y prête attention puisqu'elle est déterminée et qu'elle
concerne tout aussi bien ce qui est abstrait que ce qui est concret. Toutes les
choses présentes existent puisqu'elles ne sont pas rien. L'auteur voit

implicitement l'existence d'une manière très large puisque selon lui tout être
existe. Pour lui, exister signifie avoir une forme, être quelque chose que ce
soit une chose concrète, un sentiment ou une force déterminée. L'existence
est banale et ne soulève aucun problème pour la nature. Celle-ci l'aborde avec
sérénité, par exemple, chez l'animal, le désir inextinguible de vivre et la faculté
de le faire forme un tout harmonieux qui n'entraînent pas d'interrogations sur
la raison de la vie. La volonté de l'animal se ressent dans la puissance
aveugle de la vie et l'intellect ne se présente pas comme une barrière à cette
volonté mais s'allie avec elle pour former une symbiose. L'animal se contente
de vivre sas se demander pourquoi il le fait car il n'a pas la conscience de
vivre en tant qu'individu périssable. Il appartient à un tout qu'est la "mère
universelle" et ne vit que dans l'optique de compléter ce tout sans pour autant
en être conscient. "L'omniscience de la mère universelle" englobe ainsi toutes
les choses du monde et n'ont pas plus conscience de leur existence que les
choses elles mêmes. Elle est poussée par la volonté de vivre, universelle,
aveugle et irrésistible. Cette force est la substance intime de toutes choses,
elle est à la fois le fait de vivre et le mécanisme de tout ce qui appartient au
monde. Ainsi, toutes les choses et les êtres vivent avec plénitude une
existence inconsciente.
L'auteur remonte à la source du monde, la "mère universelle" et arrive
jusqu'au "règne des animaux pour expliquer chronologiquement l'existence
des choses. Toute la nature possède donc une existence qu'elle ignore, cette
ignorance fait la force de sa vie et l'empêche de s'étonner devant le monde et
de souhaiter l'immortalité. La Nature a l'avantage de vivre en dehors du temps
psychologique ce qui lui permet de vivre pleinement sans crainte et sans
angoisse.
En remontant dans les différentes étapes de la vie biologique, l'auteur arrive
à l'apparition de l'homme et de sa raison.
De la ligne 12 à la ligne 17, l'auteur démontre l'absurdité de la vie humaine.
L'homme est le seul être à avoir pleinement conscience qu'il existe et que son
existence est limitée dans le temps. Cette certitude fait naître chez lui un
étonnement qui contient des degrés de crainte, de surprise, d'ébranlement et
de douleur. Il vit tout en sachant que sa vie va prendre fin et il est terrifié par
sa mortalité. Cette peur l'entraîne à se poser des questions sur son existence,
cherchent un sens à un monde quelque peu absurde. La conscience que nous
avons de notre finitude nous enferme dans une sorte de paresse, le moindre
effort paraissant inutile puisque la vie est limitée et sans aucun sens. Nos
jours s'ecoulent sans espoir, sans but dans un monde dépourvu de
cohérence.
Dans la même oeuvre philosophique , Schopenhauer va plus loin dans son
raisonnement de l'absurde en affirmant que la "vie de l'homme n'est qu'une
lutte pour l'existence avec la certitude d'être vaincu." Cette citation montre une
vision quelque peu pessimiste de l'auteur sur l'existence humaine. L'homme
passe sa vie à lutter contre la mort en cherchant un sens à son existence alors
qu'il ne peut pas échapper à sa fin.
La réflexion serait donc la conséquence de la conscience de la mort et la
recherche d'un échapatoire à travers la pensée. C'est la peur de la finitude qui
nous pousse à une multitudes de questions sur le sens du monde et de

l'existence. Nous sommes inférieurs aux animaux dans le sens où nous ne
sommes pas capables d'affronter la vie avec le même calme qu'eux.
Schopenhauer pense que "la vie n'est pas là pour qu'on en jouisse mais
pour qu'on la subisse, qu'on s'en acquitte", c'est pourquoi la position neutre et
sereine des animaux est bonne car elle est poussée par une forte volonté de
vivre plutôt que par une constante remise en question de l'existence. D'un
côté, la réflexion propre à l'homme nuit à l'attente passive qu'il devrait avoir
face à sa vie, mais d'un autre côté, l'homme sachant sa vie en danger, ne peut
ignorer sa mort et la pensée est son seul recours pour s'y préparer.
La raison humaine est donc à la fois la conscience que l'existence possède
un début et une fin et une interrogation sur soi. L'homme aborde sa vie avec la
constante menace de la mort et toute son existence se résume à l'attente de
sa fin, assommé par l'absurdité incompréhensible du monde. Il lui parait alors
totalement inutile de faire le moindre effort. Il cherche par contre à comprendre
pourquoi il est condamné à vivre une vie sans aucun sens et il cherche des
réponses notamment dans la métaphysique et la philosophie.
De la ligne 17 à la ligne 22, l'auteur confirme la différence entre l'homme et
le reste de la nature en expliquant d'où lui vient le besoin métaphysique du
monde. Selon lui, l'émerveillement constant de l'espèce humaine devant le
cycle de la vie, la pousse à chercher des réponses métaphysiques et
philosophiques.
La métaphysique est enracinée dans l'étonnement de l'existence. Seul
l'homme ressent le besoin d'expliquer les choses et leurs causes premières
car lui seul s'étonne d'exister. En tant qu'être conscient de notre mortalité nous
n'arrivons pas accepter le monde. L'auteur résume notre condition dans la
phrase clé du texte, "l'homme est un animal métaphysique". Nous sommes
des animaux mais des animaux conscient de devoir vivre ou mourir. Le terme
de métaphysique est ancien, ce fut le nom donné par un commentateur
d'Aristote à l'ouvrage d'Aristote, placé après la physique. Ainsi la
métaphysique un type de spéculation prétendant s'élever au dessus des
enseignements de l'expérience.
L'homme est un animal différent des autres car il exprime le besoin d'avoir
des explications sur le monde. Il est déchiré entre le désir de vivre et celui de
comprendre pourquoi il existe avec en plus la menace grondante de la mort
qui accroît sa crainte et multiplie ses interrogations.
L'essence de la philosophie serait la connaissance des choses de la mort,
c'est à dire la conscience que la vie n'est pas éternelle et la "considération de
la douleur et de la misère de la vie". Le besoin métaphysique et philosophique
naît de l'alchimie entre la menace de la mort et la souffrance que l'être subit
tout au long de sa vie. Ce mélange douloureux provoque chez l'espèce
humaine une soif de la compréhension du monde et la négation de la
possibilité que l'existence aussi dure soit-elle puisse ne pas comporter de
sens. L'homme souffre toute sa vie et pourtant il appréhende la mort.
La pensée philosophique et l'explication métaphysique tente de donner des
réponses aux questions qui harcèlent tout être humain.
L'imperfection de la vie nous pousse à nous interroger sur la raison de nos
existences misérables et à chercher un sens à un monde qui n'en a pas.

De la ligne 22 à la ligne 25, l'auteur conclut en supposant que la vie soit
éternelle et parfaite. Nous n'aurions alors aucune raison de chercher un sens
à notre existence puisque le seul fait de vivre en serait un. Nous ne nous
interrogerions pas sur le pourquoi de la forme du monde puisqu'il nous
paraîtrait parfait comme ça. De toute évidence cette supposition montre que le
problème vient du fait que nos vies sont des vies de souffrance et que si nous
etions sereins, nous n'aurions pas à nous poser des questions sur le sens de
notre existence. "La mort est le génie inspirateur, le musagète de la
philosophie, sans elle on eut difficilement philosophé..." (Schopenhauer)
L'homme se sent étranger au monde et développe son malaise dans des
interrogations existentielles.
Comme le développe Sartre dans La Nausée, il ne trouve pas de réconfort
chez les autres et il ne peut donc pas trouver un sens à la vie dans la
communauté humaine puisqu'il est fondamentalement seul. "L'homme sans
aucun appui et sans aucun secours et condamné chaque instant à inventer
l'homme".
La théorie de Sartre rejoint sur un certain plan celle de Schopenhauer,
l'homme seul face au monde se replie sur la philosophie et la métaphysique
pour tenter de se rassurer. Sartre possède une vision très pessimiste de la
condition humaine et du monde, vision que Schopenhauer n'atteint pas dans
sa totalité. Les deux auteurs soulignent le néant et la souffrance qui
accompagne l'existence, expliquant la naissance de la philosophie et de la
métaphysique dans la réflexion des hommes.
Schopenhauer pense que l'homme est destiné à souffrir toute sa vie avec la
conscience de se rapprocher chaque jour de sa mort.
L'intérêt philosophique du texte de Schopenhauer est donc d'expliquer la
cause d'un tel besoin d'explication du monde chez l'homme. La souffrance de
la vie et la conscience de la mort nous projette dans un sentiment d'absurdité
et d'incompréhension. L'existentialisme de Schopenhauer est une philosophie
du désespoir, il a une vision très pessimiste de la condition humaine qu'il
souligne dans sa misère et qu'il réduit à une attente douloureuse de la mort. Il
établit un contraste entre l'homme et les autres êtres du monde tout en leur
attribuant une existence.
Cette position s'oppose à la vision habituelle. Nous avons tendance à
n'attribuer une existence qu'aux êtres humains en partant du principe que
l'existence s'applique aux êtres capables de projeter leur propre
anéantissement, hors seul l'être humain est doté de cette capacité.
Mais la définition de l'existence peut prendre un sens beaucoup plus large
s'en appliquant à toute chose qui possède une forme et c'est la définition
qu'utilise l'auteur dans son texte.
Schopenhauer a une vision pessimiste et absurde du monde. Il présente la
vie humaine comme perpétuelle souffrance accompagnée d'une attente
terrorisée de la mort. La recherche de sens au monde, selon lui, restera vaine
et il pense que nous devons prendre définitivement conscience que le monde
nous restera incompréhensible.
Il fait parti des auteurs existentialistes les plus pessimistes et les moins
humanistes car malgré le fait que l'existentialisme nie l'existence de tout
principe supérieur chez beaucoup d'auteurs c'est en fait une doctrine optimiste
qui déclare l'homme absolument libre, seul responsable de lui-même.
 6
6
1
/
6
100%