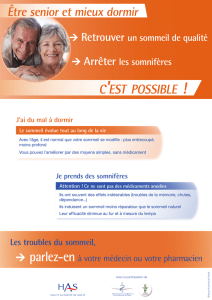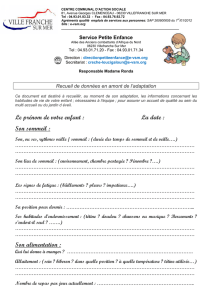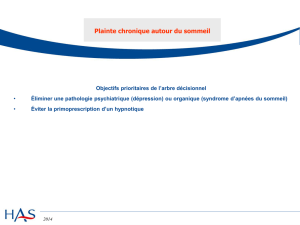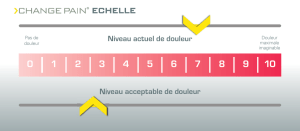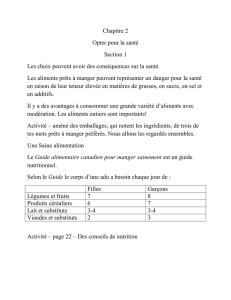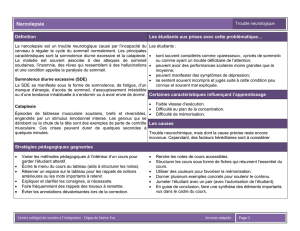AVIS concernant le développement actuel et la pratique scientifique

AVIS
concernant le développement actuel et la pratique scientifique fondée
de la médecine du sommeil
Le Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies
chroniques et pour les pathologies spécifiques de l'INAMI souhaite s'informer du
développement actuel et de la pratique scientifique fondée de la médecine du sommeil
auprès de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, dans le souci de développer des
stratégies visant à améliorer les soins de santé dans le domaine concerné. Il souhaite
plus particulièrement prendre connaissance de l'avis de l'Académie sur quatre aspects
de la question.
Afin de répondre à cette demande, l’Académie Royale de Médecine de Belgique a
constitué une Commission comprenant les professeurs Th. de Barsy (neuropsychiatre,
UCL), G. Moonen (neuropsychiatre, Ulg) et G. Franck (neuropsychiatre, Ulg,
Président), membres de l’Académie et les Professeurs G. Aubert (neuropsychiatre,
UCL), J. Grosswasser (pédiatre, ULB), P. Linkoswski (neuropsychiatre, ULB), D.
Rodenstein (pneumologue, UCL) et R. Poirrier (neuropsychiatre, Ulg, Secrétaire),
choisis comme experts extérieurs. La commission s’est réunie les 11 et 18 novembre
2006. De même la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België a constitué une
Commission comprenant les professeurs P. Cosyns (neuropsychiatre, UZA), B.
Himpens (physiologiste, KUL) et M. Decramer (pneumologue, KUL, Président )
membres de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België et les Professeurs
P. Boon (neuropsychiatre, UGent), B. Buyse (pneumologue, KUL, Secrétaire), G. Joos
(pneumologue, UGent), D. Pevernagie (pneumologue, UGent), W. Robberecht
(neurologue, KUL), W. Van Paesschen (neurologue, KUL) et M. Van Zandijcke
(neuropsychiatre, UGent) choisis comme experts extérieurs. La commission s’est
réunie le 30 août et le 18 octobre 2006.
Les deux commissions se sont réunies ensemble le 10 janvier 2007 pour discuter de
leurs avis respectifs. Elles sont arrivées à un consensus et ont décidé de formuler un
avis commun (G. Aubert et B. Buyse, rapporteurs).
Résumé
La Commission juge, de façon unanime, que le moment est venu de définir un
domaine médical spécifique consacré aux pathologies du sommeil et de l'éveil.
Au cours des 20 dernières années, on a vu émerger une médecine du sommeil qui
permet de distinguer actuellement 80 entités, définies dans une classification des
troubles du sommeil et de l'éveil actuellement acceptée de façon internationale (ICSD-
2, International Classification of Sleep Disorders). La Commission souligne la diversité
et la haute prévalence des différents troubles du sommeil et de l'éveil, et en particulier
de l'insomnie et du syndrome d’apnées et d’hypopnées du sommeil. L'impact socio-
économique de ces troubles est considérable. Les conséquences en termes de santé
publique (et particulièrement de complications cardio-vasculaires) sont clairement
démontrées.
La prise en charge de ces troubles exige une approche multidisciplinaire. Elle ne se
limite pas au seul examen polysomnographique qui doit s'inscrire dans un trajet de
soins du patient, qui part du médecin généraliste, et qui, dans de nombreux cas,
demande une prise en charge intégrée faisant appel à plusieurs intervenants de
spécialités différentes. C'est pourquoi, la commission recommande d'envisager un
Certificat de compétence en médecine du sommeil. Ces certificats seraient octroyés
aux médecins spécialistes après une formation complémentaire théorique et pratique

spécifique. Le médecin porteur de ce titre sera le garant d'une prise en charge intégrée
de qualité.
Tout ceci suppose bien entendu que l'enseignement dispensé par les universités tienne
compte de l'importance de ce domaine, et ce dès les premiers et deuxièmes cycles de
médecine, de même que dans la formation de troisième cycle.
Première question : Est-il raisonnable, sur la base de l'évolution de la
connaissance scientifique clinique et fondamentale des troubles du sommeil
et de l'état de veille, de délimiter à l'heure actuelle un domaine médical
consacré de manière spécifique à cette pathologie ?
La réponse de la Commission à cette question est affirmative et unanime. Elle s’appuie
sur les arguments suivants.
1.1. Spécificité de ce domaine médical : les troubles du sommeil et de l’éveil
Dès 1979, une première classification des troubles du sommeil et de l’éveil a été
proposée et acceptée par les diverses Sociétés d'étude du sommeil. Cette première
classification témoigne de l'émergence de la médecine du sommeil comme un domaine
clinique spécifique. Cet effort de classification diagnostique est un processus évolutif,
mené parallèlement au développement des centres de sommeil et à l'identification de
nouvelles catégories nosologiques. Une seconde classification internationale a été
proposée en 1990 et elle a fait l'objet d'une révision récente en 2005. Cette dernière
classification (ICSD-2, International Classification of Sleep Disorders) distingue 80
entités, réparties en 8 grandes catégories diagnostiques basées, soit sur une plainte
commune (ex. insomnie ou hypersomnie), soit sur l'étiologie présumée (ex.
dysfonctionnement de l'horloge biologique dans les troubles circadiens), soit sur le
système physiologique concerné (ex. troubles respiratoires liés au sommeil) (1). Les
troubles du sommeil ont pris place dans la classification internationale des maladies
(ICD-10, International Classification of Diseases).
En 1978, apparaissait la première revue scientifique internationale spécialisée,
consacrée au seul domaine du sommeil (la revue Sleep). On en dénombre aujourd’hui
plus de six. Il est révélateur que des articles et des éditoriaux sur les troubles du
sommeil et de l’éveil paraissent fréquemment dans les grandes revues internationales
de médecine, telles que le New England Journal of Medicine, le Lancet et le JAMA
(trente articles pour la seule année 2005), ou encore dans de nombreuses revues
médicales spécialisées dans les domaines les plus divers (16 985 citations dans
PubMed, en 2005). A titre de seul exemple, citons une série d’articles de revue sur les
différentes pathologies du sommeil, entre autres sur l’insomnie, dans la revue de
pneumologie Chest (2).
1.2. Prévalence et impact socio-économique
Les hautes prévalences des différents troubles du sommeil et de l’éveil, ainsi que leurs
répercussions socio-économiques très importantes (3) en font un domaine majeur,
auquel pratiquement tout médecin sera confronté dans sa vie professionnelle.
L’Institut américain de l’Académie Nationale des Sciences de la Médecine a établi, dans
son rapport de 2006 que 20 à 28% des Américains souffrent de façon chronique de
troubles du sommeil et de l’éveil, troubles qui entravent leur fonctionnement quotidien
et affectent leur santé et leur longévité (4). Les insomnies et le Syndrome d’Apnées et
d’Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) sont les troubles du sommeil et de
l’éveil dont les prévalences dominent largement le domaine.
Insomnies

L’insomnie est la plainte la plus commune du sommeil, à travers toutes les périodes de
la vie. Pour des millions d’individu, le problème est chronique. Nous en donnerons pour
exemple les résultats de l'enquête belge, réalisée en 2004 par l'institut scientifique de
la santé publique (5). Elle confirme la prévalence élevée de la plainte d'insomnie en
Belgique. D'après le questionnaire, 20 % de la population a des problèmes d'insomnie
; 5 % de la population (cela concerne donc environ un demi-million de personnes en
Belgique) a pris un somnifère (benzodiazépines) au cours des 24 dernières heures ; 9
% de la population utilise de façon régulière un somnifère.
L’insomnie s’accompagne de surcroît de profonds effets négatifs sur la qualité de la
vie, sur la productivité et sur le fonctionnement quotidien (3).
On a tenté régulièrement, ces dernières années, d’évaluer le coût de l’insomnie en
séparant sa morbidité propre et ses co-morbidités, en prenant soin de distinguer
dépenses directes et indirectes. Les coûts directs comprennent les soins médicaux
(consultations, hospitalisations) et pharmaceutiques. Les études menées en France (6,
7) montrent qu’une insomnie sévère (dont les auteurs situent la prévalence à 8%)
donne lieu à des taux d’hospitalisation et de congés de maladie doublés par rapport
aux personnes sans insomnie. Les coûts directs de l’insomnie chronique aux Etats-
Unis, sont estimés entre 1,8 et 3 milliards de dollars par an (3, 8, 9). Les coûts
indirects comprennent la productivité au travail, l’absentéisme, les accidents de
circulation, du travail et la part des co-morbidités attribuées à l’insomnie. Un rapport
récent les situent aux Etats-Unis, entre 96 et 98 milliards de dollars par an (3).
L’addition des coûts directs et indirects de l’insomnie peut donc dépasser les 100
milliards de dollars par an. A l’échelle de la Belgique, ces coûts se chiffreraient à 3,1
milliards d’euros par an.
Syndrome d’Apnées et d’Hypopnées Obstructives du Sommeil
Le Syndrome des Apnées et Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) touche
entre 2 et 4% de la population américaine, entre 30 et 60 ans, d'après des études
réalisées à la fin du siècle dernier (10). Ces chiffres seront certainement revus à la
hausse dans nos sociétés menacées par la sédentarité et l’obésité. On peut estimer
qu'au moins 0,5% de la population adulte est atteinte d'une forme modérée à sévère
de SAHOS qui nécessite un traitement spécifique par CPAP nocturne (CPAP : acronyme
anglais de Continuous Positive Airway Pressure ; en français : Pression positive
continue par voie nasale) (11). Ceci représente en Belgique environ 50.000 personnes.
La croissance constante du nombre d'utilisateurs de CPAP, dans le cadre de la
Convention « ventilation à domicile » de l’INAMI en Belgique illustre clairement ce
problème croissant (figure 1).
Fig. 1. Nombre de patients dans la convention CPAP en Belgique
(chiffres de l’INAMI, avec nos remerciements au Dr L Neyrinck)
2136
3165
4631
7694
118 8 1
14 4 0 7
15887
19 15 2
0
5000
10000
15000
20000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Le syndrome d'apnées non traité s'accompagne d'une somnolence diurne excessive ;
celle-ci entraîne une diminution de la qualité de vie ainsi que des conséquences
indirectes, en termes de morbidité et mortalité traumatiques par accidents de
circulation et accidents de travail. D’autre part, le syndrome d’apnées s’accompagne
d’une morbidité et d’une mortalité médicales importantes : hypertension artérielle,
infarctus du myocarde et décompensation cardiaque (12), accidents vasculaires
cérébraux (13, 14) et dépression (15).
Le traitement de choix du SAHOS est la Pression positive continue par voie nasale ou
CPAP. Bien conduit, ce traitement a un bénéfice économique net pour la société ; il
réduit les coûts de santé liés à la maladie et à ses complications cardio-vasculaires, et
diminue le nombre d'accidents de roulage présentés par ces patients (16, 17).
Autres troubles du sommeil
La narcolepsie concerne 0,03 à 0,18% de la population. Elle débute souvent dans
l’enfance ou dans l’adolescence ; elle est souvent méconnue. Le retard dans le
diagnostic est chiffré, en moyenne entre 5 et 10 ans dans plus de la moitié des cas.
Les errements diagnostiques surviennent à un moment stratégique de l’existence et
entraînent ainsi de graves conséquences sociales (choix des orientations scolaires et
professionnelles), médicales (accidents de circulation et de travail) et
psychopathologiques. Quant aux traitements, ils font appel à des médicaments rares,
voire à des substances prohibées en pratique médicale courante (Modafinil, Gamma-
hydroxybutyrate) (18). Ces patients requièrent aussi un accompagnement social
spécialisé (19).
Le syndrome des jambes sans repos affecte 8 à 12% de la population mais il se
présente sous une forme sévère chez au moins 1% des patients (20, 21). Pour ces
derniers, il en résulte, d’une part des insomnies et des hypersomnies rebelles, ne
cédant qu’à des traitements très spécialisés (22, 23) et d’autre part, une perte très
sérieuse de qualité de vie (21).
Restrictions sociales et volontaires du sommeil constituent un phénomène
croissant et inquiétant, tout spécialement dans nos sociétés modernes où le travail de
nuit s’étend (6% en 1970 ; 18% actuellement) et où l’économie favorise le rendement
maximal. Les effets négatifs sur la santé en sont bien démontrés (24).
1.3 Complexité de ce domaine médical et prise en charge multidisciplinaire
du patient
Nous prendrons comme exemple l'aptitude de la conduite automobile (AR du 23 mars
1998). En Belgique, les patients atteints de syndrome d'apnées du sommeil ou de
narcolepsie, non traités, sont considérés comme inaptes à la conduite ; c'est le
neurologue qui doit délivrer le certificat d'aptitude pour les candidats du groupe 2.
Certains patients atteints de syndrome d'apnées du sommeil, et traités par CPAP,
présentent une somnolence résiduelle dont l'origine peut être diverse (mauvaise
titration de la CPAP ; mauvaise compliance au traitement ; syndrome des jambes sans
repos ; dépression ; rythme veille-sommeil irrégulier ; narcolepsie associée, etc.).
L'autorisation de la reprise de la conduite automobile demande une approche
multidisciplinaire intégrée où ces divers éléments sont pris en compte. Dans certains
cas, il faudra s'assurer, de façon objective, que la vigilance est suffisante pour
permettre la reprise de la conduite, et ce par des tests particuliers comme le test de
maintien de la vigilance (MWT ou Multiple Wakefulness Test) ou le test d’OSLER. Dans
d'autres cas, le diagnostic différentiel demandera la réalisation d'autres tests
spécifiques comme le test de latence du sommeil (MSLT ou Multiple Sleep Latency
Test) ou certains tests cognitifs.

Deuxième question : Comment faut-il situer ce domaine par rapport aux
spécialités classiques, telles que la médecine générale, la pédiatrie, la
psychiatrie, la pneumologie, la neurologie, etc. ?
Les spécialités susceptibles d’être confrontées à ce domaine de la médecine, sont
avant tout la médecine générale, la médecine du travail, la neurologie, la
pneumologie, la psychiatrie, la pédiatrie, la pédopsychiatrie, l’ORL. Il faut également
prendre en considération l’anesthésiologie, la cardiologie, la dentisterie, la
stomatologie, la chirurgie maxillo-faciale, l’endocrinologie.
Toute réflexion doit prendre en compte le rôle liminaire et primordial qu’il faut
attribuer aux médecins généralistes. Ils doivent se voir renforcés dans leurs missions
d’orientations adéquates des patients, dans les prescriptions d’une hygiène et d’une
médication adaptées et dans le suivi au long cours des patients.
Tous les acteurs scientifiques et cliniciens, soucieux d'une prise en charge correcte des
pathologies du sommeil reconnaissent que cette prise en charge ne se limite pas au
seul examen polysomnographique réalisé au laboratoire de sommeil. Cet examen
technique s'inscrit dans un trajet de soins et ne constitue qu'un aspect de la prise en
charge de certains patients présentant un trouble du sommeil de la veille. Aujourd'hui
en Belgique, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, peut réaliser un examen
polysomnographique, et cela, sans garantie quant à l'indication correcte de cet
examen, la qualité de sa réalisation et de son interprétation. Un autre danger est le
fait que certains laboratoires de sommeil se limitent à un nombre restreint de troubles
du sommeil et de l'éveil (par exemple respiratoires) à l'exclusion de tous les autres. Il
arrive fréquemment qu'un patient, après examen polysomnographique réalisé dans un
laboratoire orienté vers les pathologies respiratoires liées au sommeil, reçoit
l'information qu'il a une forme modérée de syndrome d'apnées du sommeil, qui ne
justifie pas un traitement par CPAP. Une autre étiologie à sa plainte de somnolence
n’est pas systématiquement recherchée, de même, d’autres alternatives
thérapeutiques à sa plainte de ronflement et de somnolence ne lui sont pas toujours
proposées (conseils hygiéno-diététiques, intervention ORL, traitement stomatologique,
etc.).
Pour ces raisons, la Commission recommande de favoriser une approche
multidisciplinaire. Cette recommandation paraît essentielle pour garantir une approche
clinique intégrée de tous les troubles du sommeil et de l’éveil, basée sur une réelle
multidisciplinarité institutionnalisée. Elle est également faite pour assurer un recours
rationnel, non seulement à la polysomnographie mais aussi pour mesurer le bénéfice
d’autres techniques, tantôt moins coûteuses, tantôt plus précises, pour l’évaluation des
patients (questionnaires « ad hoc », actimétrie, test d’OSLER, test de latence du
sommeil (MSLT) ou de maintien de l’éveil (MWT), appareils simplifiés portables et
ambulatoires pour le dépistage des troubles ventilatoires du sommeil, etc.).
La notion de Centre multidisciplinaire consacré aux troubles du sommeil et de l’éveil
est également définie dans le même sens par l’European Sleep Research Society (25).
Troisième question : De combien de spécialistes experts devraient disposer
nécessairement les différentes régions du pays ?
La Commission suggère de structurer l’offre de soins en Belgique, selon trois niveaux
ou lignes.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%