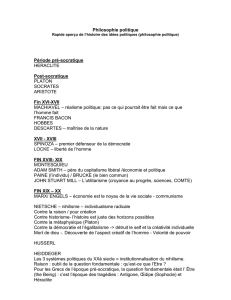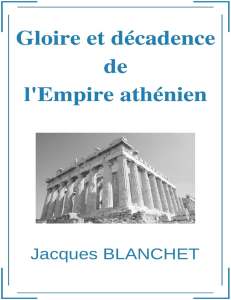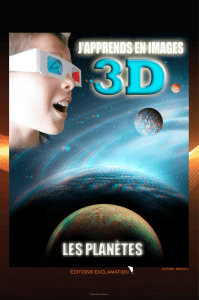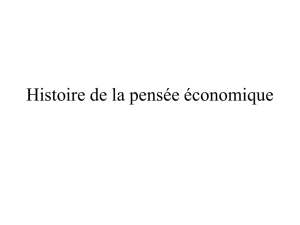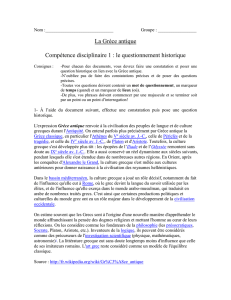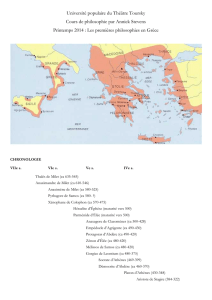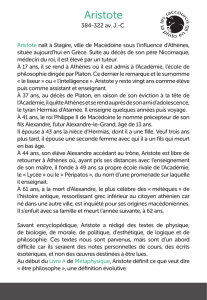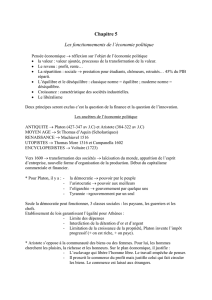Rlaboration de la question de la politique

Réélaboration de la question de la politique
Article 6. Le paradigme de l’un
Par Christian Ruby*
C’est le moment d’ouvrir le deuxième volet de
cette tentative de réélaboration de la question
de la politique. Le souci en naît de la nécessité
de saisir maintenant la distance qui nous
sépare des combinaisons, défiances ou
aventures conceptuelles édifiées au long
d’expériences humaines, soumises à des
desseins et des actes très différents des nôtres.
De ces expériences, nous ne retenons souvent
que des bribes susceptibles de servir d’armes
ou de mots de ralliement dans des conflits.
Aussi voulons-nous les tirer de ce mauvais pas
en en relisant la composition. Il s’agit de rendre
compte successivement de ce qui nous sépare
du paradigme de l’unité politique fondée sur un
parti pris transcendant, du paradigme juridico-
étatique et du paradigme utopique. À cet
énoncé, le lecteur comprend aussi que la
déprise à laquelle nous tentons de nous livrer à
l’égard de ces modèles ne tient pas à leur
existence passée. Ils ne sont pas dépassés
parce que « anciens ». Leur esprit subsiste
d’ailleurs dans de nombreux propos ayant
encore cours. S’ils n’incarnent plus une tradition
digne d’admiration en soi, ils ne fournissent
surtout plus un point de vue légitime sur le
présent dans la mesure où ils ne permettent
pas d’appréhender le lien entre politique,
rébellion et histoire. S’en défaire relève donc
d’une perspective contemporaine qui n’a pas
quitté le souci du juste/injuste, de la
transformation et du refus de considérer le jeu
des forces sociales comme absurde.
Allons donc pour l’heure un peu plus avant
dans le paradigme cosmologique de l’unité
référé à une transcendance. D’un point de vue
cavalier, une première synthèse peut consister
à préciser que, dans cet ordre d’idée, la
politique – traduite en recherche d’une
« essence » liée à une vérité absolue - voit la
cité à la lumière du modèle ontologique d’un
cosmos (ordre et beauté), une figure du monde
immuable, centrée, répartissant des valeurs
dans un ordre hiérarchique (le plus haut fraie
avec le Bien, le plus bas avec le mal ; il y a
« naturellement » des âmes d’or, d’argent et
d’airain) ou d’un Dieu. Même si les versions
grecques, romaines, islamiques et médiévales
ne se recouvrent pas et ne commentent pas
des problèmes politiques identiques (le Bien, la
Fatalité, le droit divin), elles ont pour point
commun, outre une certaine confusion entre la
morale et la politique, la réduction de la

politique à la définition des conditions du
meilleur régime politique (accompagnée d’une
inspiration téléologique concernant la cité, ses
exclusions et l'éthos communautaire) confiné à
l’horizon d’un bien transcendant (le bien
commun grec, l’utilité de la chose publique des
romains ou la création divine) qui interdit une
pensée positive du changement.
Éventuellement assortie d’un exposé portant
sur l’art (royal) de bien gouverner (selon la
métaphore maritime), en maintenant ce qui est.
La philosophie politique se donne pour objet la
cité. La politique implique à la fois une science
et un art : une connaissance et une pratique. La
fin de la politique est le bien de la cité, le
bonheur humain qui résulte de la pratique du
beau et du juste cosmique. Aristote, en
Politiques, I, 1, affirme que la cité est une
communauté constituée en vue d’un certain
bien, et ici le bien suprême. La cité (Polis) est la
fin ou la réalisation optimale et le principe
d’existence du citoyen (Politès). La politique
s'attache à réaliser l'excellence humaine au
sein d'une communauté ayant pour fin la vie la
meilleure déduite de l’ordre du monde. Elle tire
donc bien son nom du grec Polis, la cité,
l’espace de la loi entendu comme une réalité
englobante, qui ne sépare ni la société civile et
l’Etat, ni la loi et le bien ou le bonheur. En
revanche, elle sépare les êtres
(Grecs/barbares, hommes/femmes,
maîtres/esclaves…) et elle ne tient aucun
compte des individus ; séparation qui se
prolonge autrement dans le monde Romain et
celui du Moyen Âge : temporel/spirituel,
souveraineté et religion/guerre/production.
Commençons par la Polis grecque. Elle
s’invente, au cours du VIII° siècle av. JC, dans
le passage de la royauté mycénienne - avec le
personnage quasi-divin du roi et le règne de la
rivalité constante – à un système politique dans
lequel le medium privilégié de la souveraineté
devient la parole, ou ce que l’anthropologue
Jean-Pierre Vernant appelle « la mise en
commun des actes et des paroles » (Les
origines de la cité grecque, Paris, Puf, 1962).
L’existence de la Polis correspond à la
naissance d’un mode de vie politique actif
accompagné de parole.
Pour parcourir brièvement cette histoire, il
convient de rappeler que la démocratie
grecque, qui ne résume pas la politique
grecque, s’établit au V° siècle av. J-C, en
Attique, ce dont témoignent fort bien Sophocle
et Eschyle. Chacun connaît au moins le nom de
Solon, et sa « politique » : protection des faibles
contre les puissants, abolition de l’esclavage
pour dettes (pas de tout esclavage), émergence
de l’isonomie (égalité devant la loi, droit de
chacun de défendre sa cause). Voire celui de
Clisthène : reconnaissance institutionnelle du
Démos, établissement de l’assemblée des
citoyens organe suprême de gouvernement,
abolition des tribus héréditaires, instauration de
l’isegoria, le droit égal à la parole.
En se donnant pour objet la cité, la politique la
pose « une », une absolument et sans
différence (Platon), ou une dans une harmonie
hiérarchisée des différences (Aristote). En tout
cas, il s’agit du « meilleur ordre » relatif à un
monde hiérarchisé et finalisé (éternel). Si on y
traite du multiple et de l’un dans la cité, c’est
aussi pour éliminer la multitude, sachant que
l’un a une fin morale. La politique est invention
de la cité (dont on doit chasser les conflits, le
multiple). La politique se prolonge toujours en
une théorie du lien entre l’action politique visant
le pouvoir et l’éducation du citoyen (jamais de
la citoyenne). On fait de la politique parce qu’on
pense que ce qui est n’est pas ce qui doit être
et que ce qui doit être, c’est l’unité et l’harmonie
(conçus en fonction du modèle du cosmos) ; nul
expert ou spécialiste de la politique dans cette
conception. Ces deux options accompagnent la
formation du citoyen.
Dans la version de Platon (428-347 av. JC),
cette dernière est destinée aux futurs chefs
d’Etat (République). Elle consiste à montrer que
ce n'est pas parce qu'on se contente de vivre
dans une cité qu'on vit dans la rigueur et de
façon civique. Ce n'est pas parce qu'on est élu
qu'on est un « bon » homme politique. Enfin, ce
n'est pas non plus parce qu'on commande ou
qu'on règne qu'on est un véritable homme

politique. On peut avoir ce nom, sans être
capable de quoi que soit, sauf d'égarer la cité
(désunion). Le critère du politique est celui de la
possession d'un savoir spécifique, capable
d’aider à résoudre les problèmes de la cité. Le
législateur (qui sera plutôt un philosophe-roi, un
dirigeant éduqué connaissant le vrai et le juste)
doit posséder une véritable compétence. Il doit
être doué « d'une science véritable » du tissage
politique (Le politique, 293c, et Alcibiade)
susceptible de rendre la cité à l’unité, au prix
d’exclusions. Puisque telle est l’orientation, et
que ce sont les Grecs qui nous offrent la
première théorie des régimes politiques ainsi
que la définition de la plupart des noms de
régimes, le choix du meilleur régime n’est pas
difficile à accomplir. Il s’opère presque
négativement. La démocratie est évidemment
le pire d’entre eux. Elle coïncide avec le règne
de l’opinion (qui a mis Socrate à mort) que les
démagogues manipulent sans cesse à partir de
l’insatiable désir. Elle est incapable de
promouvoir la raison. L’égalité qu’elle
encourage s’identifierait à une égalisation
néfaste des intérêts et des fonctions. Elle
éloigne de la vraie justice, celle que propose le
cosmos (hiérarchisé), sur le modèle duquel le
politique doit reconstruire la cité (Callipolis), tout
en assurant, par l’éducation civique, la
prééminence de son âme en chaque citoyen.
Dans la version d’Aristote (384-322 av. JC)
faire de la politique ne peut consister à élaborer
une cité parfaite. Il faut partir de ce qui est
seulement, le monde contingent. Et chercher le
mieux de ce qui est possible, au sein des cités
réelles. Il établit ainsi une pluralité de modèles
envisageables de cité (à partir d’un inventaire
des constitutions en vigueur : Sinope, Cyrène,
Marseille, Chypre, ...). La politique consiste
aussi à considérer que l’on ne doit pas
seulement vivre (besoins) mais vivre bien,
c’est-à-dire donner à l’existence humaine la
forme d’une polis, d’une cité, susceptible de
viser le Bien le meilleur (premier dans l’ordre de
la perfection), par rapport à sa situation. Elle
doit tirer le meilleur parti possible de ce dont
elle dispose (autarcie). Quoi qu’il en soit la cité
sera toujours affaire de lois (de commun,
d’unité d’une pluralité, d’existence de fins
communes) et d’amitié, puisqu’elle favorise la
justice. Enfin, la politique est une affaire de
« prudence » (délibération rationnelle), à
laquelle les citoyens peuvent s’éduquer
(Ethique à Nicomaque).
Quant au pouvoir politique, il a une spécificité.
Nul ne doit le confondre avec le pouvoir
parental ou le pouvoir magistral. Il s’exerce sur
des hommes « libres » (les Grecs), consentant
à être dirigés. Certes, il s’exerce dans un
contexte où le jeu des opinions doit être pris en
compte. Aristote réfute largement Platon.
Vouloir une unité close de la cité, sans
différences, contribuerait à diminuer la place
des citoyens. La cité doit sans cesse relier le
peuple et les élites politiques. La justice en
dépend. Le meilleur régime politique pour la
majorité des cités est donc le régime
constitutionnel, le régime mixte, où les intérêts
de chacune des parties de la cité sont
préservés et jouent un rôle.
N’imaginons cependant pas que cette
perspective d’une cité-une modélisée et
exclusive soit demeurée sans contestation.
D’autres philosophes se sont donnés des
moyens de détisser l’homologie cosmos-cité.
Épicure montre que la soi-disant harmonie de la
cité n’existe pas. La guerre règne partout. Les
Cyniques grecs, qui constituent une école
philosophique dont la figure la plus marquante
est celle de Diogène (413-327 av. JC.), ne
cessent de démystifier la cité. La vraie
franchise du cynique constituant une force de
résistance absolue contre les fausses valeurs, il
récuse toute illusion d’unité, quand il ne refuse
pas le partage nature-culture (animal-homme),
Grecs-barbares sur lequel la cité se fonde. En
ce sens, il s’oppose directement à Aristote pour
qui « l’homme est par nature un être de cité »,
et tout homme qui se refuserait à intégrer une
cité serait un idiotès : un être qui s’isole et
meurt sans le secours des autres, qui s’aperçoit
vite qu’il ne peut se suffire à lui-même (être
dégradé, il n’a ni clan, ni loi, ni foyer, Politiques,
I, 2, 1253a).

La proximité fondamentale de ce qui vient
d’être dit avec la théorie islamique du pouvoir
(Al-Fârâbî, La philosophie de Platon, IX°s.) et la
théorie médiévale du droit divin ne doit pas
masquer les différences. D’autant que la
période médiévale déploie plusieurs registres
de pensée politique religieuse. Strictement
parlant, il ne convient pas de confondre la
théocratie (hégémonie de l’Eglise) et le droit
divin (directement articulé à la Bible). Ce
dernier sollicite une doctrine du droit
surnaturel : « Tout pouvoir vient de Dieu »,
répète-t-on au Moyen Age d’après Paul (Epître
aux Romains, XIII,1). Dieu seul est maître de
l'alliance (unilatérale) qu'il instaure avec les
peuples comme on le voit dans la royauté
davidique : « Le droit divin vient de la Grâce »
(Thomas d’Aquin, 1225-1274). Parfois il leur
accorde des rois (en lien direct avec lui : le roi
est ministre de Dieu, il ne tient son pouvoir que
de lui, cf. Bossuet, Politique tirée des Ecritures
Saintes, 1709), parfois il les encourage à
nommer des rois (dès le XVI°s, le peuple
pourrait retirer son pouvoir au mauvais prince).
Mais, la cité-une rejette les Infidèles.
Dans la version médiévale classique, en cette
alliance, Dieu privilégie son Eglise, à laquelle il
donne l'autorité (le spirituel, le pastorat) parce
qu'elle détient les clefs du royaume des cieux,
tandis qu'il réserve le pouvoir aux rois (le
temporel). D'où l'onction des rois, et la
pyramide monarchique imitant le gouvernement
du monde par Dieu. En foi de quoi, le roi
devient le père de ses sujets et des peuples
(analogie entre le pouvoir paternel et le pouvoir
royal que les Hobbes, Montesquieu, Rousseau
et alii s’acharneront à repousser). Encore cela
ne permet-il pas aux rois d’accomplir n’importe
quoi, puisqu’on peut toujours estimer que le roi
se comporte injustement et qu’il transgresse
alors la volonté divine : « Le gouvernement
tyrannique n’est pas juste parce qu’il ne tend
pas au Bien général, mais au bien particulier de
celui qui gouverne » (Thomas, Somme
Théologique, VI, 96 art. 4), ce qui n’autorise
pas le peuple à le renverser, seul Dieu peut le
faire.
Là encore, le statut des penseurs politiques
renforce la théorie proposée. Ils sont presque
tous clercs. Au demeurant, on trouve quelques
résistances internes à ces pensées (Abélard,
Luther), mais une seule comme celle de
Christine de Pisan (1364-1430), auteure de la
Cité des Dames, élevant la dignité des femmes
en rempart contre la théocratie.
À une époque où l’on semble discuter
couramment de la nécessité de restaurer de la
transcendance – autrefois comprise comme
une forme d’aliénation - et de l’unité dans des
sociétés dont on considère qu’elles sont
dispersées, le détour pratiqué ici est éclairant. Il
rappelle que si on ne doit pas confondre référer
à une transcendance et restaurer une vertu
transcendante de la politique par rapport à
l’immédiateté et au quotidien, il reste que les
deux démarches éloignent les citoyens de la
politique. Il souligne de surcroît que les
politiques de l’unité sont exclusives. Sans doute
est-ce ce pourquoi nous fabriquons du « sans-
papiers », des frontières, des camps de
rétention…
© Présence et Action Culturelle – Analyse – 2009/06
* L’auteur : Christian Ruby, Docteur en philosophie, enseignant
(Paris). Derniers ouvrages publiés : L’interruption, Jacques
Rancière et la politique, Paris, La Fabrique, 2009 ; Devenir
contemporain ? La couleur du temps au prisme de l’art, Paris,
Editions Le Félin, 2007 ; L’âge du public et du spectateur, Essai
sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne,
Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ; Schiller ou l’esthétique
culturelle. Apostille aux Nouvelles lettres sur l’éducation
esthétique de l’homme, Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ;
Nouvelles Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme,
Bruxelles, La Lettre volée, 2005.
1
/
4
100%