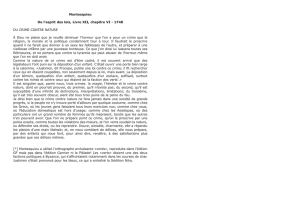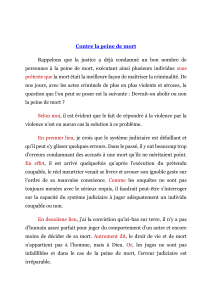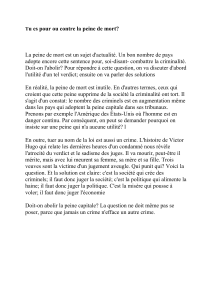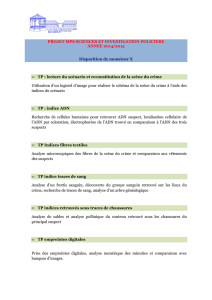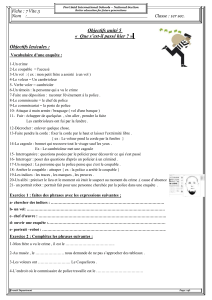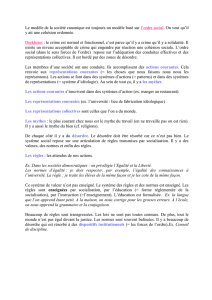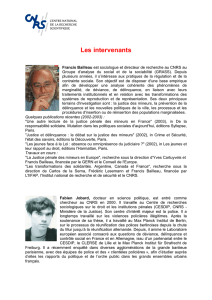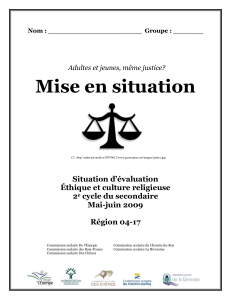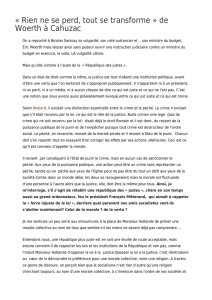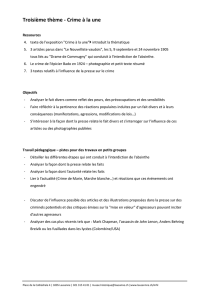La sociologie du crime

Introduction
Le crime semble partout dans le débat public quand se ressas-
sent les grandes préoccupations, voire les obsessions collec-
tives. Même si d’autres enjeux peuvent sembler de plus grande
ampleur —mondialisation économique, chômage, précarisa-
tion du salariat, incertitudes sur l’avenir de la protection sociale,
fragilisation de l’État-nation, etc. —, qui ne voit le crime tenir
compagnie àchacun d’eux ? On s’alarme d’une «grande crimi-
nalité» greffée sur les flux transnationaux de personnes, de
biens, d’argent, voire d’information, mais on s’effraie aussi d’une
«petite délinquance »de vols ou d’agressions qui met en péril
notre sécuritéquotidienne et celle de nos biens. La corruption
fait cortège aux interrogations sur la capacitédes «élites »àfaire
face aux enjeux du temps, le dopage pollue le spectacle média-
tique des sports de masse.
Cette sensibilitétoujours prompte àrenaître désigne un de ces
points de la vie collective oùmûrissent les abcès : par un aspect,
le crime évoque les sommets de l’ordre social, mais par un autre
ses bas-fonds, et il laisse toujours entrevoir, avec l’invocation de
la violence, le spectre de la mort sociale. S’il ne s’éloigne jamais
beaucoup du débat public, sa présence s’y fait plus insistante
dans les moments oùde sérieuses recompositions travaillent les
équilibres sociaux.
Il figure parmi les chantiers récurrents pour ceux qui font
profession d’analyser la vie sociale et de donner àla comprendre.
Pour la sociologie, le crime constitue un thème auquel il est

Crime
(ang. : crime ; all. : Verbrechen ; esp. : crimen ; ital. : crimine)
Le vocabulaire juridique français réserve ce mot pour désigner les infractions
les plus lourdement punies, celles que jugent les cours d’assises.
Selon une tradition qui remonte à Durkheim, la sociologie emploie généra-
lement ce terme dans un sens plus large pour désigner tout comportement que
le droit incrimine en menaçant son auteur d’une peine.
Cet usage est conforme à l’étymologie (Dictionnaire historique de la langue
française, Paris, Le Robert, 2000, vol. 1, p. 565) qui évoque l’idée de trier, de
décider, donc de soumettre une situation à une décision judiciaire.
Mais ce n’est qu’une convention. Nous pourrions parler aussi de délinquance,
au singulier ou au pluriel. Les juristes parleraient d’infractions.
difficile d’échapper,sinonpourlui-même, du moins pour ce
qu’il révèle de la mise en ordre —et du désordre —des relations
sociales.
Sa forte actualitéau tournant du XXeet du XXIesiècle a deux
conséquences sur son étude, l’une positive, l’autre négative. Une
puissante demande de connaissance joue en faveur de la création
de filières d’enseignement, de la constitution d’un marchéde la
formation professionnelle et permanente, du développement de
la recherche. Mais, dans une situation aussi passionnée, le poids
des modes et des lieux communs pèse lourdement sur tout ce qui
se dit àpropos du crime.
Placédans une conjoncture àla fois porteuse et périlleuse, le
sociologue du crime doit clarifier méthodiquement les bases et
les avenues de ce champ de connaissance. D’autant que ce
chapitre des sciences de la sociétélaisse une impression déce-
vante : depuis un bon siècle qu’il est entamé,onn’a pas le senti-
ment d’une progression réelle de la connaissance, alors pourtant
que tous les modèles imaginables ont été,touràtour, mis en
œuvre pour «expliquer »le crime. On a la sensation d’une
histoire immobile oùtoutes les hypothèses peuvent sans cesse
ressurgir sous des vêtements àpeine modernisés. De surcroît,
chaque théorie rend compte de certains crimes, mais s’adapte
mal àd’autres. Explicitement ou subrepticement, chaque auteur
a travaillésur un ou quelques cas de figure quitte àextrapoler
LA SOCIOLOGIE DU CRIME4

ensuite, de manière rarement convaincante, les résultats
obtenus.
Peut-être aussi se hâte-t-on trop de chercher àexpliquer le
crime, sans prendre le temps de réfléchir àsa définition. On fait
comme si tout le monde savait ce dont il s’agissait et comme si
ce savoir de sens commun fournissait àl’entreprise scientifique
un point de départ assez solide : l’étude du crime pâtit d’une
négligence dans la construction de son objet. Pour étudier, avec
quelque chance de succès, un objet social quel qu’il soit, il faut
d’abord saisir ce qu’il a de typique, le trait commun àtoutes
ses manifestations, ce qui le distingue d’autres objets. Le mouve-
ment criminologique y a largement échoué:construireune
discipline autour d’un seul objet ne permet pas de le comparer
àd’autres pour en saisir la spécificité. En principe, la sociologie
—qui replace le crime parmi une multitude d’autres objets
sociaux —avait tout pour échapper àcet enfermement ; elle a
pourtant eu du mal às’en extraire.
Aux sources de la criminologie
Quand elle apparaîtàla fin du XIXesiècle, la criminologie se
constitue d’emblée en science du criminel, et non du crime.
Malgréles protestations des anthropologues parisiens, les
promoteurs du nouveau savoir ont tenu dans un premier temps
au titre d’anthropologie criminelle : leur ambition consistait à
ouvrir un chapitre supplémentaire dans l’étude du comporte-
ment humain. Leur discipline était tout entière vouéeàdécou-
vrir pourquoi certains commettaient des crimes, quelle
caractéristique les rendait différents des autres.
Quelque temps, Cesare Lombroso a même espérédécouvrir un
trait physique spécifique qui permettrait d’identifier les
criminels, au moins les vrais, sur leur seul aspect. Il serait devenu
inutile d’attendre que le crime soit commis pour reconnaître le
malfaiteur. L’échec de ce «physicalisme »tardif n’apasfreiné
l’entreprise criminologique. Passant outre au scepticisme
d’Enrico Ferri, Raffaele Garofalo s’est bornéàtransférer sur le
plan moral le siège de la différence qui caractériserait le (vrai)
INTRODUCTION 5
1
/
3
100%